 Sami Sahli, Cent grammes de suicide, éd. L’arpenteur, 83 p. ISBN : 978-2-07-011996-7, prix: 12 €.
Sami Sahli, Cent grammes de suicide, éd. L’arpenteur, 83 p. ISBN : 978-2-07-011996-7, prix: 12 €.
[4ème de couverture]
Impasse de toute façon.
Au fond du bar, une dizaine d’ivrognes regroupés autour d’une femme. Frétillants. Impatients. S’imaginant, je suppose, avoir trouvé dans cette impasse : une issue. Ils me font songer à des spermatozoïdes autour d’un ovule.
La vie, lui dis-je, est une impasse.
Dis-je à l’ovule qui me fait face, et le sexe une impasse au fond de cette impasse. L’ivresse : un miroir.
[Chronique]
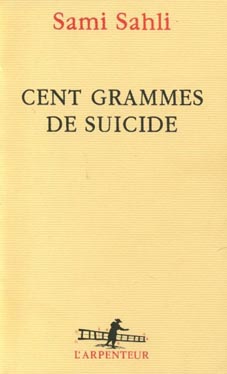 Philippe Rahmy, dans sa note sur Cent grammes de suicide, exprime la différence qu’il y a, entre l’ouverture au rêve liée à la littérature, et une forme de plongée en enfer liée à l’écriture, plongée au sens où ce qui est lu nous "écrase sous la masse d’un événement réel". Le livre de Sami Sahli transpire l’acidité d’un réel fait chair, d’un réel noir, qui se lie et se trame avec le corps qui en supporte la couleur. "Écho ce soir de mes pensées : noires. J’aime du moins cette idée, ce mot, la couleur de ce mot : noir" [p.67].
Philippe Rahmy, dans sa note sur Cent grammes de suicide, exprime la différence qu’il y a, entre l’ouverture au rêve liée à la littérature, et une forme de plongée en enfer liée à l’écriture, plongée au sens où ce qui est lu nous "écrase sous la masse d’un événement réel". Le livre de Sami Sahli transpire l’acidité d’un réel fait chair, d’un réel noir, qui se lie et se trame avec le corps qui en supporte la couleur. "Écho ce soir de mes pensées : noires. J’aime du moins cette idée, ce mot, la couleur de ce mot : noir" [p.67].
Le livre de Sami Sahli se donne à lire comme une suite de notes, de chroniques personnelles, qui témoigne, non pas seulement de la lourdeur de l’existence, mais de son extrême vacuité, et ceci immédiatement selon une formulation quasi-pascalienne. La vie est considérée, comme une "plaie ouverte dans le néant", "entre une mort passée et une mort future" [p.14]. La vie est souffrance, récurrence tout au long des pages, souffrance de la sensation d’être au monde, souffrance du vide de cet être au monde. Le corps est décrit non seulement comme lieu de blessure, mais il projette sur toute chose celle-ci, chaque détail de la ville, devenant le signe de la mort, du corps en souffrance. Dès le premier texte, sur l’étal du boucher nous retrouvons ce rapport de miroir entre corps et monde. "Il est midi. J’entre dans une boucherie. La viande déposée sur l’étal me rappelle mon corps. Je reconnais chaque organe" [p.13]. Tout au long des fragments, la tension entre intérieur, pensée, bouche, ventre et extérieur, rue, bar, chambre, se poursuit et se densifie. Face à la souffrance d’un corps, se pose uen question : est-ce le monde qui déteint sur le sujet, ou bien est-ce le sujet qui de par sa modalité affective, ses nerfs, ses os, sa noirceur matricielle, transpose sa laideur et l’arridité de son paysage intérieur.
"MA LAIDEUR EST LE PAYSAGE QUE JE TRAVERSE" [p.20]
La parole qui monologue, si elle retranscrit cette monstruosité interne, c’est pour en donner une forme de gai savoir en quelque sorte. Qui de la balade du pendu, qui pourrait faire songer à Cioran, aux verres indéfiniments bus, et ceci dans les parages de Bukowski, ou de l’anté pénultième verre de Deleuze, montre que l’existence est endurance de la souffrance, apprentissage de la douleur d’être né, que rien, y compris la femme ne saurait faire oublier.
L’écriture de Sami Sahli exprime cela dans des termes simples, ceux proches d’un post-surréalisme, où se mêlent des correspondances et des jeux de métamorphoses. "J’assiste à une succession de métamorphoses. La rue soudain n’est plus une rue mais un sillon, une blessure, le bistrot dans lequel je viens d’entrer : un vagin…" [p.74]. Avec ce livre, il ne faudra pas attendre l’exploration linguistique ou grammaticale de la folie, l’érosion du texte. Mais nous faisons face à une représentation, qui travaille non pas sur la matière linguistique, mais sur les rapports d’image et l’expression du spleen absolu qui emplit l’existence. En ce sens ce texte sera davantage fait pour ceux qui recherchent l’image poétique que ceux qui veulent explorer des formes poétiques peu communes.
![[Livre + Chronique] Cent grammes de suicide, Sami Sahli](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)