Emmanuèle Jawad. Votre travail s’articule autour de différents pôles de création et critique. Sous l’angle de la création : Ce texte et autres textes (Al Dante, 2015) est précédé de divers ensembles, notamment Voix sans voix (Sils Maria, 2002), Ecrires précédé de Poémonder (Inventaire/Invention, 2004, réédité en 2009 aux éditions Publie.net), Le silence du monde (Publie.net 2009, transformé et publié en plusieurs fois dans Diacritik en 2016), C’est pourtant Joseph K. qui est là (Publie.net, 2009), Désert ce que tu murmures (La Cinquième Roue, 2006). Vous êtes également membre du comité de rédaction de la revue Chimères et votre travail critique après Médiapart se développe aujourd’hui dans le magazine numérique Diacritik. Dans cette activité dense, comment s’opère l’articulation entre ces différents domaines de travail ? Y a-t-il un axe que vous privilégiez ?
Jean-Philippe Cazier. Je ne sais pas s’il y a une articulation. Peut-être qu’il n’y en a pas ou qu’il y en a plusieurs qui ne se recoupent pas toujours. Pourquoi devrait-il y en avoir? Est-ce que le présupposé ici ne serait pas celui, métaphysique, de l’unité, de l’identité, du sujet ? Si je disais « voilà comment s’articulent ces différents moments et activités », je ferais semblant de savoir précisément comment advient ce que je fais, à tel moment et pourquoi. Il y a de la pensée consciente qui accompagne ce que nous faisons mais aussi de l’inconscient, des affects, des choses qui s’imposent à nous sans que l’on sache véritablement de quoi il s’agit. Il y a une impersonnalité de la vie, une dimension impersonnelle de nos vies qui les rend, justement, vivantes. Et cette vie impersonnelle, en tant que telle, est nécessairement plus large que le « je », et plus large que la langue, que les mots. S’il y a une articulation entre tout ce que vous citez, elle n’est pas toujours décidée rationnellement. Je fais ce que j’ai envie de faire, ce que j’ai besoin de faire à un certain moment et tout cela s’agence plus ou moins, se juxtapose ou coexiste sans que j’en voie toujours clairement le lien. Parfois un lien m’apparaît après-coup et parfois non – mais c’est peut-être parce que je ne me pose pas la question de manière systématique ni très précise. Tout ça existe dans le vague et l’obscur et j’essaie d’avancer avec cette obscurité plus ou moins dense.
sujet ? Si je disais « voilà comment s’articulent ces différents moments et activités », je ferais semblant de savoir précisément comment advient ce que je fais, à tel moment et pourquoi. Il y a de la pensée consciente qui accompagne ce que nous faisons mais aussi de l’inconscient, des affects, des choses qui s’imposent à nous sans que l’on sache véritablement de quoi il s’agit. Il y a une impersonnalité de la vie, une dimension impersonnelle de nos vies qui les rend, justement, vivantes. Et cette vie impersonnelle, en tant que telle, est nécessairement plus large que le « je », et plus large que la langue, que les mots. S’il y a une articulation entre tout ce que vous citez, elle n’est pas toujours décidée rationnellement. Je fais ce que j’ai envie de faire, ce que j’ai besoin de faire à un certain moment et tout cela s’agence plus ou moins, se juxtapose ou coexiste sans que j’en voie toujours clairement le lien. Parfois un lien m’apparaît après-coup et parfois non – mais c’est peut-être parce que je ne me pose pas la question de manière systématique ni très précise. Tout ça existe dans le vague et l’obscur et j’essaie d’avancer avec cette obscurité plus ou moins dense.
 Je pourrais aussi donner des indications biographiques mais qui ne permettraient pas de penser une cohérence et ne suffiraient pas à dire quelque chose d’intéressant du désir d’écrire et d’écrire de la poésie ou des textes de réflexion…
Je pourrais aussi donner des indications biographiques mais qui ne permettraient pas de penser une cohérence et ne suffiraient pas à dire quelque chose d’intéressant du désir d’écrire et d’écrire de la poésie ou des textes de réflexion…
En fait, tout dépend de ce que l’on entend par « articulation ». S’il s’agit d’une cohérence prévue, construite selon une démarche rationnelle en vue d’une fin déterminée, alors ce n’est pas le cas. Pour reprendre une notion qu’emploie Frank Smith, je parlerais plutôt de co-errance, une errance commune où les choses s’agencent mais sans véritable unité, sans point de vue surplombant ni unificateur. Mes textes poétiques fonctionnent ainsi, ils agencent des fragments, des morceaux qui co-errent et ouvrent le texte plutôt qu’ils ne le ferment sur un sens, une intention, une unité. Mes différentes activités pourraient relever de la même logique d’un agencement d’un divers qui tend à demeurer divers, qui co-fonctionne. Moi-même j’ai l’impression d’être un agencement qui fonctionne comme il peut, avec ses dimensions co-errantes et évolutives, changeantes, vagues, floues. Même s’il y a aussi un moi social avec ses points fixes, ses formations plus rigides…
Si je résume, pour chercher des éléments de réponse à votre question, je pourrais dire que la logique serait celle de l’agencement, que l’articulation implique l’hétérogénéité, avec des parties qui se correspondent, qui résonnent entre elles, et d’autres non.
Il faudrait aussi évoquer le hasard des rencontres – rencontres avec des livres et des auteurs. A douze ans, treize ans, je lisais André Breton, Eluard, Prévert. Je n’y comprenais pas grand chose mais ça me fascinait, que ce langage existe me fascinait. Et Rimbaud, qui me fascinait encore plus. Je ne sais pas pourquoi j’ai reconnu immédiatement le langage de Rimbaud comme mon langage, pourquoi ce paysage m’a attiré, pourquoi je m’y suis installé pour y vivre. Le rapport n’était pas réfléchi, intellectualisé, mais de l’ordre de la fascination, de l’adhésion immédiate, de l’affect. En découvrant la possibilité de ce langage, je me suis dit que c’était ce que je voulais faire, que je voulais écrire. Et je l’ai fait. Comme si être avec ce langage impliquait que j’écrive, impliquait la production d’une écriture. Une sorte d’injonction, d’évidence, de mouvement naturel.
Il y aurait aussi les rencontres avec les gens, et le hasard de ces rencontres. Lorsque j’ai découvert les livres de Gilles Deleuze, je lui ai envoyé certains de mes textes, de la poésie, et il les a transmis à Michel Butel qui en a publié un dans L’Autre Journal. Et Deleuze a fait la même chose avec Chimères. C’est comme ça que je suis arrivé à Chimères, que je ne connaissais pas, j’avais 22 ans. Ensuite, Danielle Sivadon m’a fait entrer au comité de rédaction de Chimères. Je ne me souviens plus comment j’ai rencontré Patrick Cahuzac 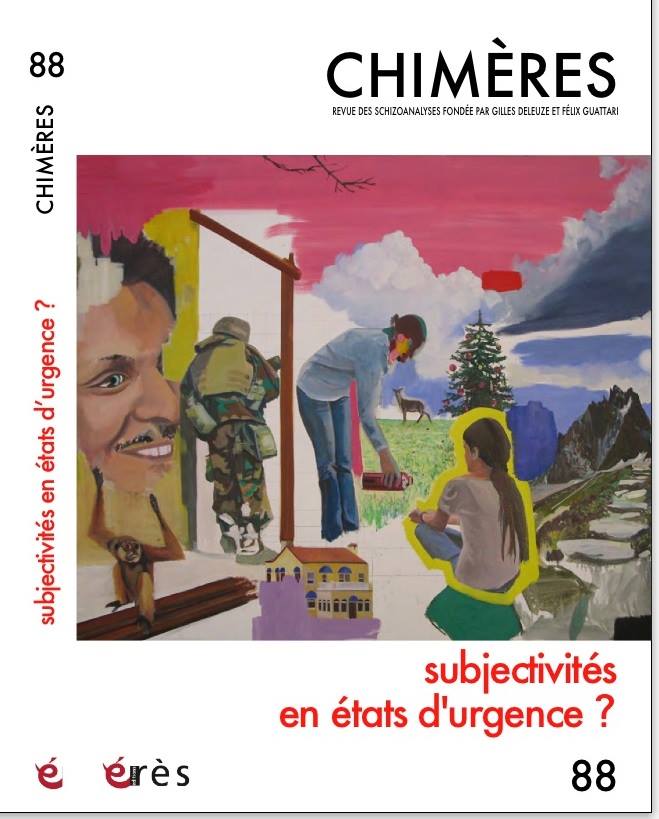 qui dirigeait Inventaire/Invention, mais il m’a proposé de faire un livre qui est devenu Ecrires. C’est en parlant avec Frank Smith que j’ai évoqué le manuscrit de Ce texte et autres textes, comme ça, au fil d’une conversation informelle. Il m’a suggéré de l’envoyer chez Al Dante, ce que j’ai fait, et quelques jours après Laurent Cauwet m’a dit ok, je le prends. Ceci pour dire que c’est surtout le hasard qui a fait que j’ai rencontré telle personne, que je me suis retrouvé dans telle revue, en situation d’écrire ceci ou cela ou de publier tel livre. Comme les personnes sont diverses, je me retrouve à faire des choses elles-mêmes diverses. En un sens, c’est l’extérieur qui me conduit, le hasard qui existe dans le monde. On pourrait dire que la logique qui articule ce que je fais est une logique du hasard auquel je fais confiance.
qui dirigeait Inventaire/Invention, mais il m’a proposé de faire un livre qui est devenu Ecrires. C’est en parlant avec Frank Smith que j’ai évoqué le manuscrit de Ce texte et autres textes, comme ça, au fil d’une conversation informelle. Il m’a suggéré de l’envoyer chez Al Dante, ce que j’ai fait, et quelques jours après Laurent Cauwet m’a dit ok, je le prends. Ceci pour dire que c’est surtout le hasard qui a fait que j’ai rencontré telle personne, que je me suis retrouvé dans telle revue, en situation d’écrire ceci ou cela ou de publier tel livre. Comme les personnes sont diverses, je me retrouve à faire des choses elles-mêmes diverses. En un sens, c’est l’extérieur qui me conduit, le hasard qui existe dans le monde. On pourrait dire que la logique qui articule ce que je fais est une logique du hasard auquel je fais confiance.
Finalement, si la question de l’articulation ne se pose pas vraiment pour moi, c’est sans doute parce que j’ai un rapport assez innocent et immédiat à ce que je fais, un rapport un peu bête peut-être. Je ne me suis pas demandé si je pouvais ou devais écrire de la poésie, si je pouvais ou devais écrire des textes de réflexion. J’ai eu envie d’en écrire, la possibilité était là, une forme de nécessité aussi, alors je l’ai fait. A chaque fois, il y a eu un mouvement que je n’ai pas vraiment initié et je me suis inscrit dans ce mouvement, dans les possibles qu’il impliquait. C’est la même chose, aujourd’hui, avec Diacritik où j’ai suivi Christine Marcandier et Dominique Bry, que je connaissais de Médiapart – là encore une histoire de hasard, de rencontre et de confiance. Tout ceci relèverait peut-être d’une sorte de disponibilité au monde que les grecs appelaient Kairos : savoir s’inscrire dans les mouvements du monde, les suivre, savoir bifurquer, ce qui implique une disponibilité aux hasards du monde, de faire confiance au monde et à son obscurité. Les noms des personnes que je cite sont aussi les noms de bifurcations, de chemins sur lesquels je suis tombé un beau jour, et dans lesquels je me suis engagé, comme Alice et son lapin…
 Il faudrait dire aussi que rencontrer des gens, ou des œuvres, c’est rencontrer des mondes : autrui en tant qu’autre monde possible, comme l’écrivait Deleuze. Je crois que c’est vrai. Derrière les noms que je cite, derrière ces activités diverses, il y a des mondes possibles, des points de vue sur le monde que je rencontre, qui pluralisent le monde et qui m’altèrent, me transforment. Je est un autre, comme disait l’autre. Ces rencontres que j’ai faites et que je fais – des rencontres avec des animaux aussi bien, et les voyages, le fait de vivre longtemps à l’étranger – n’ont cessé d’ouvrir des mondes possibles, d’ouvrir des mondes dans des dimensions et directions diverses, plus ou moins compossibles, dans lesquelles je me suis engouffré. Etre à Chimères ou à Diacritik est aussi une façon de provoquer des rencontres, d’entrer en rapport avec des points de vue hétérogènes, de multiplier les possibles du monde, de vouloir être en situation d’errance. La diversité que vous soulignez vient sans doute du fait que je suis entre plusieurs mondes possibles, donc que je suis plusieurs. On veut trop être quelqu’un, écrivait Michaux. Mais être quelqu’un n’est pas vraiment mon problème, et être écrivain n’est certainement pas être quelqu’un. Peut-être que mon problème n’est pas d’être quelqu’un mais de devenir quelque chose, plusieurs choses en même temps, qui ne se recoupent pas forcément.
Il faudrait dire aussi que rencontrer des gens, ou des œuvres, c’est rencontrer des mondes : autrui en tant qu’autre monde possible, comme l’écrivait Deleuze. Je crois que c’est vrai. Derrière les noms que je cite, derrière ces activités diverses, il y a des mondes possibles, des points de vue sur le monde que je rencontre, qui pluralisent le monde et qui m’altèrent, me transforment. Je est un autre, comme disait l’autre. Ces rencontres que j’ai faites et que je fais – des rencontres avec des animaux aussi bien, et les voyages, le fait de vivre longtemps à l’étranger – n’ont cessé d’ouvrir des mondes possibles, d’ouvrir des mondes dans des dimensions et directions diverses, plus ou moins compossibles, dans lesquelles je me suis engouffré. Etre à Chimères ou à Diacritik est aussi une façon de provoquer des rencontres, d’entrer en rapport avec des points de vue hétérogènes, de multiplier les possibles du monde, de vouloir être en situation d’errance. La diversité que vous soulignez vient sans doute du fait que je suis entre plusieurs mondes possibles, donc que je suis plusieurs. On veut trop être quelqu’un, écrivait Michaux. Mais être quelqu’un n’est pas vraiment mon problème, et être écrivain n’est certainement pas être quelqu’un. Peut-être que mon problème n’est pas d’être quelqu’un mais de devenir quelque chose, plusieurs choses en même temps, qui ne se recoupent pas forcément.
On pourrait dire que mon monde est kaléidoscopique et que la logique sur laquelle vous m’interrogez est la logique d’un kaléidoscope. Je me définirais peut-être comme un kaléidoscope, de manière un peu schizophrène sans doute. Vous me questionnez sur l’articulation des différentes choses que je fais et je finis par vous répondre par une logique de la désarticulation, du divers, une logique des possibles incompossibles, du mouvement, de l’affect et de l’obscur. Je ne sais pas si on est bien avancés avec ça…
Quant à savoir s’il y a un domaine que je privilégie par rapport aux autres, la réponse est évidemment non.
Ce qui me plaît surtout dans ce que je vous dis là, c’est que j’y découvre quelque chose qui rejoint et définit ce que j’écris, en particulier les textes que l’on peut qualifier de poétiques qui obéissent à la même logique autant en ce qui concerne les occasions qui les ont suscités que dans leur logique interne. C’est surtout cette mise au clair qui m’intéresse…
Emmanuèle Jawad. Ce texte et autres textes (Al Dante, 2015) est un texte réflexif que l’on pourrait qualifier également sous certains aspects de texte gigogne à mouvement giratoire incluant de nombreuses références littéraires et artistiques (P. Reverdy, M. Duras, O. Mandelstam, Mallarmé, M. Rothko, Malevitch notamment). Dans cet espace réflexif et intertextuel, y aurait-il des liens à établir avec la dimension critique de votre travail ? Le texte de création serait-il un lieu permettant d’ouvrir des espaces critiques et de références ?
Jean-Philippe Cazier. Ce texte et autres textes est resté longtemps dans mes fichiers, personne n’en voulait et j’avais laissé tomber l’idée de le voir publié. Comme je l’ai dit, il a finalement été publié un peu par hasard, grâce à l’intérêt de Frank et à la confiance de Laurent Cauwet.
Ce livre se construit à partir d’une logique du divers et de la dispersion, et le titre pourrait être lu comme : ce texte est autres textes, ce texte est d’autres textes. Les références qui s’y trouvent l’inscrivent dans une certaine généalogie, également pour une sorte d’hommage, d’exercice d’admiration. Mais surtout ces références ont pour fonction de pluraliser l’écriture, d’ouvrir le livre et les textes, de faire du livre un espace multiple. Les noms de Duras, de Mandelstam, de Pollock, de ce point de vue, sont moins des références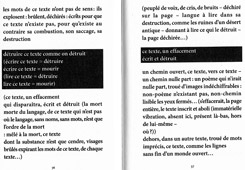 que l’occasion de brancher ce qui s’écrit sur d’autres mondes, de produire des relations qui font bifurquer l’écriture et l’entraînent où elle ne savait pas aller. Ceci est pour moi emblématique de l’écriture, c’est le mouvement de l’écriture : créer des mouvements à partir de l’autre, à partir d’un autre qui est altérant et entraîne dans l’inconnu et l’obscur. Pour cette raison, les références, explicites ou implicites, ne concernent pas que des écrivains mais aussi des peintres comme Pollock ou Hartung, ou des psychanalystes comme Freud ou Lacan. On pourrait dire que je me suis posé les questions : qu’est-ce que serait l’écriture si l’écriture était de la peinture, ou relevait d’une logique de l’Inconscient? qu’est-ce que serait ce texte si j’y introduisais Duras ou Reverdy ? qu’est-ce que serait l’écriture si j’en faisais une chose qui concerne les animaux ? Il ne s’agit pas de questions rhétoriques ou d’hypothèses abstraites. Je crois qu’effectivement l’écriture est de la peinture et de la musique, a à voir avec l’Inconscient, concerne directement les vies animales. Donc, dans le livre, j’ai multiplié les rencontres improbables, les relations a priori absurdes, les agencements incohérents. Pour la même raison, j’ai privilégié la répétition comme principe de composition et processus de production : les textes sont répétés et, à l’intérieur de chaque texte, des parties en sont également répétées. Mais la répétition n’est pas la reproduction du même puisque s’introduisent à chaque fois des déplacements, des altérations, des bifurcations. J’ai essayé de mettre en place un processus de variation par lequel le texte devient sans cesse autre chose, est un devenir qui implique l’autre et le mouvement, l’incohérence. D’ailleurs, pour pousser plus loin ce mouvement de répétition et de variation, j’ai par la suite repris la logique de ce livre que j’ai déplacée dans un autre texte mais qui est une fiction, pour composer une sorte de rencontre improbable, un agencement là encore entre hétérogènes. Le résultat est bizarre et, logiquement, aucun éditeur n’en a voulu…
que l’occasion de brancher ce qui s’écrit sur d’autres mondes, de produire des relations qui font bifurquer l’écriture et l’entraînent où elle ne savait pas aller. Ceci est pour moi emblématique de l’écriture, c’est le mouvement de l’écriture : créer des mouvements à partir de l’autre, à partir d’un autre qui est altérant et entraîne dans l’inconnu et l’obscur. Pour cette raison, les références, explicites ou implicites, ne concernent pas que des écrivains mais aussi des peintres comme Pollock ou Hartung, ou des psychanalystes comme Freud ou Lacan. On pourrait dire que je me suis posé les questions : qu’est-ce que serait l’écriture si l’écriture était de la peinture, ou relevait d’une logique de l’Inconscient? qu’est-ce que serait ce texte si j’y introduisais Duras ou Reverdy ? qu’est-ce que serait l’écriture si j’en faisais une chose qui concerne les animaux ? Il ne s’agit pas de questions rhétoriques ou d’hypothèses abstraites. Je crois qu’effectivement l’écriture est de la peinture et de la musique, a à voir avec l’Inconscient, concerne directement les vies animales. Donc, dans le livre, j’ai multiplié les rencontres improbables, les relations a priori absurdes, les agencements incohérents. Pour la même raison, j’ai privilégié la répétition comme principe de composition et processus de production : les textes sont répétés et, à l’intérieur de chaque texte, des parties en sont également répétées. Mais la répétition n’est pas la reproduction du même puisque s’introduisent à chaque fois des déplacements, des altérations, des bifurcations. J’ai essayé de mettre en place un processus de variation par lequel le texte devient sans cesse autre chose, est un devenir qui implique l’autre et le mouvement, l’incohérence. D’ailleurs, pour pousser plus loin ce mouvement de répétition et de variation, j’ai par la suite repris la logique de ce livre que j’ai déplacée dans un autre texte mais qui est une fiction, pour composer une sorte de rencontre improbable, un agencement là encore entre hétérogènes. Le résultat est bizarre et, logiquement, aucun éditeur n’en a voulu…
 Dans Ce texte et autres textes, ce sont la répétition et la variation qui engendrent le mouvement giratoire dont vous parlez, le mouvement lancinant qui devient plus important que la signification. Ce qui est apparu de manière plus claire pour moi que dans mes quelques livres précédents, c’est que le mouvement s’inscrit dans le texte comme sa limite constitutive : le langage tend vers une limite qui est un mouvement sans signification, mouvement qui constitue le texte lui-même, comme la limite ou l’autre du texte mais internes, dans le texte, constitutifs et producteurs du texte. Celui-ci n’est pas en relation avec autre chose que lui-même mais il devient cette relation à l’autre, indissociable d’un mouvement qui le détruit, l’abolit – l’idée d’une destruction immanente au texte, d’un écroulement du texte sur lui-même étant un des thèmes récurrents de ce livre.
Dans Ce texte et autres textes, ce sont la répétition et la variation qui engendrent le mouvement giratoire dont vous parlez, le mouvement lancinant qui devient plus important que la signification. Ce qui est apparu de manière plus claire pour moi que dans mes quelques livres précédents, c’est que le mouvement s’inscrit dans le texte comme sa limite constitutive : le langage tend vers une limite qui est un mouvement sans signification, mouvement qui constitue le texte lui-même, comme la limite ou l’autre du texte mais internes, dans le texte, constitutifs et producteurs du texte. Celui-ci n’est pas en relation avec autre chose que lui-même mais il devient cette relation à l’autre, indissociable d’un mouvement qui le détruit, l’abolit – l’idée d’une destruction immanente au texte, d’un écroulement du texte sur lui-même étant un des thèmes récurrents de ce livre.
Du coup, bien sûr, je trouve des résonances avec un livre récent d’Amandine André, intitulé justement De la destruction, qui pour son compte et selon ses moyens propres invente quelque chose qui rejoint cette logique et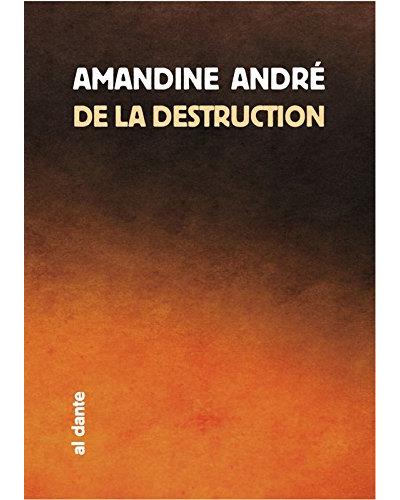 insiste sur l’importance du mouvement, sur la relation interne de l’écriture avec des mouvements asignifiants qui, chez Amandine, sont du corps, d’une dynamique désarticulante du corps. Ce qui est commun à nos deux livres est une tension de la langue vers la musique et le rythme comme surgissement et insistance de l’asignifiant, du bruit, du mouvement – surgissement et conservation que le texte produit lui-même. Produire du bruit, des mouvements sans signification, de l’incohérence, produire une vie de cette incohérence, c’est une drôle d’idée pour un texte, pour du langage – mais c’est, aujourd’hui, une idée qui me paraît intéressante pour la poésie, une idée de ce qu’elle pourrait être. Je pourrais aussi citer les textes d’A.C. Hello et les lectures étranges qu’elle en fait, lectures ou performances dont on voit bien qu’elles sont le surgissement d’un bruit, d’un chaos, l’événement d’une espèce d’animal qui dit le texte dans son langage animal, intensif, qui ne peut l’articuler qu’à la limite de la désarticulation, sur la limite de l’écrit et du cri. Et c’est déjà ce mouvement qui est présent dans ses textes eux-mêmes. Il y aurait d’autres auteurs encore à évoquer, mais ce serait peut-être un peu long…
insiste sur l’importance du mouvement, sur la relation interne de l’écriture avec des mouvements asignifiants qui, chez Amandine, sont du corps, d’une dynamique désarticulante du corps. Ce qui est commun à nos deux livres est une tension de la langue vers la musique et le rythme comme surgissement et insistance de l’asignifiant, du bruit, du mouvement – surgissement et conservation que le texte produit lui-même. Produire du bruit, des mouvements sans signification, de l’incohérence, produire une vie de cette incohérence, c’est une drôle d’idée pour un texte, pour du langage – mais c’est, aujourd’hui, une idée qui me paraît intéressante pour la poésie, une idée de ce qu’elle pourrait être. Je pourrais aussi citer les textes d’A.C. Hello et les lectures étranges qu’elle en fait, lectures ou performances dont on voit bien qu’elles sont le surgissement d’un bruit, d’un chaos, l’événement d’une espèce d’animal qui dit le texte dans son langage animal, intensif, qui ne peut l’articuler qu’à la limite de la désarticulation, sur la limite de l’écrit et du cri. Et c’est déjà ce mouvement qui est présent dans ses textes eux-mêmes. Il y aurait d’autres auteurs encore à évoquer, mais ce serait peut-être un peu long…
En tout cas, je peux dire que c’est ce que je retiens d’abord de ce que vous évoquez lorsque vous qualifiez ce texte de « réflexif » : un texte qui revient sur lui-même mais pour s’ouvrir, se reprendre et devenir autre. J’ai essayé, par ce mouvement de retour et de reprise, d’altérer le texte plutôt que de le refermer sur lui-même puisque ce qui m’intéresse, c’est de produire des textes ouverts, en déséquilibre, qui existent selon une errance, une ignorance d’eux-mêmes, une obscurité qui est le contraire de l’hermétisme ou du texte savant. Il y a des poètes qui écrivent des textes poétiques supposés dire ce qu’est la poésie, ce qu’est ceci ou cela, ce qui donne le plus souvent des choses très plates, banales, assez chiantes en fait. Il me semble plus intéressant non de dire ce qu’est ou serait la poésie, mais de le faire : produire le mouvement plutôt que dire le mouvement, produire la poésie plutôt que dire la poésie.
Ceci rejoint une autre signification possible de votre question : est-ce que Ce texte et autres textes n’est pas aussi de la réflexion sur la poésie, en particulier par la mobilisation de telle ou telle référence ? Je ne pense pas. Ou alors tout dépend de ce que l’on entend par là. Il ne s’agit pas de tenir un discours sur la poésie, discours qui aurait une forme poétique mais dont le 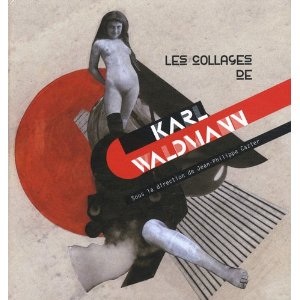 propos serait de fournir une sorte d’analyse ou de théorie de la poésie ou d’autre chose. Je ne pense pas que l’écriture poétique doive ou puisse être un prétexte pour autre chose qu’elle-même. S’il y a ces références, comme je l’ai dit, leur fonction est surtout d’ouvrir le texte, de le faire bifurquer. Evidemment, je n’ai pas choisi n’importe quels auteurs mais certains parmi ceux qui, pour plusieurs raisons, m’intéressent. Duras ou Mandelstam me plaisent, entre autres choses, car ce sont des auteurs qui écrivent sans graisse, comme du Bouchet ou Deleuze. Il s’agit d’être au plus près du mot, du rythme, de l’image, et de ce qui en même temps leur échappe et les déplace ailleurs. C’est une façon de dire que l’important est le texte, ce qu’il implique, son cadre et son propre dehors. Ces auteurs illustrent, pour moi, moins une certaine idée de la littérature qu’une certaine passion de la littérature. Je constate aussi que les auteurs ou artistes que j’utilise dans ce livre ont interrogé de manière radicale leur pratique : ce qu’ils font est pour eux inséparable d’une destruction et recréation incessantes du fondement même de ce qu’ils font. On voit bien ça chez Freud, Pollock, Lacan, Duras, etc. Même Reverdy, qu’on a un peu oublié, réfléchit à une conception radicale de l’image. Tout ceci pour dire que leurs œuvres respectives sont indissociables d’une insécurité, d’un risque toujours repris et approfondi qui est le risque du mouvement, de l’absence de sol stable. Les œuvres qui en résultent sont comme des monuments de ce mouvement, de cette instabilité, qui sont selon moi inhérents à l’écriture. Donc, oui, on pourrait dire que toutes ces œuvres sont emblématiques de ce qui m’attire dans la création. Mais ce n’est pas la même chose que de vouloir prendre la poésie comme prétexte pour écrire une thèse avec des notes de bas de page.
propos serait de fournir une sorte d’analyse ou de théorie de la poésie ou d’autre chose. Je ne pense pas que l’écriture poétique doive ou puisse être un prétexte pour autre chose qu’elle-même. S’il y a ces références, comme je l’ai dit, leur fonction est surtout d’ouvrir le texte, de le faire bifurquer. Evidemment, je n’ai pas choisi n’importe quels auteurs mais certains parmi ceux qui, pour plusieurs raisons, m’intéressent. Duras ou Mandelstam me plaisent, entre autres choses, car ce sont des auteurs qui écrivent sans graisse, comme du Bouchet ou Deleuze. Il s’agit d’être au plus près du mot, du rythme, de l’image, et de ce qui en même temps leur échappe et les déplace ailleurs. C’est une façon de dire que l’important est le texte, ce qu’il implique, son cadre et son propre dehors. Ces auteurs illustrent, pour moi, moins une certaine idée de la littérature qu’une certaine passion de la littérature. Je constate aussi que les auteurs ou artistes que j’utilise dans ce livre ont interrogé de manière radicale leur pratique : ce qu’ils font est pour eux inséparable d’une destruction et recréation incessantes du fondement même de ce qu’ils font. On voit bien ça chez Freud, Pollock, Lacan, Duras, etc. Même Reverdy, qu’on a un peu oublié, réfléchit à une conception radicale de l’image. Tout ceci pour dire que leurs œuvres respectives sont indissociables d’une insécurité, d’un risque toujours repris et approfondi qui est le risque du mouvement, de l’absence de sol stable. Les œuvres qui en résultent sont comme des monuments de ce mouvement, de cette instabilité, qui sont selon moi inhérents à l’écriture. Donc, oui, on pourrait dire que toutes ces œuvres sont emblématiques de ce qui m’attire dans la création. Mais ce n’est pas la même chose que de vouloir prendre la poésie comme prétexte pour écrire une thèse avec des notes de bas de page.
Ceci dit, je crois que la poésie parle d’elle-même, qu’elle est un discours sur elle-même – même si le terme de « discours » ici ne convient pas tout à fait. Un tableau, par exemple, dit ce qu’il est, montre ce qu’il est, et il le montre en tant que tableau, en lui-même, par les moyens de la peinture. Un livre de philosophie traite de telle ou telle chose mais dit en même temps ce qu’il est en tant que livre de philosophie, ce qu’est la philosophie telle qu’elle existe dans ce livre. Mais ce qu’il dit de lui-même, il ne le dit pas à partir d’un point de vue extérieur, il le dit de manière inhérente, immanente. La poésie dit ce qu’elle est mais elle le dit par la production effective du texte, du mouvement qui est le texte. Pour le dire autrement : le discours dont je parle, ce discours muet, est indissociable d’une performance, d’une auto-performance. Chaque texte poétique performe la poésie, se performe lui-même, performe la poésie qu’il est. C’est ce processus qui traverse Ce texte et autres textes : chaque texte est sa propre performance, dans le sens anglais du terme, to perform, comme le performatif chez Austin. Je crois qu’il y a dans cette logique une forme d’immanence matérialiste radicale. On peut alors dire que mon livre est aussi son propre objet, non dans le sens où il énoncerait sa propre théorie – quoique pourquoi pas ? –, et en tout cas pas dans le sens où il produirait une analyse critique de la littérature, de la poésie, ou des auteurs et artistes qu’il convoque. C’est un livre qui se performe lui-même et qui performe la poésie. C’est ce que je pense avoir essayé de faire : un livre au plus près de ce que je crois être la poésie, de ce qu’implique l’expérience de l’écriture poétique, ses dynamismes et processus, son errance fondamentale. J’ai essayé de ne pas parler sur la poésie mais de m’y enfoncer, m’y égarer autant que possible, concentré sur l’existence de ce mouvement, sur sa production, sa durée à travers tout le livre. Un de mes amis, le sculpteur Stéphane Gantelet, m’a dit qu’il avait aimé le livre car il y était complètement perdu. Je crois que c’est ce que l’on peut en dire de plus juste…
Emmanuèle Jawad. A partir de là, quels liens établiriez-vous entre le langage poétique et le langage théorique ? Quelles combinaisons possibles entre le poète et le critique ?
Jean-Philippe Cazier. J’insisterai sur le fait que la critique est de la création, c’est-à-dire qu’elle ne parle pas de ce qui lui serait extérieur pour en énoncer le sens ou émettre un jugement. La critique crée autant que la poésie ou la peinture, en tout cas c’est ainsi que je la comprends et qu’elle m’intéresse. Ce qui veut dire qu’elle a ses propres outils, qui ne sont pas ceux de la poésie. Par critique j’entends critique littéraire mais aussi critique dans le sens de pensée critique, philosophie critique, car dans ce que j’essaie de faire, les deux vont ensemble. Je retiens de ce que font Blanchot ou Deleuze que le discours critique n’est pas un discours surplombant, certainement pas un discours qui juge : c’est un discours qui se construit avec la littérature, avec cet autre qu’est l’écriture. La philosophie n’a pas à dire ce qu’est la poésie, ni à en livrer le sens : elle peut, et en un sens doit, travailler avec elle, produire des agencements, mais elle ne peut pas parler à la place de la poésie ni se confondre avec elle. L’inverse est également valable. Si la poésie peut avoir quelque chose à faire avec la philosophie, l’idée qu’elle pourrait lui être identique ne tient pas. Les deux sont deux hétérogènes qui peuvent s’agencer, et dans cet agencement les frontières et limites entre les deux ne peuvent que se transformer, devenir poreuses, flottantes, mais pas disparaître. Derrida a travaillé de manière importante sur ces questions, et Deleuze aussi, en particulier dans Qu’est-ce que la philosophie ?, écrit avec Guattari. Et ce qui se rejoint dans ce que Derrida et Deleuze en disent, et qui est en même temps différent, est que la littérature est une puissance de bifurcation pour la philosophie et, même s’ils théorisent beaucoup moins cet autre aspect, je crois que la philosophie est aussi une puissance de bifurcation pour la poésie.
deux vont ensemble. Je retiens de ce que font Blanchot ou Deleuze que le discours critique n’est pas un discours surplombant, certainement pas un discours qui juge : c’est un discours qui se construit avec la littérature, avec cet autre qu’est l’écriture. La philosophie n’a pas à dire ce qu’est la poésie, ni à en livrer le sens : elle peut, et en un sens doit, travailler avec elle, produire des agencements, mais elle ne peut pas parler à la place de la poésie ni se confondre avec elle. L’inverse est également valable. Si la poésie peut avoir quelque chose à faire avec la philosophie, l’idée qu’elle pourrait lui être identique ne tient pas. Les deux sont deux hétérogènes qui peuvent s’agencer, et dans cet agencement les frontières et limites entre les deux ne peuvent que se transformer, devenir poreuses, flottantes, mais pas disparaître. Derrida a travaillé de manière importante sur ces questions, et Deleuze aussi, en particulier dans Qu’est-ce que la philosophie ?, écrit avec Guattari. Et ce qui se rejoint dans ce que Derrida et Deleuze en disent, et qui est en même temps différent, est que la littérature est une puissance de bifurcation pour la philosophie et, même s’ils théorisent beaucoup moins cet autre aspect, je crois que la philosophie est aussi une puissance de bifurcation pour la poésie.
Ce que je peux dire donc, sur cette question du rapport entre poésie et critique, c’est qu’il n’y pas d’identification possible de l’une avec l’autre mais qu’il y a des rapports possibles, agencements, des possibilités de co-errance pour reprendre ce terme, ou pour le dire avec Deleuze : des devenirs.
Il me semble alors que j’essaie de créer des agencements entre poésie et philosophie. Je ne suis pas du tout un critique littéraire, si on entend par là quelqu’un qui rend compte des parutions, qui émet un avis sur les livres, etc. Faire de la critique, pour moi, est d’abord un exercice de pensée, la rencontre d’un livre, d’une œuvre étant l’occasion, là encore, de bifurcations, d’une rencontre véritable. Il s’agit, à mon niveau, de suivre des lignes, de voir où elles conduisent, ce qu’elles dessinent, permettent de reconfigurer et d’inventer, et pas du tout de juger ou de favoriser la logique marchande, libérale, du livre et de l’édition. La critique est davantage un exercice de cartographie qu’une herméneutique ou une espèce de tribunal, et surtout pas une agence de pub. C’est à cette condition, je crois, qu’elle est créatrice : elle crée à partir de rencontres et crée elle-même des rencontres, des déplacements, des dérives de la pensée puisque les cartes qu’elle trace sont les cartes de dérives, d’errances, les tracés d’un égarement. Et il en est de même pour la poésie, l’écriture poétique. Comme il en est de même dans les rapports possibles de la poésie à la philosophie : celle-ci ne dit pas à la poésie ce qu’elle est ou devrait être, elle n’en révèle ni le sens ni la finalité mais elle permet des rencontres nouvelles.
Ce serait donc un point sur lequel, selon moi, la critique et la poésie peuvent se croiser et s’agencer. Pour mieux me faire comprendre, il faudrait peut-être poser la question de la finalité de tout cela. Je crois que la poésie, la philosophie, créent des mondes, ouvrent le monde, en déplient la multiplicité, créent cette multiplicité, créent sans cesse des points de vue pour multiplier le monde et les possibilités d’existence du monde et dans le monde. La notion de vérité ne m’intéresse pas beaucoup, ce qui m’intéresse, c’est la création et 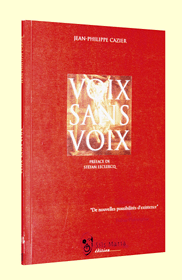 le multiple, le dépliement chaotique, pluriel et imprévisible, de la pensée et du monde. Pour moi, un texte m’intéresse moins par ses significations que par le monde qu’il construit et par les possibles du monde qu’il fait advenir et exister. Et les textes qui m’attirent le plus sont peut-être ceux où je repère le plus clairement ce processus, ce rapport du texte à lui-même et au monde. Lorsque je dis qu’un texte est en un sens son propre objet, je ne veux pas dire qu’il se referme sur lui-même, dans une espèce d’enfermement dans la langue, puisque au contraire le texte est en lui-même ouverture sur le monde, agencement avec le monde et par lequel le monde varie comme, en même temps, le texte varie en fonction de ses rapports au monde, ses rapports au chaos du monde. Le texte chaotise le monde et réciproquement. Et la poésie chaotise la philosophie et inversement. C’est de cette façon, à peu près, que je peux définir les rapports entre la poésie et la critique tels que je les comprends et que j’essaie de les expérimenter. On retrouverait ici votre première question sur l’articulation de ce que je fais, et cette articulation générale se situerait peut-être à ce niveau : construire un chaos du monde à partir d’un rapport entre poésie et philosophie. C’est aussi pour cette raison qu’il y a de la philosophie dans mes textes poétiques et que la critique telle que je la conçois implique un rapport entre littérature et philosophie. Mon premier livre, Voix sans voix, qui est un texte poétique, a d’ailleurs été publié chez Sils Maria, qui est une maison d’édition qui publie de la philosophie. Au fond, peut-être que ce qui m’intéresse ce n’est pas d’être poète ou philosophe, et sans doute que je ne suis ni l’un ni l’autre : j’essaie d’exister entre les deux, là où les deux s’agencent, dans une sorte de zone hybride un peu monstrueuse.
le multiple, le dépliement chaotique, pluriel et imprévisible, de la pensée et du monde. Pour moi, un texte m’intéresse moins par ses significations que par le monde qu’il construit et par les possibles du monde qu’il fait advenir et exister. Et les textes qui m’attirent le plus sont peut-être ceux où je repère le plus clairement ce processus, ce rapport du texte à lui-même et au monde. Lorsque je dis qu’un texte est en un sens son propre objet, je ne veux pas dire qu’il se referme sur lui-même, dans une espèce d’enfermement dans la langue, puisque au contraire le texte est en lui-même ouverture sur le monde, agencement avec le monde et par lequel le monde varie comme, en même temps, le texte varie en fonction de ses rapports au monde, ses rapports au chaos du monde. Le texte chaotise le monde et réciproquement. Et la poésie chaotise la philosophie et inversement. C’est de cette façon, à peu près, que je peux définir les rapports entre la poésie et la critique tels que je les comprends et que j’essaie de les expérimenter. On retrouverait ici votre première question sur l’articulation de ce que je fais, et cette articulation générale se situerait peut-être à ce niveau : construire un chaos du monde à partir d’un rapport entre poésie et philosophie. C’est aussi pour cette raison qu’il y a de la philosophie dans mes textes poétiques et que la critique telle que je la conçois implique un rapport entre littérature et philosophie. Mon premier livre, Voix sans voix, qui est un texte poétique, a d’ailleurs été publié chez Sils Maria, qui est une maison d’édition qui publie de la philosophie. Au fond, peut-être que ce qui m’intéresse ce n’est pas d’être poète ou philosophe, et sans doute que je ne suis ni l’un ni l’autre : j’essaie d’exister entre les deux, là où les deux s’agencent, dans une sorte de zone hybride un peu monstrueuse.
Emmanuèle Jawad. Dans ce rapport du texte avec le monde, vos affinités avec un texte qui construise le monde et qui vous intéresse « par les possibles du monde qu’il fait advenir et exister », y a-t-il une place faite à une forme d’engagement que l’on retrouverait à la fois dans le texte de création et la critique ? Pour le dire autrement, la pratique de l’écriture et le travail critique défendent-ils quelque chose ? Auraient-ils en commun une forme d’engagement, d’ordre esthétique, intellectuel, politique, etc.?
Jean-Philippe Cazier. Plutôt que d’engagement, je préfèrerais parler d’affirmation. La notion d’engagement, en raison de son contenu historique et de ses implications logiques, ne paraît plus pertinente, en tout cas si on la rattache à l’engagement des intellectuels tel que Sartre l’entendait. La critique de cette position a été faite, par exemple, par Foucault, je crois que ce n’est pas la peine d’y revenir. On a compris que l’idée selon laquelle l’intellectuel devrait s’engager relève, d’une part, d’une sorte de mauvaise conscience qui  m’est un peu étrangère, d’autre part de présupposés qui renvoient à la vieille idée de l’intellectuel qui éclaire le peuple, de la raison qui guide l’ignorant et l’écervelé – tout ceci étant politiquement et philosophiquement très douteux. Ce qui m’intéresse dans l’engagement, c’est lorsqu’il implique une affirmation du monde, c’est-à-dire une bifurcation du monde, d’autres possibles encore incalculables du monde. Lorsque j’écris une critique sur le dernier livre de Rada Iveković, c’est évidemment un choix politique, c’est en un certain sens un engagement : les migrants font irruption dans le monde et l’entraînent dans leur sillage, mettant au jour la pourriture de la politique européenne et déplaçant l’Europe vers un autre visage d’elle-même qu’elle pourrait être. Mais c’est la même chose lorsque j’écris une critique sur Safe, une fiction de Lucie Taieb : surgit dans la pensée et dans le monde une logique du rêve qui les redistribue complètement, avec les implications éthiques et politiques de cette redistribution. Avec Liliane Giraudon, Amandine André et Frank Smith, nous avons écrit un texte dont le titre est « C’est comme une guerre », qui a d’abord été publié dans la presse puis repris par Alain Jugnon dans un livre collectif intitulé Redrum. C’est un texte que nous avons écrit il y a deux ou trois ans, au moment où
m’est un peu étrangère, d’autre part de présupposés qui renvoient à la vieille idée de l’intellectuel qui éclaire le peuple, de la raison qui guide l’ignorant et l’écervelé – tout ceci étant politiquement et philosophiquement très douteux. Ce qui m’intéresse dans l’engagement, c’est lorsqu’il implique une affirmation du monde, c’est-à-dire une bifurcation du monde, d’autres possibles encore incalculables du monde. Lorsque j’écris une critique sur le dernier livre de Rada Iveković, c’est évidemment un choix politique, c’est en un certain sens un engagement : les migrants font irruption dans le monde et l’entraînent dans leur sillage, mettant au jour la pourriture de la politique européenne et déplaçant l’Europe vers un autre visage d’elle-même qu’elle pourrait être. Mais c’est la même chose lorsque j’écris une critique sur Safe, une fiction de Lucie Taieb : surgit dans la pensée et dans le monde une logique du rêve qui les redistribue complètement, avec les implications éthiques et politiques de cette redistribution. Avec Liliane Giraudon, Amandine André et Frank Smith, nous avons écrit un texte dont le titre est « C’est comme une guerre », qui a d’abord été publié dans la presse puis repris par Alain Jugnon dans un livre collectif intitulé Redrum. C’est un texte que nous avons écrit il y a deux ou trois ans, au moment où tous les réactionnaires s’en donnaient à cœur joie contre l’égalité des droits, contre l’avortement, contre les gender studies, contre la possibilité de sexualités non assignées, etc. Cette situation, la jouissance que ces connards éprouvaient à s’exhiber partout, nous étaient insupportables. Nous n’avons pas fait un texte pour démonter leurs propos, ce qui est somme toute très facile, nous avons écrit un texte affirmatif : nous affirmons nos corps, nous affirmons les sexualités, nous affirmons nos propres jouissances et nos propres désirs, nous affirmons les mille sexes et les mille bouches de chaque femme et de chaque homme. C’est-à-dire : nous affirmons le monde et la vie du monde, les différences immanentes du monde, les innombrables bifurcations qui le constituent et toutes celles qui peuvent advenir. Faire ça, c’est faire de la politique. Deleuze appelait de nouvelles façons de croire au monde, c’est-à-dire de nouvelles façons d’affirmer le monde, de dire oui à l’hétérogenèse infinie qu’il implique. C’est ce mouvement affirmatif, politique, que l’on trouve de manière très évidente chez un écrivain comme Alban Lefranc. Ou bien, de différentes manières, chez Oliver Rohe ou Mathieu Larnaudie, ou Arno Bertina. Chez Claro, cette affirmation est le centre de ses livres, leur sujet même. Ce sont des auteurs au sujet desquels j’écris quasi systématiquement. C’est aussi quelque chose comme ça que l’on retrouve avec Nuit Debout, l’affirmation d’une nouvelle forme de communauté, d’une nouvelle façon de produire du commun par l’agencement d’une foule qui n’a rien de commun, d’une nouvelle façon d’investir l’espace de la ville, de faire de la politique ici et maintenant, de produire du discours, une nouvelle façon de ne pas réclamer le pouvoir et de ne pas se compromettre avec l’Etat ou les syndicats ou les partis. Une nouvelle façon de ne pas s’opposer mais de faire advenir la vie. C’est cette dimension qui m’intéresse dans le politique et qui appelle une forme d’engagement qui n’est pas du tout le seul fait de l’intellectuel ou de l’esprit éclairé.
tous les réactionnaires s’en donnaient à cœur joie contre l’égalité des droits, contre l’avortement, contre les gender studies, contre la possibilité de sexualités non assignées, etc. Cette situation, la jouissance que ces connards éprouvaient à s’exhiber partout, nous étaient insupportables. Nous n’avons pas fait un texte pour démonter leurs propos, ce qui est somme toute très facile, nous avons écrit un texte affirmatif : nous affirmons nos corps, nous affirmons les sexualités, nous affirmons nos propres jouissances et nos propres désirs, nous affirmons les mille sexes et les mille bouches de chaque femme et de chaque homme. C’est-à-dire : nous affirmons le monde et la vie du monde, les différences immanentes du monde, les innombrables bifurcations qui le constituent et toutes celles qui peuvent advenir. Faire ça, c’est faire de la politique. Deleuze appelait de nouvelles façons de croire au monde, c’est-à-dire de nouvelles façons d’affirmer le monde, de dire oui à l’hétérogenèse infinie qu’il implique. C’est ce mouvement affirmatif, politique, que l’on trouve de manière très évidente chez un écrivain comme Alban Lefranc. Ou bien, de différentes manières, chez Oliver Rohe ou Mathieu Larnaudie, ou Arno Bertina. Chez Claro, cette affirmation est le centre de ses livres, leur sujet même. Ce sont des auteurs au sujet desquels j’écris quasi systématiquement. C’est aussi quelque chose comme ça que l’on retrouve avec Nuit Debout, l’affirmation d’une nouvelle forme de communauté, d’une nouvelle façon de produire du commun par l’agencement d’une foule qui n’a rien de commun, d’une nouvelle façon d’investir l’espace de la ville, de faire de la politique ici et maintenant, de produire du discours, une nouvelle façon de ne pas réclamer le pouvoir et de ne pas se compromettre avec l’Etat ou les syndicats ou les partis. Une nouvelle façon de ne pas s’opposer mais de faire advenir la vie. C’est cette dimension qui m’intéresse dans le politique et qui appelle une forme d’engagement qui n’est pas du tout le seul fait de l’intellectuel ou de l’esprit éclairé.
Si je reviens à votre question, ce qui me dérange aussi avec l’idée habituelle de l’engagement de l’écrivain, c’est qu’il s’agit justement de l’engagement de l’écrivain et pas d’un engagement de l’écriture. Dans ce cas, c’est la personne de l’écrivain qui s’engage et l’écriture n’est qu’un moyen de cet engagement : la dimension politique, ici, est ajoutée de l’extérieur à l’écriture et ne lui appartient pas en propre. L’écrivain engagé pourrait écrire des livres de cuisine, ce serait pareil.
Or, il me semble que l’écriture est en elle-même politique. D’abord dans le sens où elle ne peut être qu’un agencement avec des minorités, avec du mineur, ce que Deleuze et Guattari ont théorisé dans leur livre sur Kafka. Ils ont fait de Kafka un écrivain politique et pas tellement car il aurait dénoncé à l’avance les institutions staliniennes mais dans le sens où son écriture est un agencement avec ce qui ne correspond pas à la majorité, à un modèle établi, fixe, dominant. Kafka écrit avec des animaux, avec des souris, avec une taupe, avec des puissances inaperçues du corps, avec des minorités linguistiques qui font fuir le monde, ses significations, sa logique et en affirment d’autres possibles. Ce n’est pas non plus un hasard si ces minorités sont socialement et institutionnellement dominées, soumises à de la violence : violence totale contre les vies animales, violence contre tel groupe culturel ou « ethnique », etc. On peut constater la même logique chez un écrivain tout aussi incroyable que Kafka et qui est Jean Genet, lorsqu’il écrit avec les Palestiniens, avec les Black Panthers, avec les voleurs et les putes, avec leur monde, leur logique, leur langage. Il ne se contente pas de dire : « les Palestiniens sont opprimés par l’Etat israélien », ce qu’ils sont effectivement, mais il va chercher avec eux une autre logique des corps, une autre logique du rêve, de la langue, du désir, une autre logique du monde qui le fait fuir de tous côtés et en fait naître une autre carte. Son écriture devient en elle-même ce rapport, inséparable de ce que Deleuze nomme un devenir-révolutionnaire par lequel le monde s’affecte d’un automouvement qui le déplace irrémédiablement. Pour moi, c’est le mouvement le plus radical et le plus beau de l’art, qui affecte le plus fortement, qui tétanise et exalte en même temps, et qui à chaque fois m’émeut profondément. Pour donner un dernier exemple, on voit bien comment tout ceci constitue un livre particulièrement beau comme Katrina de Frank Smith, avec les Indiens de Louisiane, leur parler franco-anglais qui fait fuir le modèle majoritaire du français et de l’anglais, leur rapport au capitalisme qui les détruit, leur rapport aux forces de la nature, au temps, à l’histoire. Tout fout le camp dans ce livre et invente de nouvelles directions de tout. Je pourrais aussi parler du rapport à l’Afrique chez Arno Bertina, de ce qu’il fait avec un passager des frontières comme Johnny Cash, ou de la logique de la rencontre et du choc chez Claro. Ou encore de l’instabilité et des devenirs chez Liliane Giraudon et son écriture si particulière, du rapport de cette écriture à ce qu’il y a de mineur dans le corps des femmes, etc. Ce sont des choses qui m’intéressent beaucoup. Ce qu’il y a de commun à tous ces exemples, à tous ces écrivains, c’est que l’on retrouve dans ce qu’ils font ce qu’est selon moi l’écriture en elle-même, la poésie en elle-même et qui bien sûr ne renvoie pas à un genre littéraire. L’écriture y est pratiquée comme un agencement avec le monde et avec ce qui, dans le monde, le déterritorialise, permet d’affirmer sa puissance de bifurcation, sa puissance d’invention, qui se traduit bien sûr dans le traitement même de la langue, dans ses résonances dans la pensée. Encore une fois, je n’invente rien en disant cela, Deleuze et Guattari l’ont parfaitement dit à travers leur concept de « littérature mineure ». Et de fait, si l’écriture n’est pas mineure, si elle ne recherche pas des alliances avec les animaux, avec ce qui échappe au majoritaire, si elle n’est pas en ce sens politique, je ne vois pas bien quel en serait l’intérêt.
avec les Black Panthers, avec les voleurs et les putes, avec leur monde, leur logique, leur langage. Il ne se contente pas de dire : « les Palestiniens sont opprimés par l’Etat israélien », ce qu’ils sont effectivement, mais il va chercher avec eux une autre logique des corps, une autre logique du rêve, de la langue, du désir, une autre logique du monde qui le fait fuir de tous côtés et en fait naître une autre carte. Son écriture devient en elle-même ce rapport, inséparable de ce que Deleuze nomme un devenir-révolutionnaire par lequel le monde s’affecte d’un automouvement qui le déplace irrémédiablement. Pour moi, c’est le mouvement le plus radical et le plus beau de l’art, qui affecte le plus fortement, qui tétanise et exalte en même temps, et qui à chaque fois m’émeut profondément. Pour donner un dernier exemple, on voit bien comment tout ceci constitue un livre particulièrement beau comme Katrina de Frank Smith, avec les Indiens de Louisiane, leur parler franco-anglais qui fait fuir le modèle majoritaire du français et de l’anglais, leur rapport au capitalisme qui les détruit, leur rapport aux forces de la nature, au temps, à l’histoire. Tout fout le camp dans ce livre et invente de nouvelles directions de tout. Je pourrais aussi parler du rapport à l’Afrique chez Arno Bertina, de ce qu’il fait avec un passager des frontières comme Johnny Cash, ou de la logique de la rencontre et du choc chez Claro. Ou encore de l’instabilité et des devenirs chez Liliane Giraudon et son écriture si particulière, du rapport de cette écriture à ce qu’il y a de mineur dans le corps des femmes, etc. Ce sont des choses qui m’intéressent beaucoup. Ce qu’il y a de commun à tous ces exemples, à tous ces écrivains, c’est que l’on retrouve dans ce qu’ils font ce qu’est selon moi l’écriture en elle-même, la poésie en elle-même et qui bien sûr ne renvoie pas à un genre littéraire. L’écriture y est pratiquée comme un agencement avec le monde et avec ce qui, dans le monde, le déterritorialise, permet d’affirmer sa puissance de bifurcation, sa puissance d’invention, qui se traduit bien sûr dans le traitement même de la langue, dans ses résonances dans la pensée. Encore une fois, je n’invente rien en disant cela, Deleuze et Guattari l’ont parfaitement dit à travers leur concept de « littérature mineure ». Et de fait, si l’écriture n’est pas mineure, si elle ne recherche pas des alliances avec les animaux, avec ce qui échappe au majoritaire, si elle n’est pas en ce sens politique, je ne vois pas bien quel en serait l’intérêt.
 Je crois que l’on arrive alors à un deuxième sens dans lequel l’écriture est en elle-même politique. Elle l’est en tant que négation de tout modèle, de tout fondement donné, de tout sol fixe. Elle l’est en affirmant l’incohérence, la déterritorialisation sans fin. Elle l’est comme affirmation pure de l’autre. Jean-Luc Nancy rapproche l’écriture du cri, l’écrit et le cri. Je crois que c’est vrai, qu’il n’y a pas d’écriture si l’écrit n’est pas un cri, ce qui veut dire : si l’écrit n’est pas pris dans un devenir avec ce qui le détruit, l’inarticulé et le silence, avec d’autres zones de la langue et de ce qui peut l’habiter d’étrange et de non identifié. Comme je l’ai indiqué auparavant, ce rapport est l’objet de ce que fait A.C. Hello dans ses performances, mais déjà dans un livre comme Naissance de la gueule où il y a un rapport singulier à l’animal – puisque la gueule c’est la bouche envahie par l’animal –, où il y a des brouillages incessants de la langue et du monde, des territoires du rêve et du réel, des devenirs sans cesse repris du corps et de la pensée. Il me semble que c’est quelque chose comme ça que Derrida a repéré lorsqu’il définit l’écriture par la différance ou la dissémination, et que Deleuze et Guattari ont transformé dans le concept de « littérature mineure ». Ce qui est intéressant, c’est qu’ils ne définissent pas l’écriture ainsi sans montrer en quoi ce mouvement qu’est l’écriture implique en lui-même un mouvement du monde et de la pensée. L’écriture en elle-même est rapportée à autre chose qu’elle-même qui participe de ce qu’elle est,
Je crois que l’on arrive alors à un deuxième sens dans lequel l’écriture est en elle-même politique. Elle l’est en tant que négation de tout modèle, de tout fondement donné, de tout sol fixe. Elle l’est en affirmant l’incohérence, la déterritorialisation sans fin. Elle l’est comme affirmation pure de l’autre. Jean-Luc Nancy rapproche l’écriture du cri, l’écrit et le cri. Je crois que c’est vrai, qu’il n’y a pas d’écriture si l’écrit n’est pas un cri, ce qui veut dire : si l’écrit n’est pas pris dans un devenir avec ce qui le détruit, l’inarticulé et le silence, avec d’autres zones de la langue et de ce qui peut l’habiter d’étrange et de non identifié. Comme je l’ai indiqué auparavant, ce rapport est l’objet de ce que fait A.C. Hello dans ses performances, mais déjà dans un livre comme Naissance de la gueule où il y a un rapport singulier à l’animal – puisque la gueule c’est la bouche envahie par l’animal –, où il y a des brouillages incessants de la langue et du monde, des territoires du rêve et du réel, des devenirs sans cesse repris du corps et de la pensée. Il me semble que c’est quelque chose comme ça que Derrida a repéré lorsqu’il définit l’écriture par la différance ou la dissémination, et que Deleuze et Guattari ont transformé dans le concept de « littérature mineure ». Ce qui est intéressant, c’est qu’ils ne définissent pas l’écriture ainsi sans montrer en quoi ce mouvement qu’est l’écriture implique en lui-même un mouvement du monde et de la pensée. L’écriture en elle-même est rapportée à autre chose qu’elle-même qui participe de ce qu’elle est, qui agit sur elle comme elle agit sur lui. Un rapport radical à l’autre dans lequel l’autre est le centre. Bien sûr, cette puissance chaotique de l’écriture ne va pas sans création mais une création en déséquilibre, toujours ouverte sur un ailleurs et autrement. L’écriture ne produit pas d’ordre, une réconciliation apaisée des choses, une sérénité de l’esprit, mais toujours elle chaotise. L’écriture est par définition non réconciliée et résistance. Ce serait aussi en ce sens qu’elle est radicalement politique, politique et donc éthique, impliquant une forme de délire qui accompagne toute politique. Et l’on pourrait dire que c’est précisément ici que l’écriture croise la critique comme déstabilisation de l’établi, comme mise en crise, qu’elle rejoint le processus de la critique pris en lui-même, à la racine, lorsque la critique devient cri et donc écriture, pour reprendre là encore une série suggérée par Jean-Luc Nancy.
qui agit sur elle comme elle agit sur lui. Un rapport radical à l’autre dans lequel l’autre est le centre. Bien sûr, cette puissance chaotique de l’écriture ne va pas sans création mais une création en déséquilibre, toujours ouverte sur un ailleurs et autrement. L’écriture ne produit pas d’ordre, une réconciliation apaisée des choses, une sérénité de l’esprit, mais toujours elle chaotise. L’écriture est par définition non réconciliée et résistance. Ce serait aussi en ce sens qu’elle est radicalement politique, politique et donc éthique, impliquant une forme de délire qui accompagne toute politique. Et l’on pourrait dire que c’est précisément ici que l’écriture croise la critique comme déstabilisation de l’établi, comme mise en crise, qu’elle rejoint le processus de la critique pris en lui-même, à la racine, lorsque la critique devient cri et donc écriture, pour reprendre là encore une série suggérée par Jean-Luc Nancy.
Tout ce que je raconte là ne vaut, évidemment, qu’à condition de redéfinir le politique. Mais ce sera pour une autre fois…
![[Entretien] Entretien avec Jean-Philippe Cazier (Création et critique 2, par Emmanuèle Jawad)](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2016/05/cazierwaldmannBackG.jpg)
![[Entretien] Entretien avec Jean-Philippe Cazier (Création et critique 2, par Emmanuèle Jawad)](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2016/05/band-cazier.jpg)
in interview par Emmanuèle Jawad de Jean-Philippe Cazier qui me parle profondément par son intelligence, sa sensibilité et aussi sa liberté. Cela me donne envie de lire cet zuteur
kaléidoscopique