 Voici donc la seconde partie de l’entretien avec Jean-Claude Pinson. [Lire la première]
Voici donc la seconde partie de l’entretien avec Jean-Claude Pinson. [Lire la première]
FT : De vos derniers écrits se dégage une opposition qui semble un peu réductrice entre poésie pensante et poésie performante… Certains dispositifs critiques mis à l’épreuve de la scène ne donnent-ils pas autant à penser qu’une certaine poésie raisonneuse ?
J.-C. P. : Une poésie raisonneuse, sermonneuse, moralisante – ou même sentencieuse, on ne peut évidemment que s’en détourner. Et je vous concède bien volontiers que certains des dispositifs de mise à l’épreuve de la scène que vous évoquez puissent donner beaucoup à penser. Je ne suis pas du tout insensible à ce que tentent, dans cet ordre, certains poètes. Je pense par exemple à certaines lectures de Jérôme Game ou d’Emmanuelle Pireyre auxquelles il m’a été donné d’assister.
Mettons qu’il y en aille ici de la poésie (de la littérature) comme de la musique. Cette dernière, à partir de la tradition afro-américaine (blues, jazz), est devenue, si je puis dire, « post-coloniale » : elle s’est beaucoup diversifiée et des formes plus ou moins étrangères à la tradition occidentale savante ont imposé leurs modalités et gagné une légitimité esthétique. La poésie est sans doute en train de connaître un processus semblable. Dès lors, pour les poètes, il y a, comme pour les musiciens, deux espaces possibles pour la création : le studio mais aussi la scène. De même, il y a des poètes qui sont du côté de l’écriture savante et d’autres davantage du côté de l’oralité et de la performance.
Bref, le champ des possibles est en train de considérablement s’ouvrir pour ce que l’on appelle « poésie ». De ce point de vue, elle n’échappe pas à une mutation considérable, à ce qu’on appelle (l’expression est devenue un poncif) un « changement de paradigme », changement qui est à la fois politique, social, et technique. Politique : à l’âge « démocratique » (au sens de Tocqueville), il est logique que les arts reposant sur l’oralité et la performance, s’emparant des moyens et techniques offerts par l’industrie culturelle, prennent une place de plus en plus importante. Technique : à la faveur de la montée en puissance du son et de l’essor plus général des arts du spectacle et de la scène, la poésie sonore, sous des formes très diversifiées, a connu, lors des dernières décennies, un développement très marqué. Il ne s’agit d’ailleurs pas simplement d’une montée en puissance du son et de l’oralité. Avec l’apparition de nouveaux instruments et de nouvelles techniques, c’est l’acte créateur lui-même qui se trouve modifié. De ce point de vue, la poésie, qu’elle soit sonore ou écrite, a tendance à emboîter le pas aux musiques dites « actuelles ». Tels des DJ, nombreux sont en effet aujourd’hui les auteurs qui usent, par exemple, de la technique du sampling et recyclent, les passant au broyeur de la poésie pour en mieux faire paraître les stéréotypes, toutes sortes d’énoncés ready made véhiculés par les médias.
Il en résulte que la poésie, pour une part, a quitté l’espace littéraire. Ses points d’attache, du coup, ne sont plus (plus seulement) du côté de la littérature – du côté des prosateurs et de l’écriture narrative –, mais du côté des arts plastiques et des arts du spectacle. On a pu parler, dans cette optique, de « post-poésie ».
Vous l’aurez compris, pour toutes sortes de raisons, je suis plutôt quant à moi un poète de « studio ». Et c’est la poésie dans la littérature, cousinant avec le roman et l’essai, l’histoire et la philosophie, la poésie comme composition de musique savante (n’excluant rien des registres populaires), qui me retient. C’est elle dont j’ai voulu rappeler, dans mon dernier essai (À Piatigorsk…), l’importance et la vivacité du possible qu’elle représente (même s’il n’est plus hégémonique). Car je crois que certaines modalités de la pensée requièrent la « chambre » du poème, le silence de sa stanza, pour parvenir à floraison, atteindre la juste nuance. Je crois que c’est seulement dans sa pénombre et son intimité que peuvent s’inventer des notes, lignes et surfaces sans lesquelles l’existence ne peut que méconnaître « l’impossible » (pour parler comme Bataille) qui l’habite.
« Pensive », d’ailleurs, conviendrait sans doute mieux que « pensante », dans la mesure où la poésie, qui n’est pas la philosophie, fait droit à une certaine passivité, à une aventure de la pensée (de la pensée colorée, corporelle, affective, humorale, sexuée, temporelle, éthique, politique…), où celle-ci s’expose au sensible, aux accidents du réel et des mots, aux hasards de la trouvaille et des circonstances.
Pour ce qui est de l’idée de performance, j’ajouterai enfin qu’il faut prendre en compte, outre le studio et la scène, un troisième lieu, ou plutôt une troisième instance, l’être-au-monde lui-même que chacun nous sommes. Aussi la performance « poéthique », existentielle, est-elle pour moi tout sauf négligeable. Encore le mot de « performance » ne convient-il guère ici, avec ses relents d’efficacité managériale. Car s’il s’agit bien pour chacun de déployer sa « puissance d’être », de faire que son conatus devienne autant que possible cantus, la visée d’une vie poétique requiert aussi qu’on fasse droit au Wou-wei, au « Non vouloir saisir » cher à Roland Barthes.
FT : Oui, tout à fait. Au reste, on considère ordinairement ce terme de « performance » dans son acception linguistique : il s’agit de faire advenir sa « compétence », de la manifester sous des formes visibles et audibles qu’il faut inventer. Et dans ce domaine n’est pas créateur qui veut… J’ajouterai, après d’autres, que sous cette appellation de « performance » se trouvent subsumées des pratiques très hétérogènes : de John Cage à Arnaud Labelle-Rojoux, en passant par les futuristes italiens, DADA, Fluxus, Julien Blaine, Akenaton, ou encore Christophe Fiat, il est difficile de repérer de nombreuses et véritables convergences… Sans oublier cette réalité triviale que rappelle Jean-Michel Espitallier dans sa Caisse à outils : « Lecture-performance, performance poétique, poésie action, etc., la variété des appellations reflète la variété des pratiques, mais il faut tenir compte tout de même du fait qu’au terme de ″lecture″, beaucoup préfèrent aujourd’hui celui de ″performance″ simplement parce qu’il est plus vendeur… » (Pocket, 2006, p. 229).
Pour terminer, et dans l’optique de notre dialogue ouvert, j’aimerais vous laisser répondre à la dernière partie de mon article “Pour une poésie impure”, paru au printemps dernier…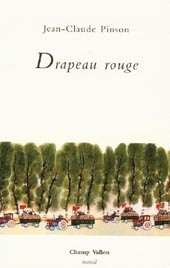
JC. P. : De quoi au juste suis-je l’héritier ? De choses assez composites, qui n’appartiennent pas toutes au domaine littéraire. Il y a d’abord eu, inauguraux, Hölderlin (en grande partie via Heidegger), Ponge, Claude Simon et … Denis Roche (jusqu’à l’emprunt de Miss Elanize dont j’ai fait un personnage fantomatique dans mes trois derniers livres). L’Ephémère, au départ, n’a pas compté pour moi. Bonnefoy est venu plus tard, avant tout comme essayiste me permettant de couper court à l’enfermement dans le concept. C’est le rimbaldien rapportant la poésie à l’existence qui m’a d’abord retenu en lui. Aucunement « l’humaniste » (si jamais ce terme lui convient). – Pour être passé, avant 68, par Althusser, je reste d’ailleurs très méfiant à l’égard de l’humanisme.
Denis Roche a été, dans mes années de formation, un choc esthétique. Comme Joyce. Avec le recul, j’ai cependant bien été obligé de constater que la langue dynamitée qu’il proposait ne tenait pas la distance (du moins à mes yeux). Ce qui, me direz-vous, est assez logique, puisqu’il s’agissait justement de quitter le langage (en tout cas la poésie). Mon souci, constructif en effet, était autre : trouver une langue, un mode discursif, qui puisse être durablement convaincant (audible, lisible…). J’ai toujours eu en tête, de ce point de vue, les réussites du free-jazz des années 60. Perec a dit cela avant moi : « Le free-jazz, écrit-il, a réussi là où la littérature a échoué ». Sous le mot de littérature, il mettait d’abord Joyce. On peut y mettre aussi, selon moi, Denis Roche. Et peut-être alors faudrait-il d’ailleurs modifier ainsi la formule : « La photographie a réussi là où la poésie a échoué ». Evidemment, il y a de superbes échecs qui valent mille fois des réussites en toc. (Au passage, l’analyse, que vous évoquez, d’Olivier Quintyn, si elle est très éclairante quant à la démarche de Denis Roche, ne me paraît pas suffire à convaincre de la valeur de l’œuvre poétique – ce qu’a pu faire Anne-James Chaton dans ce sillage-là me paraît finalement plus intéressant).
Où ai-je trouvé, en poésie (en littérature), un discours qui « tienne » et invente à l’instar du free-jazz ? Dans la prose de Claude Simon, dans le vers de Jude Stéfan, et avant tout (même si c’est venu plus tard) dans la prosodie poikilos de Fourcade (vous avez raison Le Sujet monotype a beaucoup compté pour moi). En amont, il faudrait aller chercher aussi des auteurs comme Sterne.
S’agit-il de faire rentrer la poésie dans son lit ? Je ne crois pas. J’ai peu de goût pour le revival néo-lyrique (mettons, pour faire vite, la descendance Cadou).
FT : Dans le sens que Michel Deguy donnait à cette formule, il s’agissait, comme vous l’évoquiez précédemment, de réintégrer la poésie dans la littérature…
JC. P. : Dans ce sens-là, oui. Mais en réalité je ne crois pas, comme certains (je pense à ce qu’a pu écrire Jean-Michel Espitallier), que la poésie soit vraiment sortie de l’espace littéraire. Je dirais plutôt qu’elle a conquis, avec de nouveaux supports et nouvelles modalités, de nouveaux territoires. Il n’y aurait lieu de s’en désoler que si cela signifiait la fin d’une ancienne et fructueuse conjugalité : celle qui voit cohabiter sous le même toit, celui de l’écriture, philosophie et littérature. Je crois au contraire que sous ce toit bien des possibles s’offrent encore à l’invention. Maintes œuvres, très diverses, en témoignent aujourd’hui. En tout cas, vous l’aurez compris, c’est à cette cohabitation que je reste pour ma part attaché – à ce qu’elle continue de rendre possible à l’art du sens (du sens formé et formant) qu’est la poésie.
Dans ce que veut dire Michel Deguy, deux motifs, me semble-t-il, interfèrent. Il y a d’abord, chez lui, dans l’esprit et la continuité d’Adorno, toute une critique de ce qu’il appelle le « culturel ». Devenue désormais un phénomène global, total, l’industrie de la culture obéit à la loi du « management ». Or, nous dit en substance Michel Deguy, si la finalité propre de la poésie est au contraire de « ménager le terrestre », elle risque bien, à vouloir jouer sa partition dans le « culturel », de perdre de vue cette finalité sienne. Sans méconnaître ce danger, je ne crois pas pour ma part, je l’ai dit précédemment, que les pratiques de la multitude artiste et du poétariat puissent être pensées à l’aune de cette seule logique d’une gestion marchande et sociale, festive et conviviale, du divertissement.
Le second motif touche au langage lui-même. Michel Deguy en effet ne s’inquiète pas seulement d’une sortie de la poésie hors de l’espace littéraire. C’est une sortie hors de la sphère même du logos qui pour lui est en cause. – Ou plus exactement une sortie hors du logikon, du « vernaculaire phrastique » comme milieu de la pensée, essentiel aussi bien à la littérature qu’à la philosophie. C’est la phrase qu’il faut défendre contre la « pulvérisation stochastique », car sans elle la pensée aura bien du mal à se frayer un chemin. Deguy ne méconnaît certainement pas les mérites poétiques de la parataxe (on pense à Hölderlin), mais il est d’abord, comme on sait, un poète de la relation plutôt que de l’exacerbation de la déliaison. Il est du côté de la phrase.
Pour ma part, même si je pense que la poétique du mot (du « signe debout » à la façon de Guillevic) est aujourd’hui un peu fatiguée, je voudrais ne pas choisir : les méandres proustiens, la phrase en delta, mais aussi « l’explosion hymnique » et la dissémination mallarméenne des mots ; l’auteur qui augmente et l’« ôteur » (Prigent) qui creuse en direction du vide ; la prose qui flue et digresse et le vers qui abrège et condense. Et plutôt que ou : le prosimètre donc.
Mais, plus encore que la question de la phrase, c’est celle du phrasé qui m’importe ; celle d’une prosodie qui soit capable de produire pour le lecteur un effet de voix qui soit, disons, jubilatoire. Toute la difficulté, puisque la voix n’est jamais qu’une voix écrite, seconde, est alors, sinon de la ressusciter, du moins de lui rendre un peu de verve, d’inflexion vive.
Ce qui implique en effet de vouloir, en un certain sens, « re-motiver le langage ». D’où mon intérêt pour le cratylisme (de second degré) de Ponge, même si c’est, comme dit Prigent, un pur fantasme poétique et que jamais ne sera vraiment surmontée « la séparation symbolique qui est le fait du parlant ».
C’est évidemment, vous avez raison, « une posture d’équilibriste » que la mienne. Car il s’agit bien, malgré tout (malgré cet avertissement de Nietzsche que reprend Jude Stéfan : « Cavete musicam »), il s’agit bien de renouer avec quelque chose comme un lyrisme. D’inventer dans le domaine verbal l’équivalent d’un lyrisme « free-jazz ». Et si je tiens à l’idée de lyrisme, c’est pour des raisons, je l’ai déjà dit, qui ne sont pas simplement esthétiques. Je fais volontiers mien le mot de Rilke (repris par Tsvétaïeva) : « Gesang ist Dasein » (l’existence est chant, chant du moins quand elle se tient sur sa ligne de crête). Au plan « métaphysique », c’est chez Deleuze et sa théorie de la ritournelle que je crois trouver les fondements d’une pensée du lyrisme. Deleuze : un « constructeur », un moderne « positif ». Et semblablement Negri, dans la lecture puissante qu’il a donnée de Leopardi.
Outre la question même du lyrisme, le point faible de l’entreprise, vous avez raison, c’est lorsqu’elle tente de penser la possibilité d’une extension d’un tel lyrisme à ce que j’appelle le « poétariat », poétariat dont on peut douter en effet qu’il raffole d’Ornette Coleman ou de Dominique Fourcade ! Oui, le lyrisme ordinaire des ateliers d’écriture nous ramène à la poésie sentimentale et naïve (en un sens très éloigné de Schiller !) Je m’entête pourtant, ne voulant sans doute pas, non pas désespérer le nouveau Billancourt, mais désespérer de lui. Car changer la vie seulement au plan individuel ne me satisfait pas.
![[Entretien] Jean-Claude PINSON : poéthiquement impur... (2)](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)
Si je peux me permettre et pour réagir à la réponse à la premième question :
N’oubliez pas de laisser un espace pour la poésie sonore de studio, c’est-à-dire pour celle dont le but immédiat n’est pas la performance publique mais l’enregistrement sur support. Alors l’opposition écriture « savante » / écriture orale ne fonctionne plus vraiment.
Oui, très juste, cet espace-là est créatif.