 Dans la rubrique Le roman contemporain : trajectoires et territoires, brillamment inaugurée par l’article de Francis Marcoin sur Lucien Suel, prend place cette étude fouillée de Bénédicte Gorrillot, universitaire spécialiste de Prigent et des avant-gardes, qui réussit la gageure d’appréhender une écriture par le seul prisme de deux "commencements" – ceux de Commencement et de Grand-mère Quéquette (POL, 1989 et 2003).
Dans la rubrique Le roman contemporain : trajectoires et territoires, brillamment inaugurée par l’article de Francis Marcoin sur Lucien Suel, prend place cette étude fouillée de Bénédicte Gorrillot, universitaire spécialiste de Prigent et des avant-gardes, qui réussit la gageure d’appréhender une écriture par le seul prisme de deux "commencements" – ceux de Commencement et de Grand-mère Quéquette (POL, 1989 et 2003).
PRIGENT : L’ÉCRITURE DU COMMENCEMENT
(Lecture de l’incipit de Grand-mère Quéquette)
COMMENCER : UN MOT-CLÉ
En 1989, POL publie un premier livre de Christian Prigent : Commencement. L’auteur n’est pas un inconnu des milieux littéraires : il a déjà fait paraître plusieurs ouvrages, chez Bourgois (Œuf-glotte, Power/ powder) ou Carte Blanche (Journal de l’Œuvide, Notes sur le déséquilibre). Depuis 1969, il dirige la revue d’avant-garde TXT, éditée, un temps, par Bourgois. Pourtant, de l’aveu même de l’écrivain, ce nouveau roman marque un « commencement » : « Le label POL [était] légitimant. Vu des balcons de la ″vie culturelle″, c’est même ce label, qui dans une vaste mesure a fondé mon nom comme le nom d’un écrivain. Avant, j’étais un poète épisodique et bizarre, un polémiste agité du bocal, un théoricien terroriste, un revuiste fébrilement activiste, etc. » (Christian Prigent, quatre temps. Rencontre avec Bénédicte Gorrillot [CP4T], Argol, 2009, p. 109). Si Commencement marque la naissance d’un auteur et d’une écriture, ce n’est pas au sens romantique, révolutionnaire, d’une apparition ex nihilo. L’incipit confirme cette lecture. L’écrivain y déclare : « vous pouvez pas savoir ce que c’est commencer, […] c’est surtout mastiquer, s’astiquer les tuyaux, redémarrer » (C, 12). Dans Christian Prigent, quatre temps, l’auteur revient sur ce (re)commencement. « Exilé à Berlin, en 1985 », il « travers[e] tout un tas de cahiers et carnets accumulés depuis des années » (CP4T, p. 105.). Il les laisse « coaguler » et « proliférer tous azimuts » et il « s’arrête, ahuri et exsangue trois ans et 400 pages après » : « ça s’appelle commencement. J’allais dire : forcément ». Être auteur est bien lié, chez lui, à un « commencement », mais entendu comme « perpétuel recommencement » de l’écriture. Ainsi le poète « agité du bocal » s’est-il fait romancier et auteur d’amples proses narratives.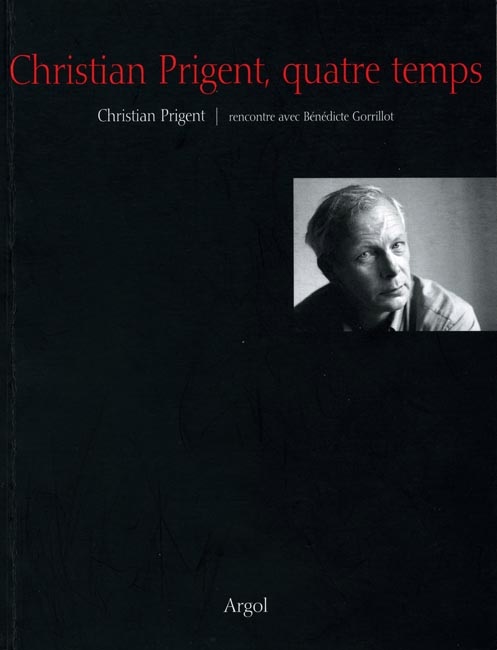
L’histoire de Commencement est aussi celle de tout homme contraint de transposer son existence en mots : « premier matin par où commencer bonjour mes beautés » (C, p. 11). La quatrième de couverture confirme cet objectif : « celui qui parle traite d’une difficulté comique à se dépêtrer de son propre tas, à naître, à parler, à entrer chaque matin dans la vie d’action, de conversation, de profession ». L’enjeu essentiel du roman est donc un enjeu d’expression : « c’est fait pour se muscler la langue : bousculades des souffles, contorsions rythmiques des sites syllabiques, roulements des phrases sur la déflation des scènes ravagées, exercices pour commencer, naître et dire : merci, je vis, j’écris, congé à la folie ! ». Dans ce récit, l’homme et l’écrivain se confondent souvent. Les « exercices » de « musculation » de la langue rappellent d’ailleurs les « exercices de rééducation verbale » par lesquels Francis Ponge, dans sa Rage de l’expression, s’efforçait d’atteindre la représentation juste des êtres du monde et fixait à la poésie ses objectifs.
Commencement énonce un programme littéraire qui dépasse largement les limites de ce seul opus. Avant ce roman, Œuf-glotte (1979) a imposé, en titre, comme thème central, ce double désir d’une langue (glotta, en grec, qui donne « glotte ») capable de se renouveler et de féconder, comme un « œuf », un « je » nouveau-né, re-né à une autre formulation de son être. Les récits postérieurs à 1989 réitèrent ce double pari : Une phrase pour ma mère (1996), Grand-mère Quéquette (2003) et plus récemment (et paradoxalement) Demain je meurs (2007). Le sommaire de Commencement prévient de l’éternel recommencement de ces tentatives réformatrices. Chaque chapitre est un « matin », un début, une « reprise et variation » qu’on numérote : « Premier matin (Pantomime des Mômes), « Deuxième matin (Le Cabanon des écorchés), […] Treizième matin (Vision de Rome) ». (C, p. 375).
Je propose d’illustrer cette « écriture du commencement », essentielle chez C. Prigent, par la lecture de l’incipit de Grand-Mère Quéquette. J’y montrerai comment l’auteur y réalise à nouveau une egophanie doublée d’une logophanie, tout en renouvelant les moyens de ces « apparitions » en langue.
DE COMMENCEMENT À GRAND-MÈRE QUÉQUETTE
Même scène de réveil
Les échos sont nombreux, entre Commencement et Grand-Mère Quéquette (POL, 2003 – GMQ). Les deux récits s’ouvrent par une scène de réveil. On a déjà évoqué le début du roman de 1989 : « Premier matin par où commencer bonjour mes beautés. Un pied puis l’autre dans la descente de ciel en peau de lit, c’est en poil d’ours qu’est ma pensée » (C, p. 11). Grand-Mère Quéquette s’ouvre par ces mots : « Tu dis que ?…………………… nerfs ? On sapant ?????? Tonnes ????? D’eau ????? Soleil ????? Ah non !!!!!!! ». La « table » des chapitres confirme cette thématique : « I. (Laudes) : impression, soleil levant ; !, p. 11 ; qui ?, p.15 ; moi, p. 18 ; eux, p. 20 ; réveil ou presque, p. 22 ; saut enfin du lit, p. 28 » (GMQ, p. 395). Prigent ménage l’entrée en scène progressive du « je » dont la voix propre (appropriée) va s’élever, petit à petit.
Cette parole du réveil qui réveille l’être à sa vérité reçoit le qualificatif de « laudes », du nom du chant religieux d’actions de grâce matinale. « Laudes » renvoie aussi à un type de discours poétique. Ce substantif rhétorique permet à l’auteur de souligner que l’enjeu de ce premier chapitre sera autant de « faire apparaître un sujet individué » que de faire apparaître une voix particulière, une langue inimitable (« logos ») qui fera sens. Et cette capacité à faire échapper à la « folie » constituera sa valeur littéraire. Les mêmes enjeux animaient déjà l’incipit de Commencement. À la salutation matinale, « bonjour mes beautés, ainsi tout a recommencé » (C. p. 12), succède cette exclamation du « je » : « pas si facile en fait de redémarrer les conjugaisons, les temps de l’action, la sortie des viandes hors des peaux de nuit […]. On se décrasse pas si illico ». Et il ajoute : « Si vous sentez pas cette difficulté, pas la peine de causer ». Pour qui parle le « je » ? Il s’exprime à la fois pour l’auteur qui précise les conditions de son écriture littéraire (dérouiller la langue et ses difficultés) et pour l’enfant du « passé recomposé, très simplifié » qui va participer aux « pantomimes de mômes », avec « Perrigault et le gros Broudic » (p. 16). Prigent ne qualifie pas d’un nom générique la prise de parole de ce « je ». Mais l’hypotexte sur lequel il écrit son incipit sert de signature générique. « Bonjour mes beautés par où démarrer » (p. 11), varié en « bonjour mes beautés ainsi tout a commencé » (p. 12), fait penser à un autre salut matinal à la beauté et à un autre cri de victoire verbale. Prigent réécrit Aube de Rimbaud (« j’ai embrassé l’aube d’été ») et glose la conclusion d’Alchimie du verbe : « je sais aujourd’hui saluer la beauté ». Ce patronage à peine implicite définit le terrain sur lequel l’écrivain se situe : celui de la poésie. Son ambition, dans Commencement, comme plus tard dans Grand- Mère Quéquette, est de réformer le langage humain et de s’obliger, lui, à renouveler son propre langage poétique, à l’image de Rimbaud.
Grand Mère Quéquette ou la surenchère de commencements
 Pourtant l’incipit de Grand-Mère Quéquette ne rejoue pas à l’identique le réveil de Commencement. C. Prigent y cumule, plus encore que dans le roman de 1989, les histoires de commencements. Dans Le Sens du toucher, l’écrivain évoque ces pages de 2003 : « elles sont chargées de faire naître, dans la vision d’un lever solaire, à la fois le mouvement de l’écriture, le rythme narratif, le personnage, le narrateur, etc. (le livre, en somme) » (Cadex, 2008, p. 34 – LST). Il faut remarquer que l’auteur parle de « naissance » plutôt que de (r)éveil. La substitution lexicale est peut-être motivée par la vieille association (venue de l’orphisme et relayée par Platon) de la mort au sommeil et de la naissance au réveil. Dans tous les cas, cette requalification fournit un avertissement précieux au lecteur. Comme dans le roman de 1989, dans l’incipit de Grand-Mère Quéquette, l’écrivain raconte un « commencement » dont on peut dédoubler la signification.
Pourtant l’incipit de Grand-Mère Quéquette ne rejoue pas à l’identique le réveil de Commencement. C. Prigent y cumule, plus encore que dans le roman de 1989, les histoires de commencements. Dans Le Sens du toucher, l’écrivain évoque ces pages de 2003 : « elles sont chargées de faire naître, dans la vision d’un lever solaire, à la fois le mouvement de l’écriture, le rythme narratif, le personnage, le narrateur, etc. (le livre, en somme) » (Cadex, 2008, p. 34 – LST). Il faut remarquer que l’auteur parle de « naissance » plutôt que de (r)éveil. La substitution lexicale est peut-être motivée par la vieille association (venue de l’orphisme et relayée par Platon) de la mort au sommeil et de la naissance au réveil. Dans tous les cas, cette requalification fournit un avertissement précieux au lecteur. Comme dans le roman de 1989, dans l’incipit de Grand-Mère Quéquette, l’écrivain raconte un « commencement » dont on peut dédoubler la signification.
Mais si, dans Commencement, le dédoublement se jouait entre le réveil des souvenirs d’enfance par l’auteur et la renaissance de l’auteur à sa vérité d’écrivain (être sans cesse capable de « recommencer » à saluer autrement la beauté), il reçoit une autre formulation, dans le récit de 2003. Dans Grand- Mère Quéquette, Prigent superpose deux nouvelles histoires : le réveil d’un enfant (l’enfant qu’il a pu être) et l’éveil malhabile d’un enfançon au monde des sons et des mots. À celles-ci, s’ajoute une troisième histoire : la renaissance de l’auteur. Toutefois, dans le roman de 2003 comme dans celui de 1989, les histoires de réveil(s) sont toujours symboliques des efforts déployés par un écrivain, pour renaître à chaque livre. Grand-Mère Quéquette cumule les commencements, mais complique la diégèse narrative, au delà de ce qu’avait déjà réalisé le premier livre POL. Tout se passe comme si le roman de 2003 relayait le récit de 1989, aggravant la technique de dédoublement narratif (non pas deux, mais trois histoires sont simultanément racontées) et prolongeant la narration au-delà des limites atteintes en 1989. Dans sa quête de la juste parole de l’homme et de l’écrivain, Prigent remonte, au delà d’une enfance située autour de 5-7ans, vers la petite, voire toute petite enfance : il remonte à l’origine de l’être, quasiment au jour de sa naissance.
La lumière intertextuelle de Commencement
D’une autre manière, Grand-Mère Quéquette ne rejoue pas strictement la même partition que Commencement − dont la recherche des intertextes est facilité par l’écrivain (dans CP4T, voir le tableau synoptique des pages 110-111). Le roman de 1989 s’ouvrait, sous les patronages conjoints de Rimbaud et de Diderot. Nous venons de reconnaître « Aube » et « Alchimie du verbe », convoqués en hypotexte. « La descente de ciel en peau de lit » (C, p. 11) est un autre emprunt à Rimbaud, cité en exergue à l’ensemble du roman : « Les calculs de côté, l’inévitable descente du ciel, et la visite des souvenirs et la séance des rythmes occupent la demeure, la tête et le monde de l’esprit » (p. 7). Par ailleurs, « La Pantomime des Mômes » dont Prigent sous-titre son « Premier matin », fait écho à la célèbre « Pantomime des Gueux » du Neveu de Rameau de Diderot. De Rimbaud, Prigent garde une plongée dans l’être sensuel et dans une nouvelle rythmique de la poésie : « je descends du lit, je sors fripé de la peau de nuit. J’écris commencement, j’écris dans le temps du pur étant encore envasé encore humidifié encore lié en moi à ce qu’huma moi avant d’être musclé habillé sorti du poil d’ours de la nuit » (C., p. 11). Cependant cette plongée se formule encore, comme dirait J.-L. Steinmetz, « en français impeccable » (entretien téléphonique du 22 février 2008). La syntaxe est certes chahutée, cisaillée par des coupes ou distendue par des tirets, parenthèses, discours inscrits, etc. ; mais, sur cette première page, les mots gardent plutôt leur intégrité lexicale. On relève des traces de patois familier ou de breton, mais peu d’attentats au signifiant (par des apocopes, ellipses ou redoublements futuristes de lettres, etc.). De Diderot, Prigent garde le souci d’un rythme prosodique, outré dans sa régularité répétitive. Il s’agissait, pour l’écrivain du 18e, de redoubler, dans la forme littéraire, le fonctionnement mécanique prévisible des sujets mis en scène (les postures des Gueux, devant le Grand qu’ils veulent séduire). Il s’agit, pour Prigent, de figurer, au plan du signifiant, les éclairs d’une conscience encore endormie et une pensée par flashes. Car « on se décrasse pas en si illico » (C, p. 12). D’où le halètement au souffle court des tétra-, penta- ou hexa-syllabes dominant la page d’incipit : « pre-mi-er ma-tin (5)/ par où com-men-cer (5)/ bon-jour mes beau-tés (5) un-pied-puis-l’autre (5)/ dans la des-cent(e) du ciel (6)/ en peau de lit (4)/ c’est en poil d’ours (4)/ qu’est ma pen-sée (4) j’ai chaud d’un(e) crass(e) de nuit (6)/ bon-jour mes beau-tés (5) par où démar-rer (5) » (C, p. 11). Au reste, l’auteur lui-même confirme sa prédilection pour ces rythmes basiques de la prosodie française (LST, 35).
La lumière intertextuelle de Grand-Mère Quéquette
Grand-Mère Quéquette s’ouvre sous le patronage de Monet et de Rabelais. Au peintre, C. Prigent emprunte le titre d’un tableau célèbre « Impression, soleil levant » dont il titre l’ensemble du premier chapitre. De Rabelais, il convoque, en hypotexte, le souvenir du chapitre 56 du Quart livre (1552) : « Comment entre les parolles geléees Pantagruel trouva des motz de gueule » :
Lors nous iecta sus le tillac plènes parolles gelées & sembloient dragée perlée de diverses couleurs. Noys y veismes des motz de gueule, des motz de sinople, des motz de azur, des motz de sable, des motz dorez. Les quelz estre quelque peu eschauffez entre nos mains fondoient, comme neiges & les oyons realement. Mais ne les entendions. Car c’estoit langage Barbare. [ …] Ce nonobstant, il en iecta sus le tillac troys ou quatre poignées. Et y veids des parolles bien picquantes, des parolles sanglantes, lesquelles li pilot nous disoit quelques foys retourner on lieu duquel estoient proférées, mais c’estoit la guorge couppée, des parolles horrificques, & autres assez mal plaisantes à veoir. Les quelles ensemblement fondues ouysmes, hin,hin, hin, hin, his, ticque torche, lorgne, brededin, brededac, frr, frrr, frrr, bou, bou, bou, bou, bou, bou, bou, bou, tracc, trac, trr, trr, trr, trrr, trrrrr, On, on ,on, on ououououon : goth, mathagoth, & ne sçay quelz autres motz barbares.
Les premières lignes de Grand-Mère Quéquette alignent des onomatopées, des borborygmes ou des barbarismes par lesquels l’auteur réduit les mots à une enveloppe graphique ou sonore et gèle toute possibilité d’accéder au signifié qu’elle recèle peut-être :
Tu dis que ?…………………… Nerfs ? On sapant ?????? Tonnes ????? D’eau ????? Soleil ????? Ah non !!!!!!! Hhhhhh !!! Hâle !! Rrrrr !! Mâche ! Mmmmmm ! Am ! Monte, Alma ! Mousse, mamme ! Falbalas ! Ffffff ! Schhhhh ! Quoi, schhhhh ? Sprint Serpents ? fuie d’Ourses, Cygnes, Chiens, Baleines, Lévriers, Taureaux ? Tohu & Bohu, tout beaux, hu-hu ! La paix, Chaos ! Des dents, c’est ça ? Qui crient : à bas l’Orsa ? Molaires dans chair putto [ …] Ah, blabla, prémices brouhaha ! Djà Barbirossa ? Khâmzim qui trépigne à Bab-el-Aoua ? (GMQ, p. 11).
Petit à petit, des sémantèmes se laissent reconnaître, des mots apparaissent : les termes latins « alma » ou « Orsa », les mots français serpents, ourses, cygnes, chaos, dents. Mais ils sont noyés dans une parataxe nominale qui empêche de les organiser en phrases. Ou bien leur possibilité de se prolonger en une isotopie signifiante est interrompue par des termes étrangers (l’arabe « khâmzim » et « bab-el-oua »). Les quelques signifiés que l’on parvient à identifier éclosent donc dans le « chaos » syntaxique le plus complet et ils évoquent un monde animal brutal, agressif, bref un monde « de gueules ouvertes et menaçantes », proche de l’« horrificque » bataille évoquée par les « motz de gueule » de Rabelais. Dans la suite de l’incipit, les « lambeaux » de « sable », de « céladon », de « cerise Tiepolo », de « garance », de « rubicond », de « dor[é] » « jaune de Mars » ou de « perle » (GMQ, p. 12) rappellent aussi le souvenir des paroles gelées, visuelles, de Rabelais.
Maturation d’un (re)commencement de l’écriture
 Le changement de patronage culturel fait changer la lumière de la scène du « commencement ». Rabelais met en avant la déformation de l’enveloppe signifiante des mots, en multipliant les courts-circuits rythmiques. Il n’hésite pas à pointer un doigt autoréflexif sur ce « langage barbare » qu’il fait entendre. L’écrivain du 16e témoigne d’une richesse lexicale que les réformes linguistiques engagées par les poètes de la Pléiade combattront, au nom d’un « françois pur » modelé sur le parler d’Anjou. En convoquant clairement l’hypotexte rabelaisien, C. Prigent veut de même insister sur « les motz barbares » et la matière linguistique non académique qu’il fait résonner dans Grand-Mère Quéquette. Mais, en adjoignant à Rabelais l’ombre de Monet, il souligne la charge hautement contestataire de ce parti pris linguistique. Au 19e, l’impressionnisme pictural de Monet fit scandale « trouant » les représentations du réel héritées de la Renaissance : « quand le soleil impressionniste se lève, dans l’inaugural tableau de Monet, c’est comme un trou rouge dans la surface opaque de la peinture ”d’avant” » (Ne me faites pas dire ce que je n’écris pas, Cadex, 2004, p. 11 – NMFPD). Prigent reprend à son compte cette charge scandaleuse passée et il annonce que, dans son récit de 2003, il poursuivra, pour le pousser plus loin, le travail (tripalium, tourment) de la langue engagé, dans Commencement. Est-ce parce qu’il aura fait l’épreuve que lui échappe l’être animal articulé à ce fatal besoin de tout symboliser et qu’il lui faut encore plus creuser la béance contradictoire de cette double nature ? Dans l’incipit de Grand-Mère Quéquette, l’écrivain produira des formes très contradictoires et assez déconstruites de la langue et du « je » qui rappellent ses expérimentations non narratives d’avant POL, contemporaines de son activisme avant-gardiste des années 70.
Le changement de patronage culturel fait changer la lumière de la scène du « commencement ». Rabelais met en avant la déformation de l’enveloppe signifiante des mots, en multipliant les courts-circuits rythmiques. Il n’hésite pas à pointer un doigt autoréflexif sur ce « langage barbare » qu’il fait entendre. L’écrivain du 16e témoigne d’une richesse lexicale que les réformes linguistiques engagées par les poètes de la Pléiade combattront, au nom d’un « françois pur » modelé sur le parler d’Anjou. En convoquant clairement l’hypotexte rabelaisien, C. Prigent veut de même insister sur « les motz barbares » et la matière linguistique non académique qu’il fait résonner dans Grand-Mère Quéquette. Mais, en adjoignant à Rabelais l’ombre de Monet, il souligne la charge hautement contestataire de ce parti pris linguistique. Au 19e, l’impressionnisme pictural de Monet fit scandale « trouant » les représentations du réel héritées de la Renaissance : « quand le soleil impressionniste se lève, dans l’inaugural tableau de Monet, c’est comme un trou rouge dans la surface opaque de la peinture ”d’avant” » (Ne me faites pas dire ce que je n’écris pas, Cadex, 2004, p. 11 – NMFPD). Prigent reprend à son compte cette charge scandaleuse passée et il annonce que, dans son récit de 2003, il poursuivra, pour le pousser plus loin, le travail (tripalium, tourment) de la langue engagé, dans Commencement. Est-ce parce qu’il aura fait l’épreuve que lui échappe l’être animal articulé à ce fatal besoin de tout symboliser et qu’il lui faut encore plus creuser la béance contradictoire de cette double nature ? Dans l’incipit de Grand-Mère Quéquette, l’écrivain produira des formes très contradictoires et assez déconstruites de la langue et du « je » qui rappellent ses expérimentations non narratives d’avant POL, contemporaines de son activisme avant-gardiste des années 70.
« Impression, soleil levant » : tableau d’une egophanie & d’une logophanie
Que raconte C. Prigent, dans l’incipit de Grand-Mère Quéquette ? L’éveil d’un « je » — corps, langue, et conscience —, le réveil d’un bambin et d’un auteur. L’écrivain remonte plus loin, dans le temps, que dans Commencement, pour mettre en scène ce triple (r)éveil. Cette complication du schéma narratif a pour conséquence de compliquer l’identification des sujets du livre. Dans Le Sens du toucher, l’écrivain commente l’incipit de Grand-Mère Quéquette, « chargé de faire naître […] le personnage, le narrateur, etc. (le livre, en somme) » (LST, p. 34). Ici l’énumération paratactique est ambivalente : elle peut suggérer une requalification (comme y invite « en somme ») ou poser une liste différentielle (comme l’indique « etc .»). Combien y a-t-il de personnages mis en scène, à l’ouverture de Grand-Mère Quéquette : trois ou un ? Prigent répond « trois et un » : trois, parce qu’un « je » nourrisson, un « je » enfant et un « je » adulte entrent simultanément dans la sphère de la parole ; un, parce ces trois « je » n’en forment qu’un seul. Ils sont trois formulations, à trois époques chronologiques différentes, de la même instance énonciative, c’est-à-dire de l’auteur Prigent.
Pourtant toutes trois n’ont pas le même degré de présence, sur la scène narrative. Si l’enfant briochain, petit-fils de « Grand Mère », occupe constamment le devant du récit avec le narrateur-écrivain, le « je » enfançon n’apparaît qu’à l’incipit. Mais il apparaît en premier. Il faut déchiffrer la leçon plus ou moins consciemment adressée par l’auteur à son lecteur. Le « je » du commencement (de la naissance, du balbutiement) est primordial. Il sert, de façon privilégiée, à figurer les autres (re)commencements de l’être : le réveil, chaque matin, à la langue (et à un corps) du « je » plus âgé du gamin et le réveil, à chaque livre, du « je » adulte de l’auteur. Par rapport à Commencement, ce choix narratif déplace l’accent sur le moment de la naissance et sur sa dynamique laborieuse. Dans l’incipit de 2003, C. Prigent renouvelle les modalités de l’égo-phanie, proposées en 1989.
Sauma-phanie/ sauma-sthésie
La naissance consiste d’abord en l’apparition factuelle (phanie) d’un corps (sauma). Elle est une épiphanie, une entrée visible, soudaine, de soi au monde. Mais il est, pour les psychanalystes, une seconde interprétation de la naissance au monde. D’ordre psychologique, elle correspond à cette période durant laquelle, au prix des pleurs, le nouveau-né fait l’apprentissage de la différenciation spatiale et matérielle. L’incipit de Grand-Mère Quéquette met en scène ce deuxième type de naissance. La tête de chapitre, « Impression, soleil levant », annonce le choix de cette focalisation interne. Le texte va raconter la conscience (sthésie) progressive d’un corps propre (sauma), distingué du grand corps du monde et séparé de la nuit d’où il émerge soudain.
Le monde nocturne de l’indifférenciation est figuré par les signes langagiers les plus confus : les signes ponctuations. L’incipit ne commence pas au « tu dis que ? » déjà cité :
… /…
!!!!!!!
???????
———-
!—- —-!?!?!?!?——- !
?????? Quoi ! !!!!!!!!
Tu dis que ?…… …… ……… Nerfs ? (GMQ, p. 11).
Ces ponctuations fonctionnent comme les traces sismographiques de l’activité primitive d’un cerveau. Les « ! » traduisent un choc, l’intensité d’un réveil physique brutal. Les « ? » marquent peut-être l’étonnement aveugle. Les « – » pourraient trahir une lacune de l’attention (le sommeil guette encore) ou des hésitations. Soudain un « quoi » articule, sur la langue, un son à ces possibles ressentis. L’être mis en scène par ces premières lignes apparaît d’emblée dans sa dualité : comme être sentant et comme capacité à lier ce ressenti à un langage. Le « quoi » marque donc ce premier moment où le bébé, cessant d’être mutique, se sépare du fonds de la nature. Le « quoi » marque surtout l’instant où la langue qui tétait animalement la chair a mué en langue humaine remodelant le monde en sons symboliques.
En effet « Alma » appelle, en réflexe culturel, « alma mater », la mère nourricière, qui est aussi, chez Lucrèce ou Virgile, la « Terre », la « mère nature ». « Mâche », rapproché de « alma » et de « mamme », évoque l’enfant à la mamelle, soit le stade « nourrisson » du bébé. Ce bébé-là infuse encore en son intérieur le « jus de pis », le lait du monde, à coups de langue animaux. Il fait toujours « corps » avec sa Mère (la Nature), c’est-à-dire qu’il est cette nature (« serpents, ourses, cygnes, chiens, baleines, taureaux » ou « chair putto », « baudruche », « téton », GMQ, p. 11) : « Gave ! Gave qui ? Pas mi ! Non moi ! Ni qui ni quoi ! ». Le trajet du lait maternel ne donne pas encore le sentiment d’un espace différencié et souligne, au contraire, la continuité d’étendue vivante existant du « je » à la mère. Pourtant, l’interrogation a fait surgir un pronom de première personne (« mi », « moi »), distingué de la troisième personne du monde (désigné par le « quoi »). Cette différenciation manque pourtant d’évidence, aussitôt niée par la voix narrative : « non moi, ni qui ni quoi ». Qui est alors nourri ? Le texte de Prigent répond par la non-personne indifférenciée du « ça ». Qui est « gavé » ? Personne, « sauf miam, miam, ça qui brame ».
Cette dernière réponse est capitale. Tout en hésitant à séparer le « je » du monde et en le réinsérant dans l’immense impersonnalité charnelle (le « ça »), l’auteur commence à le sortir (« sauf ») de la matière, par ce « brame », de suite requalifié en « blabla ». Ce bruit différent qui n’émane que de l’homme va mettre le monde en guerre avec lui-même. Il va instaurer la division de nature entre êtres non parlants (la matière brute, le lait nourricier maternel) et êtres parlants (le « je »). Ainsi « blabla » est-il « prémices de brouhaha ». Les mots de la langue symbolique annoncent donc l’individuation des êtres, en particulier du « je ». Celui-ci va prendre conscience des contours de son corps et de son individualité sensitive et il va chercher à nommer son identité personnelle.
Ego-phanie
Le texte de Prigent consomme cette logique séparatrice, née avec le langage articulé. À peine le narrateur désigne-t-il d’un pronom personnel (« moi ») celui qui parle, qu’il en interroge l’identité : « « Djà Barbirossa ? […] Auster pépère ? Galactea ? Rosabalba, c’est toi ? Rhodobava, on n’y croit pas ! Digitora, tu trottes déjà ? Galopes ? Voles ? Hop, hop » (GMQ, p. 11-12). Certes, le degré d’individuation du « je » est encore imparfait, réduit au sentiment vif d’une altérité par rapport au monde et traduit par l’autre personne grammaticale qu’est le « tu ». Quelqu’un parle qui n’est pas encore « moi » : il est « on » ou « tu ». Il dira enfin « moi », à la page suivante : « Qui oit ça ? Bernique bloc fait moi. Juste un tas qui sent. Quoi ? Jaillissements, mais lents » (p. 12). Par la vertu des mots articulés qui produisent un bruit différent du bruit naturel inarticulé des choses, « je » a séparé « un tas » de matière sensitive du reste sensible du monde. Désormais, « moi » a un corps propre. Le «jaillissement » de cette identité personnelle est « lent », mais continué. Quand « je » s’exclame à la même page « Perle, parle-moi longtemps en susurration », il se pose désormais en tant qu’interlocuteur du monde, face à lui. Il a fait l’épreuve suffisamment longue de son hétérogénéité à la nature.
Autour de l’« impression » de cette différence, va maintenant devenir visible ce qui séparait aussi corporellement le « je » du « il » du monde : une peau, des barrières de peau et de chair. Prigent écrit : « cligne pas, paupière, en tout cas pas trop, tiens bien ta visière, ouvre pas écluse, clos, récuse ! » (GQM, p. 12). Juste après, le « je » se reconnaît une « figure, bientôt visage » (p. 13). Puis une « gueule » qui « fait la gueule dans du tout froncé. La gueule c’est moi » (p. 14). Le don de la parole a permis au bébé d’isoler son corps propre et de commencer à en décrire l’enveloppe. Dans Ne me faites pas dire ce que je n’écris pas, C. Prigent a précisé que « corps est le nom du lieu où nous accueillons le monde [l’immense] et simultanément lui donnons congé » (NMFPD, p. 82). L’incipit de Grand-Mère Quéquette décrit à la fois ce lien qui nous unit au monde (nous avons bu à la mamelle de la nature le lait nourrissant toutes choses) et cette façon que nous avons eue, en tant qu’humains articulés à la parole, de nous séparer de ce fonds matériel indifférencié et mutique. C. Prigent résume l’historique de cette lente séparation, dans cette phrase : « Spasmes d’espèces d’espaces ? ça plairait assez d’y dégouliner. Tu le détendrais, onguent des gluons, le tordu de tripe. On se viderait du mauvais qui pue dans l’intestiné. Il serait pipi parmi les pipis. Je serait giclée filmée ralenti » (p. 13). Dans cet extrait, la stabilisation du « je » est encore fragile. « Il » égale toujours « je », comme en instruit l’accord du verbe, indifféremment à la 3e personne, qu’il accompagne un pronom personnel sujet de 1e ou de 3e personne. Mais, pour la première fois, « je » s’est posé comme le sujet d’un verbe d’état, indiquant la conscience réflexive, active, de son identité.
Logo-phanie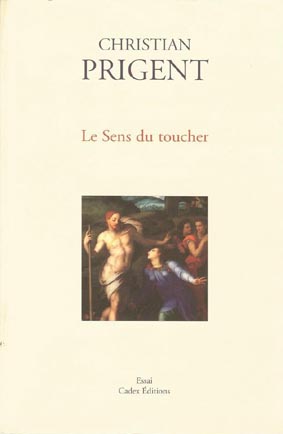
La langue symbolique favorise l’affirmation, face au monde, du sujet humain. Décrire ce langage humain (logos) et les phases de son apparition (phanie) permet donc de suivre les phases de l’egophanie. Dans Le Sens du toucher, C. Prigent commente ainsi la logophanie mise en scène par l’incipit de Grand-Mère Quéquette : « D’abord pure ligne de points, de barres, etc. ; puis bruit de syllabes non encore arrimées en net à du mot […] ; puis clous de syllabes injectées (oui ! quoi !) ; puis rafales exclamatives en traits litaniques, puis injonctions saccadées par segments, etc. Après ça s’agglutine, peu à peu ça coagule, les segments s’allongent (ça va dessiner : on passe à l’arabesque), les mots font presque des phrases, les rythmes se posent dans l’allure choisie (le pentasyllabe) : et voici les figures, la découpe est faite, le phrasé posé, tout est consommé (= tout peu commencer : un récit, une représentation, un chant — l’épos, logos…) » (LST, p. 36). L’unification du sujet autour d’un corps propre se trahit donc au plan linguistique par l’unification des mots autour d’une isotopie et par l’organisation de leur succession en phrase : « goûte ça, cul d’ange bio ! », « Rhodobova, on n’y croit pas ! » (GMQ, p. 11.). Plus le « je » affermit l’unité de son individualité, plus sa syntaxe s’enrichit et ses phrases s’allongent : « Perle, parle-moi longtemps en susurration ! Plumetis des anges, estompez ce ciel ! Essences ravies aux effloraisons d’avant toute vie, nimbez mes envies de rester au lit » (p. 12). À la moitié de la page 13, la modalité dominante est la phrase complexe, avec subordonnée(s), appositions et compléments circonstanciels : « Et ce bouffi-là qu’a pris un nuage, avec des ptits trous de noir clignotant et des nimbes de paille dans les roses encore empalichonnés : c’est quoi, dites, c’est quoi ? [ …] On dirait figure, bientôt dite visage, quasi Sainte-Face, en surimprimé dans du torchonneux » (p. 13).
Auctor-phanie
« Sainte Face » (GMQ, p. 13), « quarks », « plasma », « protons » (ibid.), « anges », « essences », « nimbez », « effloraisons » (p. 12) ou encore « Juno », « Yahvé », « Alephs », « Éole », « Borée », « Auster », « Galactea »(p. 11) obligent à conclure que le sujet peu à peu distingué de la nuit du monde est très savant. Il mobilise aussi bien le vocabulaire scientifique de la physique moderne (« quark »), de la biologie végétale (« effloraisons ») ou de la météorologie (« Borée », « Auster »), que les appellations des mythologies grecque (« Galactea ») et latine (« Juno) ou le lexique des religions judéo-chrétiennes (« Yahvé », « Sainte-face »). Il joue les clins d’œil littéraires érudits, « pour qui entend sous cape — sous les « Quoi ! Tu dis que ? Nerfs ? On sapant ? Tonnes ? D’eau ? soleil ? » — murmurer la bibliothèque tragique : « Tandis que Néron s’abandonne au sommeil ») » (LST, p. 35). Une pareille étendue du lexique invite à interroger, d’un peu plus près, l’identité du « je » ici mis en scène. Quel âge a-t-il ? Les onomatopées de la page 11 le situent à l’âge nourrisson ou bébé. Le vocabulaire familier et les phrases elliptiques (« couchés les molosses ! », « et ce con de coq en bas qui répond », GMQ, p. 13) le tirent vers l’enfance boudeuse et fragile face au grand Monde. Le lexique savant corrige l’évaluation vers l’âge adulte. L’ego qui apparaît, qui naît de ce langage profus et complexe, n’est autre que celui de l’auteur (auctor) qui totalise, dans cette prise de parole, tous les états des langues qu’il a parlées, depuis sa petite enfance bretonne.
 La description périphrastique de la peinture de Viallat, auquel C. Prigent a consacré un essai, Viallat, la main perdue, paru en 1996, agit comme une signature interne et du texte de l’incipit et de la voix ensommeillée surgie de la nuit : « C’est quoi ces boudins en ouate en forme de doigts qui tachent en rougeasse les lividités ? Ils ont trempé où, avant, dans quel sang ? Qui les a soufflés ? Qui les imprima dans les atmosphères comme main d’assassin sur le mur témoin ? Et ce bouffi-là qu’a pris un nuage, avec des ptits trous de noir clignotant et des nimbes de paille dans les roses encore empâlichonnés : c’est quoi, dites, c’est quoi ? » (GMQ., p. 13). Voici des extraits de l’essai dont une partie fut publiée, en 1978, en avant-première, dans le numéro 10 de TXT : « le travail sur la main, indique Viallat, a pris appui, en 1972, sur une visite à la grotte de Gargas (Pyrénées), où l’on peut voir des ”pochoirs de mains rouges et noirs restituant les différents types de mutilations données par Leroi-Gourhan comme langage” » (p. 79). « Soufflé » et « nuage » évoquent ces pochoirs préhistoriques ; « rougeasse » et « noir » indiquent leurs couleurs caractéristiques. « Les ptits trous de noir clignotant » renvoient à l’effet de clignotement produit par la répétition serrée et obsessionnelle du motif informe (tache, palette, haricot, empreinte de doigt ?) dont le peintre troue ses toiles et que Prigent évoquait, dans son essai : « le fameux « module » à l’allure de haricot spécifie la souscription « Viallat » et constitue l’élément lexical minimal de son œuvre. […] Viallat s’est expliqué sur sa genèse aléatoire : trace d’une éponge imbibée de couleur et pressée, puis rationalisation du procédé par utilisation d’une plaque de mousse en forme de palette (d’où le passage de bords flous et auréolés à des bords plus nets. […] Le module est transversal à toute figuration. Il est une forme sans forme » (p. 73).
La description périphrastique de la peinture de Viallat, auquel C. Prigent a consacré un essai, Viallat, la main perdue, paru en 1996, agit comme une signature interne et du texte de l’incipit et de la voix ensommeillée surgie de la nuit : « C’est quoi ces boudins en ouate en forme de doigts qui tachent en rougeasse les lividités ? Ils ont trempé où, avant, dans quel sang ? Qui les a soufflés ? Qui les imprima dans les atmosphères comme main d’assassin sur le mur témoin ? Et ce bouffi-là qu’a pris un nuage, avec des ptits trous de noir clignotant et des nimbes de paille dans les roses encore empâlichonnés : c’est quoi, dites, c’est quoi ? » (GMQ., p. 13). Voici des extraits de l’essai dont une partie fut publiée, en 1978, en avant-première, dans le numéro 10 de TXT : « le travail sur la main, indique Viallat, a pris appui, en 1972, sur une visite à la grotte de Gargas (Pyrénées), où l’on peut voir des ”pochoirs de mains rouges et noirs restituant les différents types de mutilations données par Leroi-Gourhan comme langage” » (p. 79). « Soufflé » et « nuage » évoquent ces pochoirs préhistoriques ; « rougeasse » et « noir » indiquent leurs couleurs caractéristiques. « Les ptits trous de noir clignotant » renvoient à l’effet de clignotement produit par la répétition serrée et obsessionnelle du motif informe (tache, palette, haricot, empreinte de doigt ?) dont le peintre troue ses toiles et que Prigent évoquait, dans son essai : « le fameux « module » à l’allure de haricot spécifie la souscription « Viallat » et constitue l’élément lexical minimal de son œuvre. […] Viallat s’est expliqué sur sa genèse aléatoire : trace d’une éponge imbibée de couleur et pressée, puis rationalisation du procédé par utilisation d’une plaque de mousse en forme de palette (d’où le passage de bords flous et auréolés à des bords plus nets. […] Le module est transversal à toute figuration. Il est une forme sans forme » (p. 73).
L’incipit de Grand-Mère Quéquette fait donc paraître (naître), à l’attention des lecteurs, trois sujets superposés. Au plan de l’énoncé, un « je » bébé naît en accéléré à la parole et à la conscience de son corps et un « je » enfantin peine à se réveiller. Au plan de l’énonciation, le « je » complexe de l’auteur choisit de reprendre à nouveau la parole, mais sur de nouveaux frais esthétiques. L’étude plus détaillée du « logos » qu’il mobilise alors permettra de saisir quel recommencement du langage il a tenté, dans ce roman de 2003. Elle permettra de saisir le sens de l’étonnante fin de cet incipit.
« SE MUSCLER AUTREMENT LA LANGUE » : UN EXERCICE DE RÉÉDUCATION VERBALE
En effet, le paradoxe de cette scène de « commencement » est qu’elle s’achève sur l’invalidation immédiate de la langue qui a paru dire l’être. À peine la phrase s’allonge-t-elle et modèle-t-elle le « visage » du « je », que le tout neuf sujet fait marche arrière et se récrie : « À poil, pas encore, pitié, vérité ! Pose pas de couleurs, l’aurore ! Aquarelle rien avec du ligné où sauter marelle ! Repeins rien en plus ! Esquisse à l’efface ! Nettoie ce qu’était, plutôt, dépoussière ! Dénude à l’acide ! Lave la couche en trop ! » (GMQ., p.14).
Critique du langage
« Lave la couche en trop » indique que ce « commencement à être » s’accompagne d’un « commencement à défaire ». Car le langage qui semblait l’allié de l’humain se révèle son ennemi. Pourquoi ? La langue symbolique l’écarte de sa vérité vivante, « l’être à poil » et « l’être-ours » de la page 11 : il le recouvre d’une enveloppe de mots et d’artifices verbaux (« couleurs », « aquarelle », « marelle », GMQ, p. 12). Le langage lui fait aussi oublier l’impression de « sa durée continue » par l’analyse, en mots, en lignes logiques (« le ligné »), de son vécu sensoriel. Dans un sursaut réflexif, le « je » s’adjure de revenir à ce « qu’il y avait » (p. 14), avant les mots. « Et il y avait quoi ? Du qui fait la gueule dans du tout froncé. La gueule c’est moi ». Toutefois, ce retour réflexif n’est pas le fait du « je » nourrisson, ni même de l’enfant, mais de l’auteur dont la profession est cette inquiétude réflex(iv)e de la langue.
Le début de Grand-Mère Quéquette contient donc une critique de la parole à la disposition de l’homme. Cet outil merveilleux (sans lequel il n’aurait pas conscience de sa particularité humaine) est aussi désastreux. Il dresse un « mur » entre la nature et le sujet parlant. « Je » se met à verbaliser, beaucoup. Il donne des « précisions » (GMQ, p. 13), il se mue « en giclée filmée ralenti ». Mais c’est, en réalité, pour « pose[r], plaf, un écran total » : « Ouille ! les précisions ! Boum, panneau pétant de déclarations ! Ça s’appelle réel, paraît, ce frontal de lamentations. Sûr que je il va se cogner de dedans, même si en grabat s’autruche extraplat ». C. Prigent lâche ici le mot par lequel il désigne notre être-au-monde : « le réel ». Il l’entend comme la matière corporelle qui échappe à ces tentatives de mise en forme par les langues symboliques. Il reprend à Lacan cette définition : « le réel est ce qui commence là où le sens s’arrête » (NMFPD, p. 7). Le réel est ce qui résiste au langage et se définit, de façon négative, par la somme des plaintes alors exhalées par le sujet humain, insatisfait de ses moyens d’expression.
C. Prigent laisse très vite entrevoir que cette conscience négative mine le « je » de Grand-Mère Quéquette. Que signifiait son souhait d’être « sans rien qui plisse, crispe, lance, pense ou manigance » (GMQ, p. 13) ? Le narrateur énonçait son désir de renoncer aux manipulations verbales qui, certes, produisent de la pensée, mais crispent l’être et lui font oublier l’évidence foisonnante et sauvage de sa sensibilité première. Les onomatopées du choc brutal (« boum ») et de la douleur (« ouille ») traduisent l’instant de lucidité et de déconvenue. L’on comprend alors un peu mieux, ce qui a paru contradictoire en page 12 : au moment où le sujet s’exhortait à la différenciation par le langage (« feulez mélopées ! Bêle, mélomèle ! Meugle homélie », p. 12), il travaillait à repousser l’avènement de ce langage et il le maintenait dans un état proche des cris animaux (« feulez », « bêle », « meugle »). Percevant son exil, hors du fonds du monde, il cherchait à le retarder : « Doucement ! Un peu de temps encore, pour le frais fumé ! […] Précise-toi pas, biaise ! [ …] Retiens la nuit, cuir évanoui ! »
Sur-arbitraire du signe
Une fois posée l’impropriété de la langue symbolique, l’auteur fait tout pour la rendre immanquable au lecteur et il outre l’artifice de ses développements verbaux. Le titre du premier chapitre promet, à qui connaît le tableau de Monet, une aube et un lever de soleil indécis, entre brumes et reflets aquatiques. Or, les premiers substantifs déchiffrables par le lecteur affichent leur hors sujet, par rapport au thème annoncé : chiens, serpents, dents, ourses, molaires dans chair putto, téton (GMQ, p. 11). Il faut attendre la page suivante pour que le texte semble se raccrocher au sujet coloré impressionniste : « pas de dessin ! Des ombres de chine ! Du suinté chuinté ! Du vague ! Du baveux ! Des bords ? Un nord ? Un décor ? Pitié, pas encore ! frottis de fresques ! Barbouilles de gouaches ! délices du presque ! » (p. 12). Mais le mal est fait : la parole de l’écrivain a commencé aux antipodes de la matière sensuelle qu’il était censé exprimer. Certes, l’auteur offre ensuite un bel exemple d’ekphrasis. Il évoque la pratique divisionniste de Monet qui a fait exploser l’unité de la touche de couleur, en « bouillons d’yeux des ions », en « essaims de machins » ou en « plasma gravitons » (p. 13). Mais l’utilité de cette description d’art reste problématique. Car de quoi est-il question, dans ces trois premières pages ? On y traite du réveil un peu brutal d’un sujet. Après une nuit de sommeil, celui-ci renaît à la conscience de soi et au langage : « Essences ravies aux effloraisons d’avant toute vie, nimbez mes envies de rester au lit ! Cligne pas paupière, en tout cas pas trop, tiens bien ta visière, ouvre pas écluse, clos, récuse » (p. 12). Les yeux maintenus clos ôtent logiquement toute possibilité de décrire le monde extérieur. Or, les lignes précédentes ont offert un compte-rendu visuel du monde matinal, mis en scène par Monet. Ces contradictions flagrantes obligent à comprendre que le propos de Prigent n’a jamais été de produire une description vraisemblable de l’aube entourant le « je », pas plus qu’elle n’a été d’offrir un exemple de l’usage pertinent de la parole humaine. Celle-ci tombe toujours mal, à contre temps et en hors sujet, quand elle ne fausse pas le sujet à décrire.
Quel « soleil » l’incipit de Grand-Mère Quéquette fait-il donc se lever ? Celui du « commencement » d’un douloureux constat. Le langage symbolique, censé conduire l’humain à sa pleine existence d’individu parlant, le voue, en réalité, à s’exiler hors de son être primitif, animal et sensoriel.
Ut pictura poiesis ?
Alors, pourquoi parler, si la langue conduit le sujet à sa perdition plus qu’à sa construction ? Pourquoi publier, quand on est écrivain, si c’est pour produire de nouveaux exemples de l’aporie de la parole humaine ? C. Prigent écrit et publie, malgré tout, Grand-Mère Quéquette, parce qu’il tente une réforme de cette parole déficiente. Dans l’incipit, sa rénovation passe par la convocation de la peinture en poésie.
Le titre du chapitre I, emprunté à Monet, prévient, en avant-texte, de cette promotion. La peinture surplombe l’écriture de Grand-Mère Quéquette. Dans l’incipit, Prigent cumule les références picturales. Certes « Tiepolo » et « véronèse » (GMQ, p. 12) sont donnés par l’auteur comme des adjectifs de couleur (cf. LST, p. 17). Mais la majuscule de Tiepolo fait aussi bien penser au patronyme du peintre vénitien du 18e. Ce souvenir invite alors à supposer la présence conjointe de Véronèse, auteur, au 17e, de Noces de Cana, tous deux remarquables pour leur fourmillement de couleurs. Juste après « dore pas encore jaune de Mars, tamise ! » paraît évoquer, par calembour sonore, le fleuve londonien et un autre tableau de Monet : « Vue de la Tamise ». L’artiste y a usé en abondance des rouges et violets et il a dégradé ses teintes jusqu’aux gris ombreux, près des bordures du cadre. La suite du texte semble d’ailleurs quitter « Impression, soleil levant », pour se livrer à une ekphrasis de ce second tableau : « Gare la transe, garance, laque pas rubicond ! Amande, oins le monde encore de douceurs ! Retiens la nuit, cuir évanoui ! Luis, lilas, mais peu pruineux ! Parme, calme les vacarmes à venir violets ! frôle, olivargent, frise à peine l’opale ! Fondez pas encore cendre, bistre, restes de suie » (GMQ, 12). À la page suivante, l’écrivain convoque le souvenir de peintres plus proches de lui, dans le temps. « Les tracés d’anti-sorte », les « transes d’absence de genres », ou autres « spasmes d’espèce d’espaces » (p. 13) imposent le souvenir du « dripping » de Pollock — cet art de faire dégouliner, goutte à goutte la peinture sur la toile. De même, « Wwouwww, le rouge, au fond ! Un spot, plop ! Cri du carmin ! Gicle jus d’incarnat » (p. 12) retranscrit verbalement la vitesse fulgurante du jet de couleurs, propre à l’action painting du même Pollock. Après l’Américain, Prigent évoque aussi le français Viallat.
Il ne suffit pas de constater l’extrême présence de l’intertexte pictural, dans le commencement de Grand-Mère Quéquette. Il faut encore en comprendre la fonction. Tous ces peintres ont, à leur façon, « troué » les représentations convenues du réel et de l’humain. Monet a fait exploser la perspective, patiemment conquise par Masaccio. Pollock a fait perdre à la touche colorée de Monet son aplat maîtrisé. Viallat a ramené la production artistique humaine à la foulée de pas animaux et à des traînées de mains sur d’humbles supports quotidiens. Dans son roman, C. Prigent ne reprend pas (ou peu) les procédures techniques propres à ces contestations plastiques. Dans Le Sens du toucher, il rappelle que « le rapport à la peinture ne saurait être que de compagnonnage métaphorique » (LST, p. 35). L’écrivain ne reprend aux plasticiens que leur charge critique et leur capacité à ébranler les conformismes d’expression. Pour lui, « les peintres élus […] affinent le goût, […] aident à mieux voir le monde, à mieux cerner les enjeux de sa représentation et des limites de cette représentation ; [ …] ils [ont] une capacité à mettre la peinture en crise ([ …] on l’a dit de Caravage, comme des impressionnistes) » (LST, p. 36).
Pourtant, l’on commettrait un contresens, en ne voyant dans Grand-Mère Quéquette qu’une déconstruction de la positivité du langage humain. Car la peinture offre aussi à la langue de s’amender. Son évidence sensorielle apporte à la parole conceptuelle abstraite un peu de la pulpe des choses. Dans Ne me faites pas dire ce que je n’écris pas, C. Prigent rappelle que « peindre, c’est croire voir et toucher un peu » (NMFPD, p. 48). L’auteur remet du corps et du simultané dans les signes littéraires. Il rompt l’écran blanc du discours articulé, en y projetant à nouveaux l’ombre, la forme et la chair colorée des corps phénoménaux. Ainsi le « je » qui veut ralentir son exil, hors du tuffeau des choses sensibles, prend-il le temps de décrire la robe couleur de « sinople, de « garance » ou de « nuit » des êtres extérieurs. Et, dans le « torchonneux » de leur matérialité, il prendra le temps de saisir leur vrai « visage » (GMQ, p. 13). À la fin de l’incipit, « l’écran miroitremblant dit firmament » (p. 14) désigne cette parole plasticienne où « moi opine à je », c’est-à-dire où l’être-de-langue se réconcilie un peu avec son être-de-viandes.
Ut in-fantia poiesis ?
« Moi opine à je » (GMQ, p. 14) suggère une autre voie remarquable utilisée par C. Prigent, pour amender la langue adulte coupée du vivant de l’être. Il s’agit de ce que nous proposons d’appeler « la langue-bébé » ou langue de l’in-fans. Cette langue-bébé se définit comme une régression linguistique, hors des normes de la correction lexicale et syntaxique assimilées (et mobilisées) par l’adulte. Elle se signale par la corruption sonore et graphique des signifiants, par des solécismes grammaticaux, voire par une asyntaxie (anacoluthes, parataxes). Toutes ces « fautes de langue » sont commises dans la petite enfance et l’école entreprend patiemment de les éliminer. Dans l’exemple plus haut cité, deux solécismes rendent fautive l’expression. Primo, le pronom personnel « moi » est improprement mis en position (et en fonction) de sujet, alors qu’il ne peut être utilisé que pour un complément (d’objet ou circonstanciel). Secundo, le pronom « je » est improprement mis en position de complément d’objet indirect alors qu’il ne peut que servir de sujet au verbe de la phrase. Tout se passe comme si le « je » avait mal appris sa leçon et inversé les positions correctes des pronoms. Le résultat est une impropriété maximale de l’expression, produisant un « effet d’enfance ». Au registre des déformations enfantines que Prigent fait subir à la langue, dans Grand-Mère Quéquette, il faudrait ajouter l’emploi des jargons familiers (« cul », « con », « pépère », « pipi »), des patois (gallo) et langues régionales (le breton : « emmi », « itou »), des écholalies sonores (« Avel le véloce ») et autres rimes intérieures ludiques (« Auster pépère ») copiées sur les « t’la dit bouffi » et autre « à l’aise Blaise » des cours d’écoles.
Les agglutinations paratactiques de vocables, déjà vues en première page (« Tohu & Bohu, tout beaux hu-hu ! La paix, Chaos ! », GMQ, p. 11), aggravent l’impression de régression, vers la toute petite enfance et le parler-bébé. La langue de l’in-fans, c’est-à-dire étymologiquement du petit de l’homme encore incapable (in-) de parler (-fans), ignore la syntaxe et la notion de construction de phrase et elle multiplie les malformations lexicales. L’in-fans babille, bredouille et bégaie des sons (« Mmmmmmm ! Am ! »). Il essaie des mots simples (« mamme ! », « Mâche ! ») et il ne les profère que sur la modalité du jeté intensif paratactique : « Hâle !! Rrrrrrr », « Mâche ! Mmmmmm ! ». La langue du bébé semble expulser les sons et les mots comme les autres muscles de son corps éjectent animalement, aveuglement, humeurs, fèces et urines.
Cette proximité d’expression a conduit C. Prigent et ses amis de TXT à situer, dans l’analité, cette langue-bébé du corps animal. En 1978, dans le numéro 10 de TXT (L’ÉcRiT, Le CacA), il rappelait que « Hollos a fait l’hypothèse de l’investissement des occlusives vélaires à la base du langage enfantin. Cette hypothèse est fortement corroborée par le rapport fonctionnel des deux sphincters du tube gastrique. La fermeture glottique émet une forte pression sur le diaphragme et indirectement sur les intestins […et] pourrait [s’]articul[er] [au] produit fécal » (TXT 10, p. 2). La langue-bébé qui renvoie l’être humain au « stade anal » de son existence permet à l’écrivain de figurer un état linguistique idéalement proche de ce corps pur sentant, « pur moi qu’huma moi, avant d’être […] habillé [de mots d’adultes] » (C, p. 11). Cette langue de l’infantia est donc pour Prigent « la langue qui merdRe », de « ceux qui font merder l’harmonie fade, la propreté soignée » coupées du corps aveugle, puant et vivant (Ceux qui merdRent, POL, 1991, p. 307). Cette langue-bébé recouvre le « parler grand-nègre » de J.-P. Verheggen, « plus particulièrement lié au vitalisme pulsionnel » et érigé comme idéal d’un nouvel « art poétique violent » (cf. Ridiculum vitae, 1990 ; Folio, 2001, p. 25 et 21). Dans l’incipit de Grand-Mère Quéquette, le « je » éructe en abondance des mots liés à l’analité. On peut relever, en vrac : « jus de pis », « cul », « fuite crachin [d’un] téton » et « galactea » (du grec gala) (GMQ, p. 11) qui évoquent le lait maternel ou le sperme échappé des « nerfs » ; puis, «foutre et pluie », « suinté shuinté », « oublis ! tentations ! Pâmoisons ! », « ça va fuser ! » et un « splot, plop » (p. 12) très spermique ; enfin, à la page 13, une « soupe glu », un « plasma », des « étrons », du « pipi parmi les pipis ». Ce lexique ancre fortement dans l’analité la langue de l’infantia et figure la voie d’un salut littéraire : « ça me plairait assez d’y dégouliner. […] On s’y viderait du mauvais qui pue dans l’intestiné. Il serait pipi parmi les pipis. Je serait giclée filmée ralenti. Pur jus, flux emmi les flux […] sans rien qui plisse, crispe […] ou pense » (GMQ, p. 13).
Conclusion
L’incipit de Grand-Mère Quéquette répète, en la variant, la leçon de Commencement. C. Prigent y recommence la critique du langage humain qui ne touche plus assez « l’immense, l’équivoque » corps nous constituant. Mais, plus rapidement qu’en 1989, parce que dès le tout premier chapitre, il propose de l’amender par la langue-bébé, plus proche du corps pur-sentant, et par la peinture . Cependant, l’écrivain ne copie pas (ou peu) les techniques d’expression propres aux peintres. Il transfuse juste, dans l’écrit, leur charge corrosive et leur puissance sensuelle. Le référent pictural lui sert donc plus à figurer un amendement sensible possible du langage conceptuel qu’il ne procure à proprement parler une matière sensitive aux mots. De même la langue-bébé sert à figurer ce retour rêvé à l’avant-langue, mais elle n’en atteint jamais la pureté. « Sale temps dit ma tête » (GMQ, p. 14) vient alors logiquement conclure la fausse aurore linguistique levée en incipit. Oui, « sale temps ». Car, quiconque veut se refaire une identité linguistique et refaire le monde en langue, a plus de chance de le perdre que d’en gagner un savoir plus intime. L’écrivain pose alors l’ultime question : « mieux vaudrait dire non » ? Non, car ce serait définitivement renoncer à écrire la vie et accepter « la folie » dénoncée en Commencement.
![[Manières de critiquer] Territoires du roman contemporain : Prigent, l'écriture du commencement, par B. Gorrillot](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)