 Dans la rubrique "Le roman contemporain : trajectoires et territoires", qui, depuis le début d’année regroupe une présentation et des articles sur Lucien Suel et Christian Prigent, Libr-critique a le plaisir d’inscrire cette réflexion bataillienne qui opère le dépassement des antinomies lisible/illisible et poésie/roman pour cerner ce que peut être une écriture de l’impossible : le troisième chapitre, intitulé "Écriture et liberté", du court essai que Bernard Desportes va publier en 2010. Rendez-vous sur Publie.net en septembre pour le volume numérique autour de Bernard Desportes.
Dans la rubrique "Le roman contemporain : trajectoires et territoires", qui, depuis le début d’année regroupe une présentation et des articles sur Lucien Suel et Christian Prigent, Libr-critique a le plaisir d’inscrire cette réflexion bataillienne qui opère le dépassement des antinomies lisible/illisible et poésie/roman pour cerner ce que peut être une écriture de l’impossible : le troisième chapitre, intitulé "Écriture et liberté", du court essai que Bernard Desportes va publier en 2010. Rendez-vous sur Publie.net en septembre pour le volume numérique autour de Bernard Desportes.
Je veux être ici-bas libre, ailleurs responsable,
Je suis plus qu’un brin d’herbe, et plus qu’un grain de sable ;
Je me sens à jamais pensif, ailé, vivant.
Hugo
La littérature même
Transgression du possible, du communément admis, la littérature a, pour sa plus belle part, la tâche singulière d’aborder l’indicible, l’innommable, l’insoutenable : l’inhumain qui est l’autre versant de nous-mêmes, cette part noire qui nous constitue comme homme : humain/inhumain.
Elle est l’envers asocial et subversif d’un être par ailleurs soumis à la pensée commune que nul, évidemment, n’évite – fût-ce dans la honte de cette soumission –, envers qui en est tout à la fois, de cette pensée commune, la négativité et le refus : la part inhumaine, part irréductible en nous d’une langue étrangère à la langue de communication, à la langue maternelle, admise, évidente, consensuelle.
La littérature n‘est grande que lorsqu’elle fait entendre cette langue étrangère, à la fois singulière et porteuse d’un autre en nous – souffle même de l’angoisse – qui la rend doublement inacceptable, et emporte, singularise, subvertit la langue commune ; elle n’est grande que lorsqu’elle fait entendre en contre la langue d’apparence, nulle en réalité, une langue de rupture en désaveu de la langue de socialisation.
Expression de ce qui nous fait unique et inachevé (vivant donc), cette langue étrangère, ou plus exactement cet abîme étranger au sein de la langue même, fait alors entendre ce qui en nous est uniquement nous-mêmes dans le refus de tout amalgame et de toute assimilation. Versant autre au versant acceptable, versant noir de notre abîme d’être, c’est la vraie réalité de notre liberté : part qui échappe à tout devenir socialisé, elle est subvertion de cette représentation éculée qu’est la langue de tous, la langue académique, pauvre fabricant des imaginaires de concession, agent reproducteur d’un monde déjà vécu, déjà pensé, déjà mort.
 Le jaillissement d’une langue nouvelle qui vient ébranler la langue acceptée pour tenter de combler le manque, le vide, cette place laissée vacante au sein de notre dimension réelle, exprime un innommable, un impensé, et apparaît comme une menace, une révolte contre ce que les hommes ont en partage. “Cette révolte, dit Bataille, est celle du Mal contre le Bien”. La littérature n’est grande que si elle sait faire entendre cette part noire, ce mal, cette voix inhumaine comme le versant contraire indissociable du versant positif de notre humanité.
Le jaillissement d’une langue nouvelle qui vient ébranler la langue acceptée pour tenter de combler le manque, le vide, cette place laissée vacante au sein de notre dimension réelle, exprime un innommable, un impensé, et apparaît comme une menace, une révolte contre ce que les hommes ont en partage. “Cette révolte, dit Bataille, est celle du Mal contre le Bien”. La littérature n’est grande que si elle sait faire entendre cette part noire, ce mal, cette voix inhumaine comme le versant contraire indissociable du versant positif de notre humanité.
Cette exigence seule est expression du vrai en littérature – ce “vrai” étant finalement dans ce que le chaos d’une langue singulière à l’œuvre exprime du chaos de nous-mêmes, de notre dualité paradoxale, de cette “révolte du Mal contre le Bien” – expression de la littérature même.
Tout le reste en littérature n’est que décors, routine, talent, vieux monde, mondanité, langue morte. Rien qui provoque une suffocation de l’être dans la démultiplication de son angoisse et de ses désirs, dans l’explosion de son imaginaire, rien qui provoque l’enivrante sensation – fût-elle fugace – d’une adéquation de l’être et du monde, l’appréhension fulgurante de soi et du temps.
Cela ne peut qu’être hors du monde rassurant, policé, acceptable que transmet une littérature qui bannit autant qu’elle le peut le dit et les enjeux de l’unité paradoxale et de l’affrontement sans espoir de la vie et de la mort en l’homme ; hors donc d’une littérature qui évite à tout prix de s’emparer de la tragédie de l’espèce humaine telle que celle-ci peut se livrer par et à travers une langue ouverte et toujours renouvelée qui porte seule la tension toujours singulière de ce drame et en annonce seule la dimension unique.
Ce n’est pas en effet dans ce “tout le reste” évoqué plus haut, dans cet ersatz de langue, dans cette para-littérature que se joue la tragédie de l’homme et l’enjeu des interrogations de sa pensée – le champ de cette tension étant précisément celui de la langue, dans ses explorations permanentes et à travers l’expression de son combat chaotique contre les conventions de la pensée morte, pour la libre approche de nos limites.
La seule “vérité” sera dès lors, on le comprend bien, la liberté infinie de l’expression dans l’affranchissement des limites de la pensée. L’enjeu de cette liberté c’est le pari de tout dire “à quelque point qu’en frémissent les hommes” (Sade). Ce pari étant l’aventure d’une pensée de l’homme au présent, dans la splendeur singulière de l’équilibre fragile qu’ouvre la “liberté libre” (Rimbaud) – celui d’une marche sur la voie étroite, inévitablement périlleuse, entre deux menaces mortelles pour la pensée :
– la soumission apeurée et défaitiste à un ordre totalisant (qu’il soit philosophique, religieux ou politique) qui la muselle ;
– l’abandon monstrueux à ses tentations animales.
C’est dans l’acceptation de ce pari, dans la conscience de ces menaces et la volonté d’en explorer les abîmes que se joue la liberté de la littérature.
Au bord de toute compréhension
Nous savons, pour en faire tout au long de notre vie l’expérience, que “la pensée pense ce qui la dépasse infiniment”, selon la belle expression d’Evelyne Grossman.
Le “ce” que je souligne ici est cela même qui envahit notre pensée et la propulse “au bord des limites où toute compréhension se décompose”, ce qui est tout à la fois le lieu de notre plus grande angoisse et ce qui nous force et nous impose d’écrire. Lieu où s’affrontent vie et mort, où s’exprime l’impossible d’une perpétuelle tension entre plusieurs pôles distincts qui s’opposent et se contredisent mais sont indissociablement et nécessairement liés : totalité/liberté, possible/impossible, monde/antimonde, achevé/inachevé, fini/infini… Lieu où s’exprime dans toute sa violence notre inaccessibilité au monde et seul lieu cependant où il semble parfois possible de saisir ce qu’est notre être réel dans l’insaisissable réalité du monde. Cette “présence dans la pensée de ce qui déborde la capacité de penser” (Grossman) est aussi, par l’impossibilité même de la traduction cohérente et sensée qui en découle, un impossible dire. Or l’écriture c’est cela : le dit d’un impossible dire dans lequel et par lequel résonne au plus profond ce que notre être a à vivre au-delà des compromis, des soumissions et des vaines cohérences du vécu possible. Ecrire, c’est habiter ce lieu d’un impossible vécu : vivant partout et présent nulle part.
 Loin donc d’un loisir sans enjeu ni conséquence où l’écrivain ne s’engage que par projection, le lecteur que par identification, l’écriture est alors cette expérience de l’extrême où se perdent toute référence fondatrice et toute possibilité d’abri protecteur. C’est, avec cette mise en danger de soi, une mise en jeu et en cause de notre relation au monde.
Loin donc d’un loisir sans enjeu ni conséquence où l’écrivain ne s’engage que par projection, le lecteur que par identification, l’écriture est alors cette expérience de l’extrême où se perdent toute référence fondatrice et toute possibilité d’abri protecteur. C’est, avec cette mise en danger de soi, une mise en jeu et en cause de notre relation au monde.
Une telle mise en jeu implique cependant de ne pas quitter le récit, jusque dans le pensable/impensable, de l’aventure et des interrogations humaines. Or la tentation est grande de traduire cet impossible dire dans une écriture qui, parce qu’elle aura basculée dans l’absolu de l’infini, deviendra illisible (il en va ainsi de Finnegans Wake au Livre de Guyotat). Mais l’illisible, en déniant au signifiant toute valeur et à l’homme toute possibilité dans sa quête d’infini, bascule irrésistiblement, irréversiblement, absolument du côté du non-sens ; il évacue la dualité sens/non-sens qui, dans l’angoisse, est le moteur de notre pensée du monde, le creuset même de l’écriture de l’impossible.
L’illisible, en faisant du texte une totalité et de l’écriture une énigme morte, répond à nos interrogations par une fin de non-recevoir – l’écriture devenue illisible se situe hors du monde et ne répond plus, fût-ce dans le paradoxe, aux enjeux mêmes qui sont ceux de l’écriture : la trace la plus réelle, humaine/inhumaine, du passage de l’homme. Le “bord des limites” n’est pas “le pas au-delà”.
Ecrire est ainsi faire se confronter l’être à son manque d’être, cela ne permet ni de se (re)trouver ni, moins encore, d’atteindre une hypothétique réalité qui existerait à nous attendre de toute éternité – c’est au contraire se confronter directement à la violence de ces deux impossibles, c’est en exprimer l’indicible unité.
Ecrire est ce faisant ouvrir à la pensée un champ vertigineux où se risque à chaque fois l’essence même du langage, c’est-à-dire la pensée de soi et du monde et, au-delà, la pensée de l’être comme être, inachevé, insaisissable. C’est offrir à la pensée “en même temps que le sens de la profondeur d’un gouffre, celui d’un essor” (du Bouchet), gouffre/essor insondable où la pensée se confronte, dans la parole et l’écriture mêmes, à l’inconnu sans recours d’un présent sans cesse à réinventer pour, l’espace de la vision d’un abîme, le faire exister. Ecrire devient alors le véritable espace de la liberté.
Entre sens et non-sens
L’écriture contient en elle l’infini impensable de la pensée au-delà d’elle-même – c’est l’être en possession/dépossession (angoisse/repos) de ce qui l’excède, l’être hors de soi. Mais cet “hors-de-soi”, naturellement, ne prend de valeur qu’en relation avec l’être même. Il serait sinon une chose morte et vaine : hors du sens, et non inscrit dans cette dualité sens/non-sens qui marque notre condition.
S’il fallait donner un “sens” à la littérature, un sens à l’acte insensé d’écrire, c’est dans l’expression de cet excès de l’être, dans l’exploration de ce lieu d’angoisse où se noue la parole, qu’il faudrait le chercher.
A l’instar de la parole jaillie, l’écriture est essentiellement liée au souffle, à l’inspiration/expiration, à cette alternance de présence et d’absence d’air qui agit comme se présentent à nous l’absence et la présence du monde, dans le chaos et l’incohérence de leur succession angoissante/apaisante. Présence de l’air/du monde traduite en mots : matière de texte comme une matière d’existence – mouvement même de la pensée entre sens et non-sens.
Entre inspiration et expiration, entre présence et absence (au monde), entre sens et non-sens, c’est dans la dualité paradoxale (fusionnelle/oppositionnelle) de ces contraires indissociablement liés au sein d’un lieu de tension permanente que se cherche et s’exprime, se meut et se perd l’écriture de l’impossible.
 Mais quelle écriture, précisément ?
Mais quelle écriture, précisément ?
L’écriture philosophique, évidemment, moins que toute autre. Mise tout entière au service de la pensée et de sa cohérence, et ainsi soumise à la raison de son savoir, l’écriture de la philosophie est une écriture essentiellement instrumentalisée, réduite au rôle de véhicule de la pensée conceptuelle et de la signification. Les “vérités” qu’elle révèle se perdent aussitôt dans le réel qu’elle ne peut atteindre.
Le philosophe plie, bride et borne l’écriture aux seuls besoins de sa pensée et à la cohérence de son discours. C’est encore Sartre, dans son fameux et si discutable Qu’est-ce que la littérature ?, qui donne le mieux cette conception de l’écriture pour le philosophe : “La prose est utilitaire par essence ; je définirais volontiers le prosateur comme un homme qui se sert des mots” ( ce contre quoi réagit Bataille : “La chute dans l’utilité, par honte de soi-même, quand la divine liberté, l’inutile, apporte la mauvaise conscience, est le début d’une désertion. Le champ est laissé libre aux arlequins de la propagande.” ) ; et plus loin : “L’art de la prose s’exerce sur le discours, sa matière est naturellement signifiante : c’est-à-dire que les mots ne sont pas d’abord des objets, mais des désignations d’objets. Il ne s’agit pas d’abord de savoir s’ils plaisent ou déplaisent en eux-mêmes, mais s’ils indiquent correctement une certaine chose du monde ou une certaine notion.”
Une telle écriture, vouée aux constructions conceptuelles, au signifiant, est, on le voit, entièrement tournée du côté du possible. Or l’écriture de l’impossible, l’”art de la prose” tout simplement se noue à partir de mots – mais de mots non lisibles séparément et en dehors de l’écriture qui les assemble – qui, au-delà du fait qu’ils “plaisent” ou “déplaisent” (ce qui est loin d’être secondaire), dans le même temps qu’ils sont “désignations d’objets”, bouleversent et transforment infiniment ce qu’ils indiquent du fait même de leur mise en situation dans une écriture donnée, troublant ainsi leur signification apparente en ouvrant simultanément à celle-ci un abîme insondable au sein même de cette signification qu’ils élargissent à l’infini. Ainsi la prose, lorsqu’elle est art (et a fortiori l’écriture de l’impossible), cesse-t-elle d’être “utilitaire” : elle n’indique rien de façon univoque et ne peut “indiquer correctement” une certaine chose ou une certaine notion.
Tout entière du côté du sens, l’écriture philosophique, en laissant hors de son champ le manque d’être au coeur de l’être, ne peut ouvrir à l’impossible. Elle borne ses investigations aux terrains défrichés du sens – là précisément où l’écriture vraie commence : “au bord des limites” où le sens se décompose.
La véritable écriture, faut-il le répéter, ne saurait être en service, elle n’est donc au service de rien – pas même au service du pensable. C’est dans cette aventure de l’au-delà du sens, dans cette zone de liberté absolue de la parole, là où la pensée insensée passe ce que la pensée pense, que surgit l’écriture. Son lieu véritable est celui d’un abîme impensable – et son enjeu, dès lors, en tout point, excède dans son essence même le savoir philosophique et sa prétention à dominer, à maîtriser par la pensée cet abîme entrouvert au sein de la parole.
Hors-sens et poésie
Est-ce à dire que l’écriture de l’impossible se place pour autant du côté du hors-sens ? Non, car dès lors une telle écriture, comme je le disais plus haut, ne fait que s’inscrire, ne peut que s’inscrire hors de la dualité présence/absence, monde/antimonde, fini/infini qu’exprime notre condition.
Lorsqu’elle n’est ni le basculement sans retour, aphasique ou essoufflé, hors de la signification, ni la “belle poésie” c’est-à-dire la répétition sénile (bavarde, diarrhéique, lyrique, bucolique…) d’un monde où tout serait toujours possible et potentiellement accessible, la poésie, alors, et alors seulement, est expérience du manque et peut être expérience de l’impossible. Mais elle souffre alors (le plus souvent) d’un enfermement dans ce qui la nomme poésie – qui fait sens à son insu (et à son détriment) par sa nomination même et, au-delà, par la forme qui la désigne comme “poésie” indépendamment et hors de l’expérience qu’elle exprime et qui la fonde.
Ce sens imposé – de genre, de forme, de mesure, de règles, de mise en espace… – dans un jeu des mots et de l’ordonnancement du texte qui la définit comme poésie a priori et sans lien nécessaire à l’expérience qu’elle cherche à exprimer entraîne et précipite la poésie moderne du côté du hors-sens (ou du non-sens), l’enferme dans un absolu et l’amène ainsi à faillir si ce n’est à manquer à la dualité de notre condition que cherche à exprimer l’écriture de l’impossible. Sa logique est alors dans le seul impossible dire de l’infini (et de l’illisible, que j’évoquais plus haut) ou dans le seul fini de la sommation, si naturellement propre aux avant-gardes.
Prigent : “L’objectif de la poésie est au moins autant de fixer ce non-sens du présent (d’en formuler l’informe) que de constituer du sens (de dire le monde en clair)”.
 Sommation d’autant plus impérative que, refusant le plus souvent le compromis des “récits qui révèlent la vérité multiple de la vie” (Bataille) présentés comme autant d’illusions et de chutes dans une réalité d’apparence hors du présent réel, la poésie d’avant-garde n’appréhende que hors du sens le présent dont elle se limite à “formuler l’informe”. La “poésie” (mais qu’est-elle alors si elle n’est expression même de la dualité sens/non-sens du présent ?) devant quant à elle, et par elle-même en quelque sorte, (“son objectif”, dit Prigent) apporter, “constituer du sens”. Mais un sens qui viendrait d’où s’il ne surgit à l’homme à partir du seul présent réel qui ouvre à l’être sa fulgurance et son tumulte dans la dualité essentielle sens/non-sens que peut seule exprimer un récit lui révélant “la vérité multiple de la vie” ?
Sommation d’autant plus impérative que, refusant le plus souvent le compromis des “récits qui révèlent la vérité multiple de la vie” (Bataille) présentés comme autant d’illusions et de chutes dans une réalité d’apparence hors du présent réel, la poésie d’avant-garde n’appréhende que hors du sens le présent dont elle se limite à “formuler l’informe”. La “poésie” (mais qu’est-elle alors si elle n’est expression même de la dualité sens/non-sens du présent ?) devant quant à elle, et par elle-même en quelque sorte, (“son objectif”, dit Prigent) apporter, “constituer du sens”. Mais un sens qui viendrait d’où s’il ne surgit à l’homme à partir du seul présent réel qui ouvre à l’être sa fulgurance et son tumulte dans la dualité essentielle sens/non-sens que peut seule exprimer un récit lui révélant “la vérité multiple de la vie” ?
La poésie moderne est ainsi le plus souvent prisonnière d’une appréhension alternative sens/non-sens, elle s’y enferme sans pouvoir atteindre à l’expression de la dualité qu’exprime le récit de l’être dans son rapport au monde – parce qu’elle ne comprend le rapport sens/non-sens que comme deux aspects distincts et séparés d’un présent tout entier perçu hors du sens ; parce qu’elle appréhende l’interrogation de l’être en soi et sur le monde coupée du récit qui l’exprime dans le présent en se faisant le dit du présent même. Dans ces conditions, par cette séparation qui fige et finit l’être, au lieu de rendre accessible (au moins fugacement) l’impact du présent, elle se place le plus souvent en marge, en parallèle du temps vécu, dans un hors-monde qui interpellerait le présent sans en être la matière, un présent abstrait, étranger à ce “moment de rage”, à cette “épreuve suffocante” dont parle Bataille, et ne nous offre le plus souvent qu’un présent vidé de la substance même de ce qui le qualifie comme fulgurance du réel : le récit du saisissable/insaisissable rapport de l’être à soi, au monde, au temps.
La poésie moderne – à l’exception de quelques très rares oeuvres, je pense notamment, pour la langue française, à celles de Reverdy, Michaux, Césaire, du Bouchet… – semble ainsi prise dans cette espèce d’impasse et apparaît comme un objet clos sur lui-même et en lui-même : fini. Et alors même que c’est l’infini qui la hante (ou tout du moins sa présence dans le présent de l’être), c’est le plus souvent un infini en soi, coupé de l’être, qu’elle parvient à exprimer.
Prise de la sorte entre fini ou infini, sens ou hors-sens, et contrainte de choisir (ou de présenter successivement) dans ce qui est intrinsèquement lié, la poésie moderne ne parvient qu’exceptionnellement à faire entendre la dualité de l’impossible et par là même à faire jaillir ce qui pourtant est à l’origine de son interrogation : le réel, le présent.
Une fin de non-recevoir
Ce qui s’ouvre à nous et que nous ne pouvons saisir – l’impossible –, cela que nous ne pouvons contenir en nous-même et qui cependant est en nous, cela donc qui nous partage entre nous et un hors de nous (du Bouchet), entre nous et un autre (Rimbaud), entre nous-même et le silence éternel de l’espace (Pascal), cela même que nous ne finissons jamais de désigner comme transcendant ce qui nous finit, cela traduit notre appel à l’infini, inouï et désespéré, perçu comme un non-sens inscrit au sein même du sens qui nous signifie : un impératif d’infini à jamais reconduit au sein de notre finitude.
A nouveau sur l’illisible
Ce “besoin d’infini” – cette tentative d’appréhender l’infini dans le présent de l’être – peut, comme je le disais plus haut, chercher à se traduire par l’injonction d’abolir le lisible (qui nous limiterait à ce qui en nous est fin et commencement) pour un illisible qui ne viendrait pas limiter l’infini de l’être, rendrait enfin possible l’écriture du monde. Du Bouchet, à propos de Finnegans Wake : “Car l’illisible est bien le seul infini dont un livre se donnant comme le monde écrit sache se prévaloir.”
Voulant “se donner comme le monde” et rendue illisible pour atteindre cet infini, l’écriture, alors, s’enferme elle-même dans ce qui, mot après mot, phrase après phrase – apparaissant comme autant “d’astres morts” étrangers à nos interrogations par incapacité à établir un pont, même infréquentable, entre sens et non-sens –, la coupe de nous : elle nous signifie dès lors, à plus ou moins longue échéance dans notre lecture, une fin de non-recevoir. Nous privant par là-même de ce qui constitue notre plus essentielle liberté : notre dimension d’infini, c’est-à-dire le pouvoir que nous avons d’interroger, à partir de nous-même, cet espace infini qui nous hante et nous appartient sans que nous puissions le saisir : le monde vivant surgit dans l’écart entre sens et non-sens, fini et infini. Ainsi le “monde écrit” ne peut-il être qu’un leure, tout comme l’absolu d’infini – et nous sommes là encore contraints à l’inévitable compromis d’un récit rendant présent l’écart (comme dualité vivante) entre la réalité du monde saisi et l’insaisissable réel du monde, entre fini et infini, sens et non-sens. Et c’est bien parce que sans cesse “le monde vivant se dérobe à l’étreinte nominale” (du Bouchet) que nous est essentielle l’écriture de l’impossible, laquelle, rompant avec la contrefaçon réaliste dominante de la “prose utilitaire” (Sartre) comme de la poésie du possible (la “belle poésie” et les avant-gardes), rend seule présent cet écart.
C’est dans la mise au présent de la dualité sens/non-sens, à travers l’écart qu’elle signifie entre monde saisi et monde réel (représentable/irreprésentable) que surgit l’écriture de l’impossible : elle est le récit même de cet écart. C’est ainsi, une fois encore, dans l’entre-deux, dans la dualité et le paradoxe, à travers l’impur, le souillé, le sauvage, le bâtard, l’illégitime que jaillit et se forge cette écriture. Et le lieu d’expression de cette bâtardise, de cette illégitimité fondamentale c’est ce qui en fait le récit : le roman. Ou encore : le roman comme tentative de saisir le présent par son récit.
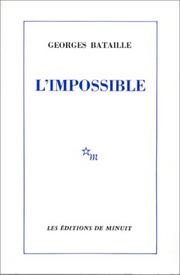 Bataille : “Un peu plus, un peu moins, tout homme est suspendu aux récits, aux romans, qui lui révèlent la vérité multiple de la vie. Seuls ces récits, lus parfois dans les transes, le situent devant le destin.” L’écriture d’un récit, donc. Un récit qui “appelle un moment de rage” et soit livré à “l’épreuve suffocante” de l’impossible.
Bataille : “Un peu plus, un peu moins, tout homme est suspendu aux récits, aux romans, qui lui révèlent la vérité multiple de la vie. Seuls ces récits, lus parfois dans les transes, le situent devant le destin.” L’écriture d’un récit, donc. Un récit qui “appelle un moment de rage” et soit livré à “l’épreuve suffocante” de l’impossible.
L’écriture d’un récit, d’un roman, qui révèle “la vérité multiple de la vie” et se situe aussi bien hors des limites du sens et du possible (c’est-à-dire des formes apparentes de la vie) qu’en dehors des impasses mentales du non-sens, bloc fermé à l’expérience vécue et coupé de la tension du réel. Le “roman” sera alors, comme seul il peut l’être, le récit même de cet écart entre sens et non-sens, fini et infini, lisible et illisible. Le récit de ce vide que l’être cherche en permanence à combler, cet espace où se joue la vie – dans le pensable/impensable, le dit/indicible : la “part maudite” de l’impossible où “la pensée pense ce qui la dépasse infiniment”.
Du Bouchet, à propos du Docteur Jivago : “Par cette place vacante au coeur de son oeuvre, Pasternak maintient envers et contre tout la chance d’une révélation presque chaque jour différée. Et à travers un ajournement qui forme la trame même de l’existence réelle et vécue, affluent par instants les indices de cette autre réalité, de notre devenir qu’il ne nous est permis de connaître que de façon intermittente, et quasi illusoire, comme le bruit d’une cascade perçu de loin au hasard d’une halte, dans une gare.”
Il ne peut y avoir saisissement de l’infini en l’être si cette dimension d’infini impensable – par et à travers le récit de notre expérience de l’impossible – ne nous donne aussi à entendre, désormais insaisissable et néanmoins présente, vécue, ce “bruit d’une cascade perçu au loin au hasard d’une halte, dans une gare”.
L’écriture du roman se joue dans cette marge étroite du dit de l’indicible, de l’écriture de l’irreprésentable, sans pour autant quitter l’expérience de la vie et basculer alors dans un absolu où se défait le sens.
L’enjeu du roman sera ainsi d’aller “au bord des limites où le sens se décompose”, dans cet espace humain/inhumain où l’être en s’échappant des limites du sens commun et du possible atteint à l’impossible dans ce qu’en tant qu’être il peut, pour lui-même, par fulgurance, se représenter.
![[Manières de critiquer] Le roman contemporain : Écriture et liberté, par Bernard Desportes](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)