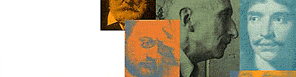 Voici le premier volet de la réflexion théorique qui ouvrira un volume à paraître sur cette démarche transdisciplinaire à laquelle se rattachent mes recherches comme une partie de mes articles sur Libr-critique.
Voici le premier volet de la réflexion théorique qui ouvrira un volume à paraître sur cette démarche transdisciplinaire à laquelle se rattachent mes recherches comme une partie de mes articles sur Libr-critique.
La sociogénétique a pour objet la sociogenèse, non seulement de la production et de la réception des œuvres, mais encore des différentes modalités d’intervention dans le champ. Ainsi le processus de communication littéraire est-il envisagé d’un double point de vue : en amont, il s’agit, grâce à l’étude d’un dossier génétique, de saisir le positionnement initial de l’auteur dans l’espace des possibles ; en aval, d’appréhender la réception de l’œuvre comme un système de relations entre trajectoire et champ. Mais l’intérêt de la sociogénétique ne s’arrête pas là, puisqu’elle vise également à rendre compte de formes et de postures (auctoriales, collégiales ou éditoriales) diversement singulières, ou encore de labels, de problématiques ou de polémiques qui, à un moment donné, représentent des enjeux cruciaux, sans oublier ces institutions que constituent les écritures codées, les revues prestigieuses, les académies ou les jurys. (À la suite d’Alain Viala, par institutions on entend les « instances qui élèvent des pratiques du rang d’usages à celui de valeurs par un effet de pérennisation (et qui, ce faisant, s’érigent elles-mêmes en autorités), et les valeurs ainsi établies » – 1990, p. 120).
Autrement dit, il s’agit d’une démarche explicative et compréhensive qui, dans le prolongement du structuralisme génétique de Pierre Bourdieu et de la sociopoétique d’Alain Viala ou de Jérôme Meizoz, s’appuie sur l’histoire individuelle et collective pour rendre compte du fait littéraire même, à savoir du fonctionnement institutionnel comme de la production et de la réception d’œuvres dont les caractéristiques formelles et éthologiques font l’objet d’une description immanente. Cette objectivation par relativisation historicisante s’impose d’autant plus que perdure une doxa littéraire toujours prompte à hypostasier écrivain et écriture. Aussi, avant tout discours de la méthode, commencera-t-on par s’interroger sur l’écriture / la valeur littéraire.
De la "littérarité"…
Qu’est-ce donc que l’écriture littéraire ? À l’évidence, la réponse ne va pas de soi. Rien d’étonnant alors à ce que Tzvetan Todorov se pose la question dans Les Genres du discours (Seuil, 1978 ; repris dans La Notion de littérature et autres essais, « Points », 1987), allant jusqu’à remettre en question la notion même de littérature. Pour cela, il examine les principales définitions. Tout d’abord, il réfute celle qui, d’Aristote à Frye, fait du texte  littéraire une fable : « Si tout ce qui est habituellement considéré comme littéraire n’est pas forcément fictionnel, inversement, toute fiction n’est pas obligatoirement littérature» (p. 14). Il passe ensuite en revue la conception esthétique — développée, du XVIIIe au XXe siècle, par Diderot, Novalis, les formalistes russes ou encore le New Criticism américain — selon laquelle l’écriture littéraire est opaque, non instrumentale et systématique : elle se distingue du langage commun par sa fonction poétique, c’est-à-dire par sa réflexivité. Or, le théoricien doute que le roman soit « autotélique » : s’il est régi par un système de conventions, il renvoie néanmoins — dans la tradition européenne classique en tout cas — à un référent extra-linguistique (événements, personnages, objets…). Considérant les travaux de R. Wellek et de N. Frye qui se situent dans la perspective de cette seconde définition (par opposition au langage scientifique — dénotatif, transparent et référentiel —, l’écriture littéraire est connotative, opaque et plurifonctionnelle), il aboutit à cette conclusion : « La visée du système, l’attention portée à l’organisation interne n’impliquent pas que le texte soit fictionnel » (p. 21). D’ailleurs, est-il possible de déceler des propriétés communes aux textes dits littéraires ? Et le critique de rappeler que « de nombreux types de texte […] témoignent de ce que les propriétés "littéraires" se trouvent aussi en dehors de la littérature (du jeu de mots et de la comptine à la méditation philosophique, en passant par le reportage journalistique ou le récit de voyage) » (p. 24). Il en vient ainsi à dénoncer ce que peuvent avoir de partiel les deux définitions de la littérature (la première a pour modèles le récit et la tragédie alors que la seconde ne se réfère qu’à la poésie) et de conventionnel les distinctions génériques (« Les genres du discours […] tiennent tout autant de la matière linguistique que de l’idéologie historiquement circonscrite de la société »). La conséquence qu’il en tire est qu’il convient de substituer à l’antinomie entre littérature et non-littérature une typologie des discours qui, contrairement à la rhétorique antique et classique — laquelle différencie les styles de discours — renonce à toute dimension prescriptive pour se borner à être uniquement descriptive.
littéraire une fable : « Si tout ce qui est habituellement considéré comme littéraire n’est pas forcément fictionnel, inversement, toute fiction n’est pas obligatoirement littérature» (p. 14). Il passe ensuite en revue la conception esthétique — développée, du XVIIIe au XXe siècle, par Diderot, Novalis, les formalistes russes ou encore le New Criticism américain — selon laquelle l’écriture littéraire est opaque, non instrumentale et systématique : elle se distingue du langage commun par sa fonction poétique, c’est-à-dire par sa réflexivité. Or, le théoricien doute que le roman soit « autotélique » : s’il est régi par un système de conventions, il renvoie néanmoins — dans la tradition européenne classique en tout cas — à un référent extra-linguistique (événements, personnages, objets…). Considérant les travaux de R. Wellek et de N. Frye qui se situent dans la perspective de cette seconde définition (par opposition au langage scientifique — dénotatif, transparent et référentiel —, l’écriture littéraire est connotative, opaque et plurifonctionnelle), il aboutit à cette conclusion : « La visée du système, l’attention portée à l’organisation interne n’impliquent pas que le texte soit fictionnel » (p. 21). D’ailleurs, est-il possible de déceler des propriétés communes aux textes dits littéraires ? Et le critique de rappeler que « de nombreux types de texte […] témoignent de ce que les propriétés "littéraires" se trouvent aussi en dehors de la littérature (du jeu de mots et de la comptine à la méditation philosophique, en passant par le reportage journalistique ou le récit de voyage) » (p. 24). Il en vient ainsi à dénoncer ce que peuvent avoir de partiel les deux définitions de la littérature (la première a pour modèles le récit et la tragédie alors que la seconde ne se réfère qu’à la poésie) et de conventionnel les distinctions génériques (« Les genres du discours […] tiennent tout autant de la matière linguistique que de l’idéologie historiquement circonscrite de la société »). La conséquence qu’il en tire est qu’il convient de substituer à l’antinomie entre littérature et non-littérature une typologie des discours qui, contrairement à la rhétorique antique et classique — laquelle différencie les styles de discours — renonce à toute dimension prescriptive pour se borner à être uniquement descriptive.
Dans l’article « Littérarité » de leur Dictionnaire raisonné de la théorie du langage (Hachette Université, 1979), A.J. Greimas et J. Courtès rejoignent la position de T. Todorov :
« 1.
Si l’on admet — ce qui ne va pas de soi — que le discours littéraire constitue une classe autonome à l’intérieur d’une typologie générale des discours, sa spécificité peut être considérée soit comme la visée ultime (qui ne sera atteinte que par étapes) d’un métadiscours de recherche, soit comme un postulat a priori permettant de circonscrire par avance l’objet de connaissance visé. Selon R. Jakobson, qui a opté pour cette seconde attitude, "l’objet de la science littéraire n’est pas la littérature, mais la littérarité", c’est-à-dire ce qui autorise à distinguer ce qui est littéraire du non-littéraire.
2.
Or, le regard, même superficiel, que le linguiste peut porter sur les textes dits littéraires, suffit à le persuader que ce qu’on appelle "formes littéraires" (figures, procédés, organisations discursives et/ou narratives) n’ont rien de spécifiquement "littéraires", car elles se rencontrent dans les autres types de discours. Dans l’impossibilité de reconnaître l’existence de lois, ou même de simples régularités qui seraient propres au discours littéraire, on est ainsi amené à considérer le concept de littérarité — dans le cadre de la structure intrinsèque du texte — comme dépourvu de sens, et à lui conférer, en revanche, le statut de connotation sociale (dont on sait qu’elle varie selon les cultures et les époques : un texte reconnu comme religieux au Moyen-Age — J. Lotman, entre autres, a insisté sur ce point— est reçu aujourd’hui comme littéraire) ; c’est dire que la littérarité doit être intégrée dans la problématique des ethnothéories des genres (ou des discours) » (p. 214).
Ce refus de distinguer le littéraire du non-littéraire explique que, parmi les différents adeptes de la critique formelle, nombreux sont ceux qui, comme Propp, Barthes ou Eco, se sont intéressés à des types de discours aussi divers que le conte populaire, le fait divers, le récit policier, etc.
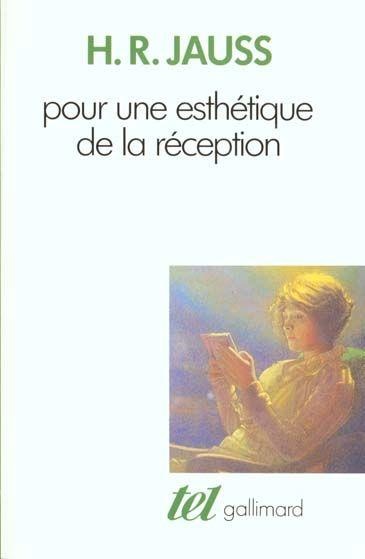 Cette position s’oppose évidemment à la théorie optimiste d’une postérité clairvoyante qui ferait le tri entre les œuvres esthétiquement valables et les œuvres ratées — théorie que G. Genette tourne en dérision dans La Relation esthétique : « les œuvres réellement belles […] finissent toujours par s’imposer, en sorte que celles qui ont victorieusement subi l’"épreuve du temps" tirent de cette épreuve un label incontestable et définitif de qualité » (Seuil, 1997, p. 128). S’il ne faut ni idéaliser la postérité, ni exagérer son rôle, il convient toutefois, selon Jauss, de ne pas négliger l’histoire de la réception des œuvres : toute œuvre ne reçoit de sens et de valeur que par l’ensemble de ses lecteurs successifs. L’approche sociologique de Jauss a le mérite de prendre appui sur des critères d’ordre esthétique (degré d’innovation de l’œuvre) et éthique (répercussions sur le comportement social des lecteurs) ; elle tente donc de dépasser l’antinomie entre le structurel (la description des formes) et l’historique (l’histoire des changements d’horizon, c’est-à-dire des systèmes référentiels qu’à chaque époque constituent pour chaque œuvre l’expérience littéraire des lecteurs, les formes et thématiques relatives, et les oppositions « entre langage poétique et langage pratique, monde imaginaire et réalité quotidienne »). Autrement dit, l’originalité d’une œuvre se mesure autant à l’importance de l’écart esthétique — à savoir de la distance entre cette œuvre et « l’horizon d’attente préexistant » — qu’à son impact sur le public. Par exemple contrairement à Fanny de Feydeau, Madame Bovary franchit le cap du XXe siècle comme classique parce que, au milieu du siècle dernier, elle introduit une forme romanesque nouvelle (le récit impersonnel) et une nouvelle vision du monde (le bovarysme, précisément).
Cette position s’oppose évidemment à la théorie optimiste d’une postérité clairvoyante qui ferait le tri entre les œuvres esthétiquement valables et les œuvres ratées — théorie que G. Genette tourne en dérision dans La Relation esthétique : « les œuvres réellement belles […] finissent toujours par s’imposer, en sorte que celles qui ont victorieusement subi l’"épreuve du temps" tirent de cette épreuve un label incontestable et définitif de qualité » (Seuil, 1997, p. 128). S’il ne faut ni idéaliser la postérité, ni exagérer son rôle, il convient toutefois, selon Jauss, de ne pas négliger l’histoire de la réception des œuvres : toute œuvre ne reçoit de sens et de valeur que par l’ensemble de ses lecteurs successifs. L’approche sociologique de Jauss a le mérite de prendre appui sur des critères d’ordre esthétique (degré d’innovation de l’œuvre) et éthique (répercussions sur le comportement social des lecteurs) ; elle tente donc de dépasser l’antinomie entre le structurel (la description des formes) et l’historique (l’histoire des changements d’horizon, c’est-à-dire des systèmes référentiels qu’à chaque époque constituent pour chaque œuvre l’expérience littéraire des lecteurs, les formes et thématiques relatives, et les oppositions « entre langage poétique et langage pratique, monde imaginaire et réalité quotidienne »). Autrement dit, l’originalité d’une œuvre se mesure autant à l’importance de l’écart esthétique — à savoir de la distance entre cette œuvre et « l’horizon d’attente préexistant » — qu’à son impact sur le public. Par exemple contrairement à Fanny de Feydeau, Madame Bovary franchit le cap du XXe siècle comme classique parce que, au milieu du siècle dernier, elle introduit une forme romanesque nouvelle (le récit impersonnel) et une nouvelle vision du monde (le bovarysme, précisément).
L’esthétique de la réception, on le voit, redonne une certaine pertinence à la notion de littérature ou à celle d’écriture littéraire, mais la situe historiquement et sociologiquement — et par là même la relativise. En ce qui concerne le style, par delà les théories particulières, examinons la mise au point d’Antoine Compagnon dans Le Démon de la théorie (Seuil, 1998) :
« Trois aspects du style sont ainsi revenus au premier plan, ou n’ont jamais été vraiment éliminés. Il semble qu’ils soient inévitables et indépassables. Ils ont en tout cas résisté victorieusement aux assauts que la théorie leur a livrés :
– le style est une variation formelle sur un contenu (plus ou moins) stable ;
– le style est un ensemble de traits caractéristiques d’une œuvre permettant d’en identifier et d’en reconnaître (plus intuitivement qu’analytiquement) l’auteur ;
– le style est un choix entre plusieurs "écritures".
Seul le style comme norme, prescription ou canon passe mal, et n’a pas été réhabilité. Mais à part cela, le style existe bel et bien » (p. 208).
Il est certes possible de repérer des caractéristiques stylistiques particulières, mais la valeur littéraire demeure théoriquement injustifiable :
« La diversité désordonnée des valeurs n’est pas une conséquence nécessaire et inévitable du relativisme du jugement, et c’est justement ce qui rend la question intéressante : comment les grands esprits se rencontrent-ils ? Comment s’établissent des consensus partiels entre les autorités chargées de veiller sur la littérature ? Ces consensus, comme la langue, comme le style, se dégagent sous la forme d’agrégats de préférences individuelles, avant de devenir des normes par l’intermédiaire des institutions : l’école, l’édition, le marché. […]. La valeur littéraire ne peut pas être fondée théoriquement : c’est une limite de la théorie, non de la littérature » (p. 273-74).
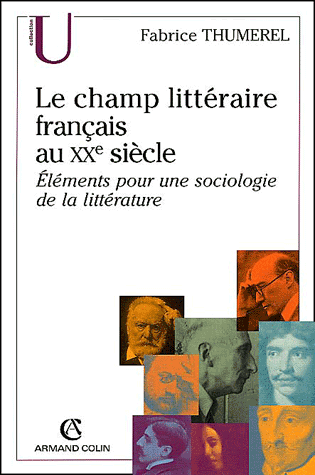 Ainsi ne saurait-il y avoir d’invariant littéraire : il n’existe aucune essence littéraire, aucune qualité intrinsèque qui puisse définir a priori et infailliblement l’écriture littéraire… Il n’y a ni écriture littéraire, ni écrivain en soi. Ce dont est conscient un écrivain comme Christian Prigent : « qu’est-ce qu’un écrivain – sinon quelqu’un qui joue à l’écrivain ? Que serait une nature d’écrivain en soi ? Un écrivain, est-ce jamais autre chose que la coagulation ponctuelle de cet ensemble de rôles (écrire, publier, être lu, recensé, critiqué, etc.) qu’accepte de jouer celui qu’alors on reconnaît socialement comme écrivain ? » (Christian Prigent, quatre temps, Argol, 2009, p. 89). Ce sont les instances de consécration (édition, critique journalistique et universitaire, institution scolaire) qui veillent à « la construction a priori d’une norme de lisibilité et d’une certaine définition […] du "littéraire" (ce qui l’est / ce qui ne l’est pas ; ce qui l’est trop / ce qui ne l’est pas assez ; ce qu’on peut en consommer / ce qui vous en pèse sur l’estomac ; ce qui vous prend la tête/ce qui vous la vide, etc. » (121).
Ainsi ne saurait-il y avoir d’invariant littéraire : il n’existe aucune essence littéraire, aucune qualité intrinsèque qui puisse définir a priori et infailliblement l’écriture littéraire… Il n’y a ni écriture littéraire, ni écrivain en soi. Ce dont est conscient un écrivain comme Christian Prigent : « qu’est-ce qu’un écrivain – sinon quelqu’un qui joue à l’écrivain ? Que serait une nature d’écrivain en soi ? Un écrivain, est-ce jamais autre chose que la coagulation ponctuelle de cet ensemble de rôles (écrire, publier, être lu, recensé, critiqué, etc.) qu’accepte de jouer celui qu’alors on reconnaît socialement comme écrivain ? » (Christian Prigent, quatre temps, Argol, 2009, p. 89). Ce sont les instances de consécration (édition, critique journalistique et universitaire, institution scolaire) qui veillent à « la construction a priori d’une norme de lisibilité et d’une certaine définition […] du "littéraire" (ce qui l’est / ce qui ne l’est pas ; ce qui l’est trop / ce qui ne l’est pas assez ; ce qu’on peut en consommer / ce qui vous en pèse sur l’estomac ; ce qui vous prend la tête/ce qui vous la vide, etc. » (121).
La relativité de la notion de littérature ou d’écriture littéraire paraît donc indéniable. Ce que confirme la sociologie du champ littéraire : d’après Bourdieu, sont tenues pour littéraires les écritures dont les caractéristiques génériques, techniques, thématiques et stylistiques s’imposent dans un état donné du champ − qui n’est pas forcément celui auquel appartient l’auteur (consécration posthume) −, parce que, en fonction des normes en cours et du point de vue dominant sur l’histoire littéraire, elles sont reconnues comme singulières par les instances de légitimation (éditeurs, écrivains et revues prépondérants, critique, académies, institution scolaire…), c’est-à-dire qu’elles constituent des positions esthétiques et/ou idéologiques marquantes − lesquelles pourront être remises en question dans l’état suivant du champ… (cf. mon Champ littéraire au XXe siècle. Éléments pour une sociologie de la littérature, Armand Colin, 2002).
![[Manières de critiquer] Pour une sociogénétique littéraire (1)](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)