 Abdelfattah Kilito, Les Arabes et l’art du récit. Une étrange familiarité, Actes Sud, coll. "Sindbad", 2009, 23 €, ISBN 978-2-7427-8110-2.
Abdelfattah Kilito, Les Arabes et l’art du récit. Une étrange familiarité, Actes Sud, coll. "Sindbad", 2009, 23 €, ISBN 978-2-7427-8110-2.
Jean-Nicolas Clamanges
Voici un livre comme on en trouve finalement bien peu. Il plaira non seulement aux amateurs des Mille et Une Nuits ou à ceux qui cherchent un chemin vers la littérature arabe ancienne, mais aussi à tous ceux qui aiment que la littérature soit un secret sur un secret. C’est un essai dense mais limpide, où les problèmes de la culture lettrée arabe classique sont présentés dans la lumière de notre présent, au fil d’une dizaine de brefs chapitres écrits dans une langue simplement élégante.
 Abdelfattah Kilito enseigne à l’université Mohammed V de Rabat. Il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages, dont notamment : L’Auteur et son double (Seuil), Les Séances (Sindbad), sur un genre littéraire essentiel de la tradition classique arabe, L’Œil et l’Aiguille (La Découverte), un des plus beaux essais que j’aie jamais lus sur les Mille et Une Nuits, et Dites-moi le songe (Sindbad/Actes-Sud) ; il est aussi l’auteur d’un roman : La Querelle des images (1985) et d’un recueil de nouvelles qui sont publiés au Maroc. Les Arabes et l’art du récit poursuit une réflexion sur quelques chef d’œuvre de la littérature arabe ancienne envisagés tout autant dans leur portée au sein de leur propre culture que dans leurs rapports complexes avec le monde indo-persan et l’Occident. Il y est question de Kalila et Dimna (VIIIe siècle), du Livre des avares de Jârhiz (IXe siècle), du Collier de la colombe d’Inbn Hazm (XIe siècle), de l’indifférence constante des anciens lettrés pour les Mille et Une Nuits, des rapports de l’art d’écrire avec l’art du secret ou encore des connivences probables entre les procédés d’Harîri (l’auteur des Séances, XIe siècle) et ceux de Georges Perec. Le fil rouge qui relie cette méditation serait peut-être ce que l’épreuve de l’étranger révèle et occulte tout à la fois dans la culture littéraire arabe – un fil tressé à une intuition subtile de ce que comporte de paradoxal l’expérience littéraire, comme sorte de vocation fructueuse à la méconnaissance et au malentendu.
Abdelfattah Kilito enseigne à l’université Mohammed V de Rabat. Il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages, dont notamment : L’Auteur et son double (Seuil), Les Séances (Sindbad), sur un genre littéraire essentiel de la tradition classique arabe, L’Œil et l’Aiguille (La Découverte), un des plus beaux essais que j’aie jamais lus sur les Mille et Une Nuits, et Dites-moi le songe (Sindbad/Actes-Sud) ; il est aussi l’auteur d’un roman : La Querelle des images (1985) et d’un recueil de nouvelles qui sont publiés au Maroc. Les Arabes et l’art du récit poursuit une réflexion sur quelques chef d’œuvre de la littérature arabe ancienne envisagés tout autant dans leur portée au sein de leur propre culture que dans leurs rapports complexes avec le monde indo-persan et l’Occident. Il y est question de Kalila et Dimna (VIIIe siècle), du Livre des avares de Jârhiz (IXe siècle), du Collier de la colombe d’Inbn Hazm (XIe siècle), de l’indifférence constante des anciens lettrés pour les Mille et Une Nuits, des rapports de l’art d’écrire avec l’art du secret ou encore des connivences probables entre les procédés d’Harîri (l’auteur des Séances, XIe siècle) et ceux de Georges Perec. Le fil rouge qui relie cette méditation serait peut-être ce que l’épreuve de l’étranger révèle et occulte tout à la fois dans la culture littéraire arabe – un fil tressé à une intuition subtile de ce que comporte de paradoxal l’expérience littéraire, comme sorte de vocation fructueuse à la méconnaissance et au malentendu.
L’ennui des Nuits ?
Le chapitre intitulé de façon provocante : "Les Nuits, un livre ennuyeux" commence par une réflexion sur la part de reconstruction du passé que comporte l’évocation des livres liés à l’enfance, particulièrement chez le grand lecteur qu’est en principe celui dont le métier est de chercher et d’enseigner dans le domaine de la littérature. Si les Mille et Une Nuits furent donc un livre lu en arabe dès l’enfance dans une édition expurgée, A. Kilito n’est pas sûr de les avoir aimées alors qu’il se souvient encore de sa fascination pour le roman d’Antar. Ce sont pourtant les Nuits que l’adulte relit, et cela parce que des livres français en furent les médiateurs à un certain moment, comme les contes de Voltaire, Le Sopha, La Recherche du temps perdu, ou encore l’impact de l’analyse structurale sur l’approche technique du récit. Ainsi A. Kilito ignore s’il a jamais vraiment aimé les Nuits  dans son enfance et il se demande dans quelle mesure son goût présent à leur égard n’est pas dicté par une doxa interdisant d’y voir le livre ennuyeux qu’il a durablement été pour la tradition arabe lettrée jusqu’aux débuts du XXe siècle. Ainsi poursuit-il une méditation inquiète quoique pleine d’humour sur ce qui fait – ou défait – la fortune des œuvres littéraires, et leur intégration au canon comme "classiques" d’une littérature nationale ou de la littérature universelle.
dans son enfance et il se demande dans quelle mesure son goût présent à leur égard n’est pas dicté par une doxa interdisant d’y voir le livre ennuyeux qu’il a durablement été pour la tradition arabe lettrée jusqu’aux débuts du XXe siècle. Ainsi poursuit-il une méditation inquiète quoique pleine d’humour sur ce qui fait – ou défait – la fortune des œuvres littéraires, et leur intégration au canon comme "classiques" d’une littérature nationale ou de la littérature universelle.
Du coup, nous apprenons ici ce qu’est un ouvrage "classique" dans la tradition arabe lettrée : il est lié à un nom d’auteur : un nom spécifié par une biographie aussi précise que possible ; il s’inscrit dans une forme repérée ; son style est élevé et s’il recourt à des niveaux plus bas, l’auteur doit le justifier ; cette distinction formelle engendre une opacité sémantique qui appelle nécessairement la glose : cet hermétisme se lie à une fonction didactique du "grand texte", qui ne peut déployer tout son enseignement que dans l’explicitation des commentaires, tâche dont se charge parfois l’auteur lui-même (comme Dante le fait par exemple dans la Vita nuova) ; ce texte est enfin réputé intraduisible, qu’il s’agisse de poème ou de prose car il y perd son nazm ou agencement. Or, le recueil aujourd’hui le plus traduit de toute la littérature arabe : celui des Nuits, ne satisfait à aucun de ces critères : "il n’a pas d’auteur, il se présente sous diverses versions, son style est vulgaire (même s’il ne dédaigne pas systématiquement la prose rimée), il n’est pas commenté et ne fait pas l’objet d’un enseignement". Et c’est donc tout à fait sérieusement qu’A. Kilito constate que la littérature arabe ancienne ne serait pas différente si les Mille et Une Nuits n’existaient pas, car leur impact y est nul. Ce n’est pas que la condition de lettré dans cette culture exclue les écrits divertissants : au contraire, il est recommandé de varier ses lectures ; simplement, les Nuits n’intéressent pas, comme le montre l’un des rares témoignages qu’on ait sur leur lecture à date ancienne, celui d’Ibn al-Nadîm (un libraire bagdadien de la fin du Xe siècle) : "j’ai eu plusieurs fois l’occasion de voir ce texte complet : à la vérité c’est un livre fort indigent et qui raconte assez froidement".
Ainsi survient la question de la relativité des jugements sur les œuvres à travers le temps, et une mise en cause ironique du fameux verdict, censé sans appel, de la postérité. L’extraordinaire intérêt des Européens puis du monde entier pour ce recueil des Nuits depuis la traduction de Galland jusqu’à nos jours, contraste radicalement avec des siècles de mépris lettré dans la culture arabe ; or, demande A. Kilito : "comment aller à l’encontre du jugement de tant de siècles ? […] et si c’était nous les victimes d’une cécité pandémique qui nous pousse à les surestimer ?" Symétriquement, on apprend d’ailleurs que si l’édition, la diffusion et les commentaires ont effectivement connu un grand essor dans le monde arabe moderne, il a tout de même fallu attendre 1984 pour qu’y paraisse une édition critique et que si la littérature vivante y fait des allusions, trouve en Shariar une figure allégorique de bien des tyrannies (politiques ou domestiques), ou encore en propose une réécriture contemporaine incisive (Naguib Mahfouz, Assia Djebar, Leila Sebbar et quelques autres), on n’y rencontre encore, selon lui, aucune œuvre témoignant d’une complicité comparable avec celle d’un Proust ou d’un Borgès. (Voir tout de même sur ce sujet : Ferial Ghazoul, Nocturnal Poetics, Le Caire, American UP., 1966).
D’une rencontre improbable en terre d’emprunt
L’avant-propos de l’ouvrage relève que si pour les Arabes le fleuron de leur culture a toujours été la poésie, celle-ci a rarement été appréciée à sa valeur en Perse ou en Europe, alors que l’Occident semble unanime à considérer depuis longtemps que, s’agissant de l’art du récit, les Arabes "surpassent les autres nations en cette sorte de composition", comme l’écrit Antoine Galland au début du XVIIIe siècle, en introduction à sa traduction des Nuits. (C’est malheureusement vrai pour la poésie ancienne – sans laquelle pourtant n’existerait pas Le Fou d’Elsa, pour ne prendre que cet exemple au XXe siècle – ; peut-être un peu moins pour certains grands modernes comme Khalil Gibran, Nizar Kabbani, Adonis, Mahmoud Darwich… – et puis on traduit aussi des voix nouvelles : cf. Abdul Kader El-Janabi et Bernard Noël, Le poème arabe moderne. Anthologie, Maisonneuve & Larose, 1999 ; ou encore Action poétique, n° 178, 2004 : "Palestine : poètes d’aujourd’hui"). Quoi qu’il en soit, Galland, malgré sa volonté de transmettre au mieux cette culture qu’il admirait, jugea impossible de faire passer les poèmes de son manuscrit syriaque dans la langue de Racine. On n’en est plus là aujourd’hui ; de Mardrus à la récente édition en Pléiade (disponible en folio-Gallimard), les poèmes sont traduits et ce sont des merveilles :
et s’il révélait les secrets, ton secret serait mon secret.
Si tout ce que je cache était montagnes, il les détruirait ;
feu, il l’éteindrait ; vent, il ne le laisserait pas souffler.
Il en est qui vous disent que le sort n’est pas sans douceur :
ils goûteront bien un jour, tôt ou tard, plus amer que la myrrhe.
(XIVe Nuit, "Histoire du deuxième calender", trad. Bencheikh-Miquel)
Sachant que toute création suppose une oublieuse mémoire, la littérature arabe classique travaille secrètement la littérature européenne depuis le Moyen Age ; le foudroyant succès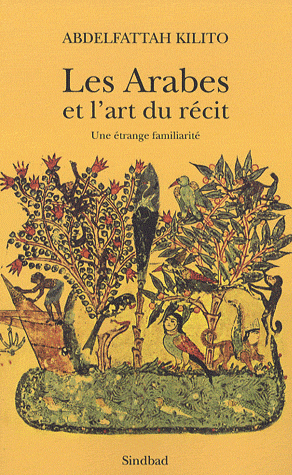 des Nuits au XVIIIe siècle aura été le moment d’émergence en lisibilité – au moins partielle – de cette figure jusque-là celée dans le tapis ; mais si en retour, selon A. Kilito, la littérature arabe moderne apprit à pratiquer des genres (le roman, la nouvelle, le théâtre) qui étaient dans l’ensemble étrangers à sa tradition, sa poésie et beaucoup de ses plus grands classiques restent encore largement ignorés en Occident – sauf quand le canon autorise un lien : Kalila et Dimna, grâce à La Fontaine, les Séances de Hamadhâni et de Harîri via le roman picaresque, l’Épître au pardon de Ma`arrî par la Divine Comédie, etc. L’élégance de l’ouvrage est précisément de partir de là pour engager l’initiation. Reste évidemment qu’à l’échelle des passionnés, c’est autre chose. On apprend ainsi en lisant le chapitre consacré à Perec et Harîri (lequel est mentionné dans La Vie mode d’emploi), que si le premier n’a peut-être pas lu le second (quoique le citant), Renan, qui était arabisant, l’avait lu, sans doute dans le commentaire "en arabe" du grand orientaliste Sylvestre de Sacy (Anthologie grammaticale arabe, 1829). A. Kilito nous montre ici que le XIXe siècle français, celui des savants du moins, n’ignorait pas ce chef d’œuvre de la culture arabe, dont Renan signale que "peu d’ouvrages ont exercé une influence littéraire aussi étendue […] : De la Volga au Niger, du Gange au détroit de Gibraltar, elles ont été le type du bel esprit et du beau style pour tous les peuples qui ont adopté avec l’islamisme la langue de Mahomet". Néanmoins, l’ironie de l’histoire veut que, du temps d’Harîri, ses confrères doutèrent durablement qu’il fût l’auteur effectif
des Nuits au XVIIIe siècle aura été le moment d’émergence en lisibilité – au moins partielle – de cette figure jusque-là celée dans le tapis ; mais si en retour, selon A. Kilito, la littérature arabe moderne apprit à pratiquer des genres (le roman, la nouvelle, le théâtre) qui étaient dans l’ensemble étrangers à sa tradition, sa poésie et beaucoup de ses plus grands classiques restent encore largement ignorés en Occident – sauf quand le canon autorise un lien : Kalila et Dimna, grâce à La Fontaine, les Séances de Hamadhâni et de Harîri via le roman picaresque, l’Épître au pardon de Ma`arrî par la Divine Comédie, etc. L’élégance de l’ouvrage est précisément de partir de là pour engager l’initiation. Reste évidemment qu’à l’échelle des passionnés, c’est autre chose. On apprend ainsi en lisant le chapitre consacré à Perec et Harîri (lequel est mentionné dans La Vie mode d’emploi), que si le premier n’a peut-être pas lu le second (quoique le citant), Renan, qui était arabisant, l’avait lu, sans doute dans le commentaire "en arabe" du grand orientaliste Sylvestre de Sacy (Anthologie grammaticale arabe, 1829). A. Kilito nous montre ici que le XIXe siècle français, celui des savants du moins, n’ignorait pas ce chef d’œuvre de la culture arabe, dont Renan signale que "peu d’ouvrages ont exercé une influence littéraire aussi étendue […] : De la Volga au Niger, du Gange au détroit de Gibraltar, elles ont été le type du bel esprit et du beau style pour tous les peuples qui ont adopté avec l’islamisme la langue de Mahomet". Néanmoins, l’ironie de l’histoire veut que, du temps d’Harîri, ses confrères doutèrent durablement qu’il fût l’auteur effectif 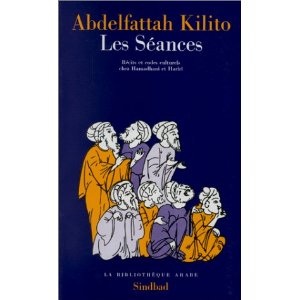 de ces prestigieuses Séances, et qu’aujourd’hui leur fortune littéraire soit inversement proportionnelle à celle des Mille et Une Nuits : "leur écriture, basée sur l’exhibition rhétorique a fini par être perçue comme un héritage stérile et encombrant […] les Séances sont devenues illisibles". Sic transit…
de ces prestigieuses Séances, et qu’aujourd’hui leur fortune littéraire soit inversement proportionnelle à celle des Mille et Une Nuits : "leur écriture, basée sur l’exhibition rhétorique a fini par être perçue comme un héritage stérile et encombrant […] les Séances sont devenues illisibles". Sic transit…
Mais est-ce bien sûr ? Et d’abord en quoi consiste cette forme de la "séance" ? Il y a "maqâma" quand un auteur donne la parole, sur le mode fictif, à un ou plusieurs personnages. Ce mot désigne aussi bien un genre (récit impliquant le retour des personnages et obédience au thème de la gueuserie) qu’un type de discours (l’auteur n’assume pas directement la parole mais la prête à des personnages fictifs, d’où une parenté avec des formes comme le banquet, la fable, la controverse). La maqâma a dès le début connu une transmission écrite : l’auteur fait recopier son manuscrit et le contresigne après l’avoir vérifié. Les grands classiques sont Hamadhani et Harîri (Xe-XIe siècle). Or l’excitant, pour notre "postmodernité" sampleuse et recycleuse, de ce que montre l’article consacré à Perec et Harîri, c’est que ce classique entre les classiques consiste en une sorte d’exercice (oulipien avant la lettre) de montage de plagiats. En effet, " à en croire le grammairien Ibn al-Khashshâb (ses composantes) sont en majeure partie des emprunts" – A. Kilito ajoutant d’ailleurs que "loin de lui en faire le moindre reproche […] (il) y voit le signe d’un mérite admirable !" ; ainsi, poursuit-il : "l’un des plus grands livres de la littérature arabe, sinon le plus grand, ne serait […] qu’un démarquage. Le même grammairien ajoute que (l’auteur) a consacré toute sa vie à l’écriture de son livre, autrement dit à réussir un plagiat parfait. Décidément, un livre plagié s’avère plus difficile à faire qu’un livre original". Il paraît que W. Benjamin ne rêvait pas autre chose pour son concept du livre idéal : nous rejoignons ici le principe de la littérature comme plagiat généralisé qui inspire après Pierre Ménard tels Européens modernes (et Butor avant Perec) et où la fameuse formule ducassienne : "le plagiat est nécessaire, le progrès l’implique", s’avère finalement l’harmonique d’une secrète fondamentale.
L’aveuglement d’Averroès : un miroir
L’un des grands plaisirs qu’on prend en lisant A. Kilito, c’est de toucher discrètement mais constamment aux quelques problèmes essentiels qui font la littérature, dans un éclairage toujours un peu borgésien. Des problèmes qui sont toujours des paradoxes ou des apories – et c’est leur propre – car ici, ceux qui sont authentiquement concernés par la chose travaillent dans les ténèbres (ainsi disait, je crois, l’auteur de Nocturne indien à propos de l’étrange métier d’écrire). Tel Averroès par exemple, qui consacrait ses nuits à la philosophie, une fois acquittées ses responsabilités juridiques. Méditant sur la nouvelle de Borgès intitulée La quête d’Averroès, A. Kilito nous peint le fameux penseur bloqué sur deux mots d’une langue qu’il ignore (le grec) au cours de sa polémique avec le théologien Ghazâli : "ces mots étaient tragoedia et comoedia. Il les avait déjà rencontrés des années auparavant, au livre troisième de la Rhétorique, personne dans l’Islam n’entrevoyait ce qu’ils voulaient dire. Impossible de les éluder tant leurs occurrences sont nombreuses…" A.  Kilito rectifie les références arabes de Borgès et rend à Abû Bishr Mattâ (Xe siècle) la paternité de la traduction de la Poétique d’Aristote d’après une version syriaque, selon laquelle le panégyrique et la satire correspondent à ce qu’Aristote vise sous les deux mots concernés : contresens qui privera durant neuf siècles, écrit-il, la culture arabe d’une rencontre possible avec le théâtre. Cependant, l’ironie de Borgès veut que l’Averroès de sa nouvelle ait rencontré ce jour-là ce qu’il cherchait, mais à son insu: par la fenêtre de son cabinet, il a vu jouer des enfants, l’un faisant le minaret et portant sur ses épaules celui qui faisait l’iman, tandis que le troisième, prosterné, incarnait les fidèles – et dans la soirée, il a entendu un voyageur rapporter les incroyables amusements des Chinois figurant des histoires en certains lieux publics, au lieu de les confier, comme il est naturel, à la seule voix d’un conteur.
Kilito rectifie les références arabes de Borgès et rend à Abû Bishr Mattâ (Xe siècle) la paternité de la traduction de la Poétique d’Aristote d’après une version syriaque, selon laquelle le panégyrique et la satire correspondent à ce qu’Aristote vise sous les deux mots concernés : contresens qui privera durant neuf siècles, écrit-il, la culture arabe d’une rencontre possible avec le théâtre. Cependant, l’ironie de Borgès veut que l’Averroès de sa nouvelle ait rencontré ce jour-là ce qu’il cherchait, mais à son insu: par la fenêtre de son cabinet, il a vu jouer des enfants, l’un faisant le minaret et portant sur ses épaules celui qui faisait l’iman, tandis que le troisième, prosterné, incarnait les fidèles – et dans la soirée, il a entendu un voyageur rapporter les incroyables amusements des Chinois figurant des histoires en certains lieux publics, au lieu de les confier, comme il est naturel, à la seule voix d’un conteur.
Mais l’apologue ne vaut-il pas pour toutes les cultures ? Si dans un ouvrage antérieur, La Langue d’Adam et autres textes (Casablanca, 1999), A. Kilito peignait déjà Averroès "condamné à se tromper d’un bout à l’autre de son ouvrage, à errer dans un labyrinthe inextricable, sans issue", parce qu’il avait cédé à la tentation de comprendre la littérature grecque à partir de la littérature arabe (p. 62), le vieux penseur andalou offre en fait une figure en miroir de celle par laquelle la culture occidentale depuis Galland s’imagine comprendre la culture arabe (cf. E. Saïd, L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Seuil) : figure au bout du compte de l’irréductible de chaque langue et de la littérature qui en émane.
Le livre dans le livre : Kalila et Dimna
Toute traduction est une sorte de conquête, pensait Nietzche ; mais traduire est aussi recueillir et recréer. La Fontaine, par exemple, ne serait pas lui-même s’il n’avait rencontré Kalila et Dimna dans le Livre des Lumières ou la conduite des rois, publié en 1615 à Leyde en édition bilingue arabo-latine et traduit en vers latins en 1673 : c’était le plus récent avatar, à cette époque et en Europe, d’une très longue histoire de traductions successives (celle de Galland publiée par Gueullette au XVIIIe siècle en fut un nouveau chaînon), et dont le livre lui-même fait remonter l’origine à l’enseignement du sage hindou Bidpaï dispensé au roi de l’Inde Debshelim, à peu près contemporain d’Alexandre. (Pour une histoire de cette transmission depuis le Pantchatantra indien, Ve-VIe siècle, voir l’introduction d’André Miquel à sa traduction de Kalila et Dimna, Klincksieck).
 L’injustice flagrante du roi à l’égard de ses sujets a motivé la démarche du sage qui ne supporte pas l’idée qu’on puisse dire un jour qu’il s’est tu. La prison immédiate est sa récompense mais son courage fait son chemin dans l’esprit du roi, qui finalement le libère et lui demande d’écrire un livre de sagesse qui les immortalisera. Bidpaï choisit de ne délivrer son enseignement qu’indirectement, sous la forme de fables animalières qu’il conseille en outre de celer soigneusement, une fois l’oreille royale avertie de leur contenu. "Par cette décision, Bidpaï se condamne à ne pas être lu", remarque A. Kilito ; et c’est une autre facette de sa réflexion qui se découvre alors : celle des rapports entre la littérature et le secret. Bidpaï craint l’usage que les Persans pourraient faire de son enseignement ; à juste titre puisque ayant appris l’existence de son livre, ceux-ci n’ont de cesse de se le procurer (la gloire en revient à l’habileté du médecin Borzouyeh) – le livre inscrivant ici par allégorie la geste de sa capture/traduction en persan. (On se dit soudain qu’un des paradoxes des Mille et Une Nuits est que les histoires de Scheherazade et de certains protagonistes sont recopiées en lettre d’or sur ordre du Sultan et versées au trésor royal interdit à quiconque est extérieur à la sphère du pouvoir. Comment se fait-il alors que le secret en soit éventé par la circulation des contes ?)
L’injustice flagrante du roi à l’égard de ses sujets a motivé la démarche du sage qui ne supporte pas l’idée qu’on puisse dire un jour qu’il s’est tu. La prison immédiate est sa récompense mais son courage fait son chemin dans l’esprit du roi, qui finalement le libère et lui demande d’écrire un livre de sagesse qui les immortalisera. Bidpaï choisit de ne délivrer son enseignement qu’indirectement, sous la forme de fables animalières qu’il conseille en outre de celer soigneusement, une fois l’oreille royale avertie de leur contenu. "Par cette décision, Bidpaï se condamne à ne pas être lu", remarque A. Kilito ; et c’est une autre facette de sa réflexion qui se découvre alors : celle des rapports entre la littérature et le secret. Bidpaï craint l’usage que les Persans pourraient faire de son enseignement ; à juste titre puisque ayant appris l’existence de son livre, ceux-ci n’ont de cesse de se le procurer (la gloire en revient à l’habileté du médecin Borzouyeh) – le livre inscrivant ici par allégorie la geste de sa capture/traduction en persan. (On se dit soudain qu’un des paradoxes des Mille et Une Nuits est que les histoires de Scheherazade et de certains protagonistes sont recopiées en lettre d’or sur ordre du Sultan et versées au trésor royal interdit à quiconque est extérieur à la sphère du pouvoir. Comment se fait-il alors que le secret en soit éventé par la circulation des contes ?)
Contrairement aux Mille et Une Nuits, Kalila et Dimna, dans la traduction d’Ibn al-Muqaffa` (VIIIe siècle) a toujours été considéré comme un texte important par les lettrés arabes ; un livre dont ce traducteur premier écrit sans ambages que "lorsqu’on connaîtra l’ouvrage, on sera assez enrichi pour se passer de tout autre". C’est qu’il y a lecture et lecture : "ce livre tout en étant un, poursuit Ibn al-Muqaffa`, contient deux livres distincts, l’un apparent, l’autre caché, il est par conséquent susceptible de deux lectures, l’une pour les esprits vulgaires et l’autre pour les esprits réfléchis". Ainsi, au recel physique du texte souhaité par Bidpaï, supplée son cryptage littéral, évidemment figuré dans la première figure : les vrais textes, les textes authentiquement utiles sont occultes dans leur lettre même : très ancienne partition de l’ésotérique et de l’exotérique dont Léo Strauss a posé quelques jalons essentiels dans son fameux livre sur La persécution et l’art d’écrire (rééd. Gallimard, "Tel", 2009) ; partition dont les "philosophes" européens du XVIIIe siècle tentèrent la transgression à cette époque de diffusion délibérée des Lumières hors de la sphère lettrée, mais dont toute l’histoire politique terrible du XXe siècle et du XXIe siècle commençant montre absolument partout l’évidente nécessité.
L’approche méditative de la littérature pratiquée par A. Kilito aide le lecteur à frayer sa propre voie au pays des Lettres arabes anciennes : on y prend conscience de ce qu’on ignore, on modifie sa perspective sur le peu qu’on connaît, on y gagne quelque ironie à l’égard de soi mais aussi l’envie d’aller plus loin ; pas une ligne, en effet qui n’exprime la certitude de la possibilité d’un partage – d’ailleurs engagé de longue date dans notre histoire culturelle, si l’on veut bien s’en aviser. (Re)commençons par là, puisqu’on nous y invite.
![[Libr-relecture] KILITO, Les Arabes et l'art du récit, par J.-N. Clamanges](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)