 Patrick Varetz, Bas monde, P.O.L, avril 2012, 192 pages, 14 €, ISBN : 978-2-8180-1627-5.
Patrick Varetz, Bas monde, P.O.L, avril 2012, 192 pages, 14 €, ISBN : 978-2-8180-1627-5.
"La réalité de ce monde, à quelque endroit qu’elle transparaisse, se révèle empreinte d’ironie et de mystère" (p. 30).
De l’univers concentrationnaire à la cellule familiale – la bien nommée -, tel est l’itinéraire qu’emprunte Patrick Varetz de son premier (Jusqu’au bonheur) à son deuxième roman, qui nous emmène jusqu’à l’envers du bonheur. Dans un bas monde où l’humanité tient à/dans peu de choses : quatre murs, une boîte à chaussures, un sac de mouchoirs souillés… et quelques rêves d’ailleurs. Autant dire rien. [Lire le dernier entretien avec l’auteur]
Bas monde tragique
"En ce bas monde, on n’accomplit rien de son propre chef :
il faut obéir ou, à défaut, offrir des signes tangibles de soumission" (p. 129).
Bas monde nous plonge dans un huis clos tragique qui semble relever d’une expérience pascalienne : l’univers se réduit à un appartement-cachot de 30 m2, dans lequel un trio familial est livré à sa "fascination du pire" (121). Les adjectifs récurrents pour désigner la mère : "pauvre" et "folle" ; le père : "pauvre" et "salaud". Ces 30 m2 délimitent le seul territoire où s’exerce l’emprise du père, tyran domestique dont la violence trahit l’impuissance et le conduit à la détestation de soi. La déchéance de ce "type sans bagage et sans avenir" (19) n’est pas sans susciter cette question : "Comment peut-on, avec autant d’indignité, s’accrocher à l’existence ?" (169). Et si une telle épave n’a pas sa place dans le monde, qu’en est-il de son fils qui vient de naître ? Sa place : un carton à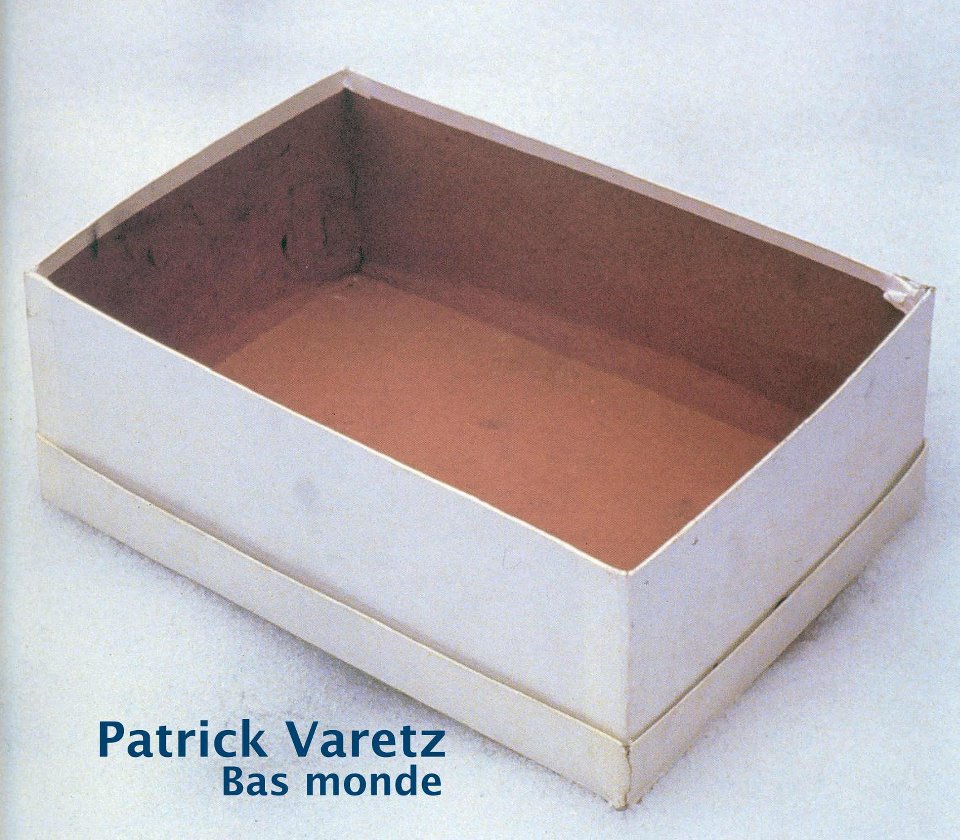 chaussures. Dans ces conditions, comment échapper à son destin tout tracé : de la mise en boîte à la mise en bière ?
chaussures. Dans ces conditions, comment échapper à son destin tout tracé : de la mise en boîte à la mise en bière ?
Dans ce bas monde tragique, les jeux sont faits et les rôles pré-établis. L’existence est un éternel recommencement, les êtres déchus étant prisonniers d’un temps circulaire. L’engrenage tragique dont nous sommes témoins peut se formuler ainsi : le bas monde est rempli de choses qui nous demeurent étrangères ; la mère demande au père de faire quelque chose ; le père fait de la mère sa chose ; le médecin fait du nourrisson sa chose, lequel a une drôle de chose dans le ventre… Ou encore : le docteur Caudron met dans ce bas monde cet avorton de Daniel, lequel reçoit de sa femme Violette un avorton de fils, lequel renferme à son tour dans le ventre un avorton… Ou encore : le père se décharge de son angoisse sur la mère, la mère sur le fils, et le fils sur l’avorton… À chacun sa "boule grise" : le père dans sa poitrine, la mère dans le sac du placard – qui contient les mouchoirs de son mari, souillés de foutre – et le fils dans le ventre… Bas monde nous plonge bel et bien dans l’innommable !
Cet innommable bas monde revêt une dimension beckettienne dès la première phrase : "Je n’appartiens pas à ce monde et j’ignore qui m’y a jeté et pourquoi". Pire : "L’origine de la vie est un cauchemar" (130). L’existence est non seulement incompréhensible, mais 
Le tragique est ici socialement circonstancié : "d’un tissu détestable de circonstances, on en déduit pour moi, avec une certitude écrasante, le sens – tragique – de toute chose" (146). Que peuvent espérer de l’existence ceux sont "relégués dans les bas-fonds du monde" (135) ? Là où règnent les bas instincts et où la fatalité prend la forme de la reproduction sociale : "les ordures, toujours, engendrent des ordures" (140). Pour sortir de sa condition, la jeune Violette en est réduite à nager "en plein roman" comme une Bovary : "il saura se saigner et échapper à sa condition pour lui offrir le bien-être qu’elle est en droit d’espérer" (75). L’irréalisation de soi pour combler le décalage entre l’espace des possibles objectif et l’espace des possibles souhaité… L’espace du rêve pour fuir la clôture du bas monde… Mais nulle échappatoire : le "flonflon d’un bal" est horrible, la valse est "boiteuse" et le vertige "funeste" (83)… Nulle harmonie, ne fût-ce que pour un seul soir, dans le monde ingrat où vit la jeune épouse : la vie n’est pas une fête, et la danse ne saurait être un refuge pour une femme enceinte… Fausse route, fausse couche.
Bas monde des faux-semblants
"Le bonheur, tel qu’annoncé chaque matin par la voie des ondes, s’apparente à une dangereuse lubie, puisqu’il nous faut – pour y prétendre – dissimuler au fond de nous – de chacun d’entre nous, de chaque personnalité qui nous constitue – un irréductible passif de culpabilité et de peur" (165).
Si Violette aspire à un "bien-être qu’elle est en droit d’espérer", c’est que la seconde moitié des années cinquante voit la phase ascendante des Trente Glorieuses : comme "les temps changent" (179), s’ouvre "un monde nouveau promis au bonheur" (48)… Un bonheur lié à la natalité et à la consommation : Faites des enfants, consommez et soyez heureux !, tel  est le message que serine la radio à longueur de journée… Le bonheur est une construction sociale, une idéologie propagée par l’air du temps. Contre "le malheur programmé de notre existence" (139), la société d’abondance a inventé une nouvelle forme de bonheur : le bien-être. Aussi, pour le bonheur des siens, la grand-mère veut-elle le progrès à tout prix ; et d’acheter une télévision ! Seulement, en dépit de l’imagerie sotériologique, cette "expansion incontrôlable" du bonheur générée par la société de consommation contraste avec le "rétrécissement du possible" pour les mal lotis (122) : dans Les Choses (1965), Georges Perec a le premier mis en lumière le décalage entre l’espace objectif des possibles et l’espace des aspirations entretenues par les discours promotionnels. Sans compter que le prêt-à-porter du bonheur est une prison et que l’envers du progrès en marche n’est autre que l’odeur que ramène le père de l’usine pétrochimique où l’on fabrique des matières synthétiques censées adoucir l’existence.
est le message que serine la radio à longueur de journée… Le bonheur est une construction sociale, une idéologie propagée par l’air du temps. Contre "le malheur programmé de notre existence" (139), la société d’abondance a inventé une nouvelle forme de bonheur : le bien-être. Aussi, pour le bonheur des siens, la grand-mère veut-elle le progrès à tout prix ; et d’acheter une télévision ! Seulement, en dépit de l’imagerie sotériologique, cette "expansion incontrôlable" du bonheur générée par la société de consommation contraste avec le "rétrécissement du possible" pour les mal lotis (122) : dans Les Choses (1965), Georges Perec a le premier mis en lumière le décalage entre l’espace objectif des possibles et l’espace des aspirations entretenues par les discours promotionnels. Sans compter que le prêt-à-porter du bonheur est une prison et que l’envers du progrès en marche n’est autre que l’odeur que ramène le père de l’usine pétrochimique où l’on fabrique des matières synthétiques censées adoucir l’existence.
Un autre envers : les "rêves de bonheur échafaudés par d’autres" (121) conduisent à l’aliénation et à l’illusion. Ainsi les mariés Daniel et Violette jouent-ils la comédie du bonheur devant le photographe ; Daniel, au Bar Royal (sic !), ferme-t-il les yeux pour vivre sa vie comme un spectacle… Du reste, tout le monde ferme les yeux devant tout ce qui n’est pas conforme à l’espérance promise. Il en est un qui est champion de la mauvaise foi : le docteur Caudron, tel un Salaud sartrien, n’existe que par un rôle social qui lui permet d’assouvir sa volonté de puissance. À l’aise dans une société de faux-semblants, il trône : à califourchon sur sa chaise, il représente le mâle dominant (califourchon provient peut-être du breton kall, "testicules") qui laisse libre cours à son mépris de classe et observe la façon dont les dominés réagissent en milieu hostile. Comme le docteur Kuzlik de Jusqu’au bonheur, le docteur Caudron ne fait pas vraiment dans l’humanisme.
Bas monde et comédie humaine
"À qui appartient cette voix ? Qui, en sous-main, dicte avec acharnement les propos ininterrompus voués à commenter notre existence ?" (164).
Le premier à observer la comédie familiale et sociale avec une distance et une lucidité qui font sourire n’est autre que le narrateur. D’abord embryon puis nouveau-né, ce narrateur fait preuve d’"une connaissance qui excède la conscience" (96) : l’invraisemblable omniscience est le premier aspect problématique que présente la narration. Le second est dû à l’indécidabilité de la voix : qui parle ? "je" ou "nous" ? l’enfançon ou l’avorton ? le moi ou le daimon ? Qui sait, cette voix est peut-être la voix originelle qui nous hante tous : "Elle sera toujours là, au fond de moi, pour me rappeler d’où je viens" (165).
Quoi qu’il en soit, ce qui est frappant, c’est le regard comique et critique que porte sur le  bas monde ce narrateur hors du commun. L’humour noir est omniprésent, qu’il évoque sa mise en boîte , sa survie dans des conditions précaires ou le mal maternel : "Je n’appartiens pas à ce monde, mais l’on a su très tôt m’y aménager une place : un endroit certes inconfortable, cependant bien à moi" (29) ; "Quelques kilos de charbon, deux ou trois paquets d’ouate : cela suffit, pour l’heure, à me maintenir de ce côté-ci du monde" (48) ; "Je n’appartiens pas à ce monde, mais celle qui m’y a jeté – soucieuse que je m’adapte à mon nouvel environnement – me remplit inlassablement de la pire part d’elle-même" (139)… Se lance-t-il dans une interrogation métaphysique, et aussitôt elle se trouve minée par une malencontreuse interjection rappelant qu’il doit sa naissance à un jet de foutre précocement éjaculé : "mais – foutre – comment s’y prend-on pour inoculer aux nouveaux arrivants cette envie naïve de persévérer ? Comme Caudron, moi aussi je m’interroge" (51)… Le cynisme ne lui est pas étranger non plus, avançant que, vu sa ressemblance au père, sa mère "aurait dû [le] faire passer" (140). Dupe ni de lui-même, ni de la comédie humaine, il tourne en dérision ceux que la gêne rend ridicules face à une situation dramatique devenue incongrue dans le nouvel âge d’or. Et de faire le philosophe : "Le café, brûlant, lie les langues et soude les consciences. L’esprit, plus encore que l’œil, est une fente qui se rétrécie à volonté : on ne voit, en ce monde, que ce que l’on veut bien voir" (92-93).
bas monde ce narrateur hors du commun. L’humour noir est omniprésent, qu’il évoque sa mise en boîte , sa survie dans des conditions précaires ou le mal maternel : "Je n’appartiens pas à ce monde, mais l’on a su très tôt m’y aménager une place : un endroit certes inconfortable, cependant bien à moi" (29) ; "Quelques kilos de charbon, deux ou trois paquets d’ouate : cela suffit, pour l’heure, à me maintenir de ce côté-ci du monde" (48) ; "Je n’appartiens pas à ce monde, mais celle qui m’y a jeté – soucieuse que je m’adapte à mon nouvel environnement – me remplit inlassablement de la pire part d’elle-même" (139)… Se lance-t-il dans une interrogation métaphysique, et aussitôt elle se trouve minée par une malencontreuse interjection rappelant qu’il doit sa naissance à un jet de foutre précocement éjaculé : "mais – foutre – comment s’y prend-on pour inoculer aux nouveaux arrivants cette envie naïve de persévérer ? Comme Caudron, moi aussi je m’interroge" (51)… Le cynisme ne lui est pas étranger non plus, avançant que, vu sa ressemblance au père, sa mère "aurait dû [le] faire passer" (140). Dupe ni de lui-même, ni de la comédie humaine, il tourne en dérision ceux que la gêne rend ridicules face à une situation dramatique devenue incongrue dans le nouvel âge d’or. Et de faire le philosophe : "Le café, brûlant, lie les langues et soude les consciences. L’esprit, plus encore que l’œil, est une fente qui se rétrécie à volonté : on ne voit, en ce monde, que ce que l’on veut bien voir" (92-93).
![[Chronique] Patrick Varetz, Bas monde (dossier 3/3)](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)