 Comme premier volet du diptyque consacré à Liliane Giraudon, voici l’entretien qu’a mené à bien un poète de la génération suivante dont il a déjà été beaucoup question sur Libr-critique : Sylvain Courtoux. Le second portera sur son dernier livre, Les Pénétrables – qui est du reste évoqué dans cette discussion passionnante.
Comme premier volet du diptyque consacré à Liliane Giraudon, voici l’entretien qu’a mené à bien un poète de la génération suivante dont il a déjà été beaucoup question sur Libr-critique : Sylvain Courtoux. Le second portera sur son dernier livre, Les Pénétrables – qui est du reste évoqué dans cette discussion passionnante.
► Sylvain COURTOUX. Tu as fait je crois de tout, des nouvellles figuratives, de la poésie blanche, expérimentale (Marquise vos beaux yeux – avec Grangaud, Portugal et Lapeyrère), post-poétique (La poétesse), de la prose expérimentale (Homobiographie ou Sker) ou pas, de la bande dessinée (Le rasoir de Borges) des carnets de voyage expérimentaux (Les talibans n’aiment pas la fiction), des listes , des livres en formes d’hommages poétiques (comme VK à la main courante), des chroniques non figuratives, de la traduction et j’en passe… ce qu’on pourrait peut-être appeler, comme tu le fais au tout début de « Divagation des chiens », des « mélanges adultères de tout »…
► Liliane Giraudon. Peut-être que dans l’expression « faire de tout » (qui pourrait être très péjoratif si on faisait précéder l’expression par « un peu » – un peu de tout) il y aurait  un signe ou le symptôme de l’absence de cette vertu cardinale qu’est la patience. Ou bien quelque chose proche en dermatologie d’une maladie de peau… on se gratte… on veut se défaire… Ecrire comme on se gratte. Ce n’est peut-être pas si imbécile que ça après tout. On peut aussi plus noblement évoquer une théorie voyageuse, du type nomade, inséparable d’une guerre de mouvement. Et puisque toute guerre est guerre de position, des manœuvres de dégagement.
un signe ou le symptôme de l’absence de cette vertu cardinale qu’est la patience. Ou bien quelque chose proche en dermatologie d’une maladie de peau… on se gratte… on veut se défaire… Ecrire comme on se gratte. Ce n’est peut-être pas si imbécile que ça après tout. On peut aussi plus noblement évoquer une théorie voyageuse, du type nomade, inséparable d’une guerre de mouvement. Et puisque toute guerre est guerre de position, des manœuvres de dégagement.
Mon premier livre chez P.O.L en 82 (ça fait 30 ans !) avait un titre programmatique… « Je marche ou je m’endors ». C’est vrai que je n’ai pas suivi le sillon du label (recette courante où l’écrivain par son style, ses tics, s’expose au regard du lecteur de manière à en être immédiatement reconnu (suce c’est du X). Le territoire de la poésie (institutions ou contre- institutions) m’est très vite apparu comme un enjeu de propriétaires pratiquant l’exclusion ou la cooptation. Des guéguerres de gros garçons sur un bac à sable (chacun le sien et les frontières sont gardées).
Moi j’ai toujours aimé le micmac. Les marges. Tester des formes en les traversant. Y expérimenter autant de travail que d’incertitudes, de hasard que de volonté. Pour aller vite, disons que je ne pense pas que la poésie soit un secteur mineur ; bien au contraire, elle m’est toujours apparue comme un lieu de ségrégation et de domination masquée. Elle est une institution avec ses appareils et parce qu’elle échappe au « commerce » justement le valorise, lui substituant de plus subtils outils d’oppression et (sous couvert de résistance) y collabore. C’est là qu’on trouve les pires petites bétonneuses idéologiques qui comme la loi du « prêt à porter » démolissent la collection saisonnière concurrente. Un « make it new » régulièrement détourné, trahi (avec profits et pertes). La poésie increvable compromet ceux-là mêmes qui veulent la crever (« celui qui le dit c’est celui qui l’est ! » crient les enfants)… Mais Denis Roche au siècle dernier avait déjà soulevé le lièvre. N’empêche, dans les années 80, entendre des poètes « aînés » parler du roman comme d’une pratique impure quasi prostitutionnelle avait quelque chose de violent et m’a fait réfléchir.
Autrement dit, c’est sans doute intuitivement et en gardant une certaine conscience d’oppression (économique, ethnoraciale et de genre) au travail dans ce milieu comme ailleurs que j’ai procédé à du brouillage, par mélanges, hybridations. On brouille des œufs pour qu’ils prennent. On commence par les casser. C’est la loi de l’omelette. Et moi je suis une femmelette. Se déplacer dans des « formes » différentes, traverser des genres, c’était peut-être tenter d’échapper à un système de contrôle, au rêve des autres (très dangereux le rêve des autres autant que notre désir d’auto-contrôle)… en restant proche d’une « nécessité », une sorte de pulsion immédiate proche de celle qui, enfant de la campagne (paysanne !) enfermée dans une « institution », m’avait jetée dans les livres pour y survivre.
Je me souviens d’un documentaire de Resnais et Marker, « Les statues meurent aussi », où ils avaient introduit un grand singe éventré par une machette. Cette image continue à me hanter au point que je me demande si cette image est réelle. Ce grand singe, c’est à lui que je voudrais adresser tous mes livres…
Et le mot film brusquement me rabat sur Paul Otchakovsky Laurens mon éditeur, celui qui m’a suivie dans mes zigzags, dans mon micmac. Il a pris tous les risques et il persévère. Sans lui et ceux (celles) qui m’ont publiée je ne sais pas si j’aurais trouvé les forces de poursuivre.
► Tu as aussi pendant dix ans codirigé la revue Banana Split et après, La nouvelle BS qui fut un temps une collection chez Al Dante. Tu as un parcours très peu banal (surtout pour une figure tutélaire comme toi, du moins pour moi). Et je me demandais presque innocemment comment tu te situais dans le champ poétique contemporain. Du côté des grands anciens de la poésie blanche, du côté des poésies sonores, visuelles, expérimentales, ou du côté de la poésie carnavalesque, ou encore complètement ailleurs ? Et je me demandais si ce n’était pas tes goûts très variés qui t’auraient fait suivre ce chemin tout à fait iconoclaste ? Dis-moi…
► L’aventure des revues Banana Split avec Jean-jacques Viton dans les années 80 (ce fanzine photocopié et transversal à l’époque des jolis petits tirages numérotés) puis IF, la Nouvelle BS et Action Poétique avec Henri Deluy ont été pour moi des aventures capitales. C’est là que j’ai appris à lire mes contemporains, à m’ouvrir à « l’épreuve de l’étranger », à revisiter les œuvres du passé tout en essayant d’habiter le présent. Toute une série d’expériences qui m’ont alertée sur la nécessité d’apprendre à penser autrement, marginalement, la question c’est quoi écrire, faire des livres, des lectures publiques… La littérature n’échappe pas au circuit d’une destruction générale où l’enjeu semble se limiter à capter l’attention pour écouler des produits. C’est ce que nous révèlent chaque jour un peu plus les industries culturelles. Ça a été dit cyniquement (« nous vendons du temps disponible… ») mais ça se fait plus ou moins avec la complicité de tous. Le marketing infiltre les nouveaux médias et participe activement à une véritable misère mentale. Pour une femme de ma génération, l’aventure est énorme et dépasse le fait de simplement « se situer dans le champ poétique contemporain ». Etre du côté des
Nouvelle BS et Action Poétique avec Henri Deluy ont été pour moi des aventures capitales. C’est là que j’ai appris à lire mes contemporains, à m’ouvrir à « l’épreuve de l’étranger », à revisiter les œuvres du passé tout en essayant d’habiter le présent. Toute une série d’expériences qui m’ont alertée sur la nécessité d’apprendre à penser autrement, marginalement, la question c’est quoi écrire, faire des livres, des lectures publiques… La littérature n’échappe pas au circuit d’une destruction générale où l’enjeu semble se limiter à capter l’attention pour écouler des produits. C’est ce que nous révèlent chaque jour un peu plus les industries culturelles. Ça a été dit cyniquement (« nous vendons du temps disponible… ») mais ça se fait plus ou moins avec la complicité de tous. Le marketing infiltre les nouveaux médias et participe activement à une véritable misère mentale. Pour une femme de ma génération, l’aventure est énorme et dépasse le fait de simplement « se situer dans le champ poétique contemporain ». Etre du côté des 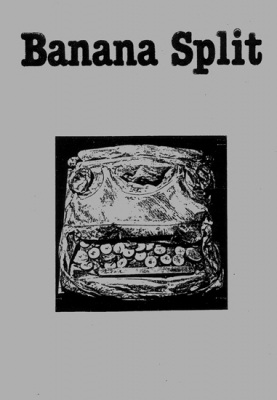 « blancs » ou des visuels ou des sonores me semble très obsolète. A te dire vrai, je m’en fous. Il y a belle lurette que je ne me pose plus la question. Je travaille, j’essaie de comprendre. C’est difficile. Les réseaux sont depuis longtemps court-circuités…Je pourrais dire que ce travail avec les autres, dans leur diversité (leur différence) m’a appris le dessaisissement. Je sais que nous sommes pris dans des dispositifs autrement dangereux. Nous sommes désarmés. Nous devons inventer de nouvelles armes, fabriquer de nouveaux concepts, inventer d’autres espaces. Les circuits de constructions sociales sont détruits, ruinés. Le simple fait d’investir dans un objet de désir de manière durable (c’est inséparable du savoir) devient problématique. J’ai enseigné en collège dans la banlieue de Marseille prés de 30 ans, et ça a été pour moi une autre « bibliothèque » celle des visages et des vies dont on ne veut pas, qu’on voudrait tenir parqués en périphérie. Je sais aussi que la contemporanéité est une singulière relation avec son temps et que « le contemporain c’est l’inactuel », il faut donc maintenir un écart, une distance. Cet après coup du maintenant. Une sorte d’activisme du passé simple. Je peux dire que l’expérience de la maladie m’apporte beaucoup dans ce travail de distanciation. Le cancer a une fonction très semblable à celle de la prison dont Genet précisait magnifiquement « c’est là qu’on échappe à l’accessoire »…
« blancs » ou des visuels ou des sonores me semble très obsolète. A te dire vrai, je m’en fous. Il y a belle lurette que je ne me pose plus la question. Je travaille, j’essaie de comprendre. C’est difficile. Les réseaux sont depuis longtemps court-circuités…Je pourrais dire que ce travail avec les autres, dans leur diversité (leur différence) m’a appris le dessaisissement. Je sais que nous sommes pris dans des dispositifs autrement dangereux. Nous sommes désarmés. Nous devons inventer de nouvelles armes, fabriquer de nouveaux concepts, inventer d’autres espaces. Les circuits de constructions sociales sont détruits, ruinés. Le simple fait d’investir dans un objet de désir de manière durable (c’est inséparable du savoir) devient problématique. J’ai enseigné en collège dans la banlieue de Marseille prés de 30 ans, et ça a été pour moi une autre « bibliothèque » celle des visages et des vies dont on ne veut pas, qu’on voudrait tenir parqués en périphérie. Je sais aussi que la contemporanéité est une singulière relation avec son temps et que « le contemporain c’est l’inactuel », il faut donc maintenir un écart, une distance. Cet après coup du maintenant. Une sorte d’activisme du passé simple. Je peux dire que l’expérience de la maladie m’apporte beaucoup dans ce travail de distanciation. Le cancer a une fonction très semblable à celle de la prison dont Genet précisait magnifiquement « c’est là qu’on échappe à l’accessoire »…
Un chemin iconoclaste ? Quelle drôle d’idée… Je ne proscris ni ne détruis aucune image pas plus les saintes que les autres. J’essaie d’écrire et de rester vivante. Poursuivre mon micmac…
► En ce qui concerne ton dernier "micmac", Les Pénétrables, tu dis une chose intéressante dans la vidéo explicative que l’on trouve sur le site de POL et sur youtube, tu dis que pendant longtemps, toi et beaucoup de poètes de ta génération, méprisaient d’écrire sur leurs vies, leurs vies matérielles et quotidiennes, l’autobiographie quoi ! Il y a des contre-exemples, bien sûr, comme le Quelque Chose Noir de Roubaud ou le Commencement de Prigent, mais on est déjà dans les années 80 ; on parle beaucoup aujourd’hui de "peopolisation" de la vie politique et publique, on peut dire de même dans la littérature française, ce triomphe de l’individualisme et de l’égotrip ultime, de l’auto-fiction ou de l’hétérographie, toi qui a toujours été très attaché au "formel", comment interprètes-tu ce glissement biographique ? Et, aussi, pourquoi as-tu si longtemps, je comprends que cela soit (peut-être) aussi un phénomène générationnel, "méprisé" ou avoir voulu écarter le fait (auto-)biographique dans tes précédents livres et pourquoi l’avoir réactivé avec ces portraits d’auteurs en forme de liste, ces « bustiers » comme tu les appelles dans l’avertissement de Les Pénétrables ?
► Dans cet entretien je parle de « biographie » au sens de biographus, c’est à dire un auteur qui écrit la vie, l’existence d’une personne. Il s’agit d’un récit de vie et ce genre existait déjà dans l’antiquité latine avec Suétone ou Plutarque. Enfant j’ai lu beaucoup de vies de saints et d’adaptations de vies de savants et d’artistes de la Renaissance. J’étais (sans le savoir) fascinée par cette indécision entre fiction et document, vérité et mensonge. Dans les années 70 cette pratique était inavouable, peu noble, quasi ignoble. Je ne parle pas d’autobiographie mais c’est interessant que le terme « biographie » t’ait rabattu sur de l’autobiographie. Au passage je m’aperçois que le verbe « biographier » que je trouve assez beau a été totalement abandonné.
Disons que la liquidation du sujet s’accordait mal avec certaines pratiques. Dans le nettoyage des écuries littéraires il fallait régler plusieurs comptes. En finir avec l’imagerie poétique du type « la terre est bleue comme une orange ». Ponge avait introduit de la lumière dans la baraque. Certains d’entre nous prolongeaient l’héritage de Mallarmé à la lecture des traductions d’un Pound et d’un Khlebnikov… La Ursonate d’un Switters scintillait comme un astre neuf… Le sujet lyrique, il fallait le noyer. Nos singularités, elles .jpg) étaient communes. Ce qui importait c’était de travailler les singularités de la langue. En ce qui me concerne, je n’ai jamais craché sur l’autobiographie puisque j’ai régulièrement « monté » des morceaux de « cahiers », sorte justement de « caillé » au sens du lait tourné, ce qu’on refoule et qui revient. J’ai même bricolé un outil que j’ai appelé « homobiographie », consciente que toute vie est celle de tout le monde, toute vie est commune et en ce sens politique.
étaient communes. Ce qui importait c’était de travailler les singularités de la langue. En ce qui me concerne, je n’ai jamais craché sur l’autobiographie puisque j’ai régulièrement « monté » des morceaux de « cahiers », sorte justement de « caillé » au sens du lait tourné, ce qu’on refoule et qui revient. J’ai même bricolé un outil que j’ai appelé « homobiographie », consciente que toute vie est celle de tout le monde, toute vie est commune et en ce sens politique.
Pour ce qui est des Pénétrables, c’est autre chose. J’ai réfléchi au portrait. C’est quoi un portrait ? Un buste ? Comment, en objet verbal, dresser le buste par exemple de Benjamin ou de Becket ou d’Emily Dickinson. J’ai pensé à leur visage. A leur corps. Ces corps machines à semence des livres qui m’ont formée, aidée à vivre. Détournée de la mort, de sa pulsion… Et j’ai ciselé ces bustes non pas en forme de liste mais en accumulation de scènes successives à la manière d’un cinématon élémentaire. Comme on feuillette un album d’images.
► Un auteur que j’adore, Benoît Sabatier, dans son livre sur la culture jeune de Elvis à Myspace, Nous sommes jeunes, nous sommes fiers (Hachette-Littératures, 2007), explique que l’art a deux fonctions pour lui (et une de ses thèses est que la subversion dans l’art, et notamment dans la culture rock, a depuis un bail était court-circuitée par la marchandisation de masse et la récupération tous azimuts) : 1. inventer de nouvelles formes esthétiques (ou essayer) 2. provoquer des émotions saisissantes. Quel est, pour toi, la fonction de la poésie, en général, et en particulier par rapport à ton écriture et la littérature que tu défends aujourd’hui ?
► Bien sûr ce programme en deux temps est très intéressant. Innover dans la forme et provoquer de l’émotion, c’est je crois ce que tout écrivain ou tout artiste désire, non ? Je n’ai pas lu « Nous sommes jeunes nous sommes fiers », mais je vais réparer ce manque… En ce qui me concerne, je suis vieille et pas particulièrement fière. J’essaie d’être contemporaine du monde que j’habite, c’est à dire de comprendre ce qui s’y passe, de l’interroger. Il me semble parfois que la toxicité s’est généralisée et que le psychopouvoir envahit tout. La destruction économique et ses ravages (humains, écologiques) me laisse hébétée… La fonction de la poésie et plus largement de la littérature, de l’art, c’est justement de « fonctionner » dans la conscience de ce monde-là. De ce qui s’y joue. En rendre compte non pas de manière réaliste mais intrinsèque. Face à la stratégie de la diversion, du divertissement vide qui de manière incessante travaille à détourner l’attention de chacun des problèmes importants qui nous assaillent…
► Ta génération, mais toi aussi, n’a jamais été très proche de la culture populaire, que ce soit le rock, la BD, etc. Et j’aimerais donc savoir pourquoi la culture rock – qui fut importante et réellement subversive dans les 60’s-débuts 70’s – n’a eu que très peu d’influences dans ta poésie en particulier — alors que pour ma génération, c’est évidemment, totalement le contraire, jusqu’à l’excès même / et c’était pareil pour des gens comme Michel Bulteau, Marc Cholodenko, Mathieu Messagier ou Dashiell Hedayat, qui sont plus ou moins de ta génération et qui ont défendu la musique rock et la culture pop très tôt, contre le puritanisme théorique des Tel-Queliens/TXTiens, etc. ? Etait-ce comme pour le fait auto-biographique, une envie de "rigueur/pureté" (je sais que ce terme ne peut pas s’appliquer à ton travail, toi qui est plutôt, je le sais, dans le rochien : « pas de limite au plaisir du mélange »), un mépris, une envie de formel avant tout, une méfiance, une défiance, une volonté de non complaisance envers l’époque, autre chose ?
importante et réellement subversive dans les 60’s-débuts 70’s – n’a eu que très peu d’influences dans ta poésie en particulier — alors que pour ma génération, c’est évidemment, totalement le contraire, jusqu’à l’excès même / et c’était pareil pour des gens comme Michel Bulteau, Marc Cholodenko, Mathieu Messagier ou Dashiell Hedayat, qui sont plus ou moins de ta génération et qui ont défendu la musique rock et la culture pop très tôt, contre le puritanisme théorique des Tel-Queliens/TXTiens, etc. ? Etait-ce comme pour le fait auto-biographique, une envie de "rigueur/pureté" (je sais que ce terme ne peut pas s’appliquer à ton travail, toi qui est plutôt, je le sais, dans le rochien : « pas de limite au plaisir du mélange »), un mépris, une envie de formel avant tout, une méfiance, une défiance, une volonté de non complaisance envers l’époque, autre chose ?
► Ta question est très intéressante. Cette histoire de culture populaire. De haut et de bas. Pourquoi au lieu d’écouter du rock j’ai préféré « The good book » avec Armstrong ou Billie Holliday… Sans doute parce que pour moi la subversion rock/pop, je la percevais comme une histoire de blancs. Une histoire masculine. Avec le jazz, c’était autre chose. Quelque chose à mes yeux de fantastiquement inventif et échappant à notre univers. N’oublie pas que je viens d’un milieu paysan du sud de la France, et dans les années 60 le jaz restait une musique de « nègre », tandis que tous les jeunes écoutaient Johnny et les « chaussettes noires »… Dans ma famille la culture populaire c’était la provençale, celle de la culture du taureau… Courses libres et corrida… Ferrades… C’est à ça que j’ai été nourrie. Il y avait aussi le rugby. Regarder, il y a encore peu, un match avec ma mère qui avait plus de 80 ans a été un bonheur immense… J’habite Marseille, où, comme le précisait Rouillan, les pauvres vivent encore au centre ville (c’est sans doute la seule ville où ce soit encore possible) et où une culture populaire non fixée est très présente. Je prépare avec Xavier Girard (commandé par les éditions Argol) un livre sur l’ail !… Comment tout ça, cette culture populaire vivante travaille ce que j’écris, je n’en sais rien, mais je ne crois pas à l’étanchéité. Et pour ce qui est du haut ou du bas niveau, mon prochain chantier avec Robert Cantarella est la réécriture d’une pièce de Labiche… Par ailleurs, je suis de près le formidable groupe Free Pussy Riot et les effets des groupes punk en Russie et ailleurs… Comment le punk aujourd’hui se déplace et survit…
► Tu dis plus haut que c’est en ayant conscience d’une certaine oppression (institutionnelle, corporative, systémique même) que tu n’as jamais fait le même livre et que tu as oeuvré dans les marges. C’est une question qui m’intéresse beaucoup, comment continuer à écrire de la poésie aujourd’hui, alors qu’on sait qu’on n’en vivra pas, ou vraiment très peu, et qu’on sera sans doute confiné à une audience restreinte. Comment oeuvrer alors dans la différence, ou essayer d’inventer de nouvelles formes de fiction saisissante, alors qu’on nous renvoie continuellement à la gueule notre statut improductif d’écrivain, d’assistés du CNL et de l’état (pour le bénéficiaire du RSA que je suis), ou pire de faire des oeuvres que personne ne lira – car le public, au fond, a toujours raison, c’est connu et s’il aime Marc Lévy ou Michel Houellebecq, pourquoi vous faites de la poésie bon sang ?
► « Comment continuer à écrire de la poésie alors qu’on sait qu’on n’en vivra pas »… Mais mon cher Sylvain on sait dès le début qu’on n’en vivra pas ! Inutile d’avoir étudié l’économie pour ça… Moi je ne me suis jamais considérée comme un écrivain professionnel. J’ai eu un boulot alimentaire (comme on dit) qui d’ailleurs m’a appris beaucoup de choses que je n’aurais pu apprendre autrement. L’économie du livre c’est ce que tout apprenti écrivain devrait se donner la peine d’étudier… Comme manuel de survie, car il ne s’agit pas uniquement de savoir comment « subvenir à ses besoins » mais aussi trouver, inventer des outils d’existence, produire avec d’autres des plateformes d’interventions (publications, lectures) si celles qui existent et dominent ne nous satisfont pas.
Un écrivain improductif n’est pas un écrivain qui ne fait pas de fric, c’est un écrivain qui n’écrit pas ce qu’il doit écrire. Et là on touche à une sorte de point aveugle, d’angle mort, car je pense que malgré tout le travail de pensée, de réflexion qui s’attache à l’acte d’écrire on ne sait pas… on écrit pour découvrir ce qui devait être écrit. Mettre à jour un objet enfoui, le déterrer… Et cet objet rejoint la cargaison « littérature » qui a quelque chose à voir avec les outils langagiers mis à notre disposition pour vivre. Que cette mise à disposition ait quelque chose à voir avec une « redistribution des richesses » est évident, et c’est bien sûr là qu’intervient le politique… Mes parents n’ont jamais pu lire aucun de mes livres… ça leur était totalement inaccessible, fermé. Pourtant, ma mère jeune fille lisait Pierre Loti…
On ne peut pas dire que « le public a toujours raison ». Le public, on sait qu’il est formaté, manipulé par un marketing qui traite le livre comme un objet de consommation à rotation rapide. L’abaissement du niveau critique dans la grande presse est consternant. Les enseignants ignorent pour la plupart ce qu’est la littérature contemporaine, qui pour eux se limite souvent à des jeux oulipiens. Il y a toujours eu des Levy et des Houellebecq sur un devant de scène tandis que d’autres travaillaient de manière quasi invisible. Alors, l’important c’est de ne pas se pourrir le moral avec ce type de question…
► J’ai l’impression qu’on traverse une vraie crise de la poésie aujourd’hui avec de jeunes auteurs qui sont d’emblée romanciers (et pas poètes – c’est étrange quand même de ne voir que très peu de nouveaux noms de poètes/poétesses nés/nées entre 1980 et 1990), avec des revues qui disparaissent sans cesse (Action Poétique, Nioques qui change encore d’éditeur, If qui devient un journal de Montévidéo — tu pourrais peut-être nous en dire plus), des éditeurs ou des collections qui se réduisent de plus en plus en peau de chagrin. J’aimerais savoir, toi qui est mon aînée, si au tout début des années 80, au moment du triomphe du virage réaliste du mitterrandisme de 1983, d’une posture anti-moderne en poésie, et la montée opératoire de concepts tels que le "post-modernisme" ou la "fin des avant-gardes", comment toi et tes collègues poètes avaient senti ce que je ne suis pas le seul à ressentir pour aujourd’hui. Et j’aimerais savoir comment tu as combattu ça (quels sont les boîtes à outils théoriques qui ont pu t’aider ?) ? Et surtout j’aimerais vraiment savoir comment tu vois, toi, l’avenir de la poésie ? A un moment, où, pour jouer au cynique pur et dur, plus personne n’en a rien à faire ?
► Je ne pense pas qu’il y ait une vraie crise de la poésie aujourd’hui, ou alors elle se borne à accompagner une crise plus générale (économique et de la pensée). Excepté le phénomène Rimbaud, les poètes « reconnus » ont toujours été des vieillards, le travail de reconnaissance et de cooptation se faisant sur la longueur. Les enjeux économiques ne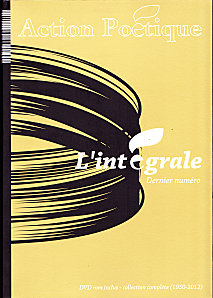 sont pas les mêmes que pour le roman. Là encore, c’est une économie de marché (le tirage des livres de poésie est éloquent). Ecrire un premier roman me semble aussi risqué que composer un livre de poésie. Je ne parle pas ici des livres verreux (ils encombrent une partie du marché). Les jeunes poètes nés dans les années 90 sont encore invisibles, sans doute parce que leur mode d’intervention ne nous les fait pas repérer. En dehors du livre, il y a de nouveaux supports et des entreprises en réseaux. La danse contemporaine, la video, le plateau théâtre, la performance infiltrent le poème et ses apparitions. Bien sûr, il y a beaucoup de déchets, de sous-produits (mais pas plus que dans les plaquettes qui continuent à se répandre )… ! Je sais que ça rend nerveux certains… Personnellement, la disparition des abeilles m’inquiète beaucoup plus ! Les revues que tu me cites sont entre les mains de gens nés entre 1932 et 1946… Action Poétique s’arrête après 60 ans de décrytage de la poésie française, mais surtout étrangère. If ne va pas devenir un journal, mais sera reprise en tant que revue par le festival ActOral (Hubert Colas), à qui on a reproché son côté expérimental… Nioques, dirigé par JM Gleize qui est né en 1946 (il est mon aîné de 13 jours !), poursuit son travail, il y a bien sûr quelque chose de « générationnel » dans toute direction rédactionnelle, mais d’autres arpentages se font, moins visibles, avec des impératifs « d’assaut contre les frontières » (Kafka) qui échappent à nos territoires souvent restreints… Ceux qui y opèrent nous sont encore inconnus…
sont pas les mêmes que pour le roman. Là encore, c’est une économie de marché (le tirage des livres de poésie est éloquent). Ecrire un premier roman me semble aussi risqué que composer un livre de poésie. Je ne parle pas ici des livres verreux (ils encombrent une partie du marché). Les jeunes poètes nés dans les années 90 sont encore invisibles, sans doute parce que leur mode d’intervention ne nous les fait pas repérer. En dehors du livre, il y a de nouveaux supports et des entreprises en réseaux. La danse contemporaine, la video, le plateau théâtre, la performance infiltrent le poème et ses apparitions. Bien sûr, il y a beaucoup de déchets, de sous-produits (mais pas plus que dans les plaquettes qui continuent à se répandre )… ! Je sais que ça rend nerveux certains… Personnellement, la disparition des abeilles m’inquiète beaucoup plus ! Les revues que tu me cites sont entre les mains de gens nés entre 1932 et 1946… Action Poétique s’arrête après 60 ans de décrytage de la poésie française, mais surtout étrangère. If ne va pas devenir un journal, mais sera reprise en tant que revue par le festival ActOral (Hubert Colas), à qui on a reproché son côté expérimental… Nioques, dirigé par JM Gleize qui est né en 1946 (il est mon aîné de 13 jours !), poursuit son travail, il y a bien sûr quelque chose de « générationnel » dans toute direction rédactionnelle, mais d’autres arpentages se font, moins visibles, avec des impératifs « d’assaut contre les frontières » (Kafka) qui échappent à nos territoires souvent restreints… Ceux qui y opèrent nous sont encore inconnus…
Le tocsin réactionnaire de « la fin des avant-gardes »est pour moi inséparable d’une crise de la pensée. Nous n’avons pas fini d’y être confrontés avec la mondialisation, car c’est tout un enjeu de société qui est désormais balancé sur le tapis. Nous assistons purement et simplement à la remise en cause de la supprématie occidentale… Ici je voudrais évoquer Haroldo de Campos, qui dans les années 80 appelait de ses vœux un poétariat internationnal Cet avenir-là est inséparable de notre avenir.
![[Entretien] La poésie pour](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)
Merci pour cet excellent entretien avec Liliane Giraudon dont l’expérience et la réflexion sont vraiment précieuses,plus que jamais.
!!!
oh merci merci
de penser fort comme ça
vous allez voir on va continuer à bien s’amuser
!
Merci « la poésie des années 2030 », c’est de cela, notamment, dont nous avons besoin, d’air, d’allant, d’obstinée insolence