 Thomas Hunkeler et Marc-Henry Soulet dir., Annie Ernaux. Se mettre en gage pour dire le monde, éditions MetisPresses, été 2012, 224 pages, 25 €, ISBN : 978-2-940406-65-4.
Thomas Hunkeler et Marc-Henry Soulet dir., Annie Ernaux. Se mettre en gage pour dire le monde, éditions MetisPresses, été 2012, 224 pages, 25 €, ISBN : 978-2-940406-65-4.
"Je vois l’écriture comme une hyperconscience sur des étendues mouvantes d’inconscience" (Annie Ernaux, "Écrire, c’est toujours au présent", entretien avec les deux éditeurs du volume, p. 211).
« "Que signifie le fait de "se mettre en gage" dans et à travers la littérature ? Quelles sont les formes de l’écriture engagée aujourd’hui, un demi-siècle après Sartre ? Jusqu’à quel point l’héritage boudieusien informe-t-il l’entreprise littéraire d’Annie Ernaux au-delà de ses célèbres récits sociologiques comme La Place ou Une femme ? », telle est la problématique centrale de ce volume homogène d’un très grand intérêt pour les études ernausiennes.
De l’engagement sartrien à l’engagement bourdieusien, tel est l’itinéraire qui se dégage des propos mêmes d’Annie Ernaux dans l’entretien qu’elle a accordé aux deux coordinateurs de l’ouvrage : soit "de la violence accusatrice" des Armoires vides au "dévoilement des rapports de domination socio-culturels" (p. 209). Mais surtout elle tient à cette mise au point : « Ma démarche ne consiste pas à dévoiler pour dévoiler, on ne serait pas loin de l’aveu et de la confession ! Ce n’est pas me dévoiler, moi, et ce qui m’est arrivé qui m’importe, mais de chercher, au travers des choses de ma vie, à faire émerger et ressentir le réel, que Pascal Quignard définit d’une belle formule, "le référent indicible" » (210). Ce qui lui importe, assurément, c’est de faire émerger une culture populaire qui continue de l’imprégner, mais sans idéalisation : c’est ce qui la distingue de la littérature prolétarienne, nous montre Michèle Touret dans "Ce que disent les chansons". C’est d’inventorier avec rigueur et esprit critique les choses de la vie : cette quête de l’exemplarité, selon Francine Dugast-Portes, fait que les choix littéraires d’Annie Ernaux 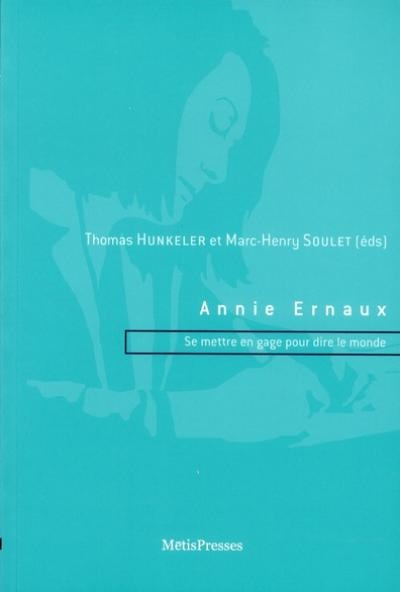 valent "comme mise en gage de soi et convocation du monde". Restent deux paradoxes : en régime ernausien, le sujet ne s’appréhende pas « comme subjectivation d’un vécu irréductiblement personnel, mais comme lieu d’une "objectivation", comme projecteur à la limite de l’impersonnel d’une expérience sociale qui, à travers lui, se donnerait en partage » (Peter Frei, p. 196) ; et si, plutôt que de s’engager et de se mettre en gage, l’auteure s’exposait pour nous engager, en produisant et de l’universel ("Je transclassiste" ou "Je transsocial") et "du commun partagé" (Je identitaire en lieu et place du Je singulier : "C’est donc un travail politique de production du groupe en soi à partir d’expériences biographiques incommensurables" – M.-H. Soulet, 166) ?
valent "comme mise en gage de soi et convocation du monde". Restent deux paradoxes : en régime ernausien, le sujet ne s’appréhende pas « comme subjectivation d’un vécu irréductiblement personnel, mais comme lieu d’une "objectivation", comme projecteur à la limite de l’impersonnel d’une expérience sociale qui, à travers lui, se donnerait en partage » (Peter Frei, p. 196) ; et si, plutôt que de s’engager et de se mettre en gage, l’auteure s’exposait pour nous engager, en produisant et de l’universel ("Je transclassiste" ou "Je transsocial") et "du commun partagé" (Je identitaire en lieu et place du Je singulier : "C’est donc un travail politique de production du groupe en soi à partir d’expériences biographiques incommensurables" – M.-H. Soulet, 166) ?
Cependant, la majorité des contributions reviennent sur les interrelations entre littérature et sociologie. D’emblée, Jérôme Meizoz ne craint pas de reposer la question : « Annie Ernaux, est-ce bien "Bourdieu en roman" ? » Non, bien évidemment : le point de vue et les moyens de l’écrivaine lui sont propres (récit de filiation personnel, récit factuel, "je transpersonnel", écriture "distanciée"). Plus précisément, il décèle dans l’instance énonciatrice même un "ethos du témoin" caractéristique "d’un regard sociologique et/ou ethnologique sur le monde" : « Réactualisant de manière singulière le récit de l’indignité sociale (dont Rousseau, Vallès et Genet sont les phares), Ernaux met en œuvre une posture ethnographique d’observatrice méticuleuse et lucide, qui enquête sur une "mémoire humiliée" pour déconstruire la "honte" sociale longtemps éprouvée » (p. 35). Vincent de Gaulejac, le spécialiste de la "névrose de classe", voit dans l’écriture ernausienne à la fois une thérapie, "une revanche sociale", « un moyen de réhabiliter ses parents, de revaloriser un monde social méprisé par "les gens biens" et, en même temps, une façon de réparer la trahison de classe, de résorber la distance culturelle qui s’était installée entre elle et ses parents » (p. 101). S’intéressant à l’écriture du premier roman, Les Armoires vides (1974), Thomas Hunkeler, quant à lui, préfère à la notion de "catharsis" celle tout aussi aristotélicienne de "anagnorisis" (révélation rationnelle).
Pour sa part, Viviane Châtel répond à cette autre question cruciale : "la littérature peut-elle sans danger se travestir en sociologie ?" La réponse affirmative est liée à quatre caractéristiques de l’œuvre : la description de la déchirure sociale comme de la pluralité .jpg) des expériences sociales, "l’idée d’une identité composite", l’exploration des limites du dire dans le récit de vie. Néanmoins, la critique craint une transdisciplinarité abusive qui briserait tout garde-fou contre "l’interprétation de l’interprétation" (p. 137)…
des expériences sociales, "l’idée d’une identité composite", l’exploration des limites du dire dans le récit de vie. Néanmoins, la critique craint une transdisciplinarité abusive qui briserait tout garde-fou contre "l’interprétation de l’interprétation" (p. 137)…
Pour terminer, arrêtons-nous sur l’article de Danilo Martuccelli, qui s’évertue à comprendre l’engouement des sociologues pour l’œuvre d’Annie Ernaux. Car l’écrivaine subvertit le paradigme du "personnage social", dont les expériences sont explicables par sa position sociale. Dans cette œuvre, comme du reste dans celle de Patrick Modiano, Christian Oster ou encore Éric Holder, le social est bien présent, mais ne permet nullement de saisir le personnage dans sa singularité. L’auteur de La Société singulariste (Armand Colin, 2010) voit trois taches aveugles dans le miroir sociologique : la passion amoureuse, la souffrance et la pudeur (la surexposition comme masque de l’intimité profonde, notamment celle des relations aux parents et aux enfants). Chez celle qui ne cache pas sa résistance à la psychanalyse, tout ne serait donc pas soluble dans le social… Pour séduisante qu’elle soit, cette hypothèse interprétative n’en est pas moins parfois excessive : qui d’autre qu’Annie Ernaux est allé plus loin dans le dévoilement de l’intimité parentale ? Peut-on aller jusqu’à avancer que "le striptease sociologique est à la fois une manière de se singulariser et de se voiler" ? En fait, pour Annie Ernaux, est racontable ce qui est partageable sans être dommageable (pour ses proches, de leur vivant). Sa position est tout à fait classique : si n’existe que ce qui est dit clairement, le dire ne s’en heurte pas moins à un je ne sais quoi… Cet indisable constitue précisément le noyau irréductible qui fait écrire Annie Ernaux.
![[Chronique] Annie Ernaux. Se mettre en gage pour dire le monde (Spécial Annie Ernaux 2/2)](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)