
En ce jour même où paraît en librairie Les Enfances Chino (P.O.L, 576 pages, 23 €), entretien avec cet ôteur dont le réelisme repose sur une négativité toute moderne. [Avec en toute fin une superbe reproduction du Carnet Goya choisie par l’auteur]
FT. Comme Une phrase pour ma mère (1996), Grand-mère Quéquette (2003) et Demain je meurs (2007, prix Louis Guilloux), Les Enfances Chino développent ce que l’on peut appeler ta « matière de Bretagne ». As-tu d’emblée eu la volonté de construire un ensemble ? Et a posteriori, conçois-tu l’ensemble comme un quatuor ou comme un polyptique, ce qui laisserait la porte ouverte au moins à un cinquième volume ?
Pourrait-on aller jusqu’à avancer que se détache un triptyque, la matière romanesque étant plus revendiquée dans les trois derniers titres que dans le premier, où elle est organisée en une seule phrase poétique (lamento-bouffe) ?
CP. — C’est Commencement (1989), qui est la matrice des quatre livres en question. Ou même plutôt le matériau des cahiers travaillé en 1985/1988 pour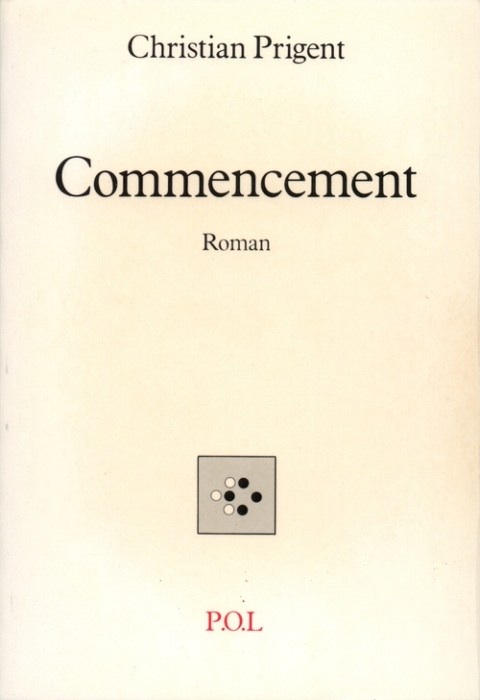 écrire Commencement. En quoi ce titre était décidément inaugural : il disait la sensation que j’avais, écrivant ce livre, de commencer à… écrire — hors de la stricte perspective avant-gardiste militante et expérimentale. Sa typographie même (tous ces piliers de « m ») avait quelque chose de… fondateur. La « matière de Bretagne » était l’un des thèmes de ce livre, surtout dans ses premiers chapitres (« Pantomime des mômes », etc). Elle y était toutefois moins dominante que dans ce qui a suivi. A partir de Une phrase pour ma mère, il y a eu une réduction de la focale à la fois sur l’espace (Saint-Brieuc), le temps (les années 1950), les protagonistes (le cercle de la parentèle). Je n’ai pas programmé ce resserrement. Il s’est imposé à moi. Je n’ai fait qu’en accepter le défi. Il n’y a eu aucune volonté de « construire » quoi que ce soit (cycle, geste, triptyque, quatuor…). Au contraire : chacun des livres évoqués une fois terminé, j’ai pensé qu’il était le dernier, que « ça suffisait », que c’était épuisé, que j’avais fait le tour, etc. Et je suis revenu à mes manies « poétiques » ou à la composition de textes théoriques ou critiques (ma bibliographie en témoigne). Mais le besoin de reprendre un fil narratif, d’une façon assez différente à chaque fois, est toujours revenu, sans crier gare — prenant plusieurs fois d’ailleurs le prétexte d’une « commande » anodine. En somme, toutes en germe dans la matière thématique et stylistique de Commencement, les quatre proses suivantes sont sortis les unes des autres comme des poupées-gigognes, sans aucun plan préconçu, ni même de ma part aucune volonté de faire « œuvre » romanesque. C’est même sans doute pour cela que j’ai pu les écrire, parce que chacune d’elles, énigmatiquement appelée par un vide (nul programme, nul sujet, nulle histoire à raconter), a été une aventure d’écriture imprévue.
écrire Commencement. En quoi ce titre était décidément inaugural : il disait la sensation que j’avais, écrivant ce livre, de commencer à… écrire — hors de la stricte perspective avant-gardiste militante et expérimentale. Sa typographie même (tous ces piliers de « m ») avait quelque chose de… fondateur. La « matière de Bretagne » était l’un des thèmes de ce livre, surtout dans ses premiers chapitres (« Pantomime des mômes », etc). Elle y était toutefois moins dominante que dans ce qui a suivi. A partir de Une phrase pour ma mère, il y a eu une réduction de la focale à la fois sur l’espace (Saint-Brieuc), le temps (les années 1950), les protagonistes (le cercle de la parentèle). Je n’ai pas programmé ce resserrement. Il s’est imposé à moi. Je n’ai fait qu’en accepter le défi. Il n’y a eu aucune volonté de « construire » quoi que ce soit (cycle, geste, triptyque, quatuor…). Au contraire : chacun des livres évoqués une fois terminé, j’ai pensé qu’il était le dernier, que « ça suffisait », que c’était épuisé, que j’avais fait le tour, etc. Et je suis revenu à mes manies « poétiques » ou à la composition de textes théoriques ou critiques (ma bibliographie en témoigne). Mais le besoin de reprendre un fil narratif, d’une façon assez différente à chaque fois, est toujours revenu, sans crier gare — prenant plusieurs fois d’ailleurs le prétexte d’une « commande » anodine. En somme, toutes en germe dans la matière thématique et stylistique de Commencement, les quatre proses suivantes sont sortis les unes des autres comme des poupées-gigognes, sans aucun plan préconçu, ni même de ma part aucune volonté de faire « œuvre » romanesque. C’est même sans doute pour cela que j’ai pu les écrire, parce que chacune d’elles, énigmatiquement appelée par un vide (nul programme, nul sujet, nulle histoire à raconter), a été une aventure d’écriture imprévue.
FT. Et qui dit « matière de Bretagne », dit retour d’une figure marquante, celle de Louis Guilloux, du reste cité dans la bibliographie finale… et son corollaire : clin d’œil ironique au naturalisme et au réalisme socialiste (cf. p. 21-22)…
CP. Louis Guilloux n’est pas nommément cité dans Les Enfances Chino (il l’était dans Grand-mère Quéquette et dans Demain je meurs, où il entrait explicitement en scène). Ce nom n’apparaît que dans la bibliographie. J’y fais figurer ses Carnets et son Herbe d’oubli parce que j’ai relu ces livres pendant que je travaillais sur Les Enfances… : ils parlent du Saint-Brieuc des années 1930/1950 (l’arrivée des réfugiés espagnols après la fin de la guerre civile, etc). Ça fait partie de ma… documentation. On ne peut évoquer Saint-Brieuc et ses partages sociologiques sans que Le Sang noir, La Maison du peuple, Le Jeu de patience soient posés quelque part dans le décor. Mais pour le reste (l’œuvre de Guilloux comme emblème d’une perspective réaliste à intentions socio-politiques, les formes écrites que se choisit cette perspective), il n’y a pas grand-chose, dans Les Enfances… qui rejoue la mise à distance « ironique » dont tu parles.
FT. Oui, tout à fait, c’est juste un clin d’œil. Tandis que vient donc de paraître cette somme romanesque de 576 pages, tu as publié l’an dernier La Vie moderne et prépares un recueil à partir des Épigrammes de Martial – cité du reste parmi les cinq auteurs gréco-latins que comporte la bibliographie des Enfances Chino… Est-ce à dire que ton écriture suit toujours le balancement cadencé entre poésie et prose romanesque ? Quatre ans après Christian Prigent, quatre temps. Rencontre avec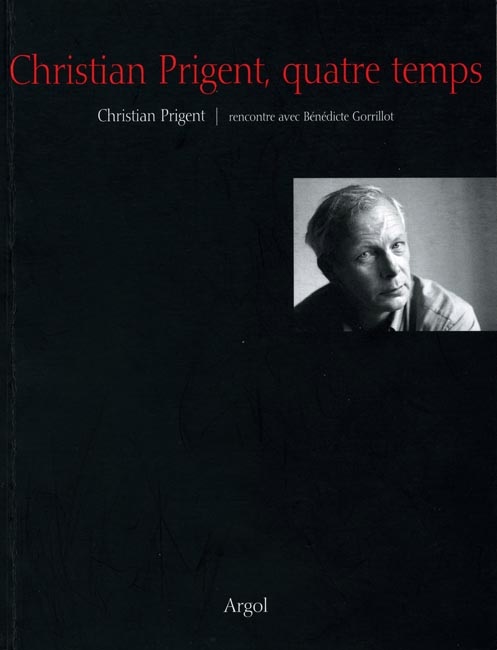 Bénédicte Gorrillot, souscris-tu encore à cette vision très contrastée : prenant tes distances vis-à-vis de ce que tu présentes comme ta manie poétique (« Ça n’a pas grand intérêt, comme œuvre »), tu soulignes au contraire « le plaisir de travailler les dispositifs de la narration dans un mouvement de passage entre, d’une part, la trivialité, le pathos cliché et la cruauté des matériaux traités, et, d’autre part, leur allègement et leur conversion en gaieté par la dynamique comique du phrasé » (p. 184 et 247) ?
Bénédicte Gorrillot, souscris-tu encore à cette vision très contrastée : prenant tes distances vis-à-vis de ce que tu présentes comme ta manie poétique (« Ça n’a pas grand intérêt, comme œuvre »), tu soulignes au contraire « le plaisir de travailler les dispositifs de la narration dans un mouvement de passage entre, d’une part, la trivialité, le pathos cliché et la cruauté des matériaux traités, et, d’autre part, leur allègement et leur conversion en gaieté par la dynamique comique du phrasé » (p. 184 et 247) ?
CP. Entre Demain je meurs (2007) et Les Enfances…(2013), il y a eu Météo des plages (2010) et La Vie moderne (2012). Voilà pour la manie poétique — qui donne des « œuvres », aussi, au bout du compte. Ce que je disais à Bénédicte Gorrillot, c’est que la notation quasi quotidienne de bribes « poétiques » sur des carnets relève de ce qui m’est spontanément agréable et facile. Après, il faut faire « livre » avec ces fragments (on se croit en tout cas, à un moment ou à un autre, mais va savoir pourquoi, soumis à cette obligation). D’où un travail de synthèse, de disposition d’ensemble et de lissage stylistique qui fait coaguler les fragments que je dis dans une composition autant que faire se peut structurée, démonstrative. Ça prend quelques semaines, dans une sorte de vivacité… technique. Rien à voir avec l’occupation longue et aventureuse qu’est, pendant des mois, voire des années, l’avancée à l’aveuglette dans le développement « romanesque ». Voilà comment je travaille, en tout cas. Il faut croire que j’ai besoin de cette alternance, que c’est ma façon de respirer avec et dans les portées variées de la langue.
FT. Dans ce même livre d’entretiens, tu vas jusqu’à rejoindre, dans une certaine mesure, la position de Jean Ricardou lors d’un mémorable colloque de Cerisy sur le Nouveau Roman ; minorant l’intérêt biographique, tu poses cette injonction : « Il n’y a rien d’autre à apprécier dans mes livres que le phrasé qu’ils tentent d’imposer » (p. 196). Mais comme par ailleurs tu affirmes avoir conscience qu’il ne saurait y avoir de littérature pure, tout signe renvoyant à ses référents, j’aimerai jouer un peu le rôle de Claude Simon, le contradicteur de Jean Ricardou : le fait est que le matériau (auto)biographique est omniprésent dans l’œuvre… Qu’en faire ? N’y a-t-il pas un reste de crispation avant-gardiste dans ton injonction ? Et si cet engagement libidinal et politique dans la langue était justement ce qui entraîne l’implication de nombreux lecteurs, savants y compris ?
CP. Je ne suis crispé sur rien d’autre que ceci : un livre de littérature est un objet d’art (au même titre qu’une peinture, un concerto, un ballet, etc). Il pose dans le monde une entité formelle jusqu’à lui non-vue. C’est en tant que tel qu’il .jpg) s’apprécie parce que c’est là tout le sens des opérations qui l’ont fait tel qu’il se donne à lire. Cette appréciation tient à la perception sensorielle d’un phrasé singulier : une certaine vitesse, une certaine allégresse et une certaine violence de la dynamique formelle (ça touche au détail rythmique, à la densité des coagulations lexicales, à la structure composée de l’ensemble). Quelque chose de d’abord sensuellement perceptible (comme la musique, comme la peinture), qui force le monde à se courber, à se former et à s’illuminer autrement — puis qui éveille la pensée à cet autrement : à la découverte d’une toujours possible altérité, d’une exception au lieu commun (au lieu idéologique commun, entre autres). Autant dire que l’intérêt est dans la transformation, l’altérité, l’exception, la différence stylistiquement formées et cinématographiées. Pas dans la conformité, l’adéquation, le rendu du matériau de vie que cela, inévitablement, traite. Ça ne minore en rien (encore moins ne dénie) ce matériau effectivement ou fantastiquement « vécu » (la donnée d’expérience, de mémoire, de rêverie). Sans sa puissance d’impulsion pour l’émotion et d’énigme pour l’intelligence, rien, d’évidence n’aurait lieu (pas de Guernica sans Guernica). Mais l’expérience ne valide pas l’œuvre. L’œuvre est validée (ou invalidée) par… l’œuvre, c’est tout. Ce que tu appelles « engagement libidinal et politique » s’investit là, dans l’affirmation d’une forme ; et ne fonde que là sa puissance de sollicitation émotionnelle et intellectuelle. Je ne m’intéresse, quant à moi, qu’à des livres dont le phrasé impose une tonicité stylistique rédemptrice. Je veux dire : une puissance stylistique qui rachète d’une sorte d’irrégularité tonique et de joie excentriquement rythmée le fond d’angoisse et de noirceur d’où il s’arrache. Non à la macération dépressive. Non à la grisaille stylistique. Non à « l’absence de style » revendiquée. Polémiquons pour rire : non à Maupassant, Houellebecq, Angot. Oui au comique goguenard de Rabelais, Flaubert, Beckett, Schmidt, Céline : chez qui la torsion de langue triomphe et relève sans la nier la négativité qui fit écrire (ne pas se satisfaire du « lieu commun »).
s’apprécie parce que c’est là tout le sens des opérations qui l’ont fait tel qu’il se donne à lire. Cette appréciation tient à la perception sensorielle d’un phrasé singulier : une certaine vitesse, une certaine allégresse et une certaine violence de la dynamique formelle (ça touche au détail rythmique, à la densité des coagulations lexicales, à la structure composée de l’ensemble). Quelque chose de d’abord sensuellement perceptible (comme la musique, comme la peinture), qui force le monde à se courber, à se former et à s’illuminer autrement — puis qui éveille la pensée à cet autrement : à la découverte d’une toujours possible altérité, d’une exception au lieu commun (au lieu idéologique commun, entre autres). Autant dire que l’intérêt est dans la transformation, l’altérité, l’exception, la différence stylistiquement formées et cinématographiées. Pas dans la conformité, l’adéquation, le rendu du matériau de vie que cela, inévitablement, traite. Ça ne minore en rien (encore moins ne dénie) ce matériau effectivement ou fantastiquement « vécu » (la donnée d’expérience, de mémoire, de rêverie). Sans sa puissance d’impulsion pour l’émotion et d’énigme pour l’intelligence, rien, d’évidence n’aurait lieu (pas de Guernica sans Guernica). Mais l’expérience ne valide pas l’œuvre. L’œuvre est validée (ou invalidée) par… l’œuvre, c’est tout. Ce que tu appelles « engagement libidinal et politique » s’investit là, dans l’affirmation d’une forme ; et ne fonde que là sa puissance de sollicitation émotionnelle et intellectuelle. Je ne m’intéresse, quant à moi, qu’à des livres dont le phrasé impose une tonicité stylistique rédemptrice. Je veux dire : une puissance stylistique qui rachète d’une sorte d’irrégularité tonique et de joie excentriquement rythmée le fond d’angoisse et de noirceur d’où il s’arrache. Non à la macération dépressive. Non à la grisaille stylistique. Non à « l’absence de style » revendiquée. Polémiquons pour rire : non à Maupassant, Houellebecq, Angot. Oui au comique goguenard de Rabelais, Flaubert, Beckett, Schmidt, Céline : chez qui la torsion de langue triomphe et relève sans la nier la négativité qui fit écrire (ne pas se satisfaire du « lieu commun »).
FT. C’est également un fait que le texte des Enfances Chino affiche ses médiations textuelles (œuvres, ouvrages et documents divers) et artistiques (art musical – chansons et opérettes – et arts visuels – peinture et cinéma – comme patrons schématiques, pour reprendre une formule du Sens du toucher) : écrire, c’est recycler les matériaux premiers. Pour Les 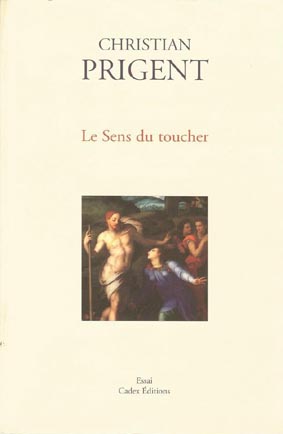 Enfances Chino, je suppose que les brouillons contiennent, comme c’est le cas pour Commencement (P.O.L, 1989), un tableau prévoyant pour chaque chapitre les MATIÈRES, ÉCRIVAINS et ARTISTES de référence…
Enfances Chino, je suppose que les brouillons contiennent, comme c’est le cas pour Commencement (P.O.L, 1989), un tableau prévoyant pour chaque chapitre les MATIÈRES, ÉCRIVAINS et ARTISTES de référence…
Dans cette perspective, ton réelisme est un artificialisme, non ?
CP. «Artificialisme», si tu veux : art, en somme, rien de plus — ni rien de moins. Fabrique, élaboration, composition, densité lexicale, refonte syntaxique, courbure d’espaces, réglage de leitmotive, tensions rythmiques, etc. Dans la joie de fabriquer du frais. Mais rien qui soit prévu, programmé, pré-pensé. Je voudrais faire comprendre cela : que ce qui au bout du compte donne un livre est d’abord une aventure, au jour le jour, au fil des séances (régulières, obstinées) d’écriture. Une aventure dont le charme tient au fait qu’on ne sait rien, a priori, de ce qui va venir, avoir lieu, demander à être formé. C’est au fur et à mesure de cette avancée à l’aveugle dans les ressources de l’émotion, de l’expérience qu’on ne savait pas et de la profusion de la langue (ce qu’elle dit et ce qu’elle psalmodie en sons et en rythmes) que ça se fait. En rencontrant de façon aléatoire des « patrons schématiques » qui relancent les opérations vers où elles n’avaient pas prévu d’aller. C’est-à-dire entre autres des bribes d’œuvres (d’Eschyle à Sade ou à Rousseau, de La Fille du Bédouin au Lai du Laostic, des Caprices de Goya aux cabanes champêtres construites pour les stations de la Troménie de Locronan…). Toutes références qui écartent d’elle-même la nudité de l’expérience (à supposer qu’il y ait jamais d’expérience nue, indemne de symbolisation) et ouvrent, dans cet écart, la chance de bricoler de l’impur : ce mixte de vécu, de rêvé, de désiré, de fantasmé, de su, de parlé et de pensé dont la résolution stylistique fait ce que j’appelais un objet d’art littéraire.
FT. Ce qui est certain, si l’on te suit dans ton substantiel entretien avec Bénédicte Gorrillot recueilli dans Le Sens du toucher (Cadex, 2008), c’est que, dans Les Enfances Chino, tu as projeté ta matière de Bretagne sur cette « machine à faire de la fiction » que proposent les tableaux de Goya. Tu décris ainsi le processus scriptural pour Grand-mère Quéquette : « Alors vient un mixte de description du tableau, de réflexions sur son traitement de l’espace […], de collages de souvenirs d’enfance et de pseudo-gloses qui coagulent in fine en une manière d’allégorie burlesque de la vie en famille » (p. 34)… En est-il allé de même ici ? Tandis que tes essais portent sur des peintres contemporains comme Dezeuze, Viallat, Boutibonnes, Tual, Pérez, ou encore Lunal, et que, par exemple, Grand-mère Quéquette convoquait Matisse, Monet, Véronèse, Tiepolo ou Giorgione, dans Les Enfances Chino, comment l’œuvre de Goya s’est-elle imposée aussi massivement (j’ai dénombré une cinquantaine d’occurrences différentes) ?
CP. Les Enfances Chino est le développement (et le résultat, après une dizaine de mois d’écriture) d’un texte d’une douzaine de feuillets qui m’avaient été commandés par le Palais des Beaux-Arts de Lille. Il s’agissait d’écrire « quelque chose » à partir de deux tableaux de Goya qui figurent dans les collections de ce Musée : Les Vieilles et Les Jeunes (ou Femmes lisant une lettre). Et de venir lire ce texte devant les tableaux. J’ai construit pour cela une petite fiction. Elle mettait en scène un petit personnage (l’enfant d’abord nommé Francisco — qui est le prénom de Goya — et devenu ensuite Chino, diminutif de François en parler gallo). Il descendait dans le tableau Les Jeunes comme s’il s’agissait d’une scène réelle, en volume. Il y rencontrait donc les figures de ce tableau, devenues des « personnages ». Il n’en faut pas plus pour lancer une « histoire », des « intrigues », des « dialogues » : un roman, en somme. Comme j’avais pris pas mal de temps (et de pages) pour simplement « décrire » la partie supérieure du tableau (le ciel vide, vert et violet), le texte lu à Lille (30 minutes) entamait à peine une « narration ». J’ai poursuivi, et voilà ! En gardant toujours en ligne de mire Goya et son œuvre : d’où les multiples références aux tableaux et aux gravures de cet artiste, qui relancent ponctuellement ma fiction. Pas seulement les « scènes » que montrent ces œuvres (jeux d’enfant, monstres, vignettes fantastiques, « désastres » de la guerre, etc), mais leur facture même : ce mixte de réalisme cru/cruel, de fantastique expressionniste, de comique goguenard, d’onirisme carnavalesque, de virtuosité et de rapidité du trait qui font leur force. Bien des pages de Les Enfances… sont quasiment des « descriptions » de ces œuvres, déportées dans le contexte de ma fiction et habitées par les petits personnages que j’ai peu à peu inventés.
par le Palais des Beaux-Arts de Lille. Il s’agissait d’écrire « quelque chose » à partir de deux tableaux de Goya qui figurent dans les collections de ce Musée : Les Vieilles et Les Jeunes (ou Femmes lisant une lettre). Et de venir lire ce texte devant les tableaux. J’ai construit pour cela une petite fiction. Elle mettait en scène un petit personnage (l’enfant d’abord nommé Francisco — qui est le prénom de Goya — et devenu ensuite Chino, diminutif de François en parler gallo). Il descendait dans le tableau Les Jeunes comme s’il s’agissait d’une scène réelle, en volume. Il y rencontrait donc les figures de ce tableau, devenues des « personnages ». Il n’en faut pas plus pour lancer une « histoire », des « intrigues », des « dialogues » : un roman, en somme. Comme j’avais pris pas mal de temps (et de pages) pour simplement « décrire » la partie supérieure du tableau (le ciel vide, vert et violet), le texte lu à Lille (30 minutes) entamait à peine une « narration ». J’ai poursuivi, et voilà ! En gardant toujours en ligne de mire Goya et son œuvre : d’où les multiples références aux tableaux et aux gravures de cet artiste, qui relancent ponctuellement ma fiction. Pas seulement les « scènes » que montrent ces œuvres (jeux d’enfant, monstres, vignettes fantastiques, « désastres » de la guerre, etc), mais leur facture même : ce mixte de réalisme cru/cruel, de fantastique expressionniste, de comique goguenard, d’onirisme carnavalesque, de virtuosité et de rapidité du trait qui font leur force. Bien des pages de Les Enfances… sont quasiment des « descriptions » de ces œuvres, déportées dans le contexte de ma fiction et habitées par les petits personnages que j’ai peu à peu inventés.
FT. Serais-tu d’accord pour distinguer trois fonctions du matériau iconographique : celles d’agent catalyseur de l’écriture ; de révélateur (il s’agit de mettre en avant le geste créatif) ; d’écran protecteur (double entreprise de dé-familiarisation : mise à distance du matériau (auto)biographique et déformation maniériste/carnavalesque) ?
CP. On peut le dire ainsi, oui. Les tableaux, gravures et autres images fournissent une sorte de cadre : un temple cadré serré sur du visuel (souvenirs, paysages, fantasmes, figures plus ou moins grotesques…). Celui qui écrit attend qu’y passent les présages (les signes, les augures) et laisse l’incident (la vitalité imprévue de la langue) animer le cadre de lapsus, irruptions de sens énigmatique, distorsions cadencées, collages d’autres scènes, figures, échos sonores, bribes de chansons, sensations hétéroclites. Autrement dit : il attend la surprise que lui fait la langue. Non patiemment, non parcimonieusement. Vite et d’abondance : en fournissant à son moteur toutes les occasions de ratés. Et il note ces ratés comme des chances d’invention : des propositions de balistique formelle chargée de significations non a priori arraisonnées.
FT. J’aimerais terminer sur la mise en perspective de ton parcours que tu viens toi-même de proposer. Toi qui viens des bibliothèques, as écrit devant le regard intimidant de la Bibliothèque, retournes aux bibliothèques sous la forme d’une œuvre archivée. Des bibliothèques aux volumes de glose, telle est la trajectoire que, après avoir déposé tes archives à l’IMEC, tu retraces dans L’Archive e(s)t l’œuvre e(s)t l’archive (IMEC, « Le Lieu de l’archive », 2012) : passé brutalement de l’underground au patrimoine, il t’a été permis « de mettre à l’aigle des gloses son gibier à portée de bec »… Alors, prêt à affronter les glossateurs l’an prochain à Cerisy, au cours du premier colloque international entièrement consacré à cette œuvre ?
CP. Outre qu’elle est narcissiquement gratifiante (je ne crache évidemment pas sur ces gratifications — et ce d’autant moins que je n’ai jamais fait grand chose pour rendre mon travail facile, aimable, accueillant à la lecture et au travail de commentaire critique), la perspective de ce colloque m’enchante évidemment. Elle ne se présente pas seulement comme une réunion savante mais aussi comme une petite fête (avec lecture, théâtre, cinéma, chansons !) autour de ce que j’ai proposé comme parcours dans la littérature et la pensée de la littérature. Que ces choses poursuivies dans pas mal de solitude, de manie impartageable, d’obsession futile et d’austérité alambiquée puisse rassembler des compétences, des intelligences, des ferveurs et des amitiés au sens le plus profond de ce terme (l’amour partagé de la pensée non dictée et de la beauté fraîche en est le socle) : rien de plus émouvant, ça justifie tout (qui fut intranquillité délibérément cultivée, réticence aux promiscuités banales, joie aussi : une bizarre petite aventure intellectuelle, éthique et émotionnelle qui, au bout du compte, fait quand même partage — et je m’en étonnerai toujours).

![[Entretien] Christian Prigent, un ôteur réeliste (Christian Prigent, les aventures d'une écriture 2/6)](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)
la perspective de ce colloque m’enchante évidemment.