Selon le principe de cette rubrique, revenons sur quatre intéressants livres reçus : Yannick Torlini, Nous avons marché ; Stéphane Nowak Papantoniou, GLÔÔSSE ; Bruno Edmond, Mahu ; Anne Versailles, Viola.
► Yannick TORLINI, Nous avons marché, Al dante, printemps 2014, 152 pages, 15 €, ISBN : 978-2-84761-775-7.
En leur temps, déjà : Baudelaire, Rimbaud, Michaux…
En ces temps d’assignation et de résignation, l’important est d’être ailleurs. Là-bas.
(Toute fuite n’est pas une échappée, et toute échappée n’est pas une fuite).
Hors de ses fameuses racines, de sa soi-disant identité. Hors de soi, de sa langue. Hors de son quotidien.
Être hors de soi pour aller vers. Et pour cela, faire sortir la langue de ses gonds : être dans la langue pour être en devenir.
Voici un exemple d’agencement répétitif, de bégaiement qui ouvre l’espace :
"Nous avons fui nous avons couru, lorsqu’il s’agissait de s’échapper échapper lorsqu’il s’agissait : quelque chose s’était bloqué s’était : désagrégé à la nuit s’était. Bien trop longtemps bien trop silence, dans l’os et la chair ces murs ces : jours bloqués passés à. Dans les barreaux les barbelés, les grilles les portes le métal et nos existences si bien cloisonnées" (p. 139). /FT/
► Stéphane NOWAK PAPANTONIOU, GLÔÔSSE, éditions Al dante, Marseille, printemps 2014, 88 pages, 13 €, ISBN : 978-2-84761-768-9.
Quand les puissances d’argent viennent ruiner plus qu’un pays, une civilisation,
quand l’hostilité vient remplacer l’hospitalité,
quand le discours dominant vient contaminer la langue maternelle,
tout est-il perdu ? Que reste-t-il au poète ? La poésie comme puissance de déconditionnement, libération de la langue… Contre la glose économo-politico-médiatique, "la glossolalie langue coupante", une "langue dégelant la gelée", le coup de glotte de la résistance…
Mêlant narratif et discursif, visualité et oralité, document objectif et inventivité verbale, cette glôôsse qui cligne aussi bien du côté de Prigent que de Rabelais est une hurmouvante descente dans le labyrinthe grec et mondial qu’il faut découvrir de toute nécessité. /FT/
► Bruno EDMOND, Mahu, éditions DIABASE, La Riche (37), printemps 2014, 112 pages, 11 €, ISBN : 978-2-911438-96-7.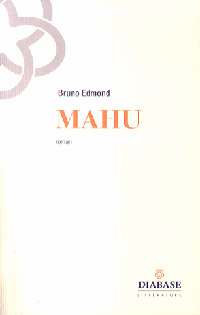
« Quand Mahu parle, Mahu crie. »
Mahu. Deux syllabes, presque deux onomatopées séparées par un souffle coupé: ce « h » entre deux voyelles. Des sons qui s’expulsent, comme un cri. « Mahu, c’est. » Un cri sans mots, oublieux du langage.
Le titre fait penser au diptyque de Robert Pinget : Mahu ou le matériau / Mahu reparle. Ici, le cri se substitue à la parole, malgré la reprise du « matériau ». Crier peut être l’expression d’un paroxysme autant que d’une perte ou du langage.
Chez Edmond Bruno, Mahu est un personnage frontière, un monstre dans sa marginalité. C’est pourquoi ses actes semblent suivre une loi déviante de la loi générale. Suivre Mahu, au-delà de la ville, dans la campagne, c’est considérer le monde à contre-courant. La langue et le langage deviennent alors un objet étranger, insolite, voire monstrueux :
« Ainsi, cachés, courbés, accrochés comme sangsues aux parois de nos gorges, des monstres habitent nos bouches.
Ainsi c’est donc avec et par un monstre que je parle, que tu parles. Parlons. » /PP/
► Anne VERSAILLES, Viola, éditions L’Arbre à paroles, Maison de la poésie d’Amay (Belgique), 2014, 10 €, ISBN : 9 782874 06774.
 Dans Viola, la violence de la nature concurrence les hommes. Les paysages regardés sont principalement de sable et d’eau, la mer et la plage encerclant une maison vidée de son occupante. Impossible de marcher sur la mer, difficile d’avancer en un rythme constant sur le sable : ces deux forces sont instables, prêtes à envahir, à étouffer. Le plus effroyable étant que pas une ride ne défigure l’eau après l’engloutissement d’un cadavre, et que le sable d’une tempête retombe paisiblement en enfouissant ses victimes après le massacre.
Dans Viola, la violence de la nature concurrence les hommes. Les paysages regardés sont principalement de sable et d’eau, la mer et la plage encerclant une maison vidée de son occupante. Impossible de marcher sur la mer, difficile d’avancer en un rythme constant sur le sable : ces deux forces sont instables, prêtes à envahir, à étouffer. Le plus effroyable étant que pas une ride ne défigure l’eau après l’engloutissement d’un cadavre, et que le sable d’une tempête retombe paisiblement en enfouissant ses victimes après le massacre.
Sur ce paysage, la narratrice se débat avec un fantôme, celui de sa sœur, la disparue de la maison face à la mer. Elle la raconte en l’interpellant, en la questionnant, et invoque une enfance pleine d’histoires aussi terribles que merveilleuses. Une relation sororale tempétueuse se reflète dans ce « tu » raconté par « je ». Pour ne pas se laisser engloutir par ses fantômes, la narratrice dit marcher par besoin. Marcher pour retrouver sa stabilité dans le sol, pour rythmer les phrases énoncées face au mot qui fait perdre pied :
« Je me souviens, j’avais besoin de marcher. Je suis sortie. Le jardin était trop petit, je suis allée dans la rue. Il n’y avait personne. J’ai ouvert l’enveloppe, déplié le papier. Il n’y avait qu’un mot. Un seul mot. Il m’a fait perdre pied. » /PP/
![[Livres] Libr-kaléidoscope (4), par Fabrice Thumerel et Périne Pichon](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)
![[Livres] Libr-kaléidoscope (4), par Fabrice Thumerel et Périne Pichon](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2014/06/band-kaleidoscope.jpg)