Aussi envoûtant que les précédents, voici le dernier agencement répétitif de Laura Vazquez – son deuxième livre aux éditions si singulières de Derrière la salle de bains.
Laura Vazquez, Le Système naturel et simplifié, éditions Derrière la salle de bains, septembre 2014, 10 €.
Trop de poètes veulent réduire le corps à ne parler que du bout du mental en oubliant ses tuyaux et ses trous. Or, la parole est dedans, invaginée ou phallique (et quel que soit le genre), avant sa sortie par effets de musculature et changement de débit. Seul ce qui se passe dans le corps est intéressant. Cela représente la faim des littératures, leur commencement. En dépit des histoires de caverne made in Platon. Mais il est plus facile de penser ainsi que de faire passer le franc « colimaçonnique » de l’inconnu. Laura Vazquez ose cette postulation poussée à l’obsession et la répétition derrière chaque souffle. La poétesse n’est pas plus une ombre sur une paroi qu’un arbre. Pour preuve, son corps comme elle-même fait beaucoup de choses comme il en refuse d’autres :
« mon ventre ne fait pas de miel, moi
mon ventre ne fait pas de bruit
quand tu viendras, tu pourras voir
je sais rouler les cigarettes
je sais m’endormir en bougeant »
Il est donc facile de comprendre que son romantisme (qui existe bel et bien) est particulier :
« je m’ennuie quand je pense à tout
je voudrais être un château crevé
je voudrais être un cheval pourri. »
Ce qui ne l’empêche pas dans ses martèlements phrastiques sourds d’appeler l’autre à l’horizon de son espoir :
« viens me parler, viens dans ma chambre
viens par les clés ».
Car – répétons-le d’autant qu’elle ne cesse de le scander – Laura Vazquez n’est pas un arbre. Même si elle a besoin d’être arrosée :
« toi tu es une goutte
et tu tombes sur ta tête
il faut que tu tombes sur le toit
tu dois faire pousser des plantes »
et la plus belle des plantes qui l’appelle :
« viens vite avec tes branches sales
viens parler avec ma bouche
avec ta bouche
viens parler avec ma chambre
avec ma bouche
viens me parler sur les doigts
avec ta bouche »
afin que l’horizon de l’amour s’annonce dans un parc où les arbres inconnus improvisent leurs croissances. L’auteure n’a pourtant rien d’une femme légère, sans être pour autant collet monté. Les cols Claudine ne sont pas de son fait – et elle peut se laisser séduire par le  passage d’un amant. Mais elle n’en fait pas la collection. Sa vie ne rentre pas dans des cartons. Rien n’y est fait pour être empilé. Tout est disponible. Et ses vêtements seront portés par d’autres. Elle garde un sac, des crayons, du papier et de quoi se changer avec brosse à dents, et savon. Elle rend facilement les clés, prend un billet de train. Elle n’est pas de ces filles qui prônent des orgies de vermillon dans leur chevelure de blé noir. Mais dans la sienne s’entend le chant des moineaux plus que celui des Horace et des Curiace. Leur guerre ne démobilise pas son sommeil de paix.
passage d’un amant. Mais elle n’en fait pas la collection. Sa vie ne rentre pas dans des cartons. Rien n’y est fait pour être empilé. Tout est disponible. Et ses vêtements seront portés par d’autres. Elle garde un sac, des crayons, du papier et de quoi se changer avec brosse à dents, et savon. Elle rend facilement les clés, prend un billet de train. Elle n’est pas de ces filles qui prônent des orgies de vermillon dans leur chevelure de blé noir. Mais dans la sienne s’entend le chant des moineaux plus que celui des Horace et des Curiace. Leur guerre ne démobilise pas son sommeil de paix.
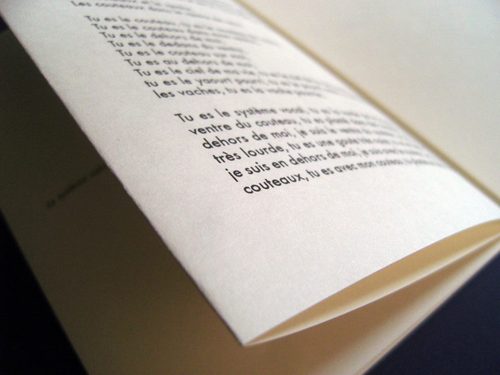 Le lecteur baisse les yeux devant tant de limpidité comme devant les seins des femmes. Ses vers si rapides deviennent des coquillages hantés d’imaginaire de nacre. Sans oublier les hommes épaves. L’œuvre creuse la glaise du silence, appelle des lisières qui ouvrent à la pénétration – sans rien d’impudique. La goutte partagée, son cristal sur les lèvres ne sont pas là pour ressasser de l’éros basique. Il parle une langue nouvelle : dans le plus empêché, elle pousse en troublant le chic et le chiqué. Là où tout est dominé par effet de métaphore active pour réveiller le boucan du corps qu’on « étouffe. Musique alors musique. Non par où ça monte mais où ça descend et tombe. Le corps n’est plus seulement un télégraphe intelligent. La langue l’incarne soufflant très fort en une sorte de piston symphonique en refrains, elle dépasse l’interdit mais sans monstration spectaculaire, séductrice. L’extérieur est à l’intérieur. L’intérieur est à l’extérieur. Les femmes ne sont pas séparées des hommes. La poétesse les fait même remonter plus haut que l’animal. Et qu’importe si la vue tue.
Le lecteur baisse les yeux devant tant de limpidité comme devant les seins des femmes. Ses vers si rapides deviennent des coquillages hantés d’imaginaire de nacre. Sans oublier les hommes épaves. L’œuvre creuse la glaise du silence, appelle des lisières qui ouvrent à la pénétration – sans rien d’impudique. La goutte partagée, son cristal sur les lèvres ne sont pas là pour ressasser de l’éros basique. Il parle une langue nouvelle : dans le plus empêché, elle pousse en troublant le chic et le chiqué. Là où tout est dominé par effet de métaphore active pour réveiller le boucan du corps qu’on « étouffe. Musique alors musique. Non par où ça monte mais où ça descend et tombe. Le corps n’est plus seulement un télégraphe intelligent. La langue l’incarne soufflant très fort en une sorte de piston symphonique en refrains, elle dépasse l’interdit mais sans monstration spectaculaire, séductrice. L’extérieur est à l’intérieur. L’intérieur est à l’extérieur. Les femmes ne sont pas séparées des hommes. La poétesse les fait même remonter plus haut que l’animal. Et qu’importe si la vue tue.
![[Livre-chronique] Laura Vazquez, Le système naturel et simplifié, par Jean-Paul Gavard-Perret](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2014/09/VazquezBackG2014.jpg)
![[Livre-chronique] Laura Vazquez, Le système naturel et simplifié, par Jean-Paul Gavard-Perret](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2014/09/band-Nufemme.jpg)