Nous remercions Esther Tellermann de nous avoir confié un texte que Bernard Desportes appréciait tout particulièrement, qui a d’abord paru dans le volume collectif Bernard Desportes autrement, avant d’être intégré à son recueil de textes Nous ne sommes jamais assez poètes (La Lettre volée, 2014, p. 163-169) – mais inédit sur le net. [Lire Hommage 1/5]
Vers les déserts, premier roman de la trilogie de Bernard Desportes, se donne comme le parcours de la langue maternelle en une seule phrase voulant rejoindre un impossible à dire : la fascination de l’enfant pour l’accouplement de la mère, la déchirure originelle qu’elle ouvre comme réel de l’inceste.
N’est-ce pas sa célébration qui inaugure le récit de Vlad dans le théâtre d’une copulation honnie et initiatique : celle d’un homme anonyme incarnant une puissance phallique rejetée pour être associée à la souillure du corps de la mère prise ?
De cela naît Vlad, de cette indignité comme fondement de la vie humaine, de la sienne, de ce trait sur la terre vierge, du noir sur la page blanche, de l’écrit qui fait barrage à l’angoisse ; celle de l’intolérable de la jouissance du père que le fils s’approprie. Désormais le récit déroule un réel cru pour être une fiction hallucinée, l’épopée d’une humanité d’avant le langage, enfermée dans le trou du monde qu’elle parcourt à l’aveugle.
Ébauche d’humanité plutôt en quête de sa nomination comme le personnage-narrateur qui se raconte, raconte le Rien qui le constitue et dont il est affecté, de n’être pas séparé de l’acte qui l’engendre.
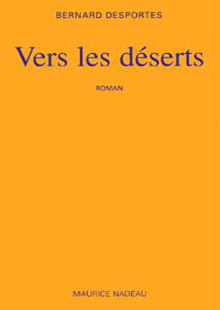 Ainsi la langue de Vlad trace-t-elle un continent tendre à force de cruauté, entre noirceur et moiteur, toujours meuble, de la souplesse des chairs où l’on s’oublie. Temps, lieux, personnages de Vers les déserts ne sont en effet que ceux de la page même où s’écrit la transgression de l’interdit qui peut arrêter l’entrée de l’homme dans les signes.
Ainsi la langue de Vlad trace-t-elle un continent tendre à force de cruauté, entre noirceur et moiteur, toujours meuble, de la souplesse des chairs où l’on s’oublie. Temps, lieux, personnages de Vers les déserts ne sont en effet que ceux de la page même où s’écrit la transgression de l’interdit qui peut arrêter l’entrée de l’homme dans les signes.
Car rien ne naît du ventre féminin si le langage n’a pas déjà laissé dans l’adresse de celle qui engendre, le sceau d’une coupure, le lieu d’une naissance.
C’est cette naissance que Vlad poursuit pour s’arracher au corps de la mère morte devenu obsessif. Où l’absente tisse une présence infinie que Vlad tour à tour implore ou torture sous la forme de tous les petits autres rencontrés : personnages infirmes, informes, vieille tante butée, garçons de ferme fondus à la terre, femmes muettes, enfants qui tous errent autour d’un centre vide que la langue approche, tendue vers un impossible à dire, impossible où Sade mit le mal absolu là où la philosophie occidentale mit le Bien suprême.
L’autre en effet dans le récit de Desportes est ce prochain qu’il faut battre à mort, violer, forcer, dont il faut jouir sans limites. Même absence de limite dans l’espace fictionnel de la narration : rivières ou canaux tracent une ligne improbable sur une terre friable mêlée au brouillard et à l’eau d’où surgit parfois une ville – Dlav – comme immergée dans un Destin qui la condamne.
Les paysages décrits, sombres et hébétés, ont la dureté de ceux qui les peuplent comme pétrifiés d’attendre la parole humaine. Cercles de l’enfer que ces plaines et ces villes où se lit notre idiotie. Rien qu’un malaise étrangement confondu à l’absence de questions comme de réponses.
Car le monde de Vlad est toujours déjà donné, figé dans le moment de la rencontre d’un homme et d’une femme à l’un l’autre étrangers, la dernière soumise au premier selon un ordre naturel qui donne raison au plus fort. Dans la lignée sadienne, Desportes dévoile en effet le fondement du Contrat social et de la loi morale, l’immonde de notre vérité ordinaire que nous désignons ordinairement comme Bien, amour du prochain, de notre propre image, ici pulvérisée dans les heurts, bouts de chairs, hargnes, rancœurs, petitesse des résignations.
Car si la « littérature » de masse actuelle oublie volontiers les auteurs qui façonnèrent la modernité, Desportes entend les faire résonner dans sa propre voix : Sade, Céline, Bataille, Beckett, Genet ne sont pas pour Desportes lettre morte, ils interrogent le sens d’une Humanité après la mort de Dieu. Qu’est-il encore après que le terreau européen a produit sa propre exténuation comme possible ?
Ainsi le désespoir que l’on peut entendre dans la fiction n’est-il pas choix narcissique, il est posture éthique, rage baudelairienne, remise en question des « progrès » et de l’humanisme proclamés encore à la fin du XXème siècle. Le XXème siècle n’a pu faire comme si rien n’avait eu lieu au milieu de son parcours. C’est là où son idéologie progressiste est venue échouer, où l’amour du prochain s’est révélé sous son vrai jour : dans la crudité de l’obscène.
Symbolisé par la figure emblématique du « nègre », l’Autre, « l’exclu » des sociétés occidentales, le nègre « seul dans sa solitude », représente le rebut, le déchet. Un nègre d’une négritude à la Césaire, portant haut la faille constitutive de l’humain et qui la rend à la détresse de l’humain, à son errance et à son désir d’ancrage.
« (De ce) nègre noir dans la ville » peut venir la rédemption des personnages voués au non-sens du sexe – pour donner à ce dernier valeur sacrée et sacrificielle. Ceux qui n’étaient qu’ébauche d’humanité, Vlad ou Ploc, pourraient atteindre à un discours sans parole, à un silence signifiant qui les feraient advenir, les arracherait à la fusion avec la terre qui les efface, à cet engloutissement dans la jouissance interdite, celle du corps de la mère qu’il faudrait par sa propre annihilation sans cesse animer.
Car Desportes écrit de cette angoisse-là, celle de Vlad : de cet univers coupable d’avoir été séparé d’une virginité première, de la copulation intolérable du père, de son orgasme à lui que son fils aurait pour tâche de taire dans la mutilation de son nom.
Les noms tronqués des personnages sont en effet à l’image des espaces de Vers les déserts, de ces terres mêlées à la mer, de ces mers mêlées aux eaux stagnantes : distincts et pourtant informes dans la violence d’une seule syllabe qui arrache hommes, lieux et temps à l’engloutissement où les voue une malédiction première : la souillure du corps vierge qui les a engendrés, la mort de la mère en novembre, deux jours après avoir rejeté ce qui grouillait en son ventre sans avoir eu le temps de le désirer.
La littérature est sombre, dira-t-on, elle n’annonce aucun espoir. Pourquoi cet antihumanisme féroce chez Desportes en ces moments de fêtes humanitaires ? Ces types de nulle part, Blav-Glav-Glov-Zglard-Logm-Glom-Mlog ? Ils ne sont que les noms d’une humanité oubliée par Dieu, de tant d’absence de signes, de tant de décharges et de tant de morts… Un cri de révolte, celui de tout écrivain qui tisse autour d’un trou qu’il lit au-dedans de soi, qu’il « maintient au dedans de soi », ne comble pas de ce « bonheur » déjà ironisé par Flaubert.
Si Desportes donne à son « voyage » l’âpreté célinienne, c’est pour subvertir les discours lénifiants d’un humanitarisme qui masque ce que la vocation au Bien recouvre de haine à déverser ses aumônes à ceux-là mêmes qu’elle éjecte. Alors passent dans les topoï de Vers les déserts, leur hors-temps et leur hors-lieu, les zones de la terre qui sont désormais le décorum de notre bonne conscience. Les « décors » que plante Desportes ne sont pas un « envers » de notre quotidien, simplement sa face réelle : dans le bâtiment érigé sa fêlure, dans le mur ce qui s’effondre, sur les parois du monde les lettres qui inscrivent dans la mort et le sexe l’appel de l’Homme, sa demande d’une éternité, d’un au-delà de la corruption et de la puanteur. Aller Vers les déserts, c’est aller vers une zone vide et blanche qui illuminerait les demi-teintes, jaunâtres, brunes, grises, c’est aller vers le désir, prendre appui sur toutes les lettres gravées dans la pierre, sur les plâtres et les éboulis des villes, les déchets des civilisations, sur leurs décombres.
Le monde de Desportes n’a donc rien de celui de la haine eugéniste et du grotesque célinien. C’est le chant désespéré d’une vieille terre à bout de souffle, épuisée par l’amoncellement des restes de l’homme : bouts d’or et de métal, bouts de dents et d’os, obstination de l’humain à ne pas tout à fait disparaître, à laisser un souvenir de sa peur.
Et c’est cette peur que Desportes interroge avec une radicale modernité, son non-dit, sa folie et sa rage qu’il n’est pas besoin de décliner dans des actes, il suffit d’en donner l’odeur. Car c’est le poète ici qui, dans sa fiction, recompose le monde avec des mots et un rythme qui les agence, rapportant la représentation classique occidentale à la nuit qu’elle recèle dans la brillance de ses glacis. Rapportant la perspective et sa splendeur à une surface à deux dimensions : celle de la verticalité. Mais au lieu de l’élévation vers le mirage des étoiles, c’est vers le bas que nous mène le poète, sous la terre, vers tous les morts qu’elle berce, sous le couvercle baudelairien. Dans l’horizontalité d’une surface sans cesse balayée par les vents, confondue à la mer et au ciel qui jamais n’émerge comme pour retirer aux hommes le fantasme qu’ils poursuivent, leur faire oublier le réel qui les pétrit : le vent qui balaie leurs mirages et leurs rêves, les villes debout qui ne tiennent pas, s’effacent dans la langue du poète pour avoir été trop factices, n’avoir rien offert à l’homme pour recouvrir sa nudité.
N’est-ce pas l’épopée de l’homme sans Dieu que Desportes ici narre ? Que devient Ulysse sans l’Olympe ? Que devient Valjean sans le rayonnement divin ? Des bouts de personnages, des concrétions consonantiques, des noms de tous les continents, tant chacun contient en lui ce qui l’exclut, l’autre côté de sa frontière, cet autre en lui qui indique dans son identité sa faille.
Mais écrire procède ici plus d’une nécessité intérieure que de la nécessité du témoignage. Car à l’origine de la naissance du fils fut le viol de la terre-mère délaissée et béante, devenue ce trou, que le père aurait pu border d’une limite, d’un interdit. Nul interdit n’a accompagné le monde de Vlad, son enfouissement dans l’élément premier, la langue-mère, sa chaleur, sa moiteur étirée dans une phrase unique comme écriture de la jouissance qu’elle n’a pas eue.
Car c’est sa jouissance à elle que le fils écrit. Le fils écrit pour dire ce que Bataille écrivit dans son récit fulgurant poursuivi dans Brèves histoires de ma mère : la jouissance de la mère sans la limite qui en interdirait l’accès au fils.
Écrire n’est-ce pas dès lors venir border cette jouissance-là qui déporte le sujet-narrateur de ville en ville, de route en route, de désert en désert, de nom imprononçable en nom imprononçable : Gdlarz-Zglard-Glog-Dlav-Lavd, valse des consonnes autour du a et du o, de leur béance.
C’est vrai que les saisons tournent encore sur les paysages plats de Vers les déserts, sur ses champs d’orge et d’avoine, étendues fécondées et stériles où s’ébauchent des guerres qui se confondent : guerre des éléments, guerres humaines fracturant le UN que le fils dans son errance ne va avoir de cesse de chercher dans ses débauches. Un fils, un autre, le même cherche le père, avec ses mots il creuse la langue comme l’enfant creuse la terre avec la pelle, détache ses mottes friables, se donne à l’autre enfant dans un jeu de reflets, ceux des désirs entrecroisés de la mère, du père et du fils de l’inceste d’où viendra rédemption et vérité de la détresse.
Alors n’est plus pour l’homme qu’une seule certitude : celle de la sexualité et de la mort portées par le vivant que l’écrit approche dans son scandale, mais au prix de ce vide que l’écrivain cherche en lui-même, cette béance propre à accueillir un rythme qui se substituera au monde.
C’est le rythme qui redonnera significations au langage déserté du XXéme siècle, à sa déréliction. L’écriture contemporaine, pour ne pas méconnaître sa mémoire, réintroduit dans son geste même le sacré, ici dans le sexe, mémoire de la fragilité de l’homme et de sa corruption.
L’étreinte, n’est-elle pas chez Desportes le poème, au bout du crime et de la transgression, dans l’au-delà du principe de plaisir freudien, dans la jouissance du corps nubile, figure de l’écriture même, métamorphose baudelairienne – de la boue en or – pour approcher cette zone que toute œuvre d’art approche, celle de l’angoisse où Baudelaire planta son drapeau noir ?
Desportes écrit donc d’un impossible à écrire qu’il décline. Car le sexe est une enfance, la perversité de l’enfance qui tisse ses jeux sur la nuit, couvre les fosses de râles, les quartiers défoncés et les rues de misère. Métaphore d’un monde contemporain qui n’a pas tiré les conséquences du pire, la fable de Vers les déserts mime en effet les béances que le monde occidental secrète dans ses représentations de masse, ses déserts de pensée et de solitude, ses promesses écœurantes de bonheur…
rues de misère. Métaphore d’un monde contemporain qui n’a pas tiré les conséquences du pire, la fable de Vers les déserts mime en effet les béances que le monde occidental secrète dans ses représentations de masse, ses déserts de pensée et de solitude, ses promesses écœurantes de bonheur…
Car ce sont les foules harassées et abattues, les foules du monde exclues de l’Idéal que charrient les idéologies qui hantent la fiction de Vers les déserts. Celles des banlieues d’Europe, les affamés du monde, tous ceux assignés au silence, et ce sont tous ceux-là qui parlent enfin : dans l’orgie sacrificielle de Slap – viol, égorgement, castration, meurtres sauvages – Slap parle enfin au nom de tous ceux-là qui taisent leur désir, en finissent avec un destin désormais imposé à l’homme par le discours de l’homme, son aporie.
Sans Érinyes, ni Olympe, le monde de Vers les déserts réduit à la croûte terrestre comme à son effondrement trouve dans le sexe et la crudité de son réel sa vérité. Car au fondement de notre Destin est la marche aveugle de Vlad dans la conscience de chaque mort, chaque voix éteinte, chaque disparition, mais avec cet espoir collé aux semelles : le nom d’une ville improbable, « mouvante et changeante », mirage sur le désert, le nom de Dieu imprononçable (Htrzmkv) – du a et du o manquant, de la voyelle absente.
Les textes de Desportes rappellent donc à l’humain son réel, d’être fracturé par son aspiration vers l’inhumain, une ville parfaite des bords de déserts où enfin faire halte. Mais Htrzmkv n’est que la cicatrice sur la blessure, une concrétion de lettres comme suturée d’une vérité absente où l’homme continue d’inscrire ce qui le déchire : la séparation d’avec le langage lui-même, oubliée un instant dans l’orgasme qui apaise l’errance dans l’extase, rédemption de l’homme sans Dieu égaré dans sa langue même, n’ayant plus dans sa nudité enfin comprise qu’à continuer son voyage… débarrassé des décorums médiocres, des propositions divertissantes et stupides à force de peur et de mensonges, cachant dans sa veulerie ses rêves de massacres et d’orgies.
Ainsi Bernard Desportes approche-t-il dans sa fiction circulaire et fracturée la vérité du désir de l’Homme débusquée par Sade : jouir du prochain comme célébration bataillienne de l’inceste. En cela consiste le voyage initiatique de Vlad, la langue de Vlad, dans le tissage de l’écrit sur la nuit du monde, la béance des trous où s’accroche le désir.
L’écriture n’est-elle, chez Desportes prière sur les hordes des morts et des vivants, dans l’odeur de la terre prière et pardon, chant qui accompagne leurs cris ? Car c’est en ce savoir de la langue qu’ils ne savent pas, au lieu même où ils sont étrangers à leur propre savoir qu’est la grâce. Celle qui permet dans l’au-delà de la fusion recherchée avec l’autre d’ouvrir à ce qui nous constitue : cet étranger en nous qui rend possible la rencontre, ordonne la lumière, fait entendre autrement les bruits du jour.
Bibliographie :
Bernard Desportes, Vers les déserts, Maurice Nadeau, 1999.
![[Article] Esther Tellermann, La Langue de Vlad [Hommage à Bernard Desportes, 2/5]](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2018/03/VdesertAfricainBackG.jpg)
![[Article] Esther Tellermann, La Langue de Vlad [Hommage à Bernard Desportes, 2/5]](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2018/03/band-VdesertAfricain.jpg)