 Alain Kamal Martial, Cicatrices, Vents d’ailleurs, été 2011, 64 pages, 8 €, ISBN : 978-2-911412-86-8.
Alain Kamal Martial, Cicatrices, Vents d’ailleurs, été 2011, 64 pages, 8 €, ISBN : 978-2-911412-86-8.
Parce que "notre époque est moins attentive au discours engagé contre nos barbaries" (p. 31), l’écrivain mahorais (né en 1974 à Mayotte, devenu territoire français d’Outre-Mer) s’/nous interroge : "est-il encore possible aujourd’hui qu’un homme parle à un autre homme ? comment convaincre par l’usage de la langue dans un monde où les armes sont un argument, le plomb qui frappe la tête, la lame qui tue de suite, le mot est stérile" (32)…
La mémoire traumatique suscite deux usages de la parole, social ou poétique, molaire ou moléculaire : l’un n’est que spirale tragique, perpétuation-malédiction-aliénation ; l’autre est débordement des limites de la langue, flux rythmique faisant sortir la langue de ses gonds, tourbillon extatique et hypnotique. Autrement dit, les cicatrices résultant d’une politique de la machette ne s’effacent pas par le sang, mais par l’invention d’une langue poétique : telle est, non pas la morale, mais l’impression de lecture qui se dégage de ce récit poétique fascinant.
Parce que ce livre nous apporte un vent d’ailleurs, provenant de ces territoires inouïs que constituent ceux de Césaire et de Raharimanana – et aussi que, parmi les courants d’air critiques soufflés par quelques blogs, il en est même un à contresens –, traçons notre propre sillage en ce territoire singulier.
Un homme sans nom dans un noir pays sans nom du Continent noir, la machette à la main, au bord de l’innommable… Instant d’éternité : "la seconde est comme une chambre sans porte où le même circuit se répète"… Cette instantanéité est celle, tragique, du descendant sur qui pèse une haine séculaire : la machette appelle la machette… Ce geste qui s’inscrit dans une Histoire tragique demeure suspendu : arrêt sur une image qui hoquète… Une vision sublime : d’une intensité maximale, l’image-cristal (Deleuze) oscille 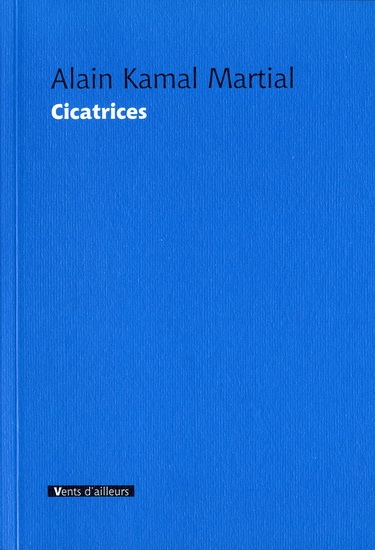 entre réel et virtuel, ouvrant ici une nouvelle perspective sur un monde archaïque : "mais en quoi ces assassinats nous appartiennent si nous nous mettons à répéter des langues et nos bras à répéter des gestes que d’autres bras avant nous ont répétés, en quoi nous sommes ce que nous sommes ?" (p. 20) ; "en quoi la colère de ma mère est ma colère ?" (21)… Dans ce conflit tragique entre tradition et individuation, morale ancienne et morale nouvelle, le narrateur refuse la réduction de son devenir à un devoir-être-bête : "je ne partage pas avec vous cet espace d’être la bête qui regarde l’autre bête […] l’homme est une bête d’anéantissement, […] l’homme en face d’un autre homme ne s’accommode de l’un ou de l’autre que lorsque l’un ou l’autre accepte de se soumettre, de s’anéantir" (29).
entre réel et virtuel, ouvrant ici une nouvelle perspective sur un monde archaïque : "mais en quoi ces assassinats nous appartiennent si nous nous mettons à répéter des langues et nos bras à répéter des gestes que d’autres bras avant nous ont répétés, en quoi nous sommes ce que nous sommes ?" (p. 20) ; "en quoi la colère de ma mère est ma colère ?" (21)… Dans ce conflit tragique entre tradition et individuation, morale ancienne et morale nouvelle, le narrateur refuse la réduction de son devenir à un devoir-être-bête : "je ne partage pas avec vous cet espace d’être la bête qui regarde l’autre bête […] l’homme est une bête d’anéantissement, […] l’homme en face d’un autre homme ne s’accommode de l’un ou de l’autre que lorsque l’un ou l’autre accepte de se soumettre, de s’anéantir" (29).
Son vertige est lié au trop-plein injonctif, aux langues qui le parlent : "des langues parlent au-dessus de ma tête, elles disent les corps incomplets qui volent en éclats sans cesse dans le geste de la machette" (16) ; à sa contamination par les discours dominants de la colonisation et de la tradition… Comment échapper à la spirale des viols, des violences et des guerres quand on n’a pu s’approprier sa propre Histoire ? Quand on est aliéné par des hypostases qui résonnent comme autant de mots d’ordre : "la nation, la communauté et tout autre regroupement des hommes sont néfastes, la religion, la race, le nom, l’idée, la liberté ne sont en réalité que des armes de destruction, des prétextes, les moyens les plus faciles dont dispose un homme pour engager un peuple dans l’anéantissement d’un autre peuple et tous ces anéantissements constituent les cicatrices que nous portons et ces cicatrices en chaîne provoquent des tueries en chaîne au point que nous ne sommes qu’une somme de morts dans nos têtes" (30-31) ? Quand on est conditionné par des superstitions religieuses : "les miliciens ont chacun au bout de leur pénis une goutte de sang, ils croient que le vagin est un fétiche, c’est ce qu’ils appellent frapper à la source de vie, en violant les mères, ils leur prennent la matrice vitale […]" (40) ? Cette machine infernale du conditionnement culturel se traduit, dans un passage particulièrement dense, par une mécanique linguistique implacable (enchaînement des conjonctives introduites par "que").
Le narrateur s’insurge donc contre un haineux devoir-de-mémoire, en appelant à une autre langue : "il fallait qu’une autre langue parle enfin dans ce pays, la vôtre a trop longtemps parlé, je ne veux plus tous vos mots, votre mémoire, je ne veux pas / j’aurai préféré entendre les choses qui n’ont pas de langue parler à la place de vos langues" (25)… Une langue tourbillonnante : "tous les noms, toutes les choses auraient dû tomber dans le trou des langues, un vertige nu" (26). Celle-là même à laquelle aboutit sa mère, qui "hallucine son viol en boucles interminables" (38) : "maman, tu avales ta pensée et les cicatrices de ta vie s’engouffrent dans la cicatrice de ta bouche, tous les noms, toutes les choses tombent dans le trou de ta langue, tu es un vertige nu" (60)… Sa parole délirante réussit la (con)fusion entre Mère Patrie, Mère nourricière et Mère sexuée : contre la contamination idéologique, la contamination sémantique/isotopique. Le texte même que nous avons lu avant de découvrir le monologue de la mère est tourbillonnant, organisé en stances rythmées par des anaphores qui constituent des pulsations textuelles – procédé qui dramatise l’instant fatidique condensant ces Cicatrices.
![[Chronique] Alain Kamal Martial, Cicatrices](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)