Suite à la disparition de Pierre Guyotat vendredi dernier (1940-2020), qui suit d’un peu moins de deux ans celle de Bernard Desportes (1948-2018), grâce à Christophe Alix, voici un inédit de notre ami et collaborateur : une relecture inédite de Guyotat après la publication de Progénitures et d’Explications, qui sera publiée dans un volume intitulé L’Hospitalité. [Tous les livres de Guyotat sont parus chez Gallimard]
Pas de sexe privé, ici, c’est indigne de l’art
(Pierre Guyotat, Explications, Léo Scheer, 2000, p. 12).
Je me souvenais d’avoir aimé l’ample phrase du Tombeau pour cinq cent mille soldats (1967), ses échos maldororiens, et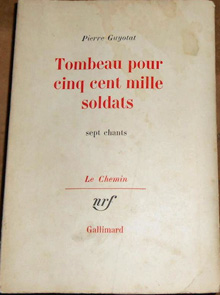 plus encore l’éclatement du récit et cette abolition du temps dans le jaillissement superbe et violent de nombreuses scènes d’Eden, Eden, Eden…. Relisant cette œuvre, je ne renie pas cette séduction passée qui, souvent, perdure par sa capacité à renouveler l’essoufflement né de ces marches suffocantes dans l’obscène et au bord de la mort. Peu de textes contemporains ont cette âpreté obsédante d’Eden.
plus encore l’éclatement du récit et cette abolition du temps dans le jaillissement superbe et violent de nombreuses scènes d’Eden, Eden, Eden…. Relisant cette œuvre, je ne renie pas cette séduction passée qui, souvent, perdure par sa capacité à renouveler l’essoufflement né de ces marches suffocantes dans l’obscène et au bord de la mort. Peu de textes contemporains ont cette âpreté obsédante d’Eden.
D’où vient alors, me suis-je dit, cette sensation – déjà ancienne quand même, mais amplifiée aujourd’hui – de lourdeur, de malaise teinté d’ennui, cette lassitude finalement à la relecture (partielle) d’Eden, Eden, Eden (1970), de Prostitution (1987), du Livre (1984), et plus encore du récent Progénitures (2000) ? Eh bien justement de la répétition morne et morte qu’entraîne cette abolition du temps qui d’abord, croyais-je, m’avait retenu. C’est bien cela, cette disparition de temps qui en supprimant la source majeure de l’angoisse humaine supprime du même coup dans cette œuvre le sentiment qu’on a affaire à des êtres autonomes et singuliers, vivants en un mot.
Que veux-je dire par abolition du temps ? Rien ici de comparable avec le bouleversement du temps dans l’œuvre de Faulkner (et l’analyse à mon avis erronée qu’en fait Sartre), il s’agit bien chez Guyotat d’une disparition.
Eden (comme les livres qui suivent[1]) n’est ni dans la chronologie (laquelle suppose une mémoire et la postulation d’un futur) ni même dans le présent dont il n’a ni le tremblement ni la fugacité ni surtout cette ouverture sur un inconnu à-venir qui le fonde seul comme possibilité vivante, avec toute sa violence et sa tragique beauté – ou son horreur. Fugacité et ouverture sont l’essence même du présent et la source fondamentale d’une « angoisse de penser »[2] qui nous place sans cesse et sans fin au bord du réel et de la vie dans l’inaccessibilité et de soi et du monde.
Ni chronologie historique ni « chronologie » mentale (pulvérisée en espace comme chez Faulkner), ni présent donc non plus : le lieu, le moment de Guyotat n’est pas dans l’hypothèse et l’attente d’un à-venir et du coup n’est pas non plus dans l’instant insaisissable : il est présent mort, immobile et statique, un instant qui est là de toute éternité – échappant au mouvement du temps aussi bien par l’absence de durée que par l’absence d’une perspective dans l’espace. Rien ne vient jamais nous arracher à ce « présent » statique qui semble nous chosifier. Les hommes, dans le monde de Guyotat, ne sont ni heureux ni malheureux, ni joyeux ni angoissés car ils sont intemporels – mais, intemporels, ils n’ont aucune conscience d’être car on ne peut dissocier conscience et temps, et « la conscience ne peut ‘être dans le temps’ qu’à condition de se faire temps dans le mouvement même qui la fait conscience »[3].
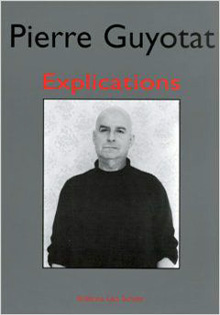 Dépourvus de conscience et ainsi chosifiés, les personnages de Guyotat semblent des pantins entre les mains d’un Dieu tout-puissant, leurs actes sont mécaniques, ils ne leur appartiennent pas, sans cause ni objet autres que d’être des actes toujours identiques et toujours recommencés. Actes qui, ne relevant pas d’une décision, sont le seul produit d’une fonction – avec toujours le même caractère obligatoire et insensé, répété et immuable, que les actes de celui qui, subissant un châtiment dont il ne connaît pas la raison, doit accomplir une peine qu’il ne comprend pas : « Dans Progénitures, nous dit Guyotat, le peuple apparaît comme soumis à cette obligation-là (la sexualité). On y voit des figures contraintes, obligées de forniquer comme on bêche (…). C’est sans cesse qu’on travaille (…) ; c’est une peine » (Explications, p. 41-42). Dans les livres de Guyotat, l’homme est un homme- forçat – dépossédé de toute liberté de décision.
Dépourvus de conscience et ainsi chosifiés, les personnages de Guyotat semblent des pantins entre les mains d’un Dieu tout-puissant, leurs actes sont mécaniques, ils ne leur appartiennent pas, sans cause ni objet autres que d’être des actes toujours identiques et toujours recommencés. Actes qui, ne relevant pas d’une décision, sont le seul produit d’une fonction – avec toujours le même caractère obligatoire et insensé, répété et immuable, que les actes de celui qui, subissant un châtiment dont il ne connaît pas la raison, doit accomplir une peine qu’il ne comprend pas : « Dans Progénitures, nous dit Guyotat, le peuple apparaît comme soumis à cette obligation-là (la sexualité). On y voit des figures contraintes, obligées de forniquer comme on bêche (…). C’est sans cesse qu’on travaille (…) ; c’est une peine » (Explications, p. 41-42). Dans les livres de Guyotat, l’homme est un homme- forçat – dépossédé de toute liberté de décision.
L’alternative dès lors n’est plus, comme la sexualité le révèle, dans la fragilité des frontières entre l’homme et l’animal puisque les hommes, ici, n’ont pas d’alternative, ne disposent d’aucun libre choix et se posent d’autant moins de questions qu’ils ne sont pas d’abord pour eux-mêmes une question. Leur présent n’est pas d’abord une possibilité d’être, dans la permanence d’une interrogation ; et naturellement ils ne se situent pas davantage, car l’ailleurs n’existe pas pour eux, lequel renvoie à une mémoire du lieu et donc au temps. Le futur de même est absent qui supposerait la conscience d’un possible à-venir, une liberté d’être … En vérité, dépossédés de présent et dépossédés de liberté ils n’existent pas.
Pour Guyotat, le malheur de l’homme ne vient donc pas d’une temporalité dont il est dépourvu mais de sa sexualité – de la « fatalité sexuelle » nous dit-il :
Tout ce que je fais, je le fais pour me débarrasser de la sexualité, je n’en veux pas, je veux évacuer ça…
Cette obligation de la sexualité qu’il y a en l’homme, c’est une des tâches les plus terribles de l’homme (…). Je pense que c’est vraiment une des tâches les plus monstrueuses que le « Créateur » ait imposées à sa créature… (Explications, p. 41).
Ainsi l’acte sexuel est-il une malédiction, quoique que Guyotat s’en défende. Pas seulement une « peine », comme il le dit, mais bien une malédiction qui apparaît comme une fatalité imposée par le « créateur » à sa « créature ». Une créature là encore défaite de toute liberté décisionnelle, réduite à l’état d’objet, de pantin aux mains d’un Dieu tout-puissant.
*****
Au bord de l’obscène, disais-je plus haut. En effet, loin d’ouvrir sur un abîme toujours béant devant nous et toujours plus profond  lorsqu’on s’y engage au point de nous faire abîme nous-même, gouffre infini dont l’appel vertigineux nous submerge et nous emporte aux confins du sensible, le sexe dans les livres de Pierre Guyotat est une donnée brute, un travail à accomplir qui s’accomplit, mécaniquement, immédiatement clos sur lui-même avant que d’être immédiatement et à l’infini recommencé. A l’acte sexuel succède le même acte sexuel, sans que celui-ci en rien – comme celui qui l’a précédé et celui qui va lui succéder inexorablement – ne modifie le présent ni de l’acte ni de l’être qui l’accomplit.
lorsqu’on s’y engage au point de nous faire abîme nous-même, gouffre infini dont l’appel vertigineux nous submerge et nous emporte aux confins du sensible, le sexe dans les livres de Pierre Guyotat est une donnée brute, un travail à accomplir qui s’accomplit, mécaniquement, immédiatement clos sur lui-même avant que d’être immédiatement et à l’infini recommencé. A l’acte sexuel succède le même acte sexuel, sans que celui-ci en rien – comme celui qui l’a précédé et celui qui va lui succéder inexorablement – ne modifie le présent ni de l’acte ni de l’être qui l’accomplit.
La sexualité dans cette œuvre n’est pas une angoisse qui, dépossédant momentanément l’être de son moi, l’ouvre aux abîmes de la mort et de l’impossible – elle n’est que cette fatalité à la cadence de métronome, cette obligation absurde, cette malédiction qui frappent le forçat enchaîné à son destin comme un bagnard à son bagne. De même que le présent n’est pas d’abord, ici, une possibilité d’à-venir mais simplement une masse brute de « temps » hors durée qui s’empile et s’entasse sur du « temps » figé, depuis toujours déjà là et donc depuis toujours déjà mort, de même la sexualité dans cette œuvre n’est pas une tension ouverte sur l’inconnu, un vertige, mais la production codifiée, calibrée, sempiternellement reproduite et prévisible d’une activité de sexe établie selon les mêmes schémas programmés, aliénés, obligatoires : un travail de forçat…. ou de martyr.
De martyr ou de saint – car l’obsédante et épuisante obligation de « fornication » (il est intéressant de remarquer que Guyotat choisit toujours de préférence des termes religieux ou à forte connotation religieuse) est subie comme une mission rédemptrice rédemptrice et salvatrice :
– il faut absolument « évacuer ça », « en évacuer le plus possible », « on peut lire Progénitures comme mon cri de révolte maximum contre le sexe »… (p. 41) ;
– « je pense que je pourrai enfin vivre quand j’en aurai terminé avec ce devoir de produire ce chant, et cette scène. Il sera peut-être trop tard physiologiquement à ce moment-là, mais en tout cas, j’ai l’impression que je n’ai travaillé à tout ça que pour avoir les mains libres, si je puis dire, l’esprit et le cœur libres pour vivre enfin ! J’ai toujours pensé, et je le pense de plus en plus, que toute cette œuvre n’est qu’une préparation à la vie que je pourrai mener après » (p. 96).
L’écriture ne vise pas à justifier les mots qui la constituent et lui font, parfois, aborder l’inconnaissable, elle n’a à rendre compte ni d’utilité ni de moralité ou de nobles desseins, elle ne saurait avoir une visée consolatrice : elle n’est pas chargée de mission. Mais Guyotat, lui, veut absolument nous montrer le bien-fondé et la mission de sa parole, la fonction sociale et spirituelle de sa langue, et nous faire part de ce qui justifie ses écrits.
Il est chargé (par qui – sinon par Dieu ?) d’accomplir une tâche surhumaine, et cette tâche l’accable, il y travaille sans cesse, il s’y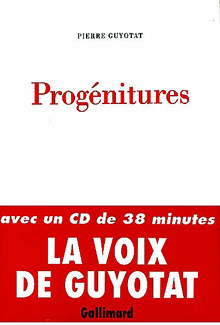 sacrifie – martyr d’une cause dont le commun des mortels, dans son innocence ahurie, ne soupçonne ni l’importance ni l’enjeu. Seul, stoïque et dépourvu du moindre doute sur le caractère unique et quasi sacré de son sacerdoce, saint Guyotat porte sa croix. Après s’être comparé à Fra Angelico (béatifié il y a quelque trente ans) et à Sade (non béatifié encore), saint Guyotat, parlant de sa mission, nous dit modestement : « la rédaction d’une œuvre de ce genre exige, pendant des années, une abstinence, une chasteté totales ; je dis, totales. C’est-à-dire la privation de tout acte produisant de la matière sexuelle, si je puis dire, à l’extérieur comme à l’intérieur ; de tout épanchement. C’est comme ça que je l’ai vécu ; je n’en fais absolument pas une loi » (p. 47). On compatit, bien sûr. Certes, notre martyr en fait d’autant moins une loi qu’il sait son sacrifice hors de portée du profane – et cette chasteté totale de dix ans au moins (temps consacré, d’après Guyotat, à la rédaction de Progénitures), ce jeûne de soi en quelque sorte est en tout point comparable à l’extase des reclus en prière, à ses privations qui transportent le saint hors de soi et hors du monde sensible pour une communion directe avec Dieu.
sacrifie – martyr d’une cause dont le commun des mortels, dans son innocence ahurie, ne soupçonne ni l’importance ni l’enjeu. Seul, stoïque et dépourvu du moindre doute sur le caractère unique et quasi sacré de son sacerdoce, saint Guyotat porte sa croix. Après s’être comparé à Fra Angelico (béatifié il y a quelque trente ans) et à Sade (non béatifié encore), saint Guyotat, parlant de sa mission, nous dit modestement : « la rédaction d’une œuvre de ce genre exige, pendant des années, une abstinence, une chasteté totales ; je dis, totales. C’est-à-dire la privation de tout acte produisant de la matière sexuelle, si je puis dire, à l’extérieur comme à l’intérieur ; de tout épanchement. C’est comme ça que je l’ai vécu ; je n’en fais absolument pas une loi » (p. 47). On compatit, bien sûr. Certes, notre martyr en fait d’autant moins une loi qu’il sait son sacrifice hors de portée du profane – et cette chasteté totale de dix ans au moins (temps consacré, d’après Guyotat, à la rédaction de Progénitures), ce jeûne de soi en quelque sorte est en tout point comparable à l’extase des reclus en prière, à ses privations qui transportent le saint hors de soi et hors du monde sensible pour une communion directe avec Dieu.
« L’espace que dessine les écrits de Guyotat, nous dit Christian Prigent, (…) est un espace radicalement tragique…. »[4] – ah bon ? mais d’où naît le tragique si ce n’est de la conscience que prend l’être de sa fragilité, de la précarité, de l’éphémère de sa condition ? Or les personnages de Guyotat sont dépourvus de cette anticipation de soi qui détermine la conscience, l’être conscient d’être, ainsi que nous l’avons vu plus haut. Privés d’à-venir ils sont du même coup hors du présent de l’être où se noue sa tragédie et hors de l’angoisse qui l’entretient. « L’homme tragique, nous dit Blanchot, vit dans la tension extrême entre les contraires… »[5], « l’homme tragique, nous dit-il encore, est celui pour qui l’existence s’est soudain transformée »[6] – rien de tel chez les personnages de Guyotat.
Un aspect « tragique » d’inquiétude et de déstabilisation fut par contre ouvert par Pierre Guyotat avec Eden – et pour ce seul 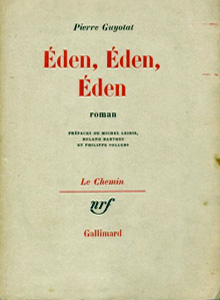 livre. Non que cette œuvre dessinât en elle-même un « espace tragique », mais parce que ce texte venait rompre historiquement dans la manière conventionnelle du récit. Par le dit, par la forme, par le rythme il insufflait une liberté nouvelle à l’écriture – qui s’inscrivait dès lors comme un paradoxe en regard de l’absence de liberté des personnages du récit. Et cette « liberté » formelle venait (en France, après mai 68) « coïncider avec la liberté réelle quand celle-ci entre en crise et provoque une vacance d’histoire » (Blanchot, ibid.). Or cette liberté appelée par Eden, Eden, Eden reste « tragiquement » en crise par une histoire désertée – ainsi Eden demeure-t-il, dans son projet, inacceptable : c’est cela, et cela seul, qui en fait sa force tragique. A contrario, les livres qui ont suivi – malgré leur tension, souvent – n’ont fait que s’empiler comme autant de pierres élevant un mur aveugle qui obstrue le présent d’hommes privés de la seule interrogation qui les fonde comme hommes présents parmi nous : celle de leur à-venir, celui-ci fût-il défait de tout espoir, fût-il étranger à tout alibi d’un lendemain.
livre. Non que cette œuvre dessinât en elle-même un « espace tragique », mais parce que ce texte venait rompre historiquement dans la manière conventionnelle du récit. Par le dit, par la forme, par le rythme il insufflait une liberté nouvelle à l’écriture – qui s’inscrivait dès lors comme un paradoxe en regard de l’absence de liberté des personnages du récit. Et cette « liberté » formelle venait (en France, après mai 68) « coïncider avec la liberté réelle quand celle-ci entre en crise et provoque une vacance d’histoire » (Blanchot, ibid.). Or cette liberté appelée par Eden, Eden, Eden reste « tragiquement » en crise par une histoire désertée – ainsi Eden demeure-t-il, dans son projet, inacceptable : c’est cela, et cela seul, qui en fait sa force tragique. A contrario, les livres qui ont suivi – malgré leur tension, souvent – n’ont fait que s’empiler comme autant de pierres élevant un mur aveugle qui obstrue le présent d’hommes privés de la seule interrogation qui les fonde comme hommes présents parmi nous : celle de leur à-venir, celui-ci fût-il défait de tout espoir, fût-il étranger à tout alibi d’un lendemain.
« Y aurait-il, dans ce siècle du moins, des textes avec autant de couleur, autant de postures, autant de matières, etc, autant de son que dans celui-là ? » (Explications, p. 121-122), s’interroge Guyotat parlant de Progénitures…. En ces temps d’incertitude, ça fait plaisir à entendre : rarement un écrivain aura paru aussi pénétré de sa suprématie et aussi content de soi. Et sans doute n’est-on jamais si bien servi que par soi-même, mais cette « autocélébration » récurrente doublée « tantôt (d’) un sérieux pontifical fort peu fissuré d’humour, tantôt (d’) un ton de prédicateur cathare » (Prigent, op. cit., p. 187) qui sont la marque de Guyotat parlant de Guyotat ne manquent pas seulement d’humour, ils révèlent le manque cruel du rire, l’autre grand absent de cette œuvre. Sans doute parce que le rire n’appartient qu’au présent…. Le rire (le fameux rire de Bataille), écho tragique du moi, éclat sauvage, libre et obscène ouvrant sur la folie et l’abîme de celui qui échappe à son « destin » et forge lui-même sa propre perte en forgeant seul son existence d’homme libre. Toutes choses absolument étrangères à l’univers de Pierre Guyotat – car saint Guyotat ne se commet pas dans le présent ordinaire (« c’est indigne de l’art »), saint Guyotat ne rit pas : c’est un saint triste et laborieux, un abstinent douloureux, sérieux comme un pénitent sous le poids de sa tâche.
(Prigent, op. cit., p. 187) qui sont la marque de Guyotat parlant de Guyotat ne manquent pas seulement d’humour, ils révèlent le manque cruel du rire, l’autre grand absent de cette œuvre. Sans doute parce que le rire n’appartient qu’au présent…. Le rire (le fameux rire de Bataille), écho tragique du moi, éclat sauvage, libre et obscène ouvrant sur la folie et l’abîme de celui qui échappe à son « destin » et forge lui-même sa propre perte en forgeant seul son existence d’homme libre. Toutes choses absolument étrangères à l’univers de Pierre Guyotat – car saint Guyotat ne se commet pas dans le présent ordinaire (« c’est indigne de l’art »), saint Guyotat ne rit pas : c’est un saint triste et laborieux, un abstinent douloureux, sérieux comme un pénitent sous le poids de sa tâche.
[1] Avec Coma (Mercure de France, Paris, 2006) puis Formation (NRF-Gallimard, Paris, 2007) et Arrière-fond (NRF-Gallimard, Paris, 2010), Guyotat change radicalement d’écriture, optant même pour une langue devenue sans doute de plus en plus « lisible » mais qui, surtout, perd de plus en plus toute radicalité.
[2] Je renvoie au bel ouvrage d’Evelyne Grossman : L’Angoisse de penser, Editions de Minuit, 2008.
[3] Jean-Paul Sartre : « A propos de Le Bruit et la Fureur, la temporalité chez Faulkner », in Situations I, « Idées », NRF-Gallimard, Paris, 1975, p. 96.
[4] Christian Prigent, Ceux qui merdRent, P.O.L, 1991, p. 198.
[5] Maurice Blanchot : « La pensée tragique », in L’Entretien infini, NRF-Gallimard, 1969, p. 141.
[6] Id., ibid., p. 142.
![[Chronique] Bernard Desportes, Saint Guyotat, forçat et martyr](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2020/02/GuyotatBackG.jpg)
![[Chronique] Bernard Desportes, Saint Guyotat, forçat et martyr](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2020/02/band-Guyotat.jpg)