
Il n’y a d’"affaire Millet" que par la réaction de tous ceux qui, plutôt classés à gauche, ont pris le risque de passer pour de belles âmes tombant dans les travers qu’elles ont toujours dénoncés : la condamnation morale, la censure, l’ostracisme… Et en effet, on a pu parler à leur encontre de "lynchage", de "police de la pensée", de "fatwa germanopratine"… Dans "Pourquoi me tuez-vous ?" – publié dans L’Express en réponse immédiate au texte d’Annie Ernaux dans Le Monde approuvé par une centaine d’écrivains –, l’auteur lui-même, qui n’hésite pas à se ranger en droite ligne de Dostoïevski, de Drieu la Rochelle ou de Céline, se pose en victime d’une haineuse "chasse à l’homme", d’autant plus incompris que pas vraiment lu. On appréciera la mesure dont il fait preuve à l’égard de ses contradicteurs : "Mes ennemis ? Des fonctionnaires du système médiatico-littéraire, journalistes, échotiers, écrivains parvenus, indigents essayistes. […]. Quelques têtes molles se croient tenues de clamer leur indignation, parmi lesquelles un multiculturaliste invertébré, un poète liquide, un francophone mal à l’aise dans la langue française, un pop philosophe reconverti dans le méharisme saoudo-qatari, une romancière extralinguistique, une pasionaria de l’aveuglement postracial, des KGBistes de l’inculture active et tous ceux qui, n’en doutons pas, vont chercher à exister enfin à mes dépens… Pourquoi me tuez-vous ?"
De quoi s’agit-il ? Un auteur-éditeur aussi connu pour ses provocations extrémistes que pour son œuvre romanesque publie chez un éditeur quasi inconnu, sous couvert du label "éloge littéraire", ce qu’il n’était pas de bon ton que Gallimard publiât : non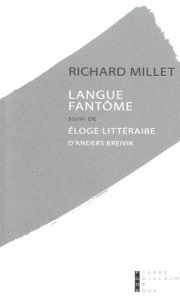 pas tant une apologie totalement explicite du crime, mais, dans la plus pure tradition de l’extrême-droite, un pamphlet xénophobe contre la décadence de l’Europe. L’indignation suscitée dans le champ littéraire comme dans le champ du pouvoir, notamment parmi les autres auteurs de la vénérable maison d’édition – dont le prix Nobel Le Clézio –, n’est pas sans conséquence : jeudi 13 septembre, Richard Millet démissionne du prestigieux Comité de Lecture.
pas tant une apologie totalement explicite du crime, mais, dans la plus pure tradition de l’extrême-droite, un pamphlet xénophobe contre la décadence de l’Europe. L’indignation suscitée dans le champ littéraire comme dans le champ du pouvoir, notamment parmi les autres auteurs de la vénérable maison d’édition – dont le prix Nobel Le Clézio –, n’est pas sans conséquence : jeudi 13 septembre, Richard Millet démissionne du prestigieux Comité de Lecture.
Assurément, plusieurs questions demeurent en suspens : la publication d’un tel livre était-elle censée bénéficier d’un quelconque poids social et symbolique ? La polémique n’en fait-elle pas la promotion ? Est-ce, comme le prétend son auteur, la littérature qu’on vise à travers lui ? Fallait-il fustiger Richard Millet en le suivant sur son propre terrain, celui du lexique moral, voire en jouant les procureurs ? Pourquoi s’arrêter au seul Éloge littéraire d’Anders Breivik, sans le rattacher à l’essai principal (Langue fantôme, Pierre-Guillaume de Roux, été 2012, 120 pages, 16 €), lequel fait écho, chez le même éditeur, à De l’antiracisme comme terreur littéraire (été 2012) et à La Fatigue du sens (2011) ? S’opposer à une quelconque bien-pensance suffit-il pour être subversif ? Toute réaction à un excès affiché comme dérangeant doit-il être taxé de "réactionnaire" ? En fin de compte, de quoi Richard Millet est-il le nom ?
Sans oublier de renvoyer à quelques positions emblématiques, on tentera ici de préciser, avec le plus de distance et de rigueur possibles, en quoi consiste l’imposture Millet.
Cette polémique a-t-elle de quoi surprendre ? Certes non, vu la réactivation dans le champ des clivages politiques et la prégnance d’une tradition française par excellence, celle de l’intellectuel engagé et de l’écrivain pétitionnaire ; il convient également de prendre en compte la dimension symbolique : l’auteur eût-il été moins reconnu et n’eût-il pas appartenu à la prestigieuse maison, sans doute n’y eût-il pas eu d’"affaire". Emboîtant le pas à celui qui se revendique ouvertement de Jean Paulhan avec De l’antiracisme 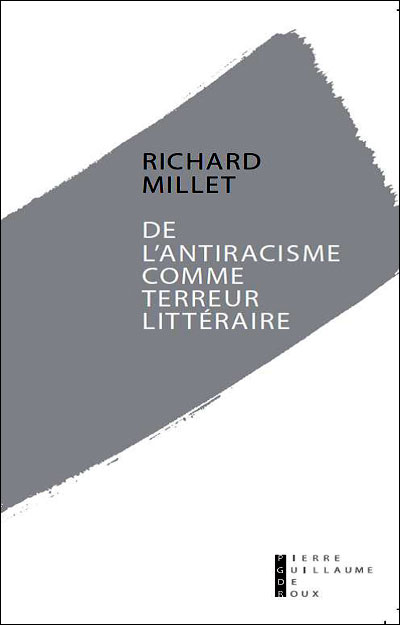 comme terreur littéraire et estimant que Richard Millet a au moins le mérite de poser le problème de l’immigration, mais en condamnant fermement ses excès, Pierre Jourde s’interroge sur une réception aussi hostile : faut-il répondre au racisme par l’ostracisme, au purisme par l’épuration ? Et pourtant, doit-on se laisser imposer un débat en termes faussés, une problématique sans construire son objet en toute indépendance (ce qui pose problème, est-ce l’immigration ou l’intégration, l’intégrisme, le déséquilibre Nord-Sud ?). Ne doit-on pas prendre Richard Millet à la lettre : ne serait-ce pas conforter la décadence de nos démocraties – ramollies par leur excès de tolérance – que de confondre liberté créatrice et folie exterminatrice ? L’écrivain n’a fait qu’exercer sa liberté d’expression ou a-t-il commis une atteinte au droit en justifiant le crime, voire en lançant un appel à la vindicte ? Que penser de cette posture consistant à crier au complot et à se répandre en lamentations, quand on sait le prix qu’ont dû payer de nombreux artistes pour avoir poursuivi jusqu’au bout leur entreprise subversive ? Les vrais subversifs ne doivent-ils pas assumer leurs actes au lieu de s’afficher en victimes ? Les 77 victimes d’Oslo ont-elles trouvé esthétique le geste d’Anders Breivik ?
comme terreur littéraire et estimant que Richard Millet a au moins le mérite de poser le problème de l’immigration, mais en condamnant fermement ses excès, Pierre Jourde s’interroge sur une réception aussi hostile : faut-il répondre au racisme par l’ostracisme, au purisme par l’épuration ? Et pourtant, doit-on se laisser imposer un débat en termes faussés, une problématique sans construire son objet en toute indépendance (ce qui pose problème, est-ce l’immigration ou l’intégration, l’intégrisme, le déséquilibre Nord-Sud ?). Ne doit-on pas prendre Richard Millet à la lettre : ne serait-ce pas conforter la décadence de nos démocraties – ramollies par leur excès de tolérance – que de confondre liberté créatrice et folie exterminatrice ? L’écrivain n’a fait qu’exercer sa liberté d’expression ou a-t-il commis une atteinte au droit en justifiant le crime, voire en lançant un appel à la vindicte ? Que penser de cette posture consistant à crier au complot et à se répandre en lamentations, quand on sait le prix qu’ont dû payer de nombreux artistes pour avoir poursuivi jusqu’au bout leur entreprise subversive ? Les vrais subversifs ne doivent-ils pas assumer leurs actes au lieu de s’afficher en victimes ? Les 77 victimes d’Oslo ont-elles trouvé esthétique le geste d’Anders Breivik ?
*****
Cela dit, la question posée est celle de la responsabilité de l’écrivain : a-t-on le droit de tout dire au nom de la littérature ? Toute prise de position est-elle "littéraire" du seul fait qu’elle se présente comme contestataire ? "L’extermination comme motif littéraire : voilà l’injustifiable" (Éloge d’Anders Breivik, p. 116)…
La première imposture de Richard Millet, qui explique le tollé sans précédent à son encontre, est d’avoir pris un criminel – rien moins que le responsable de la tuerie d’Oslo en juillet 2011 (77 victimes !) – comme porte-étendard de sa posture fondamentalement 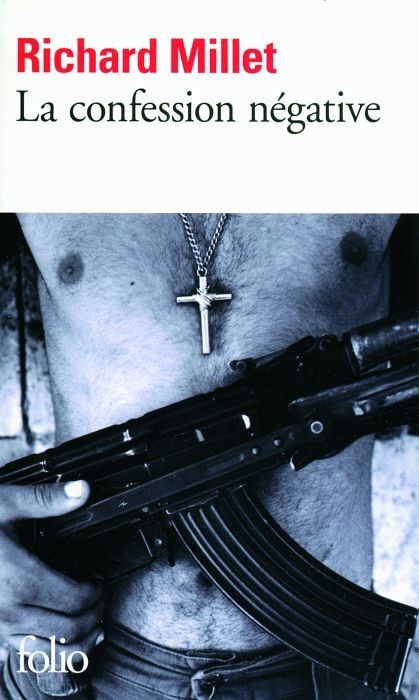 antihumaniste et antimoderne, de l’avoir transformé en justicier, et par là même d’avoir opéré une insidieuse sanctification. Malgré les précautions oratoires, le message est en effet à peine voilé : pour avoir perdu son âme, l’Europe mérite ce genre de châtiment ! La position de celui qui se place au rang le plus élevé de la hiérarchie littéraire n’est somme toute ni moins simpliste, ni moins radicale que celle de tout fanatique : tout individu ou tout peuple qui se perd, trahissant son idéal sacré, s’expose à l’extermination… Dans cette logique, celui qui "est un symptôme de notre décadence" (p. 110), "un enfant de la ruine familiale autant que de la fracture idéologico-raciale que l’immigration extra-européenne a introduite en Europe depuis une vingtaine d’années" (108), n’a fait que contribuer à une épuration salutaire, celle du modèle dominant : le "petit-bourgeois métissé, mondialisé, inculte, social-démocrate" (109). La mort comme aboutissement logique d’une civilisation et, plus métaphysiquement, d’un Homme déchus… Chez ce penseur à capitales (la Nation, le Sang, la Langue, etc.) et à coups de sabre, le pessimisme revêt une dimension aussi idéologique que psychologique. De littérature il n’est nullement question. Que dire, en effet, du tour de force argumentatif par lequel il en vient sur le terrain littéraire ? L’aberration logique débouche ici sur le terreau idéologique : "La crise financière est celle du sens, de la valeur, donc de la littérature. Breivik, d’une façon naïve, loin d’incarner le Mal, s’est fait le truchement sacrificiel du mal qui ronge nos sociétés tombées dans une horizontalité acéphale et trompeuse" (115). Sauvera-t-on ce médiocre et insipide pamphlet en invoquant son style ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que Millet n’est pas Céline.
antihumaniste et antimoderne, de l’avoir transformé en justicier, et par là même d’avoir opéré une insidieuse sanctification. Malgré les précautions oratoires, le message est en effet à peine voilé : pour avoir perdu son âme, l’Europe mérite ce genre de châtiment ! La position de celui qui se place au rang le plus élevé de la hiérarchie littéraire n’est somme toute ni moins simpliste, ni moins radicale que celle de tout fanatique : tout individu ou tout peuple qui se perd, trahissant son idéal sacré, s’expose à l’extermination… Dans cette logique, celui qui "est un symptôme de notre décadence" (p. 110), "un enfant de la ruine familiale autant que de la fracture idéologico-raciale que l’immigration extra-européenne a introduite en Europe depuis une vingtaine d’années" (108), n’a fait que contribuer à une épuration salutaire, celle du modèle dominant : le "petit-bourgeois métissé, mondialisé, inculte, social-démocrate" (109). La mort comme aboutissement logique d’une civilisation et, plus métaphysiquement, d’un Homme déchus… Chez ce penseur à capitales (la Nation, le Sang, la Langue, etc.) et à coups de sabre, le pessimisme revêt une dimension aussi idéologique que psychologique. De littérature il n’est nullement question. Que dire, en effet, du tour de force argumentatif par lequel il en vient sur le terrain littéraire ? L’aberration logique débouche ici sur le terreau idéologique : "La crise financière est celle du sens, de la valeur, donc de la littérature. Breivik, d’une façon naïve, loin d’incarner le Mal, s’est fait le truchement sacrificiel du mal qui ronge nos sociétés tombées dans une horizontalité acéphale et trompeuse" (115). Sauvera-t-on ce médiocre et insipide pamphlet en invoquant son style ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que Millet n’est pas Céline.
Le lecteur attentif de l’œuvre ne saurait être étonné, sachant que le tragique chez Millet est lié à une vision archaïque du monde, telle qu’est exposée dans La Confession négative, qui confère à la guerre une "fonction sacrée" et pose "la haine comme fait de civilisation" 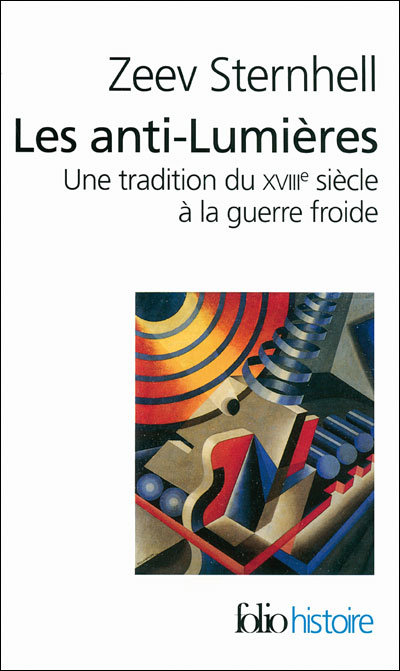 (Folio, 2010, pp. 202 et 251) : "Tout meurtre est rituel, même dans sa folie abstruse, ou dans ce qu’on appelle si pudiquement le feu de l’action. C’est pourquoi, d’une certaine façon, il n’y a pas de criminel de guerre, ni de crime contre l’humanité – cette dernière étant coupable dès l’origine et ne cessant de choir, l’homme restant une abomination pour l’homme" (109). Une autre explication (justification ?) du geste d’Anders Breivik (de la geste ?) nous reconduit aux précédents essais. De L’Opprobre, essai de démonologie (Gallimard, 2008) à De l’antiracisme comme terreur littéraire, en passant par L’Enfer du roman : réflexions sur la postlittérature (Gallimard, 2010) et La Fatigue du sens, Richard Millet exprime son dégoût pour un monde contemporain qu’il caractérise au moyen de qualificatifs commençant par post- : postchrétien, postidentitaire, posthumaniste, postdémocratique, postpolitique, posthistorique, postlittéraire… Un monde infernal qui provoque la fatigue du sens, c’est-à-dire la "résignation devant la puanteur d’un réel devenu cadavre" (2011, p. 11), la chute de la verticalité axiologique dans une horizontalité anomique. Et quand on sait qu’Anders Breivik a lu les Réflexions sur la Révolution française (1790) d’Edmund Burke, l’un des premiers penseurs des anti-Lumières, on comprend pourquoi il séduit Richard Millet. Du point de vue révolutionnaire-réactionnaire, qui, tel que le reconstruit avec rigueur Zeev Sternhell dans une somme remarquable (Les Anti-Lumières, Folio, 2010), préfère l’irrationalisme au rationalisme, le particularisme à l’universalisme, le spiritualisme au matérialisme, le communautarisme à l’individualisme, le purisme au métissage universel (Millet), la tolérance est "signe de déclin" (Spengler) et tout mélange est altération. D’où ce fantasme explicité dans La Confession négative : contre la menace d’aliénation, œuvrer "pour une Europe blanche et chrétienne" (294).
(Folio, 2010, pp. 202 et 251) : "Tout meurtre est rituel, même dans sa folie abstruse, ou dans ce qu’on appelle si pudiquement le feu de l’action. C’est pourquoi, d’une certaine façon, il n’y a pas de criminel de guerre, ni de crime contre l’humanité – cette dernière étant coupable dès l’origine et ne cessant de choir, l’homme restant une abomination pour l’homme" (109). Une autre explication (justification ?) du geste d’Anders Breivik (de la geste ?) nous reconduit aux précédents essais. De L’Opprobre, essai de démonologie (Gallimard, 2008) à De l’antiracisme comme terreur littéraire, en passant par L’Enfer du roman : réflexions sur la postlittérature (Gallimard, 2010) et La Fatigue du sens, Richard Millet exprime son dégoût pour un monde contemporain qu’il caractérise au moyen de qualificatifs commençant par post- : postchrétien, postidentitaire, posthumaniste, postdémocratique, postpolitique, posthistorique, postlittéraire… Un monde infernal qui provoque la fatigue du sens, c’est-à-dire la "résignation devant la puanteur d’un réel devenu cadavre" (2011, p. 11), la chute de la verticalité axiologique dans une horizontalité anomique. Et quand on sait qu’Anders Breivik a lu les Réflexions sur la Révolution française (1790) d’Edmund Burke, l’un des premiers penseurs des anti-Lumières, on comprend pourquoi il séduit Richard Millet. Du point de vue révolutionnaire-réactionnaire, qui, tel que le reconstruit avec rigueur Zeev Sternhell dans une somme remarquable (Les Anti-Lumières, Folio, 2010), préfère l’irrationalisme au rationalisme, le particularisme à l’universalisme, le spiritualisme au matérialisme, le communautarisme à l’individualisme, le purisme au métissage universel (Millet), la tolérance est "signe de déclin" (Spengler) et tout mélange est altération. D’où ce fantasme explicité dans La Confession négative : contre la menace d’aliénation, œuvrer "pour une Europe blanche et chrétienne" (294).
Voilà de quoi Richard Millet est le nom.
*****
Dès lors s’explique une autre imposture : se faire passer pour le dernier écrivain ! Rien moins que cela… et à peu de frais : ignorant les dizaines d’écrivains qui comptent dans le 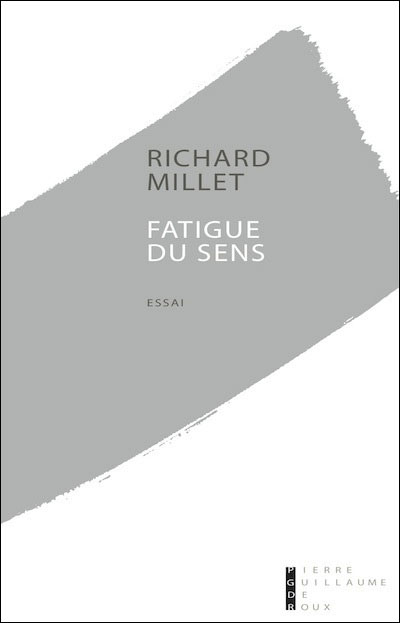 champ littéraire français actuel et ne se définissant que par rapport aux seules valeurs marchandes, il apparaît comme un champion autoproclamé qui, faute de véritable confrontation, est de fait sans rival possible. Que sa vision tragique ait engendré une œuvre particulière oscillant entre prose classique et technique romanesque moderne, nul ne le conteste ; de là à crier au génie… Replacer cette œuvre dans l’histoire littéraire, c’est déjà en atténuer sensiblement la portée.
champ littéraire français actuel et ne se définissant que par rapport aux seules valeurs marchandes, il apparaît comme un champion autoproclamé qui, faute de véritable confrontation, est de fait sans rival possible. Que sa vision tragique ait engendré une œuvre particulière oscillant entre prose classique et technique romanesque moderne, nul ne le conteste ; de là à crier au génie… Replacer cette œuvre dans l’histoire littéraire, c’est déjà en atténuer sensiblement la portée.
Si l’écriture est dotée d’une fonction sacrée, ce dernier écrivain est un élu, à la fois missionnaire et martyr, dont le rôle est de faire éclater la vérité et de lutter contre ces nouveaux fléaux que sont le multiculturalisme, le tout-culturel conforme au "totalitarisme démocratique" (L’Enfer du roman, p. 16), la haine de la langue, le ludisme et le politiquement correct, la tyrannie d’une bien-pensance qui a pour socle les Droits de l’Homme et des minorités (ethniques, religieuses et sexuelles)… Dans un monde postlittéraire, lui seul prétend demeurer fidèle aux valeurs traditionnelles et défendre la pureté de la langue. Et l’âpreté de la lutte justifie les moyens : la littérature doit se ranger du côté de l’injustifiable, du mal absolu. D’où son fantasme de "l’extermination comme motif littéraire".
*****
La dernière imposture de Richard Millet réside dans une stratégie que l’on pourrait qualifier de subconservatrice. Poser comme doxa un Nouvel Ordre Moral fabriqué de bric et de broc, l’agiter comme un épouvantail pour mieux le transgresser, c’est arborer une subversion fallacieuse : un tel renversement n’est qu’un retour à l’ordre ancien exposé précédemment. Car il faut une nouvelle fois prendre Millet à la lettre : si écrire suppose systématiquement "une inversion des valeurs admises" (La Confession négative, p. 262), alors, oui, le multiculturalisme est invivable, il y a trop d’humanisme et de tolérance, vive la mort et l’intolérance, imposons la Culture-unique, partons en croisade contre les infidèles, retrouvons nos racines chrétiennes…
Qui plus est, l’écrivain et polémiste est passé maître dans l’art de subvertir les hérauts de la modernité (de Rimbaud à Blanchot, en passant par Bataille). Considérons ce passage symptomatique de l’Eloge littéraire d’Anders Breivik : "loin d’être un ange exterminateur, ni une bête de l’Apocalypse, il est tout à la fois bourreau et victime, symptôme et impossible remède. Il est l’impossible même, dont la négativité s’est déchaînée dans le ciel spirituel de l’Europe" (119). Celui qui, 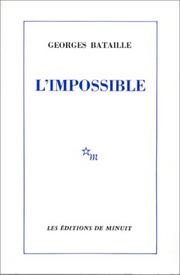 un peu plus haut, avait voulu nous faire croire qu’il a bien assimilé la lecture de Bataille en associant la littérature et le Mal, manipule ici des concepts clés de la modernité (l’impossible, la négativité) ; seulement, l’engagé catholique est un substantialiste manichéen qui ne peut s’empêcher de rechercher la pureté, l’innocence, le salut dans la lutte contre les forces antagonistes du Mal.
un peu plus haut, avait voulu nous faire croire qu’il a bien assimilé la lecture de Bataille en associant la littérature et le Mal, manipule ici des concepts clés de la modernité (l’impossible, la négativité) ; seulement, l’engagé catholique est un substantialiste manichéen qui ne peut s’empêcher de rechercher la pureté, l’innocence, le salut dans la lutte contre les forces antagonistes du Mal.
Imagine-t-on un seul instant Bataille s’ingéniant à incarner le Mal dans le crime d’un déséquilibré ? Qu’est-ce que ce Mal qu’il pose comme la limite de la littérature ? Une relation non dialectique entre les contraires, corrélative d’une tension vers l’impossible, qui crée un autre type de tension, ontologique et scriptural : en régime bataillien – comme blanchotien du reste –, il n’est d’être et d’écriture possibles que sous tensions. Et dans cette optique, qu’est-ce que la transgression ? Pour qui est avide d’absolu, toute quête s’avère impossible puisqu’elle se heurte à l’expérience du vide dans la solitude : l’être-avide condamne au solipsisme, enferme chaque sujet dans la béance de son trou, dans sa continuité fermée. Seuls le partage de l’excès horrible, la destruction de la continuité fermée dans l’abomination fraternelle favorisent l’extase, qui est passage du même à l’autre, accès à la discontinuité, l’alteridentité. Autrement dit, la transgression commune des interdits est la seule issue possible vers la souveraineté, cette communication forte qu’est la fraternité ; elle seule opère la transsubstantiation de l’horrible en sacré, selon une théologie paradoxale qui érige le Mal en sainteté. Or, dans l’univers de Millet, nulle écriture sous tensions, nulle tension perpétuelle entre deux pôles contradictoires, nulle réversibilité des contraires s’ouvrant sur la fraternité. Millet n’est ni Bataille, ni Desportes.
*****
On peut certes tourner l’"affaire" en dérision : tempête dans un verre d’eau, jeux de dupes chez les nantis… On peut également se demander, vu le poids de la littérature dans nos sociétés, ce que signifie pour un écrivain de se draper de solennité avant de prendre position dans l’espace public ; ou encore si ses réponses sont à la mesure des enjeux actuels.
Reste cette question cruciale : comment ne pas dénoncer de quoi Millet est le nom, dans un contexte où les idéologies d’extrême-droite gagnent du terrain en France et dans une partie de l’Europe ; où la subversion est recyclée par les discours extrémistes (ceux de l’ultra-libéralisme et de l’extrême-droite traditionnelle) ; et où le recul de l’héritage révolutionnaire et universaliste des Lumières – sans ignorer, bien évidemment, les critiques de l’universalisme abstrait – laisse la place à l’obscurantisme, l’intolérance, l’intégrisme et un particularisme qu’exploitent les discours idéologiques (chacun a droit à ses croyances, quelles qu’elles soient, ou à ses goûts – pourvu qu’il consomme toujours-plus…).
![[Chronique] Carnet de libr-critique / 2. L'imposture Millet](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)
Suffit de rajouter une virgule :
« Et là, soudain, je me sens bien, seul dans ce wagon plein d’étrangers… »
Bravo ! Bravo, bravo, bravo !
Il aura fallu attendre un peu pour tomber sur une analyse intelligente de cette « affaire ».
C’est la joie d’internet qui se découvre ici : les critiques les plus fines sont là.
Mais c’est à se désespérer des journaux papiers. Comment ni Le Monde, ni aucun autre d’ailleurs n’ont de journalistes capables de proposer un tel niveau de lecture ? Ou peut-être n’ont-ils pas la place tout simplement.
Votre critique est très maligne, et j’y souscris pleinement. Mais sa jolie ruse est surtout de frapper là où R.M ne s’y attend pas. Je ne souhaite qu’une seule chose : qu’il vous lise.
Encore bravo et continuez !
@ Bruno : oui, il suffit parfois de peu… De ce peu qui fait faire de grands pas à l’humanité !
Merci Jérémie : ce site a été justement créé pour proposer des réflexions que ne peuvent ni ne veulent développer les journaux et magazines de la presse dite « spécialisée »…