Christophe Manon, Pâture de vent, Extrêmes et lumineux II, Verdier, 2019, 112 pages, 13 €, ISBN : 978-2-37856-005-8. [Sur Extrêmes et lumineux, prix Révélation de la SDGL 2015 : lire la chronique et voir/écouter la rencontre à Lille]
« L’écriture est une activité solitaire et dégoûtante
qui ne devrait pas exister dans une société civilisée.
Il faut être absolument dénué de scrupules et de pudeur
pour écrire, pour être capable de saisir des phrases
de façon authentique, de les déballer et de les jeter
sur le papier au regard de tous et de chacun » (p. 103).
En son temps, ça avait commencé ainsi : « Le soleil avait achevé plus de la moitié de sa course et son char, ayant attrapé le penchant du monde, roulait plus vite qu’il ne voulait. Si ses chevaux eussent voulu profiter de la pente du chemin, ils eussent achevé ce qui restait du jour en moins d’un demi-quart d’heure ; mais, au lieu de tirer de toute leur force, ils ne s’amusaient qu’à faire des courbettes […]. Pour parler plus humainement et plus intelligemment, il était entre cinq et six quand une charrette entra dans les halles du Mans »…
On aura reconnu l’ouverture excentrique du Roman comique de Scarron, qui d’emblée donne le ton : le contraste entre la référence mythologique et la chute triviale introduit le lecteur dans un univers burlesque où le Destin même prend l’aspect d’un personnage de comédie.

Avec Pâture de vent, la seconde autopoéfiction de Christophe Manon, le comique rémanent cède le pas au cosmique – mais, bien entendu, un cosmique qui ressortit à une autre cosmologie :
« C’est ainsi que tout a commencé. Le jour était venu. Un jour comme un autre, pas plus. L’univers était en expansion et le monde tournait mollement sur son axe sans qu’on s’en aperçoive. Humblement les êtres et les choses convergeaient et s’appliquaient à participer à l’édification d’un réel à peu près recevable, aussi confus, aussi fugace et inconsistant qu’il puisse paraître. Le soleil pataugeait mollement dans une grande bassine de ciel blanc […]. Jamais il n’avait été si haut ni si brutal ni si accablant, sauf peut-être sous d’autres règnes sous d’autres cieux, avant ce commencement » (p. 11)…
 Au réel aristocratique dé-figuré succède un réel impressionniste, bien que post-einsteinien : « La matière avait renoncé au jeu subtil des apparences, tout n’était qu’exhalaison, brouillard, vapeur, vains simulacres, tout suintait et transpirait, tout se dissolvait. Dieu avait dû bifurquer ou s’était égaré dans quelque recoin sordide du réel […] » (17)… Ce monde sensible en fusion, dans lequel les êtres et leurs passions sont portés à l’incandescence, ce monde sans Dieu est celui du Chaos : « Les flux de molécules circulaient librement et s’entrechoquaient sans finalité. L’énergie n’obéissait plus aux principes élémentaires de la physique et le centre avait rejoint la périphérie. Des puissances aveugles et impitoyables étaient à la manœuvre sans se soucier des causes ni des effets et toutefois elles convergeaient vers un même point invariable et pourtant fluctuant. Le visible et l’invisible refusaient de se dissocier et s’attelaient à l’édification d’un ordre sensible inédit, régi par des forces redoutables » (11-12). Et si c’était ici une mise en abyme textuelle ? Car, de quel « ordre sensible inédit » pourrait-il s’agir sinon celui de l’écriture, ce monde chaotique dans lequel nous sommes d’emblée irrésistiblement entraînés, régi par Éros et Thanatos ? Qu’est-ce que l’écriture, pour Christophe Manon, si ce n’est un univers du télescopage, une fission lexicale et grammaticale, « un immense tumulte de figures et de formes inachevées » (56) ? En témoigne tout particulièrement la seconde partie, dans laquelle la cella du sujet scriptural, « aussi instable qu’un mélange de matières explosives » (86), devenue « le théâtre d’un combat de spectres » (69), est saisie par un maelström de vertigineuses visions : « Je vois des villes en ruines abandonnées par les belligérants puis livrées aux pillards et aux hordes de sauterelles. Je vois des corbeaux au blanc plumage et des agneaux carnassiers » (64)…
Au réel aristocratique dé-figuré succède un réel impressionniste, bien que post-einsteinien : « La matière avait renoncé au jeu subtil des apparences, tout n’était qu’exhalaison, brouillard, vapeur, vains simulacres, tout suintait et transpirait, tout se dissolvait. Dieu avait dû bifurquer ou s’était égaré dans quelque recoin sordide du réel […] » (17)… Ce monde sensible en fusion, dans lequel les êtres et leurs passions sont portés à l’incandescence, ce monde sans Dieu est celui du Chaos : « Les flux de molécules circulaient librement et s’entrechoquaient sans finalité. L’énergie n’obéissait plus aux principes élémentaires de la physique et le centre avait rejoint la périphérie. Des puissances aveugles et impitoyables étaient à la manœuvre sans se soucier des causes ni des effets et toutefois elles convergeaient vers un même point invariable et pourtant fluctuant. Le visible et l’invisible refusaient de se dissocier et s’attelaient à l’édification d’un ordre sensible inédit, régi par des forces redoutables » (11-12). Et si c’était ici une mise en abyme textuelle ? Car, de quel « ordre sensible inédit » pourrait-il s’agir sinon celui de l’écriture, ce monde chaotique dans lequel nous sommes d’emblée irrésistiblement entraînés, régi par Éros et Thanatos ? Qu’est-ce que l’écriture, pour Christophe Manon, si ce n’est un univers du télescopage, une fission lexicale et grammaticale, « un immense tumulte de figures et de formes inachevées » (56) ? En témoigne tout particulièrement la seconde partie, dans laquelle la cella du sujet scriptural, « aussi instable qu’un mélange de matières explosives » (86), devenue « le théâtre d’un combat de spectres » (69), est saisie par un maelström de vertigineuses visions : « Je vois des villes en ruines abandonnées par les belligérants puis livrées aux pillards et aux hordes de sauterelles. Je vois des corbeaux au blanc plumage et des agneaux carnassiers » (64)…
Dieu est absent, et pourtant, dès l’incipit plane un fatum sur ce monde instable : des forces obscures sont en mouvement ; quelque chose est venu rompre l’équilibre, un événement a entraîné la perte (« C’est ainsi que tout a commencé » / « C’est ainsi que tout a basculé »)… Dieu est absent, et pourtant certains passages de « L’Ecclésiaste » (« Un temps pour tout ») sont repris sous formes de litanies qui scandent le texte bipartite, 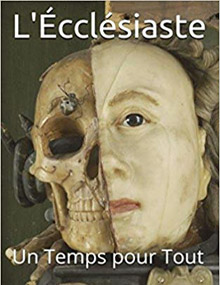 finissant par former une série de répétitions-variations : « il y a une saison pour toute chose, un temps pour tout, temps de détruire et temps de bâtir, temps de rire, temps de pleurer, un temps pour danser et un temps pour se recueillir, temps d’aimer, temps de haïr, temps de naître et temps de mourir, toute chose vient à son heure, chaque chose l’une après l’autre, tout n’est que vapeur et pâture de vent sous le ciel immobile […] » (40-41)… Ce relativisme fataliste est une façon pour le poète de prendre du recul, de transformer une/des vie(s) en destin(s), à commencer par celle du petit frère mort-né. Son rêve : « avoir un destin non pas plus accompli, car cela ne signifie rigoureusement rien, mais bien plein comme un gros galet et chargé d’intensité » (86) – en somme être en-soi-pour-soi, dynamisé et magnifié par l’écriture. Mais « L’Ecclésiaste » aboutit au dégoût et au renoncement : « j’eus de l’aversion pour tout ce qui se passe sous le soleil, voyant que tout est vanité et pâture de vent ». Le poète, pour sa part, trouve la paix au bout de son cheminement : « Me voilà à présent presque nu, pauvre de sens et de savoir. Tout bouge, tout varie, tout fluctue, nous-mêmes nous ne cessons de changer. […] Et si toutes ces heures de vertige, d’ivresse, de grâce ou de détresse ne m’ont certes pas rendu meilleur, peut-être m’ont-elles au moins permis de saisir plus intimement l’inconcevable beauté des êtres et des choses, d’approfondir ma science très partielle du vivant […] » (86).
finissant par former une série de répétitions-variations : « il y a une saison pour toute chose, un temps pour tout, temps de détruire et temps de bâtir, temps de rire, temps de pleurer, un temps pour danser et un temps pour se recueillir, temps d’aimer, temps de haïr, temps de naître et temps de mourir, toute chose vient à son heure, chaque chose l’une après l’autre, tout n’est que vapeur et pâture de vent sous le ciel immobile […] » (40-41)… Ce relativisme fataliste est une façon pour le poète de prendre du recul, de transformer une/des vie(s) en destin(s), à commencer par celle du petit frère mort-né. Son rêve : « avoir un destin non pas plus accompli, car cela ne signifie rigoureusement rien, mais bien plein comme un gros galet et chargé d’intensité » (86) – en somme être en-soi-pour-soi, dynamisé et magnifié par l’écriture. Mais « L’Ecclésiaste » aboutit au dégoût et au renoncement : « j’eus de l’aversion pour tout ce qui se passe sous le soleil, voyant que tout est vanité et pâture de vent ». Le poète, pour sa part, trouve la paix au bout de son cheminement : « Me voilà à présent presque nu, pauvre de sens et de savoir. Tout bouge, tout varie, tout fluctue, nous-mêmes nous ne cessons de changer. […] Et si toutes ces heures de vertige, d’ivresse, de grâce ou de détresse ne m’ont certes pas rendu meilleur, peut-être m’ont-elles au moins permis de saisir plus intimement l’inconcevable beauté des êtres et des choses, d’approfondir ma science très partielle du vivant […] » (86).
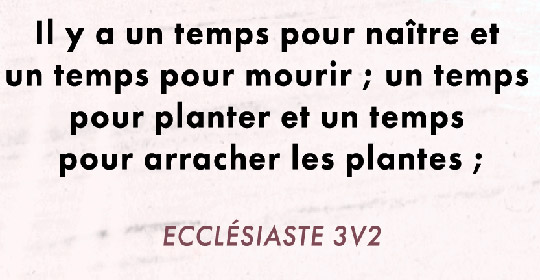
 « C’est ainsi que tout a commencé »… Quoi ? L’Éternité… C’est la mer allée avec le soleil… Car « l’écriture permet de rendre grâce, c’est à la fois une célébration et une révolte contre l’oubli, c’est une chose vivante que la mort n’a pas encore figée et qui permet de témoigner de l’intensité des événements, de la beauté des êtres et de la vie, qui permet de saisir avec d’infinies précautions le cœur palpitant des hommes et d’en observer les complications, l’émouvante profondeur, la noirceur et la noblesse, la grandeur et la faiblesse » (41). Une écriture salvatrice et/parce que lyrique, même si l’auteur avoue détester son « lyrisme grandiloquent » et son « sentimentalisme exacerbé » (97)… Contrairement au premier volume, Extrêmes et lumineux, celui-ci débouche sur la confession, car nous entrons dans l’oeil du cyclone autopoéfictif : cette fois, celui qui a « vécu dans la fureur et dans l’excès » (85) remonte à des origines qui expliquent sa duplicité et sa culpabilité.
« C’est ainsi que tout a commencé »… Quoi ? L’Éternité… C’est la mer allée avec le soleil… Car « l’écriture permet de rendre grâce, c’est à la fois une célébration et une révolte contre l’oubli, c’est une chose vivante que la mort n’a pas encore figée et qui permet de témoigner de l’intensité des événements, de la beauté des êtres et de la vie, qui permet de saisir avec d’infinies précautions le cœur palpitant des hommes et d’en observer les complications, l’émouvante profondeur, la noirceur et la noblesse, la grandeur et la faiblesse » (41). Une écriture salvatrice et/parce que lyrique, même si l’auteur avoue détester son « lyrisme grandiloquent » et son « sentimentalisme exacerbé » (97)… Contrairement au premier volume, Extrêmes et lumineux, celui-ci débouche sur la confession, car nous entrons dans l’oeil du cyclone autopoéfictif : cette fois, celui qui a « vécu dans la fureur et dans l’excès » (85) remonte à des origines qui expliquent sa duplicité et sa culpabilité.
Une autre transfuge de classe, Annie Ernaux, confiait écrire pour « venger sa race » ; Christophe Manon, lui, cultive son sentiment de révolte. D’où ses éloges/remerciements paradoxaux adressés aux persécuteurs, aux journalistes, « aux professeurs et aux instituteurs qui enseignent aux enfants la crainte de la connaissance et le dégoût du savoir et de ceux qui les possèdent » (99)…
![[Chronique] Christophe Manon, Pâture de vent, par Fabrice Thumerel](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2019/02/ManonPatureBackG.jpg)
![[Chronique] Christophe Manon, Pâture de vent, par Fabrice Thumerel](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2019/02/band-ManonPature.jpg)