Suite à la première présentation du livre, voici la lecture lumineuse de Jean-Nicolas Clamanges – que nos Libr-lecteurs connaissent bien maintenant.
Claude Favre, A.R.N. agencement répétitif névralgique_ voyou, éditions de la Revue des Ressources, février 2014, 146 pages, 10 euros, ISBN : 978-2-919128-07-5.
[Ce volume reprend A.R.N. – que nous avons eu le bonheur de publier dans le dossier Claude Favre en 2013 – et Interdiction absolue de toucher les filles même tombées à terre, développe Comme quoi un mot est un galop et propose Précipités].
Certains écrivains sont des sismographes : ils anticipent les désastres en voie de coagulation dans leur époque, et sans doute les précipitent au sens chimique du terme, voire en son sens historique, comme des accélérateurs. Précipités est d’ailleurs le titre de l’un des ensembles du recueil, et quant à l’accélération, un autre titre se passe de commentaire : Comme quoi un mot c’est un galop. À lire Claude Favre, si la langue va mal, c’est qu’elle est fille d’un siècle en ruines (le précédent) et si elle survit, c’est pour rire en pleurs faute d’espoir car c’est devenu « un drôle de mix » ; c’est en effet un précis de décomposition in process que livre son A.R.N. agencement répétitif _ voyou, composé du texte éponyme suivi de trois autres ensembles dont une réédition (Interdiction absolue de toucher les filles même tombées par terre, éd. Cousu main, 2011).
« Zoom la pagaille la langue »
Dans cet accélérateur de particules verbales qu’est l’emportement de son écriture, la langue est soumise à de telles vitesses mentales et à de telles contraintes formelles qu’elle y entre en mutation : les liaisons grammaticales fondamentales se déchirent ou disparaissent, les syntagmes implosent, les mots de liaison se volatilisent ou se regroupent vaille que vaille en chaînes aléatoires. Quant à la ponctuation, soit elle disparaît quasiment, soit elle combat rythmiquement ce qui reste de la syntaxe de l’écrit avec les scansions de l’oralité.
Par exemple :
Elle, dit, d’efforts à je suis de, n’être suis si
je n’ai, tant pis pour moi si la mort est plus
cruelle que la vie, elle dit je n’ai plus la tête à,
trésor en peines, tous les gens dans ma tête
qu’on enlève, l’hôpital en bras-de-fer avec
la charité, la mort est ma vivante elle dit,
parodie elle dit, qu’on me l’enlève, et litres
litres de sang rouge ça vif tort travers belle
nature traduis elle dit, qu’on me l’enlève,
je suis fatiguée
A.R.N., p. 33
Imaginons la langue comme une nébuleuse autour d’un trou noir qui aspire violemment toute matière verbale attirée dans sa proximité et dans lequel disparaissent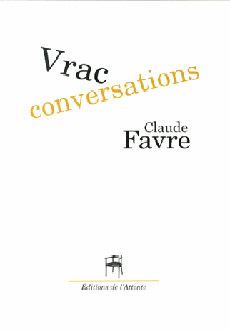 en vrac tous les vocabulaires possibles, toutes les façons de dire, du plus trivial de l’expression au plus littérairement sophistiqué, où « elle s’en va jusqu’à trop & tard & tohu plus que diable bohu » (Précipités, p. 86). Supposons votre esprit suffisamment éloigné du trou pour ne pas y passer mais assez bien équipé pour observer ce qui s’y perd en tourbillons affolés, que verriez-vous passer ? Le tohu-bohu, c’est la Genèse ; mais aussi Le Bateau ivre : « Et les péninsules démarrées/N’ont pas subi tohus-bohus plus triomphants » ; et puis la mythologie « parce que des enfers descendus sont revenus Gilgamesh, Dionysos, Orphée et Tirésias et Énée » ; d’ailleurs la voilà l’Énéide, avec le mythe de Palinure, ce pilote d’Énée voué par les dieux à périr sacrifié en échange de la vie de tous, si bien « _que Palinure plouf à la mer s’est fait la belle » ; plongeons, chutes, sauts et vertiges, c’est l’axe de chute dans le champ gravitationnel du temps humain :
en vrac tous les vocabulaires possibles, toutes les façons de dire, du plus trivial de l’expression au plus littérairement sophistiqué, où « elle s’en va jusqu’à trop & tard & tohu plus que diable bohu » (Précipités, p. 86). Supposons votre esprit suffisamment éloigné du trou pour ne pas y passer mais assez bien équipé pour observer ce qui s’y perd en tourbillons affolés, que verriez-vous passer ? Le tohu-bohu, c’est la Genèse ; mais aussi Le Bateau ivre : « Et les péninsules démarrées/N’ont pas subi tohus-bohus plus triomphants » ; et puis la mythologie « parce que des enfers descendus sont revenus Gilgamesh, Dionysos, Orphée et Tirésias et Énée » ; d’ailleurs la voilà l’Énéide, avec le mythe de Palinure, ce pilote d’Énée voué par les dieux à périr sacrifié en échange de la vie de tous, si bien « _que Palinure plouf à la mer s’est fait la belle » ; plongeons, chutes, sauts et vertiges, c’est l’axe de chute dans le champ gravitationnel du temps humain :
_à traverser les bouches précipités d’histoires
quand Kafka dans son journal évoque si
fréquemment le saut par la fenêtre comme
unique solution
Précipités, p. 117
Défilent des lambeaux de récits des atrocités sans précédents du XXe siècle : les meurtres déguisés en suicides par les tortionnaires, les massacres en masse, les dictateurs qui monnaient leurs peuples, et Primo Levi récitant Dante à Auschwitz « pour se dire vivant se dire je suis un être humain ». S’emmêlent à cela les paroles, comme citées de mémoire, de la misère, de la faim, du froid et de l’extrême solitude de la grande pauvreté contemporaine :
Un corps traversé du froid c’est crispes an-
kyloses, est-ce le temps qui se ralentit, ou
est-ce le cœur, sécessions, faims amères et,
relents sens dessus dessous et, esprit lent, elle
dit non, ce n’est à côté rien, loin de, non,
voudrais me taire, taillé cœur, nos réveils
lents, que de plus nous, quand certains
geignent vacances certains dorment sous
des tentes l’hiver dehors, dorment on dit,
café chaud
A.R.N., p. 41
Et puis tous les lexiques : les mots du besoin, du désir, de la souffrance, ceux du corps, de la mémoire et de l’amour, ceux du déchet et de l’avoir, du cosmos et de la poussière, du silence et des mots, de l’insomnie et de l’extase, de la métaphysique et du quotidien, des humeurs et du sang, des tempêtes et de l’aridité, de l’animalité et de l’angélitude, de l’art et de la barbarie, du dicible et de l’ineffable, de la mort et de la joie et de la farce aussi : comme un abrégé de tous les langages, parlures, styles, tons, niveaux de langue tournant en sorte de maelström dans un creuset sorcier qui aurait l’échelle de l’infini, « un drôle de mix » :
scories des langues, beautiful crânes,
calvaire variante oh les beaux, tempes
hurlent j’entends mes loups chambres
d’échos, alors que finira, beau pas q’un
peu fou bestiaire comme quoi un mot
mâchoires, à langue la pendouille, bien
pendue crocs, mal ma tête, est-ce tête,
plus qu’un plus qu’un, galop fracturé,
contre les tempes du labyrinthe, vous
m’auriez dit vous dites du sang mon
amour votre bouche c’est du sang,
j’aurais dit, sans doute ut pictura poesis,
un peu panache à mal encontre, toujours
un tantinet […]
Comme quoi un mot c’est un galop, p. 73
Dans le cosmos, un trou noir s’observe par déduction car on ne peut pas le voir, la lumière y étant capturée comme le reste par la densité du champ gravitationnel. Ici, on nous donne l’illusion du direct parce que les textes sont presque tous adressés, que l’infinitif et l’indicatif y tournent à plein régime, nous procurant l’illusion d’assister à la chose (même si aucun des autres modes n’est exclu, en particulier le conditionnel, mode des possibles), que la syntaxe tend à la concaténation, à l’agglutination en chaînes de mots ou au contraire à leur dissémination, comme si nous assistions, le temps d’une lecture, à un abrégé de l’histoire de la langue passée, présente et à venir :
[…] les heures ça tourne, nous arrange
ça débande, aveuglé, pas drôle des
fois, d’envies faire tant pagaille, des
fois boules, ça tourne, matins bonjour,
matins traduire, encore et déjà, qui
noue le corps la langue ça tourne, et
quelquefois pire, qu’il m’en souvienne
Comme quoi un mot c’est un galop, p. 65.
« La grammaire ça échappe »
Parfois, on dirait qu’on nous emmène au cœur de la spirale où tout s’engendre et se défait. Ce n’est pas pour rien que le titre A.R.N. est décalqué de la chimie du vivant où, nous dit l’encyclopédie, l’acide ribonucléique est une copie, une transcription, autant dire une traduction engendrée à partir de l’ADN en double hélice dans le noyau des cellules : « hélice force motrice c’est-à-dire la vie pousse, succombe, implosive, preuve de l’inexistence de dieux » (p. 52). Et puis le verbe traduire qui engage ici une genèse balbutiante, comme d’après déluge, comme un recommencement du désir de dire-vivre, tel un « agencement répétitif névralgique » où les noms sont encore mal différenciés des verbes :
c’est pas dit, de traduire c’est pas dit,
d’extension débandades, d’apercevoir
ce n’est pas rien, et des fois pavanes,
ça surprises des fois, et des fois aussi
gambades, et dépouilles, ça fait toute
une histoire assombrie, ça colle aux
basques, l’effroi, certains soirs sont des
riens, vous comprenez mon amour,
ce qui palpite, de parler, de parler
commencer à, de parler commencer,
on ne sait quoi, on ne sait quoi des
dépouilles, faire quoi, sinon traduire à
l’envers à l’endroit, en dérives […]
Comme quoi un mot c’est un galop, p. 64.
Écrire procède d’absence : il manque des mots : pas d’adjectif en français « pour dire qui ne pleure pas » ; les dictionnaires se trompent : contrairement à ce qu’ils prétendent, « abominable veut dire qui ne peut pas avoir de nom » ; et puis la mort n’est pas un substantif « mais un verbe malmené, défectif » ; quant au verbe se rendre, il n’est pas classé dans la bonne liste, le bon paradigme, car c’est « un verbe insistant, ça ne peut être qu’après, après le chaos, après apprendre » ; la grammaire n’est pas si morte ou si formelle qu’on croit (Baudelaire l’avait dit et pratiqué), « dire est un verbe qui bouge », il faut inventer une « grammaire vivre ». Et c’est tout un art. En principe, on considère que la poésie s’occupe de ça pour l’essentiel, cependant, méfiance :
Elle dit sables mouvants elle dit poussière de
foin, elle dit blatte dans la soupe, elle dit on
ne peut pas me séparer de la vie elle insiste,
brutale, si, il faut attaquer la poésie […] elle
dit bravo, ne ménagerai mes points de fuite
A.R.N., texte d’ouverture.
C’est dans la série intitulée Précipités qu’on trouve, à peu près au centre de l’ensemble, des textes qui disent de quoi il retourne, en mode d’ailleurs aussi facétieux qu’énigmatique. Quelques mots ici de la structure de cette série qui exhibe assez ouvertement les paramètres formels dont les variations règlent moins ostensiblement l’agencement des textes de tout le recueil : marquage des frontières par tiret bas ou par crochets ; présence ou défaut de ponctuation ; usage de l’esperluette ou conjonction « et » ; énonciation à l’indéfini ou à l’impersonnel, énonciation en Je explicitement adressée ou non, et leur mélange aussi ; nombre de lignes des textes, disposition en paragraphes ou en versets séparés par un, deux ou trois blancs typographiques selon les cas, etc. Cela donne cinq dispositifs textuels agencés et enchaînés fermement selon différentes combinaisons de ces paramètres, sans négliger les transitions entre les agencements, ni la place réglé de deux citations (l’une de Vitez, l’autre de Quignard) qui annoncent deux thématiques majeures de l’ensemble. Du travail d’orfèvre, ou de fée brodeuse (mais l’énonciation évite absolument le féminin, à la différence des autres ensembles du recueil).
qu’énigmatique. Quelques mots ici de la structure de cette série qui exhibe assez ouvertement les paramètres formels dont les variations règlent moins ostensiblement l’agencement des textes de tout le recueil : marquage des frontières par tiret bas ou par crochets ; présence ou défaut de ponctuation ; usage de l’esperluette ou conjonction « et » ; énonciation à l’indéfini ou à l’impersonnel, énonciation en Je explicitement adressée ou non, et leur mélange aussi ; nombre de lignes des textes, disposition en paragraphes ou en versets séparés par un, deux ou trois blancs typographiques selon les cas, etc. Cela donne cinq dispositifs textuels agencés et enchaînés fermement selon différentes combinaisons de ces paramètres, sans négliger les transitions entre les agencements, ni la place réglé de deux citations (l’une de Vitez, l’autre de Quignard) qui annoncent deux thématiques majeures de l’ensemble. Du travail d’orfèvre, ou de fée brodeuse (mais l’énonciation évite absolument le féminin, à la différence des autres ensembles du recueil).
C’est aussi un ensemble très questionneur, voire auto-questionnant, particulièrement à partir de la petite série intitulée « Devinettes », qui débouche sur une réponse en forme d’énigme joueuse qu’on peut lire comme une sorte d’art poétique à l’envers :
[On ne sait quoi ni répondre que cette
question -sous des dehors facétieux s’en
cache- est celle de l’art ; c’est-à-dire
l’œuvre. Ajustement, des histoires d’histoires
& carcasses.
Tendre des cordes sur les murs ?
L’occasion de se faire entendre, rien de plus.
Qu’entendre ?
L’histoire de quoi qu’entendre ?
Suspections ? Inspections ? Beau voir.
Quel œil quand le doigt sur la bouche ?
On se concentre -désir fait décalage- &
voilà on ne sait plus, on se mêle pinceaux
& corbeaux.
On s’enrage trompettes, on fait l’ange.
De quoi que voir saisir ?
Une façon de glisser ?]
Précipités, p. 107
« Le doigt sur la bouche » est la troisième occurrence d’une formule apparue dans les pages précédentes, qui dit muettement le secret, l’exigence intimée de tenir sa langue (c’est aussi une figure classique du dieu Harpocrate, censé signifier le silence des initiés sur les mystères d’Isis dans l’Antiquité). Autrement dit, c’est la nécessité hermétique de l’art qui se trouve à la fois affirmée et questionnée ici : on touche peut-être le fonds mallarméen (ou trobar clus ?) de la poétique de Claude Favre, selon une interrogation sur ce que fait voir le dire, autrement dit sur ce que peint la voix et ce que figure ou représente l’œuvre, comme si l’inusable ut pictura poesis, qu’on avait lu plus haut se trouvait renversé en disjonction – en contre-ut ou en contre-comme, si l’on peut dire : « l’histoire de quoi qu’entendre ?» La réponse est qu’on ne sait plus, sinon que dire-entendre-voir-saisir, etc., tout cela est glissade à la chute.
« On préfère renseigner les frontières »
Pourtant, il y a peut-être (ou peut-être eu) une alternative vers le haut, une sorte d’escalade : quand je lis « tendre des cordes sur les murs ? », je pense à cette phrase 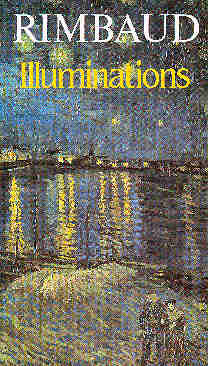 des Illuminations : « J’ai tendu des cordes de clocher à clocher ; des guirlandes de fenêtre à fenêtre ; des chaînes d’or d’étoile à étoile, et je danse. » Le mot « cordes » apparaît un peu en amont, lié au mot « ombrage » dans un verset au passé qui semble évoquer une rébellion vitale : « On était prévenu contre. Perdu la tête, on manquait d’air. Par cordes, ombrages, de langues prévenu ». Sur la page d’en face, en revanche, quelqu’un paraît plus calme : « Il existe aussi ce que certains appellent l’oubli, on dépose les cordes on ne prend pas ombrage pour un oui non, on n’est pas loin de la langue, celle des autres ». Pas loin, mais pas dans : une sorte de paix armée en somme, à l’égard de cette langue étouffante : « on cherche des mots » est la phrase suivante, elle conclut la page.
des Illuminations : « J’ai tendu des cordes de clocher à clocher ; des guirlandes de fenêtre à fenêtre ; des chaînes d’or d’étoile à étoile, et je danse. » Le mot « cordes » apparaît un peu en amont, lié au mot « ombrage » dans un verset au passé qui semble évoquer une rébellion vitale : « On était prévenu contre. Perdu la tête, on manquait d’air. Par cordes, ombrages, de langues prévenu ». Sur la page d’en face, en revanche, quelqu’un paraît plus calme : « Il existe aussi ce que certains appellent l’oubli, on dépose les cordes on ne prend pas ombrage pour un oui non, on n’est pas loin de la langue, celle des autres ». Pas loin, mais pas dans : une sorte de paix armée en somme, à l’égard de cette langue étouffante : « on cherche des mots » est la phrase suivante, elle conclut la page.
Rimbaud danse sur les cordes de ses métaphores inouïes et se ramasse: « Moi ! moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol, avec un devoir à chercher, et la réalité rugueuse à étreindre ! Paysan ! » (« Adieu », Une saison en enfer). Dans Précipités, quelqu’un dit qu’on sait bien ça, qu’ « on regarde la danse des plongeurs tellement/qu’on ne sait plus », sauf que tout tourne à perte, cf. Icare : « _une si petite mer intérieure s’y jeter c’est déjà fait » – car enfin tout défaille :
[On n’est pas toujours bien équipé.
On sait des cœurs lourds le plongeon. On se
trompe dans les mots & plombs.
Un cri nous rappelle. Alors on regarde les
corbeaux mais où ils vont.
On s’emmêle les souvenirs, y a du collage
, contes et défaits. Cela peut coûter cher à
chercher forces quand raison n’est.
On se mêle aux cordeaux & trompettes mais
où elle va la langue on peut se demander
pourquoi on a failli on peut se demander.]
Précipités, p. 100
Beaucoup serait à étudier de ce côté des contes, des corbeaux-augures, du montage, en lien avec d’autres contemporains (je pense au travail de Philippe Beck sur Grimm dans Chants populaires), mais je fais l’impasse pour m’en tenir au travail du texte avec l’ancien vers et ce qui s’y dissimule ouvertement, si j’ose dire (c’est le côté facétieux de Claude Favre). J’entends ici une citation d’un fameux monostiche d’Apollinaire : le poème « Chantre » d’Alcools :
Et l’unique cordeau des trompettes marines.
On pense au cordeau du maçon ou du jardinier qui dessine la ligne virtuelle d’un mur ou d’un semis. Dans Précipités, Ce thème est inscrit dans une suite de quatre versets dont voici le second et le troisième :
_le doigt sur la bouche bornoyer on peut se
demander et pourquoi se jeter
_pleine tête tempête les vendanges sont
faites qu’est-ce qu’on perd à
Précipités, p. 104
Bornoyer, c’est cligner de l’œil pour vérifier un alignement, sa rectitude. Traduction : à quoi ça sert encore d’aller à la ligne dans la langue ? Et pour vérifier quoi ? Pour chanter quel air quand « le monde radote en magasin », quand « on se bluffe trompettes on se trompe et blues » ? Circulez, plus rien à voir : est-ce que tout n’a pas été déjà fait dans cet ordre, pourquoi semer au cordeau quand les vendanges ne sont plus à faire ? Et risquer sa tête dans l’affaire ? Traduction encore, pourquoi s’acharner à écrire des ‘blocs justifiés’ (comme dans Des os et de l’oubli ou Pas de titre ni rien et peut-être encore ici) pour faire parler autrement la langue en la comprimant à mort entre les marges, sachant que « poésie c’est crevé », comme l’a écrit Denis Roche au siècle précédent ? « [… Aussi il arrive qu’on ne soit pas loin de dépasser les bornes, même si quelqu’un./Cela arrive mais./C’est trop tard./Pourquoi on ne sait pas. C’est trop & tard & pourtant./On préfère renseigner les frontières.] »
chanter quel air quand « le monde radote en magasin », quand « on se bluffe trompettes on se trompe et blues » ? Circulez, plus rien à voir : est-ce que tout n’a pas été déjà fait dans cet ordre, pourquoi semer au cordeau quand les vendanges ne sont plus à faire ? Et risquer sa tête dans l’affaire ? Traduction encore, pourquoi s’acharner à écrire des ‘blocs justifiés’ (comme dans Des os et de l’oubli ou Pas de titre ni rien et peut-être encore ici) pour faire parler autrement la langue en la comprimant à mort entre les marges, sachant que « poésie c’est crevé », comme l’a écrit Denis Roche au siècle précédent ? « [… Aussi il arrive qu’on ne soit pas loin de dépasser les bornes, même si quelqu’un./Cela arrive mais./C’est trop tard./Pourquoi on ne sait pas. C’est trop & tard & pourtant./On préfère renseigner les frontières.] »
Travailler aux frontières, aux bords, à flanc d’à-pic. Par exemple avec des tirets soulignés, des crochets, des paragraphes aux lignes comptées, des points à la ligne ou pas de point final, et tout le reste ; et puis encore (surtout) en soumettant la prose à la puissance rythmique du vers, c’est-à-dire en effaçant quasiment leurs frontières puisque « rien, rien, rien, limons, rien, rien, sauf la scansion poétique qui défamiliarise, cœur, craque dire, simplement rien, mais cela suffit ».
Ainsi scandez comme on ne scande plus, c’est-à-dire classiquement, et vous trouverez que les deux premières lignes des versets cités de la p. 104 sont des 12 syllabes, idem pour les deux dernières de la p. 100 ; et vous vérifierez aussi en passant que « le doigt sur la bouche » et « pleine tête tempête » sont des segments à césure lyrique (accentuée sur le ‘e’ caduc interconsonantique comme souvent chez Rimbaud : « Périssez! puissance, // justic(e), histoire, à bas! », tandis que « où elle va la langue » et « on peut se le demander » sont des hémistiches réguliers. Ce n’est qu’un fragment minuscule du travail métrique de vaste envergure qui se poursuit – à la syllabe près il semble –, dans l’écriture de Claude Favre, et pas seulement dans tels lignes ou versets mais quasiment partout. Je ne puis qu’en suggérer la réalité car c’est trop technique pour en faire matière de chronique à peu près lisible. Mais essayez un peu d’entendre/voir ce qui se passe là, y compris en comptant sur vos doigts, pourquoi non ? S’y confronter, sera s’assurer de ce que la musicalité proprement unique de sa diction en performance présuppose un art aussi raffiné que trop un petit peu voyou – comme elle dit ; un art qui est aussi, parfois, joie de la langue vive, jouissance du joglar et de son gai savoir, car si « _Palinure ne croit pas savoir ne croit pas/savoir gouverner ne croit pas au retour ni aux/mythes », croyons, puisque Claude Favre nous l’écrit, que :
[…] certains jours à l’endroit de la
langue je me rends, hospitalière, sauvée,
des tempêtes si vous saviez certains jours,
d’un mot à l’envers, la renverse étourdie,
je me brouille bruisse, ça palpite la vie
comme ça et on peut écrire comme
ça, paille, étourdissements, lièvres en
débandade
Comme quoi un mot c’est un galop, p. 63
« Et puis… »
Tout de même, après ces enthousiasmes et ces étourdissements, on sait qu’il faut retourner « à la rudesse qui fait la lecture » des lignes bornoyées au cordeau, pour aller voir « les gouttes de pluie sur le fil à linge » – le fil de ligne où ça s’écrit la chute des temps. Cap au fond :
_d’aller en déchié serait-ce progrès &
contestable dans l’ordre de la connaissance
& à grandes plongées s’esquiver léger léger
Précipités, p. 83
– Vous avez vu Le Grand Bleu ?
![[Chronique] Claude Favre, A.R.N. agencement répétitif névralgique, par Jean-Nicolas Clamanges](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2014/03/TrouNoir.jpg)
![[Chronique] Claude Favre, A.R.N. agencement répétitif névralgique, par Jean-Nicolas Clamanges](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2014/03/band-ADN.png)