Fernando Pessoa, Bureau de tabac, édition définitive (bilingue) : traduit du portugais par Rémy Hourcade, illustrations de Fernando de Azevedo, préface de A. Casais Montero et postface de Pierre Hourcade ; Nice, éditions Unes, 2017, 64 pages, 14 €, ISBN : 978-2-877041-75-1.
Avant Beckett Pessoa nous a appris que le « je » n’est pas forcément un autre mais personne. La dénomination de Pessoa le prouve puisqu’elle signifie « personne ». A savoir « quelqu’un » dont l’unicité et l’identité ne brillent pas.
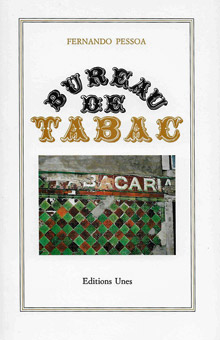 Bureau de Tabac – œuvre majeure et reprise plusieurs fois par l’auteur même quelques mois avant sa mort – rappelle à chaque instant que l’être est à personne. Et pas même à lui-même. C’est donc peut dire qu’il n’y a jamais rien d’acquis. Et l’auteur le prouve dans l’évidence d’un poème qui souligne le plus extrême dénuement qui nous guette – pour peu que nous soyons lucides – à tout instant de notre vie. Il suffit pour s’en convaincre de faire comme Pessoa : se mettre à la fenêtre ou regarder dans la rue, voire se déplacer jusqu’au bureau de tabac du coin telle une moindre semence poussée par le vent.
Bureau de Tabac – œuvre majeure et reprise plusieurs fois par l’auteur même quelques mois avant sa mort – rappelle à chaque instant que l’être est à personne. Et pas même à lui-même. C’est donc peut dire qu’il n’y a jamais rien d’acquis. Et l’auteur le prouve dans l’évidence d’un poème qui souligne le plus extrême dénuement qui nous guette – pour peu que nous soyons lucides – à tout instant de notre vie. Il suffit pour s’en convaincre de faire comme Pessoa : se mettre à la fenêtre ou regarder dans la rue, voire se déplacer jusqu’au bureau de tabac du coin telle une moindre semence poussée par le vent.
Du temps creux, de l’homme vide le poète fait son miel. Et d’une certaine manière il en tire partie. Car ce qui nous détruit jour après jour, dans un enfouissement lent, sinon nous construit du moins nous tenons en vie sans nous chérir pour autant. Dès lors l’ « autofiction » (si l’on peut dire) prend un aspect particulier : elle n’élit jamais personne et à peine Personne (à savoir l’auteur lui-même).
Il n’est pas deux qui s’aimaient. Il avait mieux à faire : fonder un certain bonheur (des plus incertains) qui repose sur le rien. Celui-ci reste plus profond que le néant – au sens capitaliste ou sociétal du terme. Si bien que dans le poème il n’a pas de réalité autre que dans la façon dont tout prend feu en l’imaginaire et la lucidité du Lusitanien.
Reste néanmoins la beauté de l’œuvre. Or – à part le rien – quoi de moins saisissable, de plus évanescent, que la beauté ? Celle du livre ramène à l’envie de vivre. Preuve que l’œuvre, lorsqu’elle est sans abri, reste majeure : elle délivre et module l’esprit aux heures creuses de la pensée. Bref, le vide de Pessoa allège nos angoisses. En jouxtant le néant, sa poésie reste ce qui enfin nous sauve. Et ce n’est pas le moindre des paradoxes. A nous d’en titrer partie.
![[Chronique] Fernando Pessoa, Bureau de tabac, par Jean-Paul Gavard-Perret](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)
![[Chronique] Fernando Pessoa, Bureau de tabac, par Jean-Paul Gavard-Perret](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2017/02/band-PessoaBarTabac.jpg)