Joachim Séné, L’Homme heureux. Détruire internet, Publie.net, coll. « Temps réel », 2020, 216 pages, 18 €, ISBN : 978-2-37177-592-3 ; 5,99 € en format numérique : télécharger.
Il est des œuvres dont on rend compte plus difficilement que d’autres, L’Homme heureux est de celles-là, tant elle déroute par son foisonnement et sa manière, agencée par des flux entremêlés qui composent cette matière tout à fait englobante : tout y est pris, tout y est brassé, nos lubies et nos désirs, nos divertissements et nos errements, c’est le quotidien qui s’y esquisse, celui de nos vies contrôlées et disciplinées.
Quel fil tirer, ou plutôt quel câble ? Parce que de câbles – sous-terrains et sous-marins – il en sera question tout au long des 200 pages qui composent ce texte singulier, ces câbles qui font internet, par l’intermédiaire desquels vous lisez ces lignes. Et C’est là l’une des particularités de ce texte, rendre compte du monde en s’attardant sur la manière dont le média numérique en façonne notre représentation – nous l’évoquions avec Pierre Ménard –, tout en prolongeant le questionnement du côté des infrastructures qui font et font tourner le média numérique.
Le pouvoir est dans l’infrastructure
Nous sommes passés des sociétés disciplinaires aux sociétés de contrôle, il faut avant tout contrôler et non pas simplement  réprimer. Et pour exercer ce contrôle, il faut des infrastructures, car « le pouvoir réside désormais dans les infrastructures de ce monde » (Le Comité invisible, À nos amis, La Fabrique, 2014, p.83). Et c’est ce que démontre admirablement L’homme heureux, on les voit, on les lit ces mots d’ordre qui partout essaiment, dans le monde de l’entreprise comme dans celui des transports – « Vous êtes à bord du tramway 1, en route pour une belle journée de travail, avec la ratp et votre employeur » –, les corps, donc les êtres et leurs manières, domestiqués – « tout le monde est debout, les sièges ont été enlevés des transports en commun pour des questions d’optimisation (…) tout se joue debout désormais ». Mots d’ordre qui se répercutent et que lentement on intériorise, cette Karine végétarienne et qui se met à manger de la viande parce qu’ « être carniste permet de mieux s’intégrer (…) elle a développé d’autres compétences relevant de la virilité me dit-elle, une autorité agressive quand il faut, les blagues aussi, sous forme d’une misogynie tendre qu’elle s’applique avant les autres.» Elle se rassure, Karine, « c’est un rôle qui lui sert ». Mais à y regarder de plus près, à y regarder du côté de l’étymologie, le rôle, l’adoption d’un rôle, c’est déjà la victoire du contrôle.
réprimer. Et pour exercer ce contrôle, il faut des infrastructures, car « le pouvoir réside désormais dans les infrastructures de ce monde » (Le Comité invisible, À nos amis, La Fabrique, 2014, p.83). Et c’est ce que démontre admirablement L’homme heureux, on les voit, on les lit ces mots d’ordre qui partout essaiment, dans le monde de l’entreprise comme dans celui des transports – « Vous êtes à bord du tramway 1, en route pour une belle journée de travail, avec la ratp et votre employeur » –, les corps, donc les êtres et leurs manières, domestiqués – « tout le monde est debout, les sièges ont été enlevés des transports en commun pour des questions d’optimisation (…) tout se joue debout désormais ». Mots d’ordre qui se répercutent et que lentement on intériorise, cette Karine végétarienne et qui se met à manger de la viande parce qu’ « être carniste permet de mieux s’intégrer (…) elle a développé d’autres compétences relevant de la virilité me dit-elle, une autorité agressive quand il faut, les blagues aussi, sous forme d’une misogynie tendre qu’elle s’applique avant les autres.» Elle se rassure, Karine, « c’est un rôle qui lui sert ». Mais à y regarder de plus près, à y regarder du côté de l’étymologie, le rôle, l’adoption d’un rôle, c’est déjà la victoire du contrôle.
Et c’est là la force de ce texte, c’est de s’attarder sur la représentation, ce monde de la représentation – « tout ce qui était directement vécu s’est éloigné dans une représentation » (Guy Debord, La société du spectacle, Folio Gallimard, 1992 [1967],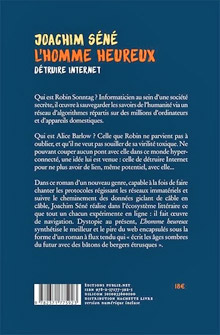 p.15) –, mais en pointant la manière, la matière physique dont se construit le spectacle de la représentation ou la représentation du spectacle. Ces câbles, ces câbles qui charrient la masculinité. Et la finesse de Séné, en excellent connaisseur du numérique, ce n’est pas de faire du web un mal en soi[1]. Pour internet comme pour toute chose, il n’y pas de mal, mais du mauvais, ce mauvais venu par la centralisation, le bon étant le code, ce code qui nous permet de faire d’internet ce que nous voulons et désirons. « Le code ne pourra pas faire loi sur les réseaux sociaux, comme il fait loi sur le transport neutre de données malgré les tentatives des états de casser ça. »
p.15) –, mais en pointant la manière, la matière physique dont se construit le spectacle de la représentation ou la représentation du spectacle. Ces câbles, ces câbles qui charrient la masculinité. Et la finesse de Séné, en excellent connaisseur du numérique, ce n’est pas de faire du web un mal en soi[1]. Pour internet comme pour toute chose, il n’y pas de mal, mais du mauvais, ce mauvais venu par la centralisation, le bon étant le code, ce code qui nous permet de faire d’internet ce que nous voulons et désirons. « Le code ne pourra pas faire loi sur les réseaux sociaux, comme il fait loi sur le transport neutre de données malgré les tentatives des états de casser ça. »
Ainsi s’agira-t-il de « Détruire internet » tel qu’il s’est construit, tel qu’il se fait prolongement du contrôle. Sortir internet, et nos vies avec, de la marchandise, du travail marchand, de la production qui n’a d’autre but que de produire et se reproduire.
« … cette étanchéité entre les deux, total schizo mais ça marche et se maintient et ça ne bouge pas, c’est une condition de fonctionnement de l’ensemble et on tremble de penser que, sous d’autres conditions, dans les murs d’une entreprise on pourrait vivre comme dehors en lisant, en créant, en prononçant des mots vains sans rapport direct avec demain et la production, en organisant des événements, en imprimant des journaux. »
Un tramway simonien
À lire les lignes ci-dessus, on pourrait croire que nous avons affaire à un essai ou à quelque roman à thèse, il n’en est pourtant rien. L’une des plus grandes forces de L’Homme heureux est que le propos s’insère dans l’écriture, et cette même écriture sert le propos. Joachim Séné fait partie de ces quelques écrivains et écrivaines ayant lu avec l’attention qui lui est due Claude Simon, 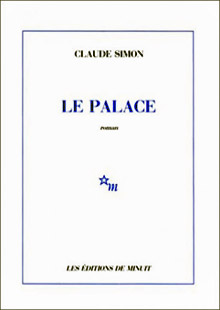 et qui prolongent à leur manière l’écriture simonienne – il y a peu, je vous parlais de Ryad Girod. À lire L’Homme heureux, à voir tout au long de ses pages ce tramway cheminer, impossible de ne pas faire le parallèle avec l’auteur du Tramway et ce n’est pas tant à ce roman que je pense, mais au Palace – 1962, Minuit – trop injustement méconnu, se déroulant à Barcelone au cœur de la révolution de 1936, et dont la troisième partie met en scène, selon une composition tout à fait singulière, le cheminement de tramways portant des enseignes publicitaires disséminant ces « réclames » dans toute la ville, répétant l’apparition de ces réclames par leurs allers et retours incessants, avec les arrêts de ces tramways, leurs cahots. Et c’est à un tel jeu que se prête Joachim Séné avec ce tramway qui va et qui vient, ce tramway qui traverse le roman et qui, à mon sens, est l’allégorie de la révolution. Tramway et révolution, quel lien ? Pour le comprendre, il faut en revenir à l’épigraphe du roman de Claude Simon susmentionné :
et qui prolongent à leur manière l’écriture simonienne – il y a peu, je vous parlais de Ryad Girod. À lire L’Homme heureux, à voir tout au long de ses pages ce tramway cheminer, impossible de ne pas faire le parallèle avec l’auteur du Tramway et ce n’est pas tant à ce roman que je pense, mais au Palace – 1962, Minuit – trop injustement méconnu, se déroulant à Barcelone au cœur de la révolution de 1936, et dont la troisième partie met en scène, selon une composition tout à fait singulière, le cheminement de tramways portant des enseignes publicitaires disséminant ces « réclames » dans toute la ville, répétant l’apparition de ces réclames par leurs allers et retours incessants, avec les arrêts de ces tramways, leurs cahots. Et c’est à un tel jeu que se prête Joachim Séné avec ce tramway qui va et qui vient, ce tramway qui traverse le roman et qui, à mon sens, est l’allégorie de la révolution. Tramway et révolution, quel lien ? Pour le comprendre, il faut en revenir à l’épigraphe du roman de Claude Simon susmentionné :
« Révolution : Mouvement d’un mobile qui, parcourant une courbe fermée, repasse successivement par les mêmes points » (Larousse).
Ce tramway donc qui sillonne le roman de Séné et qui fait écho à la contre-révolution advenue, ce passage, que nous évoquions, de sociétés disciplinaires à des sociétés de contrôle. Et voici, comment nous bouclons notre propre boucle.
[1] Spinoza et tant d’autres nous ont appris à nous affranchir des conceptions du Bien et du Mal, leur préférer la relativité du bon et du mauvais. Une chose étant bonne ou mauvaise selon son contexte et sa situation. « Par exemple, la Musique est bonne pour le mélancolique, mauvaise pour l’affligé ; et pour le sourd, ni bonne, ni mauvaise » (Préface du Livre 4 de L’Éthique, trad. Bernard Pautrat, Le Seuil, 2014).
![[Chronique] Joachim Séné, L'Homme heureux, par Ahmed Slama](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2020/02/SeneHommeHeureuxBackG.jpg)
![[Chronique] Joachim Séné, L’Homme heureux, par Ahmed Slama](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2020/02/band-SeneHommeHeureux.jpg)