Laurent Cauwet, La Domestication de l’art. Politique et mécénat, La Fabrique éditions, automne 2017, 162 pages, 12 €, ISBN : 978-2-35872-156-1.
► Rencontres avec Laurent Cauwet pour son livre La Domestication de l’art. Politique et mécénat : jeudi 1er mars à 19H, Librairie Texture (94, Avenue Jean Jaurès 75019 Paris), avec Véronique Pittolo ; le vendredi 2 mars à 19H, Librairie Transit (45 boulevard de la Libération, 13001 Marseille) ; samedi 3 mars, 19H, à La Boutique de La Ciotat (8, rue des Frères Blanchard).
 Le point de départ de Laurent Cauwet, qui se situe en droite ligne de la pensée debordienne, est le constat que la société du spectacle a phagocyté la sphère artistique, dont l’autonomie est par conséquent en voie de disparition. Le champ artistique est annexé par ce que l’éditeur/auteur nomme l’"entreprise culture" : les institutions publiques comme privées n’ont de cesse de domestiquer en le divertissant un public le plus large possible et une foule de créateurs de tous poils en obtenant leur servitude volontaire. Cette dernière formule nous fait songer à Pierre Bourdieu, dont l’un des derniers travaux portait sur la révolution conservatrice dans l’édition : à la bipolarisation du champ littéraire (espace autonome versus espace commercial) succède la domination d’une vaste zone interlope où se recyclent les formes et les thèmes propres à la modernité ; d’où l’avènement de bricoleurs géniaux devenus experts dans l’art de récupérer, voire de subvertir des valeurs consacrées de l’art moderne comme la notion même de "subversion", la "liberté créatrice"… La "bohème" : "Portée par l’entreprise culture, la bohème affichée est une catégorie des classes moyennes, de celle qui jouit avec arrogance de ses privilèges, de ceux qu’on octroie en contrepartie d’une employabilité à toute épreuve" (p. 53). Le gain de l’opération est de taille : le rejet de tous ceux qui doutent de cette bohème sponsorisée/subventionnée dans la catégorie pestiférée de "réactionnaires" ; et bien entendu sont antimodernes tous ceux qui s’opposent à cette néo-modernité qui est un ersatz de la Modernité (CQFD). Désormais triomphe le simulacre : "Ce qui est demandé à l’artiste n’est plus de produire des gestes critiques, mais d’obéir à l’injonction de produire des gestes critiques" (45).
Le point de départ de Laurent Cauwet, qui se situe en droite ligne de la pensée debordienne, est le constat que la société du spectacle a phagocyté la sphère artistique, dont l’autonomie est par conséquent en voie de disparition. Le champ artistique est annexé par ce que l’éditeur/auteur nomme l’"entreprise culture" : les institutions publiques comme privées n’ont de cesse de domestiquer en le divertissant un public le plus large possible et une foule de créateurs de tous poils en obtenant leur servitude volontaire. Cette dernière formule nous fait songer à Pierre Bourdieu, dont l’un des derniers travaux portait sur la révolution conservatrice dans l’édition : à la bipolarisation du champ littéraire (espace autonome versus espace commercial) succède la domination d’une vaste zone interlope où se recyclent les formes et les thèmes propres à la modernité ; d’où l’avènement de bricoleurs géniaux devenus experts dans l’art de récupérer, voire de subvertir des valeurs consacrées de l’art moderne comme la notion même de "subversion", la "liberté créatrice"… La "bohème" : "Portée par l’entreprise culture, la bohème affichée est une catégorie des classes moyennes, de celle qui jouit avec arrogance de ses privilèges, de ceux qu’on octroie en contrepartie d’une employabilité à toute épreuve" (p. 53). Le gain de l’opération est de taille : le rejet de tous ceux qui doutent de cette bohème sponsorisée/subventionnée dans la catégorie pestiférée de "réactionnaires" ; et bien entendu sont antimodernes tous ceux qui s’opposent à cette néo-modernité qui est un ersatz de la Modernité (CQFD). Désormais triomphe le simulacre : "Ce qui est demandé à l’artiste n’est plus de produire des gestes critiques, mais d’obéir à l’injonction de produire des gestes critiques" (45).
 L’auteur énumère les conséquences pernicieuses de cet état de fait : prolétarisation des artistes et des poètes (transformation des noms en labels) ; prédominance du festif et de l’événementiel ; totalitarisme culturel, c’est-à-dire hégémonie de la culture-pour-tous comme forme élaborée du bien-vivre-ensemble ; patrimonalisation des formes artistiques socioculturellement admissibles et marginalisation de tout ce qui n’est pas intégrable ; mise à mort de l’esprit critique au profit d’une logique consensuelle… Et le polémiste de soulever les paradoxes les plus brûlants : à la lutte des classes a succédé la lutte des places, mais à quoi bon se battre si l’enjeu est d’être larbinisé par l’entreprise-culture ? Pourquoi prétendre écrire pour tous, alors que la réception de la poésie est par essence limitée ?
L’auteur énumère les conséquences pernicieuses de cet état de fait : prolétarisation des artistes et des poètes (transformation des noms en labels) ; prédominance du festif et de l’événementiel ; totalitarisme culturel, c’est-à-dire hégémonie de la culture-pour-tous comme forme élaborée du bien-vivre-ensemble ; patrimonalisation des formes artistiques socioculturellement admissibles et marginalisation de tout ce qui n’est pas intégrable ; mise à mort de l’esprit critique au profit d’une logique consensuelle… Et le polémiste de soulever les paradoxes les plus brûlants : à la lutte des classes a succédé la lutte des places, mais à quoi bon se battre si l’enjeu est d’être larbinisé par l’entreprise-culture ? Pourquoi prétendre écrire pour tous, alors que la réception de la poésie est par essence limitée ?
Il faut dire que la définition de la poésie que défend Laurent Cauwet est conforme à des décennies d’engagement (oui, engagement, et non pas ce nouveau terme à la mode, "implication", qui n’implique que les moins impliqués) : "La constellation poétique est le non-lieu où se réinventent les mots pour dire le monde qui nous entoure ; où est remise en question la langue de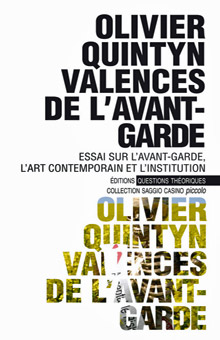 la domination" (23). Son panthéon, ce sont quelques revues des années 60-80 qui l’incarnent : "Les Lettres (des Garnier), Ou (d’Henri Chopin), Doc(k)s (de Julien Blaine), Robbo (du même), Émeute (de Serge Pey), CÉÉ (de F. J. Ossang), L’Humidité (de Jean-François Bory)… puis TXT (de Christian Prigent), Banana split (de Jean-Jacques Viton et Liliane Giraudon), Nioques (de Jean-Marie Gleize)…" (20). Avec un tel lignage, il ne peut que s’inscrire dans la radicalité : ou l’artiste cède aux sirènes de l’entreprise-culture, ou il poursuit son combat solitaire et exigeant, sans la moindre subvention – et avec tous les -SANS. Cette position rappelle un peu celle du théoricien Olivier Quintyn dans Valences de l’avant-garde. Essai sur l’avant-garde, l’art contemporain et l’institution (Questions théoriques, 2015) : après avoir décrié l’actuel "jeu de faire-semblant qui se persuade que l’art s’identifie intégralement à un pôle de résistance actif aux logiques de la domination sociale", il opte pour un "activisme souterrain", "une guérilla de la marge, de la minorité, de l’invisibilité" (p. 99 et 101).
la domination" (23). Son panthéon, ce sont quelques revues des années 60-80 qui l’incarnent : "Les Lettres (des Garnier), Ou (d’Henri Chopin), Doc(k)s (de Julien Blaine), Robbo (du même), Émeute (de Serge Pey), CÉÉ (de F. J. Ossang), L’Humidité (de Jean-François Bory)… puis TXT (de Christian Prigent), Banana split (de Jean-Jacques Viton et Liliane Giraudon), Nioques (de Jean-Marie Gleize)…" (20). Avec un tel lignage, il ne peut que s’inscrire dans la radicalité : ou l’artiste cède aux sirènes de l’entreprise-culture, ou il poursuit son combat solitaire et exigeant, sans la moindre subvention – et avec tous les -SANS. Cette position rappelle un peu celle du théoricien Olivier Quintyn dans Valences de l’avant-garde. Essai sur l’avant-garde, l’art contemporain et l’institution (Questions théoriques, 2015) : après avoir décrié l’actuel "jeu de faire-semblant qui se persuade que l’art s’identifie intégralement à un pôle de résistance actif aux logiques de la domination sociale", il opte pour un "activisme souterrain", "une guérilla de la marge, de la minorité, de l’invisibilité" (p. 99 et 101).
L’ancien éditeur d’Olivier Quintyn, proche également d’auteurs Al dante comme Sylvain Courtoux et Christophe Hanna pour leur refus de toute compromission, dénonce « l’inépuisable  maxime collaborationniste du "si c’est pas moi, c’est un autre. Alors à quoi bon…" » (40) et va jusqu’à mettre les artistes devant leurs responsabilités : "Le problème n’est pas d’où vient l’argent. Il est de savoir ce qu’implique, pour l’artiste, d’accepter cet argent : non seulement les comptes qu’il doit rendre à ceux qui le financent mais aussi le contexte dans lequel l’œuvre se trouve dès lors insérée – les financements et les partenaires donnent une couleur aux œuvres et aux gestes" (51). Pour lui, accepter quelque fonds que ce soit, c’est tolérer une atteinte à la liberté créatrice et s’exposer à la censure – comme Larissa Sansour par Lacoste et Frank Smith par Cartier. Et de fustiger les collusions entre monde de l’art et monde de l’argent, institutions publiques et institutions privées (exemple : Grand Palais / Louis Vuitton). Et de dévoiler la stratégie politique du Tout-culturel (mécénat public) : "les grandes messes festives prescrites par l’entreprise culture (fêtes de la musique, gay pride, Banlieues bleues, Printemps des poètes, Nuit des musées, Paris-plage et autres festivals, biennales, triennales…) ont pour fonction principale d’occulter la guerre sociale" (35). Mais aussi la stratégie commerciale du mécénat privé, dont il explicite ainsi le discours, insistant sur l’alibi que constitue l’humanisme new look : « "Oui nous sommes riches, oui nous gagnons beaucoup d’argent. Mais nous sommes des gens de cœur, et aimons l’humanité. Et cet argent que nous gagnons honnêtement, nous n’hésitons pas à en reverser une partie pour le bien-être de tous et pour participer à la grandeur de notre civilisation" » (91). La face cachée de cette propagande : les pratiques anti-humanistes de ces entreprises (nuisances, malversations, exploitation !) ; leur passé trouble (collaboration de Vuitton durant la Seconde Guerre mondiale ; l’argent de Cartier provient de l’apartheid)… Et pourtant les expositions organisées par les principales fondations fonctionnent bien : alors, que demande le peuple ? La réponse de Laurent Cauwet est des plus cinglantes : par exemple, Cartier participe au "travail de lissage de toute pensée critique, en substituant l’exaltation de la bonne conscience et de la morale à la réflexion politique" (117).
maxime collaborationniste du "si c’est pas moi, c’est un autre. Alors à quoi bon…" » (40) et va jusqu’à mettre les artistes devant leurs responsabilités : "Le problème n’est pas d’où vient l’argent. Il est de savoir ce qu’implique, pour l’artiste, d’accepter cet argent : non seulement les comptes qu’il doit rendre à ceux qui le financent mais aussi le contexte dans lequel l’œuvre se trouve dès lors insérée – les financements et les partenaires donnent une couleur aux œuvres et aux gestes" (51). Pour lui, accepter quelque fonds que ce soit, c’est tolérer une atteinte à la liberté créatrice et s’exposer à la censure – comme Larissa Sansour par Lacoste et Frank Smith par Cartier. Et de fustiger les collusions entre monde de l’art et monde de l’argent, institutions publiques et institutions privées (exemple : Grand Palais / Louis Vuitton). Et de dévoiler la stratégie politique du Tout-culturel (mécénat public) : "les grandes messes festives prescrites par l’entreprise culture (fêtes de la musique, gay pride, Banlieues bleues, Printemps des poètes, Nuit des musées, Paris-plage et autres festivals, biennales, triennales…) ont pour fonction principale d’occulter la guerre sociale" (35). Mais aussi la stratégie commerciale du mécénat privé, dont il explicite ainsi le discours, insistant sur l’alibi que constitue l’humanisme new look : « "Oui nous sommes riches, oui nous gagnons beaucoup d’argent. Mais nous sommes des gens de cœur, et aimons l’humanité. Et cet argent que nous gagnons honnêtement, nous n’hésitons pas à en reverser une partie pour le bien-être de tous et pour participer à la grandeur de notre civilisation" » (91). La face cachée de cette propagande : les pratiques anti-humanistes de ces entreprises (nuisances, malversations, exploitation !) ; leur passé trouble (collaboration de Vuitton durant la Seconde Guerre mondiale ; l’argent de Cartier provient de l’apartheid)… Et pourtant les expositions organisées par les principales fondations fonctionnent bien : alors, que demande le peuple ? La réponse de Laurent Cauwet est des plus cinglantes : par exemple, Cartier participe au "travail de lissage de toute pensée critique, en substituant l’exaltation de la bonne conscience et de la morale à la réflexion politique" (117).
 Pour incisif et stimulant que soit cet essai qui se compose de 17 chapitres plus ou moins longs suivis de 6 annexes, il n’en comporte pas moins deux limites. La première est d’ordre méthodologique : non seulement il manque une mise en perspective de ces nouvelles pratiques par rapport à l’histoire du mécénat en France et en Europe, mais en outre on peut regretter une certaine hésitation entre perspective sociologique et analyse politique. La seconde est d’ordre contextuel : une bonne partie des écrivains que Laurent Cauwet a publiés chez Al dante, adeptes d’une écriture exigeante, se sont précipités à l’appel des fondations (Vuitton, Ricard, etc.)… Comment (s’)explique-t-il ce phénomène, nous n’en savons rien à la fin de notre lecture. À ces réserves s’ajoutent ces questions fondamentales : doit-on forcément vivre dans la précarité pour être un véritable créateur ? Où commence et où s’arrête la compromission : quand un artiste, un poète, un dramaturge, ou encore un comédien bénéficie d’une subvention publique ou d’une résidence dans un lieu plus ou moins prestigieux, quel est l’impact véritable sur le processus créateur ? Un éditeur doit-il refuser toute subvention, y compris du CNL ? N’est-ce pas suicidaire ? N’y a-t-il aucune différence entre mécénat privé et mécénat public ?
Pour incisif et stimulant que soit cet essai qui se compose de 17 chapitres plus ou moins longs suivis de 6 annexes, il n’en comporte pas moins deux limites. La première est d’ordre méthodologique : non seulement il manque une mise en perspective de ces nouvelles pratiques par rapport à l’histoire du mécénat en France et en Europe, mais en outre on peut regretter une certaine hésitation entre perspective sociologique et analyse politique. La seconde est d’ordre contextuel : une bonne partie des écrivains que Laurent Cauwet a publiés chez Al dante, adeptes d’une écriture exigeante, se sont précipités à l’appel des fondations (Vuitton, Ricard, etc.)… Comment (s’)explique-t-il ce phénomène, nous n’en savons rien à la fin de notre lecture. À ces réserves s’ajoutent ces questions fondamentales : doit-on forcément vivre dans la précarité pour être un véritable créateur ? Où commence et où s’arrête la compromission : quand un artiste, un poète, un dramaturge, ou encore un comédien bénéficie d’une subvention publique ou d’une résidence dans un lieu plus ou moins prestigieux, quel est l’impact véritable sur le processus créateur ? Un éditeur doit-il refuser toute subvention, y compris du CNL ? N’est-ce pas suicidaire ? N’y a-t-il aucune différence entre mécénat privé et mécénat public ?
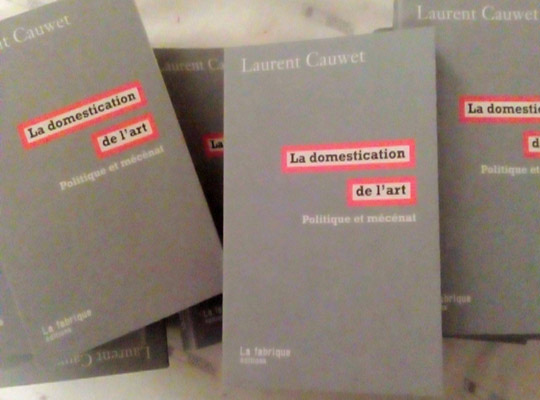
![[Chronique] Laurent Cauwet, ou le pavé dans la mare artistique, par Fabrice Thumerel](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2018/02/FondationVuittonBackG.jpg)