 Tandis que vient de paraître L’Atelier noir (éditions des Busclats, 208 pages, 15), titre des plus expressifs qu’a choisi Annie Ernaux pour une partie de son journal d’écriture, nous poursuivons le dossier avec cinq avant-textes inédits des Années que nous sommes reconnaissants à l’auteure de nous avoir donnés en exclusivité.
Tandis que vient de paraître L’Atelier noir (éditions des Busclats, 208 pages, 15), titre des plus expressifs qu’a choisi Annie Ernaux pour une partie de son journal d’écriture, nous poursuivons le dossier avec cinq avant-textes inédits des Années que nous sommes reconnaissants à l’auteure de nous avoir donnés en exclusivité.
Elle [1] est née à L. en 1940.
(Commencer ainsi suppose qu’il est possible de transformer en histoire l’existence, vague et sans signification à ses propres yeux, d’une femme qui a vécu de la dernière guerre à aujourd’hui – où elle vient de voir à la télé, comme la plupart de Européens et des Américains, le procès de Nicola et d’Elena Ceaucescu avant leur exécution.
Cela veut dire, non pas glisser cette existence dans une forme romanesque, que les modèles en soient ceux de La Recherche du Temps perdu ou d’Autant en emporte le vent, mais de chercher à en atteindre la réalité, à la fois singulière et partagée peut-être par une génération. Prendre en compte ses désirs, ses expériences personnelles, moins uniques qu’elle ne l’a cru longtemps, et la série des déplacements, des influences – milieux, idées – grâce auxquelles elle s’est constituée. Décrire ce qui a changé autour de cette femme et en elle. Bref, rester toujours à la croisée de sa mémoire et de l’Histoire, de l’individuel et du collectif, en utilisant la troisième personne, le « elle », qui, dans certains cas, n’est que la forme historique, objective et distanciée d’un « je ». )
(Je suis assise à mon bureau, devant la fenêtre. Je la vois, cette femme, qui revoit les lieux où elle a vécu – d’ailleurs vous me voyez aussi, assise à mon bureau, devant la fenêtre. Je la vois comme elle se sent, ordinaire, ayant connu un certain nombre d’événements, un mariage, des enfants, un divorce, des amants – bien que ce terme romanesque lui paraisse toujours étrange. Il y a eu des amies, des relations de travail, des voyages. De plus en plus elle s’étonne : tout ce qu’elle a vu, entendu, appris, disparaîtra avec elle. Elle me paraît très proche, à cette différence près qu’elle n’écrit pas, sauf quelquefois dans son journal intime. Elle est ma dépouille vivante.
Ce que je sais d’elle de plus certain, en dehors de l’état-civil et du curriculum vitae, c’est qu’elle n’a jamais cessé de penser aux hommes. Le reste est informe et demande un récit).
Le glissement presque immobile[2] des années d’enfance s’est effectué à L., 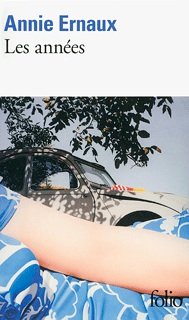 en Normandie, sous l’occupation allemande. Dans la mémoire, ce temps qui n’a pas de commencement est dépourvu de dates, de repères, il n’y a que des lieux et des scènes, des impressions violentes dont le degré de bonheur ou de douleur est difficile à établir. En premier, toujours le commerce près de la rivière. A l’arrière, la petite cour pavée avec une buanderie, des loges pour les lapins et les cabinets qui donnaient au dessus de la rivière. Les excréments restés au fond étaient emportés peu à peu par l’eau qui clapotait sans cesse au fond. C’est dans cette courette qu’elle jouait avec la chienne Poupette et qu’on sortait après les alertes pour regarder le ciel, « ce n’est pas encore pour cette fois ». Y ont été prises aussi la plupart des photos de cette époque, d’elle et de ses parents, devant le muret surplombant la rivière. La salle à manger à l’étage, réservé aux jours de fête, avec, sur la table, une coupe de fleurs artificielles orange aux tiges noires entremêlées. Il fallait passer par la salle pour entrer dans la chambre où elle dormait dans un petit lit rose à droite de celui de ses parents. Parallèle à la salle à manger une autre chambre, longue et vide, qui servait peut-être avant la guerre à stocker les marchandises. Au dessous, le café plein de soldats anglais et américains qui la prennent sur leurs genoux, lui offrent des sucreries. L’épicerie où les femmes font la queue avec des sacs et dont l’accès ne lui est permis qu’en disant haut et clair bonjour madame. La cuisine, lieu de passage entre le café, la courette, l’épicerie et l’escalier vers les pièces du haut. On y mangeait et on s’y lavait. Elle ne sait plus sur quel mur était accroché la cage du petit serin jaune.
en Normandie, sous l’occupation allemande. Dans la mémoire, ce temps qui n’a pas de commencement est dépourvu de dates, de repères, il n’y a que des lieux et des scènes, des impressions violentes dont le degré de bonheur ou de douleur est difficile à établir. En premier, toujours le commerce près de la rivière. A l’arrière, la petite cour pavée avec une buanderie, des loges pour les lapins et les cabinets qui donnaient au dessus de la rivière. Les excréments restés au fond étaient emportés peu à peu par l’eau qui clapotait sans cesse au fond. C’est dans cette courette qu’elle jouait avec la chienne Poupette et qu’on sortait après les alertes pour regarder le ciel, « ce n’est pas encore pour cette fois ». Y ont été prises aussi la plupart des photos de cette époque, d’elle et de ses parents, devant le muret surplombant la rivière. La salle à manger à l’étage, réservé aux jours de fête, avec, sur la table, une coupe de fleurs artificielles orange aux tiges noires entremêlées. Il fallait passer par la salle pour entrer dans la chambre où elle dormait dans un petit lit rose à droite de celui de ses parents. Parallèle à la salle à manger une autre chambre, longue et vide, qui servait peut-être avant la guerre à stocker les marchandises. Au dessous, le café plein de soldats anglais et américains qui la prennent sur leurs genoux, lui offrent des sucreries. L’épicerie où les femmes font la queue avec des sacs et dont l’accès ne lui est permis qu’en disant haut et clair bonjour madame. La cuisine, lieu de passage entre le café, la courette, l’épicerie et l’escalier vers les pièces du haut. On y mangeait et on s’y lavait. Elle ne sait plus sur quel mur était accroché la cage du petit serin jaune.
« La maison natale », sujet de rédaction des années cinquante, mais elle ne pouvait pas décrire ce qui ne serait jamais une maison, c’est-à-dire un endroit privé où les gens frappent , mais « le commerce », un lieu ouvert à tous, traversé de voix multiples, le langues familières ou inconnues, à peine séparé de la rue par les vitres de la devanture.
_____________________________________
Début 1990, essai en « impersonnel » :
Il y a aussi la guerre au moment où les bombardiers allemands et alliés se disputaient le ciel. A la sirène de l’alerte on courait se réfugier n’importe où. La poussette cahotait, folle, 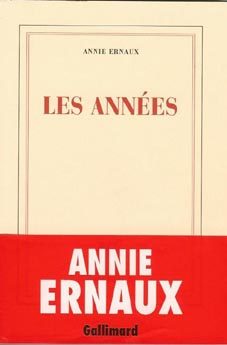 dans les rues de L. au milieu des passants qui fuyaient. Le souffle des bombes pulvérisait les vitres de la devanture. La nuit on allait avec des couvertures dans la tranchée ouverte au flanc de la colline, au dessus de la Vallée mais on préférait s’accroupir sous le billard du café dont l’épaisseur rassurait contre l’effondrement des murs. Après, on sortait dans la courette pour regarder le ciel en se demandant où c’était tombé.
dans les rues de L. au milieu des passants qui fuyaient. Le souffle des bombes pulvérisait les vitres de la devanture. La nuit on allait avec des couvertures dans la tranchée ouverte au flanc de la colline, au dessus de la Vallée mais on préférait s’accroupir sous le billard du café dont l’épaisseur rassurait contre l’effondrement des murs. Après, on sortait dans la courette pour regarder le ciel en se demandant où c’était tombé.
Plus tard, les soldats américains remplissaient la maison, donnaient des chew gums et des bananes, prenaient les enfants sur leurs genoux. L’après-midi on montait les voir au camp installé sur les hauteurs de L. Le ciel était devenu muet, juste traversé par les avions postaux. On portait des robes d’été. La fête était partout. Des balançoires étaient installées place du marché. Sur une scène en plein air, on montrait des Allemands torturant un enfant qui refusait de dénoncer un Résistant et une femme enfermée dans une boîte traversée de part en part d’épées et qui en ressortait vivante. Les enfants avaient le droit de tout faire, hurler, se salir, jouer dans la rue et rester au café tard avec les parents qui chantaient en levant leur verre si je meurs je veux qu’on m’enterre dans la cave où il y a du bon vin. La guerre était finie.
Le véritable commencement est ailleurs. Il est dans l’histoire de deux lignées d’hommes et de femmes.
___________________________________
Projet rédigé en 1990, reprenant des passages écrits en 1989.
Ecrire sur ma passion, comme je le fais depuis plusieurs jours, me paraît inutile. C’est une façon d’accompagner moi-même une souffrance que personne n’imagine et que des livres et des films aviveraient parce qu’il y est presque toujours question d’amour. C’est retourner en arrière, le plus loin possible, et me tenir à une telle distance de moi-même que je me considérerai comme une autre femme, qui m’offre une chance de m’en sortir.
Je partirai donc à la recherche d’une femme dont l’existence s’est déroulée de la dernière guerre à maintenant, début des années 90, à cet aujourd’hui où, en costume marine, Vaclav Havel président de la République de Tchécoslovaquie serre la main du chancelier Köhl, événement dont, pour le moment, la signification est nulle – cet aujourd’hui qui ne cessera de reculer au fur et à mesure que j’écrirai. Cette existence, ma mémoire me la donne comme mienne, unique, particulière. Pourtant je la sens, même dans la passion violente éprouvée pour un homme, comme fondue au milieu d’autres dans le temps commun d’une génération. Ce « je » que j’emploie encore ici ne m’appartient pas complètement, il est un lieu de pensées, de désirs, que j’ai dû partager avec autrui. Je ne suis, d’une certaine façon, que du temps qui a passé à travers moi.
Pour saisir objectivement cette existence, ne pas prendre seulement en compte les images du souvenir, ni les anecdotes révélatrices d’une identité unique mais aussi les conditions sociales et l’évolution du monde. Il faut mettre au jour ce qui a changé dans cette femme et autour d’elle. Rester toujours dans l’écriture à la croisée du singulier et du collectif. Dans ces conditions, la scission entre « je » et « elle » s’impose comme une évidence.
Sans doute parce que née dans un milieu populaire et passée dans un autre monde où l’on ne « travaille pas de ses mains », je n’ai pu que me sentir autre. Quand j’étais étudiante, je vivais pendant la semaine à la cité universitaire et je rentrais le samedi chez mes parents à une demi-heure de train. J’avais l’impression d’être deux personnes différentes sans rapport l’une avec l’autre. Celle qui allait à la fac, écoutait des cours, buvait du viandox dans les cafés près de la gare et celle qui mangeait dans la cuisine entre son père et sa mère, les entendait parler des voisins et des clients, des livraisons, comme toujours depuis l’enfance.
Mais peut-être aussi parce que l’époque dans laquelle j’ai commencé de grandir,  l’immédiat après-guerre, était plus proche du XIXème siècle que d’aujourd’hui. Sentiment, illusion, en lisant les descriptions de Combray, d’une familiarité, par delà les différences sociales entre le milieu de l’enfance de Proust et le mien, rues sans voitures, chiens en liberté, rideaux qu’on soulève pour voir sans être vu, vieilles demoiselles. La petite fille des années cinquante vit dans un autre siècle.
l’immédiat après-guerre, était plus proche du XIXème siècle que d’aujourd’hui. Sentiment, illusion, en lisant les descriptions de Combray, d’une familiarité, par delà les différences sociales entre le milieu de l’enfance de Proust et le mien, rues sans voitures, chiens en liberté, rideaux qu’on soulève pour voir sans être vu, vieilles demoiselles. La petite fille des années cinquante vit dans un autre siècle.
Et comment pourrais-je dire « je » en évoquant cette adolescente à genoux sur un prie-dieu, la tête couverte d’une mantille à la messe du dimanche – qui m’est plus étrangère que n’importe quelle fille avec son walkman sur les oreilles, à Châtelet-les-Halles. Il y a trop de fausse permanence dans le « je », le « elle » sera ici la forme historique du moi.
Définir la nature de cette entreprise est difficile. Il s’agit d’une investigation où, comme en histoire et en sociologie, la visée est la saisie d’une réalité, où chaque trace, archive, souvenir, photo, témoignage oral est soumis à un examen. Une sorte d’auto-enquête. Mais les résultats de celle-ci s’inscriront dans la trame [la coulée] d’un récit, seul capable de faire revivre le passage des années dans un déroulement figurant celui qui va de la naissance à la mort. Le modèle idéal du récit est peut-être ce que disent avoir vu les gens qui croyaient mourir, « toute une vie en quelques secondes »
Ce récit sera lui-même fait de temps, pas seulement des heures où je m’astreins à rester assise à ma table, à réfléchir et tracer des phrases, mais aussi des nuits de sommeil avec les rêves, des petits-déjeuners où j’écoute le transistor, les trajets en métro et en RER, les courses dans les magasins, les conversations et même les rêveries où je retrouve S., lui dis que ce livre lui est dédié. Toute l’usure quotidienne du cours de la vie qui me paraît indispensable pour porter, comme on le dit de la mer, l’écriture de ce livre. Pour lui donner une sorte de garantie de réalité, venue de la confrontation réitérée de l’expérience immédiate de vivre et de ce qui est écrit, du désespoir devant un bol de café, un matin d’août, et la description d’un désespoir identique dans la page d’hier ou de demain. C’est à ce prix sans doute que je réduirai au maximum la distance entre l’écriture et la vie.
Mon projet porte sans doute la marque de l’époque, de la fin du siècle, mais plus certainement d’une situation sociale : femme et issue d’une classe dominée, je ne me sens pas [suis pas sentie] « sujet de ma propre histoire ». Celle-ci m’a toujours paru déposée dans les lieux, dans les gestes et les paroles des gens que j’ai fréquentés, parfois aimés, dans les livres que j’ai lus, les chansons que j’ai entendues. Pas d’autre moyen, donc, pour la comprendre et la rendre réelle, que d’interroger les mondes qui m’ont traversée.
J’ai commencé d’écrire à cause d’un homme, je pourrais par la suite supprimer les premières pages et ne laisser que le véritable commencement [le début à venir]. Mais il y a sans doute une relation [une continuité] entre la passion que j’ai eue pour lui et ce qui suivra. Déjà ceci : je voudrais atteindre en écrivant le même degré d’évidence et de nécessité absolue qu’il y a dans le désir sexuel, cette impossibilité de ne pas aller « jusqu’au bout »
__________________________________
Fragment (en 2000)
Les yeux qui se posaient sur l’enfant avaient, pour certains, vu finir le XIXème siècle, surgir l’électricité et les voitures à pétrole. Presque tous avaient vu flamboyer l’aurore boréale de 1914, annonciatrice de la guerre disaient-ils, partir les soldats au front, mourir les jeunes filles de la grippe espagnole. Et ils avaient connu des hommes et des femmes qui se souvenaient de la Commune et de la guerre de 1870. De même qu’aujourd’hui en 2000, le regard que je pose sur mes enfants (les jeunes) a vu les décombres des villes ravagées par les bombes de la seconde guerre mondiale et les premiers postes de télévision. La mémoire, pas plus que le désir sexuel ne s’arrête jamais.
Mais pour l’enfant (de cinq ans) qui vient au monde il n’y a ni siècles ni décennies. Plus ou moins vieux, les gens autour de lui ont vécu dans le même temps, immense, celui où l’on n’a pas été, où l’on ne sera jamais, le temps d’avant.
_____________________________________
A propos de ma façon d’écrire (2002)
Je constate ceci, que je ne « reconstruis pas l’Histoire, le temps plutôt, des années 40-45 avec des images de scènes, de souvenirs personnels. Assez peu même, et ce sont alors des images gravées par leur côté insolite, des images traumatisantes. Ce qui me vient dans l’écriture, ce n’est pas de la mémoire ponctuelle, personnelle, mais quelque chose d’enregistré en vivant, sans y prendre garde, une espèce de courant continuel, qui serait l’enregistrement du monde en soi au cours des années, en un lieu donné, au travers d’expériences dont beaucoup sont communes à tous, la famille, l’école, le progrès, le langage.
[Je comprends pourquoi je suis découragée par les autobiographies, les confessions, où chacun ne parle que de soi, ses images, ses souvenirs, sa libido, etc. Ces textes ne donnent qu’une part de la réalité]
Lorsque je suis devant une image comme « l’opération des amygdales à L. », c’est un souvenir personnel de douleur. J’en fais, je vois, un souvenir aussi collectif, historique, l’opération à tout va des amygdales. Tout seul, c’est insuffisant.
Ce que j’écris sur la guerre n’est pas lié à un souvenir précis mais vient de l’impression laissée par les récits, les corps, les visages des gens qui racontaient, sans que je puisse me rappeler un souvenir ponctuel. Aucun même. C’est du « façonnement » de l’être que je transcris, du discours intériorisé que je retrouve et mets à distance en même temps.
Quand je retrouve une phrase qu’on employait souvent dans mon milieu, enfant, comme « on ne sait plus comment on vit » (= quel jour on est) instantanément quelque chose m’enveloppe, qui n’est pas mon être d’enfant, mon passé, pas seulement, mais le monde social de ce temps-là, éprouvé comme une totalité. J’éprouve une grande satisfaction, celle d’avoir retrouvé une réalité qui n’est pas seulement d’ordre individuel mais collectif.
Ce sont ces images, ces phrases, qui vont me servir à reconstituer l’Histoire.
![[Dossier Annie ERNAUX - 3] Annie Ernaux, Cinq avant-textes des <em>Années</em>](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)