Suite à la chronique de Fabrice Thumerel sur Janis Joplin, voix noire sur fond blanc, voici l’entretien passionnant que Véronique Bergen a bien voulu accorder à Emmanuèle Jawad pour Libr-critique – et nous la remercions chaleureusement.
Emmanuèle Jawad : Janis Joplin est ton quatrième livre publié aux Editions Al Dante après Edie. La danse d’Icare (2013), Marilyn. Naissance année 0 (2014) et Le Cri de la poupée (2015). Un autre livre Gang blues ecchymoses sur des photographies de Sadie von Paris est prévu. Le choix thématique s’est opéré sur un personnage féminin comme dans les précédents livres, d’une icône également. Comment précisément ce choix d’un livre sur Janis Joplin s’est-il effectué et s’insère-t-il dans ton parcours d’écriture ?
Véronique Bergen : Mon élection d’un personnage vient de très loin. Certains personnages me fascinent, m’accompagnent depuis l’adolescence, d’autres surgissent au fil des années. Choc en miroir, phénomène d’échos entre eux et moi, appel, envoûtement. Ils frappent à ma porte comme si leur existence appelait leur mise en mots, en voix. Le mouvement de genèse est composite. La présence du personnage me taraude selon des coordonnées qui lui sont propres (Edie Sedgwick, Marilyn, Unica Zürn, Janis Joplin en ce qui concerne mes fictions publiées par Laurent Cauwet chez Al Dante, mais aussi Kaspar Hauser, Ulrike Meinhof, Louis II de Bavière…), je lui donne un abri langagier, je plonge dans un travail d’archivage. À partir de cette collecte de documents déjà orientée par la mise en forme que je vois se dessiner, je greffe ma création, mes inventions, j’opère une ventriloquie de l’époque à laquelle appartient le personnage, j’injecte des questions métaphysiques, des blocs de sensations, des rugissements poétiques, la sève d’une langue qui cherche de nouveaux espaces. Le personnage que je choisis est souvent féminin, mais pas exclusivement, parfois une icône, une anti-icône, mais ce n’est guère un parti pris. Je ne choisis pas ceux et celles qui me raptent. Un souci de leur rendre justice me poursuit, me guide. Dans mon parcours d’écriture, je pense que je vais bifurquer vers
concerne mes fictions publiées par Laurent Cauwet chez Al Dante, mais aussi Kaspar Hauser, Ulrike Meinhof, Louis II de Bavière…), je lui donne un abri langagier, je plonge dans un travail d’archivage. À partir de cette collecte de documents déjà orientée par la mise en forme que je vois se dessiner, je greffe ma création, mes inventions, j’opère une ventriloquie de l’époque à laquelle appartient le personnage, j’injecte des questions métaphysiques, des blocs de sensations, des rugissements poétiques, la sève d’une langue qui cherche de nouveaux espaces. Le personnage que je choisis est souvent féminin, mais pas exclusivement, parfois une icône, une anti-icône, mais ce n’est guère un parti pris. Je ne choisis pas ceux et celles qui me raptent. Un souci de leur rendre justice me poursuit, me guide. Dans mon parcours d’écriture, je pense que je vais bifurquer vers 
Emmanuèle Jawad : La contre-culture est très présente dans tes livres. Dans Janis Joplin : « Et si je n’avais pas envie de quitter les sixties, de vivre dans une décennie qui enterra tout ce que les années soixante ont expérimenté ? La contre-culture commence à rentrer dans le rang (…) ». Peut-on dire que ton livre s’apparente autant à un texte sur une période historique – les années 60 – que sur un personnage, Janis Joplin ? Certains énoncés semblent relever quasi du documentaire, bien qu’il s’agisse d’une fiction. Quelle documentation est-elle nécessaire en amont de l’écriture ? Quels rapports fiction/ document ?
Véronique Bergen : Le questionnement de l’époque, ici en l’occurrence les Sixties, m’importe autant que la focalisation sur Janis. Comme Deleuze parle, en art, d’une conversion des perceptions (vécues, intimes) en  percepts (impersonnels, non humains), des affections en affects, le personnage de Janis Joplin que je construis excède le référent « Janis » résumé par un ensemble de paramètres identitaires. La construction du personnage implique son devenir impersonnel au sens d’extra-personnel, l’érosion de la division entre agencement privé et agencement public, entre flux de désirs individuels et flux de désirs collectifs. Chez Proust, les personnages sont pris dans des paysages, dans une nébuleuse nominale, un fond géographique dont ils se décollent peu, bien qu’ils soient sondés dans les plis d’une psychologie aiguisée. C’est ce que Julien Gracq relève magnifiquement dans Proust considéré comme terminus en parlant de l’art proustien du bas-relief : « frappé que je suis, que j’ai toujours été, de l’écart minimum de densité et de relief qui sépare les personnages de son livre de la masse foisonnante vivante dont le livre est fait, et dont ils émergent tout juste. Ils sont comme des bas-reliefs de faible saillie, pris dans l’épaisseur, et qui se détacheraient à peine, non d’une paroi lisse, mais d’un grouillement déjà animé, comme celui des murs des temples hindous ». Merveille de la phrase gracquienne et de ses visions inouïes qui percent les couches cachées, captent le souffle de la création littéraire…
percepts (impersonnels, non humains), des affections en affects, le personnage de Janis Joplin que je construis excède le référent « Janis » résumé par un ensemble de paramètres identitaires. La construction du personnage implique son devenir impersonnel au sens d’extra-personnel, l’érosion de la division entre agencement privé et agencement public, entre flux de désirs individuels et flux de désirs collectifs. Chez Proust, les personnages sont pris dans des paysages, dans une nébuleuse nominale, un fond géographique dont ils se décollent peu, bien qu’ils soient sondés dans les plis d’une psychologie aiguisée. C’est ce que Julien Gracq relève magnifiquement dans Proust considéré comme terminus en parlant de l’art proustien du bas-relief : « frappé que je suis, que j’ai toujours été, de l’écart minimum de densité et de relief qui sépare les personnages de son livre de la masse foisonnante vivante dont le livre est fait, et dont ils émergent tout juste. Ils sont comme des bas-reliefs de faible saillie, pris dans l’épaisseur, et qui se détacheraient à peine, non d’une paroi lisse, mais d’un grouillement déjà animé, comme celui des murs des temples hindous ». Merveille de la phrase gracquienne et de ses visions inouïes qui percent les couches cachées, captent le souffle de la création littéraire…
Exhumer Janis Joplin, sa formidable soif de vie, c’est exhumer les mouvements de contestation des Sixties, de libération sexuelle, socio-politique, esthétique, l’aventure du Flower Power, la sécession par rapport au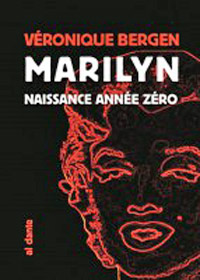 système, le refus du consumérisme, le grand élan d’optimisme, le pari pour un autre vivre ensemble lancé par les hippies. S’est imposée à moi la nécessité d’établir, de réfléchir à un jeu de contrastes entre les promesses de liberté des Sixties et les nouvelles formes du biopouvoir mondial actuel, les nouveaux dispositifs répressifs qui, sous le signe de TINA (« There Is No Alternative », « il n’y a pas d’alternative » au capitalisme déchaîné, dévastateur des corps, des puissances de pensées, des écosystèmes, de la planète) signent la mort des utopies hippies et tendent de mettre à quia les mouvements alternatifs, les luttes, les propositions d’autres formes de société. Comme je le mentionne ci-dessus, le nouage entre documentation et fiction est placé sous le signe de la liberté : à partir d’une fidélité à la matière historique, aux faits, aux données biographiques, politiques, je lance mon imaginaire qui a peut-être besoin, pour ne pas s’hyperboliser, de se resserrer sur un ancrage précis, de se donner un périmètre. Le choix de partir d’Edie Sedgwick, Marilyn, Unica Zürn, Janis Joplin… me permet aussi un jeu quasi-borgésien de masques, de mixer, au sens musical du terme, des pans de mes sensations, de mes obsessions, de mes fêlures aux voix des personnages, de brouiller les frontières entre autofiction, biofiction, exofiction. D’illimiter le « je » (celui de Janis Joplin, de l’auteure…) par son évanouissement dans une matière langagière où il n’y a plus de propre.
système, le refus du consumérisme, le grand élan d’optimisme, le pari pour un autre vivre ensemble lancé par les hippies. S’est imposée à moi la nécessité d’établir, de réfléchir à un jeu de contrastes entre les promesses de liberté des Sixties et les nouvelles formes du biopouvoir mondial actuel, les nouveaux dispositifs répressifs qui, sous le signe de TINA (« There Is No Alternative », « il n’y a pas d’alternative » au capitalisme déchaîné, dévastateur des corps, des puissances de pensées, des écosystèmes, de la planète) signent la mort des utopies hippies et tendent de mettre à quia les mouvements alternatifs, les luttes, les propositions d’autres formes de société. Comme je le mentionne ci-dessus, le nouage entre documentation et fiction est placé sous le signe de la liberté : à partir d’une fidélité à la matière historique, aux faits, aux données biographiques, politiques, je lance mon imaginaire qui a peut-être besoin, pour ne pas s’hyperboliser, de se resserrer sur un ancrage précis, de se donner un périmètre. Le choix de partir d’Edie Sedgwick, Marilyn, Unica Zürn, Janis Joplin… me permet aussi un jeu quasi-borgésien de masques, de mixer, au sens musical du terme, des pans de mes sensations, de mes obsessions, de mes fêlures aux voix des personnages, de brouiller les frontières entre autofiction, biofiction, exofiction. D’illimiter le « je » (celui de Janis Joplin, de l’auteure…) par son évanouissement dans une matière langagière où il n’y a plus de propre.
Emmanuèle Jawad : Des sections intitulées « interludes », graphiquement marquées (en italique), s’insèrent dans le récit proposant une approche plus précise du contexte social, politique, historique dans lequel a vécu Janis Joplin. Quel est le statut précisément de ces différents interludes entrant dans la composition ? Comment la construction du livre s’est-elle effectuée ?
Véronique Bergen : La partition du livre s’est imposée d’emblée au niveau de sa construction : alterner les voix de Janis Joplin, la mise en fiction de sa vie, de ses rencontres, de ses espoirs, de ses dévastations, de son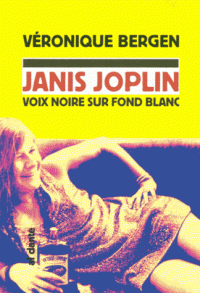 manque abyssal, de sa voix noire, de sa faim d’intensités vitales, de ses pulsions destructrices avec des interludes rompant la fiction, où montent les voix de la guerre du Vietnam, de l’héroïne, de Jim Morrison, des guitares électriques, des écrivains de la Beat Generation, des punks, des personnages des romans qui fascinaient Janis… Non pas à proprement parler un opéra rock, non pas une cathédrale psychédélique mais un agencement vocal qui soit comme la lanterne magique de La Recherche : proposant les facettes du cristal des Sixties, de la contre-culture, disposant une descente dans le monde des sensations, des lignes de faille (privées, publiques, cosmiques), une exploration de tous les funambulismes, des régions des excès où, l’air se raréfiant, la griserie déferle. Au niveau du contenu comme de la forme, je ne puis expérimenter que ce qui se déterritorialise, ce qui danse sur les crêtes, ce qui sort des rails, ce qui trace des lignes de fuite qui font fuir l’ordre aliénant, qui dynamitent le conformisme.
manque abyssal, de sa voix noire, de sa faim d’intensités vitales, de ses pulsions destructrices avec des interludes rompant la fiction, où montent les voix de la guerre du Vietnam, de l’héroïne, de Jim Morrison, des guitares électriques, des écrivains de la Beat Generation, des punks, des personnages des romans qui fascinaient Janis… Non pas à proprement parler un opéra rock, non pas une cathédrale psychédélique mais un agencement vocal qui soit comme la lanterne magique de La Recherche : proposant les facettes du cristal des Sixties, de la contre-culture, disposant une descente dans le monde des sensations, des lignes de faille (privées, publiques, cosmiques), une exploration de tous les funambulismes, des régions des excès où, l’air se raréfiant, la griserie déferle. Au niveau du contenu comme de la forme, je ne puis expérimenter que ce qui se déterritorialise, ce qui danse sur les crêtes, ce qui sort des rails, ce qui trace des lignes de fuite qui font fuir l’ordre aliénant, qui dynamitent le conformisme.
Emmanuèle Jawad : La voix de Janis Joplin est qualifiée de « militante, politique, aphrodisiaque, chamanique » (p. 87). Aussi dans l’avancement du livre « j’ai ouvert dans un monde d’hommes une place pour les femmes, une autre manière de chanter ». Pour faire lien avec notre précédent entretien (cycle « création et politique »), ce livre Janis Joplin couvre-t-il des enjeux politiques ? D’autre part, quels sont tes projets d’écriture ?
Véronique Bergen : L’acte d’écriture tel que je le pose et le vis est porteur d’un enjeu politique. Un enjeu de résistance, d’insistance des luttes comme le dit Dork Zabunyan, de contre-pouvoir, de sécrétion de lignes d’indiscipline, de transversalité, de lignes de fuite minant, à leur très modeste échelle, le Léviathan, le système broyant nos puissances de vie. Le geste est politique dans son désir d’opposer un contre-feu. Parmi mes projets d’écriture, un essai sur Horses de Patti Smith qui sortira dans la collection Discogonie des Éditions Densités. Au printemps 2017, je sors un essai sur Hélène Cixous, Hélène Cixous. La langue plus-que-vive aux Éd. Honoré Champion et un essai sur Visconti, Luchino Visconti. Les promesses du crépuscule aux Éditions Impressions nouvelles. J’espère que le livre Gang blues ecchymoses, composé de mes textes poétiques et des sidérantes photos de Sadie von Paris verra le jour également au printemps, je lance ici un appel à tous les amis, donateurs, aficionados de l’art de Sadie von Paris, de mes textes afin que le livre voie le jour…
Je suis plongée dans une fiction romanesque dont je préfère ne rien dire, viens de terminer un roman autour de la Renaissance italienne et j’entame un recueil poétique. Je vais peut-être peaufiner, revoir quelques romans inédits .jpg) qui montent la garde dans mes tiroirs. Laisser aussi à jamais inédits bon nombre de fictions, de recueils de poèmes, de textes divers achevés. Ne pas les faire circuler dans un monde où l’excroissance des informations, leur médiatisation, leur publicité les égalise dans un « inférieur clapotis quelconque ». L’opération de soustraction par rapport à une époque dopée à la multiplication métastasique et frappée d’idiotie me requiert de plus en plus. Il est devenu de plus en plus difficile de croire en l’espace littéraire au sens d’accorder une valeur au geste de publier. Il y a une schize entre l’urgence de créer, d’écrire qui m’habite, qui ne fait qu’un avec mon existence, et le monde du dehors, l’espace public, l’échiquier de la production-consommation des biens (livres, etc.). Le geste de publier me paraît de plus en plus problématique. Au niveau de sa place. De ses puissances dans un monde régi par le non-esprit d’une centrifugeuse-broyeuse. Écume de surface, clapotis médiocre d’egos bouffis, miroirs de vanités, jeu de dupes, abdication et règne de la littérature-marketing, de la non-littérature produite par les histrions de service composent le visage dominant du présent. Mais je conserve aussi la confiance en une « littérature mineure », séditieuse, inventive, en des passeurs de créations sauvages, en des communautés de lecteurs, en des archipels d’écritures, d’éditeurs exploratoires, de pensées, de musiques, d’événements qui font barrage à la ruine. Je rêve de livres qui déferlent comme des forêts en marche. Au clan des capitaines de navires prenant un aquarium pour un océan, à côté des écrivains-Ulysse qui, se bouchant les oreilles de cire afin de ne pas entendre le chant des sirènes, ne prennent aucun risque esthétique, existentiel, il y a le clan frère de Boutès comme l’a écrit Pascal Quignard (dans Boutès), ceux qui plongent, sautent au milieu de flots, pour rejoindre les sirènes, sans jamais les domestiquer, laissant les filles-fleurs à leurs danses échevelées.
qui montent la garde dans mes tiroirs. Laisser aussi à jamais inédits bon nombre de fictions, de recueils de poèmes, de textes divers achevés. Ne pas les faire circuler dans un monde où l’excroissance des informations, leur médiatisation, leur publicité les égalise dans un « inférieur clapotis quelconque ». L’opération de soustraction par rapport à une époque dopée à la multiplication métastasique et frappée d’idiotie me requiert de plus en plus. Il est devenu de plus en plus difficile de croire en l’espace littéraire au sens d’accorder une valeur au geste de publier. Il y a une schize entre l’urgence de créer, d’écrire qui m’habite, qui ne fait qu’un avec mon existence, et le monde du dehors, l’espace public, l’échiquier de la production-consommation des biens (livres, etc.). Le geste de publier me paraît de plus en plus problématique. Au niveau de sa place. De ses puissances dans un monde régi par le non-esprit d’une centrifugeuse-broyeuse. Écume de surface, clapotis médiocre d’egos bouffis, miroirs de vanités, jeu de dupes, abdication et règne de la littérature-marketing, de la non-littérature produite par les histrions de service composent le visage dominant du présent. Mais je conserve aussi la confiance en une « littérature mineure », séditieuse, inventive, en des passeurs de créations sauvages, en des communautés de lecteurs, en des archipels d’écritures, d’éditeurs exploratoires, de pensées, de musiques, d’événements qui font barrage à la ruine. Je rêve de livres qui déferlent comme des forêts en marche. Au clan des capitaines de navires prenant un aquarium pour un océan, à côté des écrivains-Ulysse qui, se bouchant les oreilles de cire afin de ne pas entendre le chant des sirènes, ne prennent aucun risque esthétique, existentiel, il y a le clan frère de Boutès comme l’a écrit Pascal Quignard (dans Boutès), ceux qui plongent, sautent au milieu de flots, pour rejoindre les sirènes, sans jamais les domestiquer, laissant les filles-fleurs à leurs danses échevelées.
![[Entretien] À propos de Janis Joplin, entretien de Véronique Bergen avec Emmanuèle Jawad (2/2)](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2017/01/BergenposeBackG.jpg)
![[Entretien] À propos de Janis Joplin, entretien de Véronique Bergen avec Emmanuèle Jawad (2/2)](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2017/01/band-Joplin1.jpg)