Nous sommes très heureux de reprendre ce work in progress que constitue le dossier consacré à un écrivain majeur d’aujourd’hui, Jean-Michel Espitallier : la chronique sur la réédition de Caisse à outils séparera les deux parties de ce long entretien exclusif/explosif. [Lire Libr-Java 7]
FT. Jean-Michel, qu’est-ce qui fait courir Espitallier ? Pas vraiment l’amour du sport, ça on l’a compris…
JME. Pas vraiment l’amour du sport, mais au fond, le sujet de mes livres, ça n’est pas le sujet. Je souscris pleinement à ce qu’écrit Valéry à propos de l’intention : « C’est l’intention de faire qui a voulu ce que j’ai dit. » Le  sujet, ce serait l’intention. Ce désir de faire. Voire de faire quelque chose. Après seulement vient la question du sens et le travail sur la matière qui fait partir le livre, et le fait toujours partir un peu ailleurs. L’Invention de la course à pied fut d’abord une commande de Laurent Cauwet pour la collection d’architecture que dirigeait Rudy Ricciotti chez Al Dante. Il s’agissait d’écrire sur un stade de foot… Un stade de foot ? Bigre ! Bon, allons-y ! Écrire avec un motif mais contre toute empathie naturelle, pour éviter d’égarer l’intensité de l’écriture, de l’émietter. Et aussi parce qu’un sujet imposé, par soi ou par d’autres, donne la liberté de procéder plus explicitement à des figures telles que le hors sujet, la digression, le quiproquo, la parodie, le détournement, etc., de jouer avec les poncifs, les jargons, les approximations, les paresses qui font sens en ratant la cible, en tournant autour du pot, en tournant à contre-sens. Alors j’ai écrit cette histoire de la course à pied avec une sorte de désinvolture pilotée par un certain nombre de figures qui constituent mon écriture : énumérations, syllogismes, prose énergumène, etc. La contrainte, voilà le sujet, le point d’appui de l’écriture. Un peu comme au saut à la perche ! Elle permet de se débarrasser de ce quelque chose à dire et libère l’intention. Il ne reste plus qu’à ajuster l’écriture et, du coup, le sujet de l’écriture devient l’écriture elle-même, dans ce cadre préétabli qu’est le sujet. On y gagne en liberté. Finalement, quand on tient le sujet à distance, lorsqu’il importe peu, on se sent très libre et on peut s’attaquer au vrai, au seul sujet qui compte pour un écrivain et qui est la question de la langue, de sa position par rapport à la langue. Faire parler la langue, l’explorer, l’exploser et lui rentrer dans le lard. Dans cette liberté gagnée par la contrainte, il s’agit alors de resserrer les boulons pour créer ses propres règles et faire voler l’engin. « Il faut chercher la discipline dans la liberté », nous dit le Monsieur Croche de Claude Debussy.
sujet, ce serait l’intention. Ce désir de faire. Voire de faire quelque chose. Après seulement vient la question du sens et le travail sur la matière qui fait partir le livre, et le fait toujours partir un peu ailleurs. L’Invention de la course à pied fut d’abord une commande de Laurent Cauwet pour la collection d’architecture que dirigeait Rudy Ricciotti chez Al Dante. Il s’agissait d’écrire sur un stade de foot… Un stade de foot ? Bigre ! Bon, allons-y ! Écrire avec un motif mais contre toute empathie naturelle, pour éviter d’égarer l’intensité de l’écriture, de l’émietter. Et aussi parce qu’un sujet imposé, par soi ou par d’autres, donne la liberté de procéder plus explicitement à des figures telles que le hors sujet, la digression, le quiproquo, la parodie, le détournement, etc., de jouer avec les poncifs, les jargons, les approximations, les paresses qui font sens en ratant la cible, en tournant autour du pot, en tournant à contre-sens. Alors j’ai écrit cette histoire de la course à pied avec une sorte de désinvolture pilotée par un certain nombre de figures qui constituent mon écriture : énumérations, syllogismes, prose énergumène, etc. La contrainte, voilà le sujet, le point d’appui de l’écriture. Un peu comme au saut à la perche ! Elle permet de se débarrasser de ce quelque chose à dire et libère l’intention. Il ne reste plus qu’à ajuster l’écriture et, du coup, le sujet de l’écriture devient l’écriture elle-même, dans ce cadre préétabli qu’est le sujet. On y gagne en liberté. Finalement, quand on tient le sujet à distance, lorsqu’il importe peu, on se sent très libre et on peut s’attaquer au vrai, au seul sujet qui compte pour un écrivain et qui est la question de la langue, de sa position par rapport à la langue. Faire parler la langue, l’explorer, l’exploser et lui rentrer dans le lard. Dans cette liberté gagnée par la contrainte, il s’agit alors de resserrer les boulons pour créer ses propres règles et faire voler l’engin. « Il faut chercher la discipline dans la liberté », nous dit le Monsieur Croche de Claude Debussy.
Je n’écris pas pour donner du sens ni faire sauter des points de résistance, je cherche à installer des conditions de langue propices à activer cette énergie signifiante. Voilà pourquoi, en ce qui me concerne, j’essaie de créer ce que Ponge appelle des « clefs de tension ». Parce qu’il faut tenter de s’approcher au plus près de ce que l’on veut dire, ou de cette intention de dire, tout en restant à distance. La distance est le territoire du désir mais aussi de la crainte. Elle génère donc une tension. J’ai aussi beaucoup observé les dispositifs logiques et déductifs chez Wittgenstein, et j’en ai importé parfois dans mon écriture cette rigueur dure que je surchauffe – et pas seulement dans une intention parodique –, pour aller autre part dans mon expérience de la langue, la recharger et monter le voltage.
Deleuze dit que « le créateur ne fait que ce dont il a absolument besoin ». De quoi ai-je absolument besoin ? D’y voir plus clair, de me retrouver, d’atteindre quelque chose, d’ordonner un peu mon chaos, de me mettre en travers des discours dominants-décérébrants, de réenchanter la langue, au besoin avec du désenchanté, de donner corps à mes révoltes, et en même temps d’obscurcir la ligne d’horizon pour réactiver le champ des possibles. Partir « trafiquer dans l’inconnu », comme écrivait Rimbaud au Harar. De quoi ai-je absolument besoin ? D’avoir besoin. D’avoir besoin de ce besoin. Voilà mon moteur !
possibles. Partir « trafiquer dans l’inconnu », comme écrivait Rimbaud au Harar. De quoi ai-je absolument besoin ? D’avoir besoin. D’avoir besoin de ce besoin. Voilà mon moteur !
Ce qui me fait courir, c’est ce moment de grâce quand, au cours du travail, quelque chose tout à coup se met à marcher. Se met à parler. À montrer quelque chose qui n’était pas montrable, que l’on ne pouvait montrer, que l’on ne savait pas que l’on pouvait montrer. Ce qui rend universel, c’est-à-dire nécessaire, une œuvre, c’est quand cette chose enfin montrée s’impose, naturellement, et devient instantanément irremplaçable. Appelons ça le syndrome inspecteur Bourrel : « Mais c’est bien sûr ! » Louis Zukofsky définit la poésie comme cet instant où, « soudain, on voit quelque chose ». Une épiphanie. Ce moment de grâce est toujours le fruit d’assemblages et d’agencements. L’écriture, le style, c’est du montage, un jeu de permutations, de logique, de construction. Je me définis volontiers comme un bricoleur. J’assemble, j’essaie des trucs, je dispose, je récupère des bouts de choses, je fais sonner, je me fabrique un nouvel outil, je tente des techniques maison en gardant quand même un œil sur le mode d’emploi, etc. Et soudain, quelque chose se dit qui était précisément ce que je cherchais à dire sans le savoir. « L’intention de faire qui a voulu ce que j’ai dit. »
C’est très comparable à la composition musicale. En plus de jouer de la batterie, j’adore jouer du piano, j’ai fait un peu de piano quand j’étais jeune mais disons plutôt que je pianote. J’aime bien essayer des trucs,  harmonies, disharmonies, accords dissonants, variations tonales / atonales, jeux sur les intervalles, arythmies, etc. Et voilà que, tout à coup, deux accords s’imposent dans leur majesté ou au contraire leur dissonance agressive. Prenons la quarte augmentée (do-fa#, do#-sol, ré-sol#, etc.), le fameux triton, qui donne une couleur si particulière, l’intervalle dissonant par excellence. Je vais opérer diverses manipulations sur cet intervalle, essayer de l’aggraver, de l’exagérer, chercher à comprendre pourquoi il est si peu agréable à l’oreille, en quoi d’ailleurs est-il désagréable, l’est-il vraiment (le triton, autrement appelé diabolus in musica, était proscrit par l’Église dans la composition musicale jusqu’à l’âge baroque ! Pour dire aussi ce que les formes peuvent mettre en jeu), etc. Ou bien je plaque un accord parfait que je tente de fêler en ajoutant un demi-ton par-ci, une ou deux notes dissonantes par-là, et j’écoute ce que ça produit. Ça raconte toujours quelque chose. Ces manipulations peuvent produire des effets très inattendus. Parfois c’est nul et non avenu, parfois c’est très puissant. On tombe sur quelque chose qui paraît tout à fait neuf à l’oreille, très juste dans sa proposition harmonique, avec des effets très divers : étranges, dramatiques, comiques, ridicules, etc. Eh bien, c’est tout à fait comparable à l’écriture. Soudain, un énoncé se met à sonner avec une grande singularité, uniquement parce que j’ai fait permuter un nom et un adjectif, ou ajouté un adverbe, ou changé la position d’un mot, ou coupé une phrase en deux, etc. C’est du montage. Du cadrage. Et voilà qu’une simple permutation se met à raconter quelque chose différemment, parfois avec une grande précision, une grande finesse, et à raconter quelque chose qui ne pouvait se raconter autrement. Ce « mathématiquement exact[e] » dont parle Baudelaire. On a l’impression que l’énoncé, dans sa singularité, son timbre, vient de rencontrer ce pourquoi il était fait. Ou plutôt qu’une chose était en attente de son énoncé pour la formuler. Céline dit qu’écrire c’est simplement nettoyer une médaille cachée enfouie dans la glaise. Comme du sens préexistant à toute intention de le dévoiler. Chercher dans le fouillis des langues les pièces d’une sorte de maquette à construire soi-même. Aller à la pêche ! En réalité, c’est la langue qui donne du sens au réel. Je veux dire que c’est une situation grammaticale donnée qui produit une situation sémantique inédite et donc un petit territoire inédit du réel. Même s’il faut parfois garder le silence pour lui donner tout son sens. Histoire sans parole. En tout cas, cette attention au style comme vecteur de sens ou d’effets de sens est peut-être l’autre nom de la poésie, qui réinvestit alors son vieux sens d’un faire. Il ne s’agit pas de faire du style pour faire du style. Il s’agit de faire parler la langue. Trouver son style c’est
harmonies, disharmonies, accords dissonants, variations tonales / atonales, jeux sur les intervalles, arythmies, etc. Et voilà que, tout à coup, deux accords s’imposent dans leur majesté ou au contraire leur dissonance agressive. Prenons la quarte augmentée (do-fa#, do#-sol, ré-sol#, etc.), le fameux triton, qui donne une couleur si particulière, l’intervalle dissonant par excellence. Je vais opérer diverses manipulations sur cet intervalle, essayer de l’aggraver, de l’exagérer, chercher à comprendre pourquoi il est si peu agréable à l’oreille, en quoi d’ailleurs est-il désagréable, l’est-il vraiment (le triton, autrement appelé diabolus in musica, était proscrit par l’Église dans la composition musicale jusqu’à l’âge baroque ! Pour dire aussi ce que les formes peuvent mettre en jeu), etc. Ou bien je plaque un accord parfait que je tente de fêler en ajoutant un demi-ton par-ci, une ou deux notes dissonantes par-là, et j’écoute ce que ça produit. Ça raconte toujours quelque chose. Ces manipulations peuvent produire des effets très inattendus. Parfois c’est nul et non avenu, parfois c’est très puissant. On tombe sur quelque chose qui paraît tout à fait neuf à l’oreille, très juste dans sa proposition harmonique, avec des effets très divers : étranges, dramatiques, comiques, ridicules, etc. Eh bien, c’est tout à fait comparable à l’écriture. Soudain, un énoncé se met à sonner avec une grande singularité, uniquement parce que j’ai fait permuter un nom et un adjectif, ou ajouté un adverbe, ou changé la position d’un mot, ou coupé une phrase en deux, etc. C’est du montage. Du cadrage. Et voilà qu’une simple permutation se met à raconter quelque chose différemment, parfois avec une grande précision, une grande finesse, et à raconter quelque chose qui ne pouvait se raconter autrement. Ce « mathématiquement exact[e] » dont parle Baudelaire. On a l’impression que l’énoncé, dans sa singularité, son timbre, vient de rencontrer ce pourquoi il était fait. Ou plutôt qu’une chose était en attente de son énoncé pour la formuler. Céline dit qu’écrire c’est simplement nettoyer une médaille cachée enfouie dans la glaise. Comme du sens préexistant à toute intention de le dévoiler. Chercher dans le fouillis des langues les pièces d’une sorte de maquette à construire soi-même. Aller à la pêche ! En réalité, c’est la langue qui donne du sens au réel. Je veux dire que c’est une situation grammaticale donnée qui produit une situation sémantique inédite et donc un petit territoire inédit du réel. Même s’il faut parfois garder le silence pour lui donner tout son sens. Histoire sans parole. En tout cas, cette attention au style comme vecteur de sens ou d’effets de sens est peut-être l’autre nom de la poésie, qui réinvestit alors son vieux sens d’un faire. Il ne s’agit pas de faire du style pour faire du style. Il s’agit de faire parler la langue. Trouver son style c’est s’ajouter à la langue, mettre son grain de sel, ou de sable, dans la machine. La détraquer pour la revitaliser et y tatouer sa propre langue. C’est très ambitieux ce désir de vouloir se transformer en langue, de s’ajouter au monde ou plutôt à ce qui le constitue. Écrire ce serait énoncer quelque chose d’une « certaine façon ». Et donc, de mon point de vue, le travail de l’écrivain doit d’abord consister en cette « certaine façon », à trouver cette « certaine façon », à rentrer en contact avec soi-même et avec le monde en passant par cette « certaine façon ». C’est assez magique, et je crois que, pour revenir à ta question, ce qui me fait courir ce sont ces manipulations physiques sur la langue, ce bonheur très personnel de se trouver subitement sur l’accord parfait, fût-il absolument disharmonique. L’expression parfaite de quelque chose. De quelque chose de la langue. De quelque chose qui n’existait pas jusque-là. Constater que l’opération de montage fait surgir des effets de sens et, très égoïstement, des explications personnelles du monde (au passage, ces explications personnelles du monde me transforment et, comme j’appartiens au monde, elles transforment le monde) et des explications qui ne s’expliquent pas. Il est arrivé à tout le monde au cours d’une lecture d’être percuté par une phrase, quelques mots, etc., et d’en tirer un sentiment de plénitude, un bonheur absolu, quelque chose de complet. Comme avec la musique. Ce sentiment survient de la même manière quand on écrit. Soudain, on est sur la note juste ! Et donc, le sujet importe peu – d’où l’inanité des 3/4 des romans contemporains qui ne sont le plus souvent écrits que pour raconter une histoire en instrumentalisant la langue avec, de-ci de-là, quelques aimables effets de style. Ça tombe des mains. Ce n’est souvent que du reportage sociopsychologique écrit par des Bac + 3.
s’ajouter à la langue, mettre son grain de sel, ou de sable, dans la machine. La détraquer pour la revitaliser et y tatouer sa propre langue. C’est très ambitieux ce désir de vouloir se transformer en langue, de s’ajouter au monde ou plutôt à ce qui le constitue. Écrire ce serait énoncer quelque chose d’une « certaine façon ». Et donc, de mon point de vue, le travail de l’écrivain doit d’abord consister en cette « certaine façon », à trouver cette « certaine façon », à rentrer en contact avec soi-même et avec le monde en passant par cette « certaine façon ». C’est assez magique, et je crois que, pour revenir à ta question, ce qui me fait courir ce sont ces manipulations physiques sur la langue, ce bonheur très personnel de se trouver subitement sur l’accord parfait, fût-il absolument disharmonique. L’expression parfaite de quelque chose. De quelque chose de la langue. De quelque chose qui n’existait pas jusque-là. Constater que l’opération de montage fait surgir des effets de sens et, très égoïstement, des explications personnelles du monde (au passage, ces explications personnelles du monde me transforment et, comme j’appartiens au monde, elles transforment le monde) et des explications qui ne s’expliquent pas. Il est arrivé à tout le monde au cours d’une lecture d’être percuté par une phrase, quelques mots, etc., et d’en tirer un sentiment de plénitude, un bonheur absolu, quelque chose de complet. Comme avec la musique. Ce sentiment survient de la même manière quand on écrit. Soudain, on est sur la note juste ! Et donc, le sujet importe peu – d’où l’inanité des 3/4 des romans contemporains qui ne sont le plus souvent écrits que pour raconter une histoire en instrumentalisant la langue avec, de-ci de-là, quelques aimables effets de style. Ça tombe des mains. Ce n’est souvent que du reportage sociopsychologique écrit par des Bac + 3.
Ce qui remet encore une fois le couvert sur la question des genres et de leurs frontières arbitraires. Il y a des romans qui sont fabriqués dans cette attention à la langue, primordiale, qui sonnent, travaillent la langue, où le récit vient comme un motif, s’entrelace au style, un subtil tressage de ce que ça raconte et de comment ça raconte. Eric Vuillard, François Bon, Annie Ernaux, Jean Echenoz, Eric Chevillard, Céline Minard, pour rester chez les Français, sont de ce côté-là, du côté de ce que l’on peut appeler le style, le phrasé, des constructions narratives singulières ; on peut quasiment les fredonner ! Inversement, il existe aussi une poésie qui ne décolle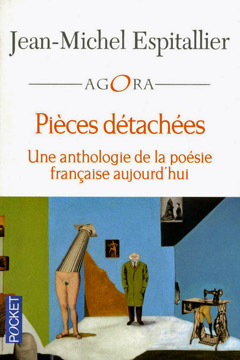 pas du petit exercice de style, de la petite démonstration formelle, assez vaniteuse, en plus, mais sans intérêt, sans muscle, sans nerf, sans proposition, sans vertige, sans rien ! C’est encore pire avec la lecture-performance, terme d’ailleurs un tantinet tautologique. Sauf exception, la lecture-performance est aujourd’hui un peu bloquée dans des postures post-post-ce-que-vous-voudrez (Dada, Beat, Heidsieck, Tarkos, etc.), une pratique d’actionnistes en viennoiseries ou de conceptuels coolos. Un lieu devenu démonstration de force et de supposée audace artistique, de pose qualifiante et d’inscription dans le champ. Chacun y va de son petit truc, c’est généralement très ennuyeux, bouffi de prétention, et le public, qui n’en pense pas moins, écoute sans ciller, un doigt sur la couture mais jure, en douce, et c’est là le problème, qu’on ne l’y prendra plus. La prochaine fois qu’il entendra parler de performance, il s’enfermera chez lui à double tour et il aura peut-être raté Antoine Boute ou Natacha Muslera ! On s’habitue un peu trop aux choses tiédasses, surjouées, dans ce milieu. On ne fait pas de l’expérimental parce qu’on lirait ses textes en gardant une jambe en l’air. Moi j’ai besoin qu’une œuvre me malmène, m’émerveille, me contrarie, me rende profondément heureux, violemment triste ou archidéboussolé. Il n’est que de voir les grands performeurs dont les actions nous sont immédiatement nécessaires, je pense au grand Joël Hubaut, aux pièces sonores d’Anne-James Chaton, aux performances de Charles Pennequin ou de Jérôme Game, aux lectures discrètement chorégraphiées de Gwenaëlle Stubbe qui font exploser dès les premiers tours de roue les petites mises en scène indigentes-indigestes qui pullulent dans cet univers. Bref, aucun genre, aucun geste artistique n’est automatiquement qualifiant. Ce serait trop simple ! Pour redire que cette question des genres et des catégories ne marche jamais ! En tout cas telle qu’on la pose généralement.
pas du petit exercice de style, de la petite démonstration formelle, assez vaniteuse, en plus, mais sans intérêt, sans muscle, sans nerf, sans proposition, sans vertige, sans rien ! C’est encore pire avec la lecture-performance, terme d’ailleurs un tantinet tautologique. Sauf exception, la lecture-performance est aujourd’hui un peu bloquée dans des postures post-post-ce-que-vous-voudrez (Dada, Beat, Heidsieck, Tarkos, etc.), une pratique d’actionnistes en viennoiseries ou de conceptuels coolos. Un lieu devenu démonstration de force et de supposée audace artistique, de pose qualifiante et d’inscription dans le champ. Chacun y va de son petit truc, c’est généralement très ennuyeux, bouffi de prétention, et le public, qui n’en pense pas moins, écoute sans ciller, un doigt sur la couture mais jure, en douce, et c’est là le problème, qu’on ne l’y prendra plus. La prochaine fois qu’il entendra parler de performance, il s’enfermera chez lui à double tour et il aura peut-être raté Antoine Boute ou Natacha Muslera ! On s’habitue un peu trop aux choses tiédasses, surjouées, dans ce milieu. On ne fait pas de l’expérimental parce qu’on lirait ses textes en gardant une jambe en l’air. Moi j’ai besoin qu’une œuvre me malmène, m’émerveille, me contrarie, me rende profondément heureux, violemment triste ou archidéboussolé. Il n’est que de voir les grands performeurs dont les actions nous sont immédiatement nécessaires, je pense au grand Joël Hubaut, aux pièces sonores d’Anne-James Chaton, aux performances de Charles Pennequin ou de Jérôme Game, aux lectures discrètement chorégraphiées de Gwenaëlle Stubbe qui font exploser dès les premiers tours de roue les petites mises en scène indigentes-indigestes qui pullulent dans cet univers. Bref, aucun genre, aucun geste artistique n’est automatiquement qualifiant. Ce serait trop simple ! Pour redire que cette question des genres et des catégories ne marche jamais ! En tout cas telle qu’on la pose généralement.
Qu’est-ce qui me fait courir ? Ce serait de tenter de m’expliquer pourquoi je cours ! J’écris aussi pour tuer le temps, comme tout le monde ! Inventer des stratégies pour ça, pour me faire croire que j’en aurais la possibilité ! Écrire pour fixer une inquiétude, l’identifier pour la mettre à distance en lui donnant langue. Et aussi, la court-circuiter, la purger, lui coller un nez rouge.
Qu’est-ce qui me fait courir ? Ce serait, j’y reviens, de chercher et de chercher l’objet perdu, comme le fétichiste ou le collectionneur, chercher à rechercher, d’où, sans doute, mon goût pour les listes. Cet objet perdu l’est à jamais – c’est ce qui compte ! – mais c’est là aussi un motif pour mettre en route l’intention de la foreuse, du détecteur et du radar.
FT. Eh, dis donc, tu viens de me faire une réponse de marathonien – un peu guerrier, tout de même, vu les quelques flèches dans ton carquois !
Entre ton Invention de la course à pied et ton précédent livre, beaucoup plus volumineux, De la célébrité, il y a un lien évident…
JME. Le lien évident serait, pardon pour ce truisme, qu’ils ont le même auteur, en même temps que ces deux livres n’ont pas été écrits, réalisés, pensés, conçus, désirés au même moment. De livre en livre, on retrouve les mêmes outils, les mêmes préoccupations formelles mais aussi éthiques, thématiques, politiques, et les mêmes fascinations, et les mêmes peurs, et les mêmes doutes. En réalité, écrire un nouveau livre, m’embarquer dans cette aventure est toujours pour moi un moyen d’expérimenter quelque chose de nouveau. Chaque livre génère son mode de fabrication. Je suis toujours très excité de savoir que, à l’orée d’un nouveau livre, quelque chose d’inédit va se jouer, un espace vierge s’offre à l’exploration, une nouvelle boîte à outils est en train de s’ouvrir dans laquelle je vais devoir choisir. Tout est possible, on rebat les cartes. Et en même temps, quel que soit le motif du livre, mes obsessions, mon univers, mes techniques finissent toujours par me rattraper. On n’échappe pas à qui on est. De la célébrité rejoue et réinvente mes régimes d’écriture ; il est aussi une sorte de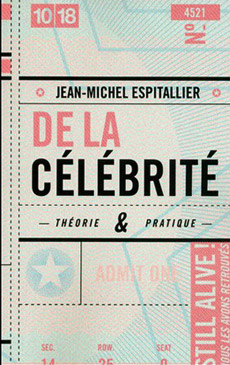 prolongement théorique de mon Syd Barrett qui abordait déjà les questions du star system, de la fascination qu’engendrent les rock stars et les idoles, du statut du fan, personnage éminemment postmoderne, et bien sûr de la disparition, de l’effacement. Cette question de l’effacement qui semble me travailler a été une découverte. Je me suis rendu compte que ça revenait sous différentes formes, de livre en livre. Pour dire qu’écrire est aussi un outil de connaissance de soi.
prolongement théorique de mon Syd Barrett qui abordait déjà les questions du star system, de la fascination qu’engendrent les rock stars et les idoles, du statut du fan, personnage éminemment postmoderne, et bien sûr de la disparition, de l’effacement. Cette question de l’effacement qui semble me travailler a été une découverte. Je me suis rendu compte que ça revenait sous différentes formes, de livre en livre. Pour dire qu’écrire est aussi un outil de connaissance de soi.
Il y a autre chose. J’ai souvent l’impression que mes livres font diversion au livre disons essentiel et tellement essentiel que trop grand pour moi, au grand livre que je rêve d’écrire. Comme si tous mes livres n’en étaient que les phases préparatoires. Je continuerais donc d’écrire des livres qui diffèrent chaque fois l’instant où je me mettrais (conditionnel !) au livre essentiel qui serait le livre, le seul livre que je devrais écrire et que je n’écrirai pas… Un travail d’approche pour rester à distance ! Comme si je tournais autour du pot. Comme si certaines zones du réel résistaient à se faire attaquer par ma langue, par intimidation, peut-être. Finalement, ne pas écrire ce livre-là est peut-être un moyen de ne pas avoir à faire le triste constat d’une impossibilité de dire. Alors, j’écris peut-être ceci pour ne pas avoir à écrire cela. J’écris peut-être pour ne pas avoir à ne pas écrire.
Je n’ai pas envie d’écrire des livres qui se ressemblent, ça n’est pas programmatique, ça vient naturellement, même si je me retrouve, dans tous mes livres. Il me semble que je n’écris qu’un seul livre, jamais le même mais toujours une suite du livre précédent. Parce qu’il arrive un moment où il faut bien l’arrêter. Chaque livre est donc toujours un livre inachevé. « Tout au plus fait-il semblant » d’avoir un début et une fin, comme dit Mallarmé. J’essaie peut-être de poursuivre, de corriger et d’achever ce livre-ci en commençant un autre livre qui restera lui-même inachevé, etc. C’est un moyen d’éprouver le temps. C’est peut-être aussi une façon d’éprouver l’expérience de la mort, de la différer en se faisant croire que rien n’est jamais fini. L’inachevé donne rendez-vous, alors que la fin donne congé. C’est mon analyse, elle vaut ce qu’elle vaut ! Comme les Détails d’Opalka, cette suite numérique qui ne s’arrêta qu’à la mort d’Opalka. Mais en définitive, revanche sur la mort puisque c’est la mort d’Opalka qui continue son œuvre en l’achevant sans fin et la constitue en objet fini, infiniment fini !
FT. Le monde défile derrière une mire / et dans les graduations de ta lunette de tir… Ce clin d’œil à Army nous fournit assurément un outil pour définir ton travail : variant les angles de tir, tu réussis à faire entrer progressivement dans ton champ différentes cibles sociales (poétique, musicale, militaire, médiatique, et plus largement spectaculaire)…
JME. Je m’ennuie assez vite. En même temps, je suis têtu comme une mule, obsessionnel. Voilà pourquoi je suis toujours sur plusieurs chantiers à la fois. Je passe de l’un à l’autre. Question d’énergie. Je n’aurais pu écrire plusieurs livres avec un même mode opératoire. Je suis assez admiratif des auteurs qui écrivent toujours dans le même univers linguistique, je pense à Valère Novarina, par exemple, ou à Jacques Sivan. Moi je ne peux pas faire ça, je ne sais pas faire ça, même si, bien sûr, je suis pris dans mon propre univers, mon propre style, etc. Je suis plutôt un écrivain à traçabilité aléatoire… Je suis comme ça dans ma vie aussi ! Une foule de choses me  passionnent et j’ai souvent le désir d’écrire avec ces passions. En tout cas, elles me percutent, me stimulent, m’électrisent. Dès Pont de frappes, mon premier livre, on trouve des listes, des énumérations, une rêverie sur le langage, une inquiétude, de l’autodérision, des effets parodiques, comiques, mélancoliques, etc. Et mon dernier livre à ce jour, Un rivet à Tanger, formellement très différent puisqu’il s’agit de cut-up, fait apparaître à peu près ces mêmes préoccupations. J’ai besoin de faire varier les plaisirs et, pour reprendre ton terme, de changer les cibles. Mais au fond, comme je disais tout à l’heure, on est toujours rattrapé par soi-même. En ce moment, je travaille sur l’histoire de mon grand-père qui était cow-boy en Californie. Je ne sais pas où ça ira. C’est assez loin, formellement, de mes autres livres et pourtant je vois remonter sur la page tout ce qui constitue mon univers stylistique. C’est encore un motif pour travailler la langue, pour me fondre dans cette chose-là. On écrit d’abord pour soi. Or, si, écrivant pour soi, on donne à lire quelque chose qui peut parler aux autres, alors on fait de la littérature.
passionnent et j’ai souvent le désir d’écrire avec ces passions. En tout cas, elles me percutent, me stimulent, m’électrisent. Dès Pont de frappes, mon premier livre, on trouve des listes, des énumérations, une rêverie sur le langage, une inquiétude, de l’autodérision, des effets parodiques, comiques, mélancoliques, etc. Et mon dernier livre à ce jour, Un rivet à Tanger, formellement très différent puisqu’il s’agit de cut-up, fait apparaître à peu près ces mêmes préoccupations. J’ai besoin de faire varier les plaisirs et, pour reprendre ton terme, de changer les cibles. Mais au fond, comme je disais tout à l’heure, on est toujours rattrapé par soi-même. En ce moment, je travaille sur l’histoire de mon grand-père qui était cow-boy en Californie. Je ne sais pas où ça ira. C’est assez loin, formellement, de mes autres livres et pourtant je vois remonter sur la page tout ce qui constitue mon univers stylistique. C’est encore un motif pour travailler la langue, pour me fondre dans cette chose-là. On écrit d’abord pour soi. Or, si, écrivant pour soi, on donne à lire quelque chose qui peut parler aux autres, alors on fait de la littérature.
FT. Ce travail de déconstruction s’explique par ton horizon premier : littéraire et musical…
JME. En fait j’ai toujours voulu être écrivain ou musicien (ou conducteur de locomotives !), pour moi, il n’y avait pas d’autres choix. Quand j’étais petit, j’avais besoin de passer par la fiction pour m’approprier le réel, il me fallait la reproduction pour m’intéresser à l’original. Par exemple, pour m’intéresser aux montagnes de ma région, lesquelles ne me faisaient pas du tout rêver, j’avais besoin d’aller d’abord regarder des cartes IGN et je 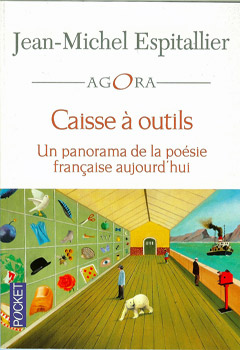 rêvassais sur les toponymes et les étranges dessins des courbes de niveau. Il y a là-bas des noms absolument merveilleux, très étranges : Chaude-Oreille, Cornille, Soleil-Bœuf, la Malune, etc. Ensuite seulement je trouvais de l’intérêt à aller voir sur place – pour vérifier quoi ? si le langage tenait ses promesses ? Si le rêve valait la peine d’être réalisé ? – et ça rendait le monde magnifique. C’est un peu du même ordre que l’« artialisation » chère à Alain Roger, cette perception du paysage déterminée par les reproductions qu’on en a. La chose à évaluer devenant la chose qui évalue. Bref, j’ai toujours eu ce rapport linguistique et fictionnel au réel.
rêvassais sur les toponymes et les étranges dessins des courbes de niveau. Il y a là-bas des noms absolument merveilleux, très étranges : Chaude-Oreille, Cornille, Soleil-Bœuf, la Malune, etc. Ensuite seulement je trouvais de l’intérêt à aller voir sur place – pour vérifier quoi ? si le langage tenait ses promesses ? Si le rêve valait la peine d’être réalisé ? – et ça rendait le monde magnifique. C’est un peu du même ordre que l’« artialisation » chère à Alain Roger, cette perception du paysage déterminée par les reproductions qu’on en a. La chose à évaluer devenant la chose qui évalue. Bref, j’ai toujours eu ce rapport linguistique et fictionnel au réel.
Pour la musique, je cherchais depuis longtemps comment connecter la batterie avec la littérature mais je ne trouvais pas, je ne sentais pas de nécessité fondamentale et je n’avais pas envie de faire pour faire. Et puis j’ai eu une commande d’une pièce sonore, à Marseille, en 2006, dans le cadre du projet Vox Hôtel initié par Jean-Paul Curnier (nous étions une petite dizaine d’écrivains poètes, Sivan, Maestri, Quintane, Fiat, etc.). J’ai alors demandé à disposer d’une batterie et j’ai essayé des trucs, sur place, en studio, avec des bouts de textes, etc. Je n’avais pas vraiment d’idée mais beaucoup de désirs – c’est mieux ! –, et tout à coup, quelque chose s’est mis à marcher. Ce sont deux énergies très différentes, et à un moment, elles se sont rencontrées, parfois pour se contrarier, se contredire, s’écrire l’une sur l’autre et emmener le tout ailleurs. Ça a donné Autobiographie. Et puis, la batterie m’a permis aussi de m’éloigner un peu de la poésie en remontant sur scène pour faire du rock, pendant quatre ans, avec le groupe Prexley. Ce fut une expérience exaltante qui m’a beaucoup apporté aussi dans mon rapport à l’écriture et à la scène. Je n’ai plus lâché les baguettes depuis, pièces sonores et collaborations diverses, avec le bassiste Kasper Toeplitz, par exemple, ou le poète Jérôme Game.
J’avoue que j’ai été infiniment partie prenante de cette histoire de poésie contemporaine dans les années 1990 et 2000, notamment avec Java et Pièces détachées, un peu malgré moi, d’ailleurs, mais je m’en suis éloigné 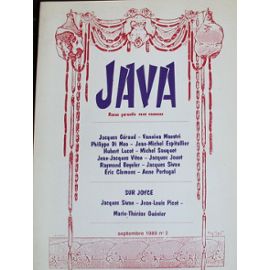 après la parution de Caisse à outils en 2006, année qui correspond à mon retour au rock. Caisse à outils a liquidé cette histoire personnelle, ce moment de ma vie. Pour moi, la poésie est d’abord une position politique. Je dis ça sans trémolo dans la voix. Je le vis ainsi surtout depuis que j’ai quitté mon emploi pour me consacrer exclusivement à l’écriture, au printemps 2002, et donc refuser un certain mode de vie, ce confort un peu anesthésiant en même temps que cette brutalité du monde du travail – et aussi pour ne plus avoir à me taper les récits de vacances radicalement ennuyeux des voisins de bureau, ce qui pompe beaucoup d’énergie ! Je ne dis pas qu’il faille quitter son travail pour écrire, mais pour moi c’était ce qui me convenait. Deleuze dit qu’être de gauche, c’est être minoritaire. Eh bien, écrire, et écrire des choses qui s’apparentent à de la poésie, c’est d’abord être minoritaire, se placer dans une minorité. C’est donc une position éminemment politique. Je crois qu’on ne peut pas comprendre la poésie, comme champ, mais aussi comme engagement éthique et esthétique, si l’on ne comprend pas ça.
après la parution de Caisse à outils en 2006, année qui correspond à mon retour au rock. Caisse à outils a liquidé cette histoire personnelle, ce moment de ma vie. Pour moi, la poésie est d’abord une position politique. Je dis ça sans trémolo dans la voix. Je le vis ainsi surtout depuis que j’ai quitté mon emploi pour me consacrer exclusivement à l’écriture, au printemps 2002, et donc refuser un certain mode de vie, ce confort un peu anesthésiant en même temps que cette brutalité du monde du travail – et aussi pour ne plus avoir à me taper les récits de vacances radicalement ennuyeux des voisins de bureau, ce qui pompe beaucoup d’énergie ! Je ne dis pas qu’il faille quitter son travail pour écrire, mais pour moi c’était ce qui me convenait. Deleuze dit qu’être de gauche, c’est être minoritaire. Eh bien, écrire, et écrire des choses qui s’apparentent à de la poésie, c’est d’abord être minoritaire, se placer dans une minorité. C’est donc une position éminemment politique. Je crois qu’on ne peut pas comprendre la poésie, comme champ, mais aussi comme engagement éthique et esthétique, si l’on ne comprend pas ça.
![[Entretien] Espitallier : libr-Java (1/2) [Libr-Java 8]](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2014/05/SpitbatterieBackG.jpg)
![[Entretien] Espitallier : libr-Java (1/2) [Libr-Java 8]](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2014/05/band-SpitJava.jpg)
BRAVO !!!
bien dit bien dû bien nu bien fût bien fait
J’avoue que j’ai été infiniment partie prenante de cette histoire de poésie contemporaine