 Voici la première partie d’un entretien dont vous pourrez trouver l’intégralité dans le volume numérique disponible fin avril sur publie.net. Bien que de sensibilité différente et ne revendiquant pas les mêmes héritages, j’ai tenu à rendre hommage à celui qui nous aide à mieux penser la poésie (et en particulier la poésie contemporaine) et à mieux la vivre au quotidien.
Voici la première partie d’un entretien dont vous pourrez trouver l’intégralité dans le volume numérique disponible fin avril sur publie.net. Bien que de sensibilité différente et ne revendiquant pas les mêmes héritages, j’ai tenu à rendre hommage à celui qui nous aide à mieux penser la poésie (et en particulier la poésie contemporaine) et à mieux la vivre au quotidien.
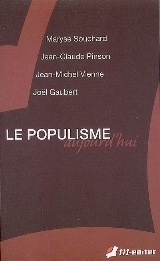 FT : Jean-Claude, dans votre contribution au volume collectif sur le populisme (Le Populisme aujourd’hui, M-Editer, 2007), vous quittez le champ politique pour le champ esthétique, où vous entendez « saisir les conditions de cette démagogie insidieuse et doucement endoxique plutôt que brutalement idéologique qu’est aujourd’hui la logique du populisme » (p. 37). Car, pour vous qui êtes un lecteur avisé de Bernard Stiegler, le populisme est favorisé par un monde où la télévision véhicule un individualisme de masse indissociablement lié à l’« ethos démocratique» contemporain ; où l’expérience sensible, parce que médiatisée, n’a plus rien d’authentique ni d’esthétique ; où l’extinction de la sublimation artistique a pour corollaire l’aliénation à la société de consommation. Pour vous, la seule façon de résister au « populisme culturel », c’est-à-dire à la « désublimation engendrée par la domination du capitalisme culturel » (p. 46), ressortit moins à la logique avant-gardiste – qui oppose à la culture de masse une « politique de la forme résistante » (Adorno) – qu’à une logique rhizomatique de la « raison artistique », plus conforme à l’ethos individualiste actuel : il ne s’agit plus d’en appeler à un « peuple qui manque » (Klee), mais de faire advenir le « devenir-artiste » (Deleuze) des individus. Reste à savoir l’impact social et esthétique d’une « logique créative » qui, pour être moins ambitieuse que la révolution avant-gardiste, n’en est pas moins presque aussi utopique…
FT : Jean-Claude, dans votre contribution au volume collectif sur le populisme (Le Populisme aujourd’hui, M-Editer, 2007), vous quittez le champ politique pour le champ esthétique, où vous entendez « saisir les conditions de cette démagogie insidieuse et doucement endoxique plutôt que brutalement idéologique qu’est aujourd’hui la logique du populisme » (p. 37). Car, pour vous qui êtes un lecteur avisé de Bernard Stiegler, le populisme est favorisé par un monde où la télévision véhicule un individualisme de masse indissociablement lié à l’« ethos démocratique» contemporain ; où l’expérience sensible, parce que médiatisée, n’a plus rien d’authentique ni d’esthétique ; où l’extinction de la sublimation artistique a pour corollaire l’aliénation à la société de consommation. Pour vous, la seule façon de résister au « populisme culturel », c’est-à-dire à la « désublimation engendrée par la domination du capitalisme culturel » (p. 46), ressortit moins à la logique avant-gardiste – qui oppose à la culture de masse une « politique de la forme résistante » (Adorno) – qu’à une logique rhizomatique de la « raison artistique », plus conforme à l’ethos individualiste actuel : il ne s’agit plus d’en appeler à un « peuple qui manque » (Klee), mais de faire advenir le « devenir-artiste » (Deleuze) des individus. Reste à savoir l’impact social et esthétique d’une « logique créative » qui, pour être moins ambitieuse que la révolution avant-gardiste, n’en est pas moins presque aussi utopique…
J.-C. P. : Dans l’essai auquel vous faites allusion, plutôt que d’aborder sous l’angle directement politique la question du populisme, j’ai voulu mettre en lumière ses soubassements dans la sensibilité, tels qu’ils peuvent être aujourd’hui façonnés à même notre expérience et notre éthos, notre façon habituelle d’être au monde. La modernité artistique, telle que la pense notamment Adorno, a très souvent été comprise à partir d’un schéma binaire, opposant la logique commerciale de l’industrie culturelle à celle, luttant pour son autonomie, de l’art d’avant-garde. Dans cette perspective, la multitude ne pouvait guère que succomber aux sortilèges de la « camelote » (c’est le mot d’Adorno), en attendant de pouvoir un jour, à la faveur d’un autre partage du sensible, échapper à la misère symbolique en s’ouvrant aux dissonances d’un art nécessairement « extrémiste ».
Adorno, on le sait, a violemment exclu le jazz de l’art véritable, ne voulant voir en lui qu’un avatar parmi d’autres de l’entertainment. Il ne méconnaissait pas ainsi seulement la réalité même du jazz comme forme d’art ; il demeurait aveugle à son sens politique, à la poussée historique dont il pouvait témoigner. Il manquait, et avec lui toute une tradition moderniste, l’émergence, essentielle pour l’époque contemporaine, de ce que j’appelle un « tiers-état artistique ». Or la culture afro-américaine dont le jazz est issu offre clairement le modèle d’une autre logique de l’art. S’y peut observer à l’œuvre une vis creativa, une force créative, qui fait des destinataires de la culture de masse non pas de simples consommateurs passifs et aliénés mais des agents qui tâchent, en s’appropriant une pratique artistique, de s’approprier leur propre existence, individuelle et collective. La culture hip-hop, notamment, offre aujourd’hui, me semble-t-il, confirmation de cette approche.
Est-on toujours dans l’utopie ? Plus tout à fait, pour autant qu’est déjà là, en devenir et en pointillés, cette nouvelle configuration où la multitude tend à se faire artiste. La démocratie, dit Cornel West (un universitaire américain qui se définit lui-même comme « bluesman du monde des idées et jazzman du monde de l’esprit »), est « une affaire de voix qui s’élèvent et le manque de démocratie une affaire de voix qui s’éteignent ». La multitude artiste est donc l’enjeu d’une lutte politique et culturelle et le lieu d’un rapport de forces. De même que c’est seulement en luttant contre la tentation du kitsch qu’elle peut, au plan proprement artistique, « élever des voix » qui affirment son devenir aristocratique.
FT : Au reste, dans votre contribution au volume sur Mai 68 (Argol, 2008), vous notez que cette période marque le passage du prolétariat au poétariat : pensez-vous que le second constitue vraiment un tout aussi bien organisé que l’était le premier ? Peut-on subsumer sous un tel concept des pratiques aussi hétérogènes et aussi individualistes ?
J.-C. P. : Il me semble en effet que « Mai 68 » marque l’irruption massive dans l’histoire de ce que j’appelle le « poétariat » (jeunes ouvriers peu enclins à obéir aux injonctions des appareils, étudiants refusant de faire carrière, femmes et minorités rejetant les mœurs et formes de vie anciennes…). Dans l’action collective de ces temps-là, la multitude commence à entrevoir la possibilité d’une société où le modèle du travail fordiste et l’obsession de la rentabilité et de la productivité pourraient ne plus prévaloir. Le modèle ancien, celui du prolétariat, distinguait clairement les places et les rôles : les militants d’avant-garde d’une part, les masses de l’autre. C’est ce modèle que « Mai 68 » frappe de péremption. Désormais, chacun aspire à devenir pleinement acteur de soi-même et du monde commun, à faire entendre sa voix et à suivre sa propre voie.
Est-ce, cette idée de « poétariat », une notion « attrape-tout », recouvrant des réalités hétéroclites ? Sans doute. Mais d’abord parce que la réalité sociale elle-même est devenue plus bariolée que jamais. Certes, les prolétaires voués à des tâches manuelles de simple exécution n’ont évidemment pas disparu. Mais d’autres sont apparus qui sont des travailleurs instruits impliqués dans l’économie de la connaissance, de l’information, de la communication et de la culture. Les couches intellectuelles, de leur côté, alternant de plus en plus souvent « petits boulots » et activités « créatrices », se sont dans une large mesure prolétarisées. Il n’est pas étonnant, du coup, que le parti centralisé de type léniniste soit devenu une forme d’organisation obsolète. D’autres formes, davantage horizontales et rhizomatiques ne cessent de s’inventer, au gré des luttes. Les exemples ne manquent pas, mais je ne suis guère compétent pour en parler.
Si la notion de « poétariat », que je n’invente pas tout à fait (elle apparaît en 1920 sous la plume d’un poète dadaïste demeuré presque inconnu, René Edme), a retenu mon attention d’observateur des choses de l’art et de philosophe, c’est qu’elle me semble assez adéquatement circonscrire une intersection : celle où une mutation sociale profonde rencontre une mutation du régime propre de l’art. Dans cette optique, je distingue un sens large et un sens restreint d’une notion où je souhaite que l’on entende dans le mot « poète » non seulement l’idée de « fabrication » (poiésis) qu’implique son étymologie, mais aussi celle d’activité (praxis) et au bout du compte, pour le dire en anglais, celle d’agency ou d’empowerment.
Participent du poétariat au sens large tous ceux qui, confrontés aux mutations du système capitaliste (à diverses formes de précarité), refusent la soumission et se saisissent de ses modalités nouvelles (celles notamment du travail intellectuel) pour inventer, au jour le jour et dans les interstices, des formes de vie, sinon alternatives, du moins soustraites au modèle dominant. Quant au sens restreint, il vaut pour tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, mettent l’art au cœur de leur existence et se veulent créateurs. Parmi eux, les passionnés de poésie (de littérature) qui fréquentent les ateliers d’écriture, publient des plaquettes ou des textes en ligne sur la Toile, participent à des soirées de slam… Leur nombre, partout, est en croissance exponentielle, en même temps qu’est à la hausse dans l’ordre des valeurs le modèle de travail non aliéné attribué à l’artiste. Les seconds (artistes au sens restreint) sont une sous-classe des premiers (« poètes » de leur propre existence), et c’est un continuum qui conduit de ceux-ci à ceux-là (et réciproquement).
FT : Que soient poéthiquement intéressantes des formes populaires comme le hip-hop ou le slam, je n’en disconviens pas. Du reste, en ce mois de mars 2009, je vais participer au Festival lillois de slam, avec Julien Delmaire et Marc Alexandre – lequel vient de lancer avec son A.D.N. (Afriques Diaspora Négritude) sa micro-maison d’édition PO-ÉTHIQUES…
Mais croyez-vous vraiment qu’il y ait dans une bonne partie de ce poétariat la volonté de changer la vie en changeant la syntaxe ? Par ailleurs, quels bouleversements formels observez-vous dans la poésie lyrique actuelle ?
J.-C. P. : On pourrait sans doute sans trop de mal reprendre le diagnostic que faisait déjà Mandelstam dans un essai de 1923 intitulé « L’armée des poètes ». Très sévère, il y peignait le « cercle des producteurs de poésie » comme un « monde de ratés notoires » pour qui les mots n’ont aucune importance. S’il y a chez eux une rage de l’expression, c’est seulement, explique-t-il, une « rage de se voir imprimés » (ou de faire entendre une voix dont ils ne perçoivent pas qu’elle est « leur propre ennemi ») ; elle n’a rien à voir avec celle dont parle Ponge. Elle prend le parti, non des mots, mais du pathos : « c’est un perpétuel je vis, je veux, j’ai mal », ajoute Mandelstam, qui conclut : « Nous portons tous des chaussures – mais tout le monde n’est pas cordonnier. »
Comme critique (et « cordonnier »), je ne nourris guère d’illusions quant au penchant au kitsch propre à la poésie pratiquée par tous. Mais le point de vue du « poèthe » n’est pas celui du seul lettré. Là où ce dernier ne prend en compte que le plan textuel, poétique (esthétique), le premier n’omet pas de voir le plan existentiel, « biopoétique ». Il ne s’illusionne pas sur la valeur esthétique de l’art qui peut être ainsi produit. Mais il est, quoi qu’il en soit, du côté du poétariat. Car il sait que la valeur éthique d’un art pratiqué par la multitude n’est réductible ni aux savoir-faire techniques ni à l’art des œuvres d’art. Il sait que cette pratique de l’art, qui n’est pas sans défaut, est essentielle à l’invention d’une nouvelle économie de l’existence. Il n’idéalise pas le « poétariat », mais il se refuse aussi à l’enfermer dans un perpétuel état d’incompétence poétique. « Mélioriste », il s’obstine, sans certitude aucune, à l’envisager sous l’angle d’un possible favorable : celui que circonscrit l’oxymore de cette improbable « démocratie nietzschéenne » dont parle Jean-Luc Nancy. Cornel West, que je citais précédemment, dit cela très bien : « Je ne suis certainement pas optimiste, mais je suis prisonnier de l’espoir. »
Pour le reste, on peut douter que « changer la syntaxe », subvertir les usages dominants de la langue, puisse contribuer autrement qu’à la marge à « changer la vie ». La poésie « peut peu », comme dit Christian Prigent.
Sommes-nous aujourd’hui en présence de grands bouleversements formels ? À vrai dire, je n’en sais trop rien, faute notamment de pouvoir considérer de plus près ce qui peut résulter pour l’écriture du recours au nouveau support constitué par l’écran et la page informatique.
Si cependant je retiens aujourd’hui quelque chose, même si ce n’est pas vraiment nouveau, c’est tout un jeu de navettes, de plus en plus marqué, entre prose et vers, narration et poème. Dans ce cadre, ce qui personnellement m’intéresse aujourd’hui, c’est d’abord la recherche d’une grande forme prosimétrique, impure, où entrent en collision les modes d’énonciation les plus divers, du narratif à tous ces types de discours dont la poésie est le terrain d’élection (profération, invocation, prière, méditation, chanson, incantation, divagation, etc.). Le Sujet monotype de Dominique Fourcade est un bon exemple, très convaincant, d’une telle forme métissée. Mais il faudrait envisager aussi ce métissage depuis le roman, dans le sillage de ce que le dernier Barthes recherchait sous les traits du roman rhapsodique, fragmentaire, roman dont la forme poikilos (bariolée) non seulement admet, mais requiert les éclats du poème et les épiphanies du chant.
FT : Dans votre propre pratique, quelles formes recouvre votre principe de composition à sec ? En quoi vous sentez-vous proche de Philippe Beck ?
J.-C. P. : « Composer à sec » : est-ce vraiment un principe ? La formule n’apparaît pas dans un énoncé théorique, mais dans un passage en vers de Fado. Je la mets dans la bouche d’un personnage qui est une sorte de sosie de Janacek, lequel en fait un précepte de son art.
Plusieurs raisons, plus ou moins contingentes, m’ont conduit à m’intéresser à Janacek : son côté outsider provincial, sa maturité tardive (au plan esthétique), son goût pour la voix… Mais, avant tout, j’ai retenu de sa musique (et spécialement de ses quatuors à cordes) qu’un lyrisme était possible après et à l’écart du pathos post-romantique ; que l’innovation formelle et le plaisir de l’écoute spontanée (comme dit à peu près Adorno) n’étaient pas nécessairement ennemis l’un de l’autre. Au fond, il me semblait que Janacek avait résolu dans l’ordre de la musique le problème qui était le mien au seuil d’un livre qui affrontait le motif, périlleux par excellence, de l’histoire d’amour. « Composer à sec », c’est tenir la bride à l’épanchement, à l’humidité des humeurs et des larmes, sans toutefois (telle est la quadrature du cercle) renoncer à inventer la musique d’un discours amoureux. Car pourquoi faudrait-il forclore le genre de la lyrique amoureuse ? Cahin-caha, le livre a donc tâché de trouver sa forme, celle, polyphonique, d’une sorte d’« opéra de chambre » où la voix du sujet-narrateur se démultiplie en autant de personnages qu’il y a d’interlocuteurs. Parmi eux, un faux Beaudelaire, un pseudo-Pessoa… mais aussi un autre musicien, Ornette Coleman, l’inventeur du free-jazz, dont on pourrait dire qu’il a lui aussi « composé à sec » sans pourtant rien renier du blues et de son pathos (dans le bon sens du terme).
L’enjeu est ici de sauver la possibilité de quelque chose comme un lyrisme. C’est d’abord une affaire d’énonciation et de langage, où font difficulté l’expression subjective et tout recours au ton élevé. La première conduit trop facilement aux mièvreries de l’effusion, « horriblement fadasse » selon le mot de Rimbaud. Et l’emphase guette toute entreprise d’enfiévrer la langue, de susciter en elle ce mouvement d’« apothéose » en quoi Baudelaire voyait l’essence même du lyrisme.
Mais la question a aussi pour moi un arrière-plan métaphysique : nous « sans dieu » (pour parler comme Nietzsche), nous qui venons après la fin de l’hymne, que pouvons-nous encore chanter ? À quelle « explication orphique de la Terre » (Mallarmé) pouvons-nous encore prétendre ? Pour le poète moderne, c’en est fini, semble-t-il, d’un ordre enchanté de la parole et d’une expérience auratique du monde. Si la « musique des sphères » est inexistante, vaine alors est la prétention du poète lyrique à la rejoindre en s’élevant au-dessus de la prose disharmonieuse du monde. L’orphisme alors fait difficulté et le lyrisme avec lui.
 C’est pourquoi n’ont pas tort les poètes qui aujourd’hui se défient de l’idée de musique et de chant. Emmanuel Hocquard, par exemple, fait de la « démusicalisation » un impératif essentiel : « En poésie, écrit-il, une bonne cure d’amaigrissement musical s’impose : déchanter, désenchanter, rompre le charme. » Sans doute. Pourtant, autant que l’effort au style, me paraît nécessaire l’effort au chant. Car n’ont pas tort non plus, telle est la contradiction où je me tiens, ceux pour qui la « musique des lettres » est l’essentiel. Mais c’est alors une musique sans emphase, une musique au ton « désapplaudi, sec » (Dominique Fourcade).
C’est pourquoi n’ont pas tort les poètes qui aujourd’hui se défient de l’idée de musique et de chant. Emmanuel Hocquard, par exemple, fait de la « démusicalisation » un impératif essentiel : « En poésie, écrit-il, une bonne cure d’amaigrissement musical s’impose : déchanter, désenchanter, rompre le charme. » Sans doute. Pourtant, autant que l’effort au style, me paraît nécessaire l’effort au chant. Car n’ont pas tort non plus, telle est la contradiction où je me tiens, ceux pour qui la « musique des lettres » est l’essentiel. Mais c’est alors une musique sans emphase, une musique au ton « désapplaudi, sec » (Dominique Fourcade).
Philippe Beck ? Je tiens son œuvre pour l’une des plus importantes d’aujourd’hui. Son traitement du vers, sa façon de l’abréger et de le densifier ne peuvent pas laisser indifférent. Si je me sens proche de son travail, c’est en raison de la manière dont chez lui le « discours musical » est une manière de réarticuler autrement, en régime sensible et rythmique, toute la matière et toute la tradition de la philosophie (et plus largement de la littérature). Je suis aussi sensible à sa tentative de refaire du chant (et même de l’enchantement). Car à sa façon Beck est un lyrique, composant lui aussi à sec. Au-delà, il y a évidemment entre nous bien des différences, dans les formes comme dans les dispositifs d’énonciation, ou encore dans la place faite ou non à l’autobiographie.
![[Entretien] Jean-Claude PINSON : poéthiquement impur... (1)](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)