
Plutôt là que ici, mais toujours dans ça… le dialogue exceptionnel entre deux poètes de talent.
Matthieu GOSZTOLA : Blanchot écrit dans L’Entretien infini : "Il se peut, comme on aime à le déclarer, que « l’homme passe ». Il passe. Il a même toujours déjà passé, dans la mesure où il a toujours été approprié à sa propre disparition. Mais, passant, il crie ; il crie dans la rue, dans le désert ; il crie mourant ; il ne crie pas, il est le murmure du cri".
Dans cette citation, deux fragments m’arrêtent. Le premier est : "l’homme […] a toujours été approprié à sa propre disparition". En quoi pour toi l’écriture travaille-t-elle cette question de l’appropriation (paradoxale), pour l’homme, de sa disparition ? L’écriture, est-ce façon de suspendre la disparition ou bien de la rendre réalité, puisque dans le langage ce n’est pas le réel qui paraît, puisque du langage sourd le meurtre du réel qui lui a préexisté ? (Nous reviendrons sur cette question tout au long de l’entretien.)
Mathieu BROSSEAU : Tout ce qui parle est parfois formules verbales mais plus souvent, il demeure silence ouvert. Ou plutôt silences. Ces silences ont des sens latents dont certains peuvent être réactivés dans le vivre de l’appréhension, de façon spectrale. Le "murmure du cri" serait pour moi cette façon quasi aphasique que nous avons de vouloir désespérément dire une totalité une via l’incomplétude d’un langage qui se fragmente dans le temps du dire, et de ses mots.
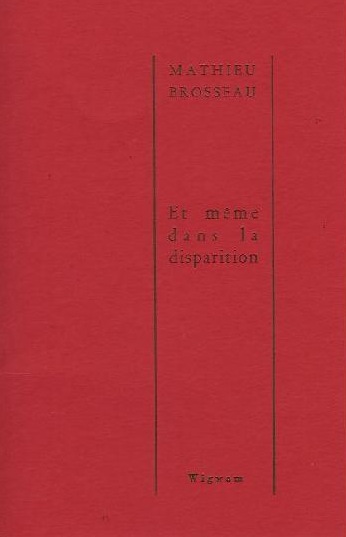 Dans mon court opus Et même dans la disparition (éd. Wigwam, 2010), j’ai beaucoup travaillé la question du réel de la disparition par des approches empiriques et fantasmatiques. Peut-on suturer une absence par des mots ? Si nous sommes si seuls en nous-mêmes, pourquoi ne pourrions-nous pas défier la mort, y compris en ayant recours à des hallucinations scénaristiques, des fantasmagories ? En fait, je crois que non, il est impossible de maintenir la vie en vie, si je puis dire ; où qu’elle soit. Ni corps ni émotion ni pensée n’échappe aux incessants deuils. Et cette valse des deuils participe (le mot est faible) à l’apprentissage et à l’initiation que nous faisons de notre vie propre, son récit. Mais quelle est la réalité du récit de notre vie ?
Dans mon court opus Et même dans la disparition (éd. Wigwam, 2010), j’ai beaucoup travaillé la question du réel de la disparition par des approches empiriques et fantasmatiques. Peut-on suturer une absence par des mots ? Si nous sommes si seuls en nous-mêmes, pourquoi ne pourrions-nous pas défier la mort, y compris en ayant recours à des hallucinations scénaristiques, des fantasmagories ? En fait, je crois que non, il est impossible de maintenir la vie en vie, si je puis dire ; où qu’elle soit. Ni corps ni émotion ni pensée n’échappe aux incessants deuils. Et cette valse des deuils participe (le mot est faible) à l’apprentissage et à l’initiation que nous faisons de notre vie propre, son récit. Mais quelle est la réalité du récit de notre vie ?
A chaque fois qu’on parle de réalité, deux questions relatives à ses propriétés attirent toute mon attention : sa matérialité et sa vérité.
Vouloir ramener la mort à la lettre et à l’écriture provient sans doute du fait que la mort a le même attribut (littératurable) que les idées : elles n’ont pas matière et ne sont pensées que par la mise en fiction de soi (ce que raconte la vie est un fantasme) dans un ailleurs inexistant que j’appellerai ailleurs-horizon. Or comme je le disais plus haut, tout parle. Y compris l’absence ou l’ailleurs en ce que nous lui donnons contours, en creux.
L’hypothèse parle, le doute parle, l’immatériel parle. Et comme souvent, nous donnons plus de poids à la parole qu’à la matière, nous finissons par croire que la parole fait poids, davantage que les objets matériels qui nous entourent. Ainsi confondons-nous réalités physiques et réalités historiques par exemple. Et la possibilité du délire (collectif aussi) est présente. Et ce tout qui parle vient produire du réel tangible et matériel. La parole tue ou plutôt, elle déclare la mort. Et quand elle-même meurt, j’y vois un renversement poétique. Et tu le sais, tu l’as éprouvé de tout ton corps en écrivant Débris de tuer, est-ce que je me trompe ?
Matthieu GOSZTOLA : Oui, la parole déclare la mort, et je l’ai éprouvé empiriquement avec une certaine douleur en écrivant ce livre, tu as raison. Je l’ai éprouvé en voulant donner corps à cette fiction qu’est Débris de tuer, pensée comme un cri de l’Histoire, un cri parfaitement anonyme restitué (du moins, telle a été mon ambition) à sa part de singularité. Une singularité qui ne détruit pas son anonymat mais qui l’enracine dans cette si fragile lueur : l’humain.
Mathieu BROSSEAU : Et justement, vient ici la question de la vérité, qui est essentielle : en effet, existe-t-il autre chose que les fictions pour raconter notre rapport au monde, y compris perceptuel ? Non. De ne pas accéder au réel, on accède au récit.
Et pourtant, nous ne pouvons pas tout faire ni tout nous raconter, si bien que la réalité est faite de bornes qui nous étreignent autant qu’elles nous contraignent. Et les bornes sont justement les autres. Et quand l’autre, un autre disparaît, il nous semble que notre propre monde s’écroule précisément parce qu’une de nos bornes – qui forme notre réalité, – s’écroule. Et contre cela, la littérature ne peut rien. Sinon, peut-être, gagner du terrain sur la folie, c’est-à-dire inventer de nouvelles vérités sur lesquelles nous pourrions nous appuyer, un dictionnaire personnel. En fait, le faux n’existe pas. Il y a ce qui produit des réalités nouvelles et ce qui les avorte.
Je viens d’énoncer des marqueurs de ce que j’appelle réalité alors qu’en fait,  tout est de l’ordre du phénomène. Rien n’est figé ni isolé. Tout est déroulement. Aussi, pour bien voir l’événement phénoménologique que constitue toute réalité, il faut admettre que pour produire une réalité, matérielle ou pas, il faut être deux. Un pour énoncer ce qu’il voit, l’autre pour confirmer, c’est-à-dire pour rendre vraie la chose vue ou sentie (si on est dans le domaine des idées). D’où la structure marquante du couple et de tout dualisme. Et je pense bien sûr au couple auteur/lecteur.
tout est de l’ordre du phénomène. Rien n’est figé ni isolé. Tout est déroulement. Aussi, pour bien voir l’événement phénoménologique que constitue toute réalité, il faut admettre que pour produire une réalité, matérielle ou pas, il faut être deux. Un pour énoncer ce qu’il voit, l’autre pour confirmer, c’est-à-dire pour rendre vraie la chose vue ou sentie (si on est dans le domaine des idées). D’où la structure marquante du couple et de tout dualisme. Et je pense bien sûr au couple auteur/lecteur.
Dans ce que tu me dis, une autre chose me paraît fondamentale, c’est l’idée de propriété. En effet, je crois que ce qui protège l’homme de la folie, c’est la propriété. La propriété de son corps, de sa peau, la propriété de son imaginaire, de son style, la propriété de ses perceptions, de ses oublis, la propriété de son terrain, de ses frontières, la propriété de son pays, de sa langue, etc. Il faudrait l’entendre sous un angle psychanalytique : dans le développement humain, tu le sais, une étape fondamentale est celle de l’appropriation, là où le jeune enfant apprend à déterminer ce qui est à lui. Or tout son monde est à lui, ce qui le rend tyran. Devenir propriétaire de sa mort propre est pour moi un fantasme, une supercherie ou un délire. C’est une littérature que seuls des fantasmes enfantins pourraient honorer par la croyance en l’omnipotence du tout-avoir (qui revient au tout-être).
Mais je le répète, la réalité de la littérature n’est pas discutable en ce que, par son évocation (par la lecture), elle est productrice de réels nouveaux, de réels à venir, de réels qui eux seront matériels. Je sais bien que c’est une folie mais oui, le délire fait être. Il vaudrait donc mieux étudier, par recoupement, ce qui passe de la lettre à la chair…
Tout événement a sa chronologie constituée de réalités différentes, matérielles ou pas, et la notion de vrai devient une croyance à elle toute seule !, pourtant nécessaire aux fondations psychiques de tout individu (ce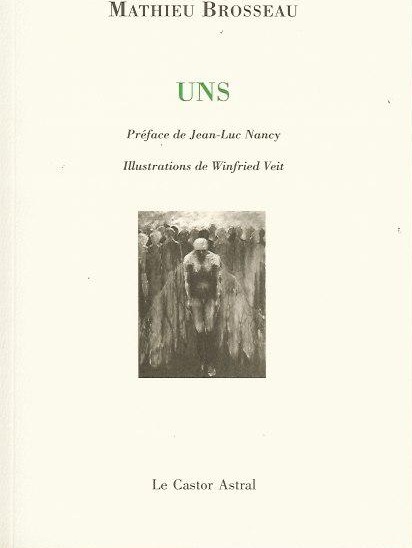 qui les fait tenir). La puissance de la littérature (c’est-à-dire de tout) provient de ce nœud-là : sa puissance évocatoire, en ce qu’elle entraîne, est sans doute ce qu’il y a de plus fertile (c’est-à-dire de phénoménologiquement réelle). Proust possède sa madeleine, il possède sa mémoire sans quoi, l’évocation comme l’association n’aurait pas eu lieu. L’autre distinct (comme scindé) n’existe que comme ailleurs-horizon. Tout ce qui nous approche, tout ce qui apparaît est nécessairement et aussitôt approprié par l’esprit. Nous vivons dans notre réalité. Une réalité qui serait parfaitement autre ne pourrait avoir d’existence pour nous, même en creux. Le croire est ainsi imbriqué à l’avoir. Entrevoir l’autre, c’est se voir, soi en lui.
qui les fait tenir). La puissance de la littérature (c’est-à-dire de tout) provient de ce nœud-là : sa puissance évocatoire, en ce qu’elle entraîne, est sans doute ce qu’il y a de plus fertile (c’est-à-dire de phénoménologiquement réelle). Proust possède sa madeleine, il possède sa mémoire sans quoi, l’évocation comme l’association n’aurait pas eu lieu. L’autre distinct (comme scindé) n’existe que comme ailleurs-horizon. Tout ce qui nous approche, tout ce qui apparaît est nécessairement et aussitôt approprié par l’esprit. Nous vivons dans notre réalité. Une réalité qui serait parfaitement autre ne pourrait avoir d’existence pour nous, même en creux. Le croire est ainsi imbriqué à l’avoir. Entrevoir l’autre, c’est se voir, soi en lui.
Sauf que la disparition ou la mort est précisément cette réalité parfaitement autre et nous ne pouvons donc ni en faire l’expérience ni l’évoquer. Tout ce que nous pouvons faire, c’est de croire que dans un temps complètement autre, nous serons ce qui ne possède plus. Autant dire qu’alors nous ne serons plus humains, et c’est là une autre histoire…
Matthieu GOSZTOLA : Le deuxième fragment qui me saisit est "l’homme […] est le murmure du cri". Ton écriture, telle qu’elle se déploie, me semble être précisément ce murmure du cri. Cette façon qu’a la masse sonore du langage de se déployer peu à peu, dans toute son étendue. Et même lorsqu’elle reste en retrait, elle continue alors de nous donner à saisir son intensité. Comment travailles-tu l’élément sonore du langage ? Y a-t-il pour toi oralisation de tes textes pendant le processus d’écriture ? Est-ce une oralisation intérieure ? En quoi la disposition des signes de ponctuation sur la page sert-elle cette oralisation ? En quoi l’invention de nouveaux signes de ponctuation est-elle façon qu’a le souffle de la phrase d’être précisément guidé ? Peux-tu revenir sur cette richesse typographique qui caractérise Uns, par exemple ?
Mathieu BROSSEAU : C’est aussi là, par une réflexion sur la typographie ou la syntaxe que l’on peut parler du meurtre de la langue. Tuer la langue, c’est s’avouer que toute identité ne peut être que périphérique (à l’intérieur, il y a un magma sans-nom). Il s’agit je crois de produire une manière d’écrire qui soit le produit même du vivre (c’est-à-dire du sans-nom), sa mise en réalité si je puis dire, sa mise en souffle. Or, pour échapper au réel nôtre dont je parlais plus haut, pour le dépasser, pour tendre (car tout est histoire de tension) vers le parfaitement autre, vers celui qu’on ne peut pas décrire, ou pas encore, il convient de définir une langue dont le mouvement général traduirait ce vers quoi l’on va, hors des conventions collectives de la communication. Car pour dire l’absence, ou l’infiniment ailleurs, quand bien même il serait en nous, il convient d’élaborer un rythme, un chant (de guerre) qui nous dit autant qu’on le dit, dans un double mouvement. Il est un moment, il me semble, où surgit la nécessité d’assassiner sa langue maternelle, son système clos et su, son critère d’inertie, pour en réinventer une autre, qui autorise d’aller et de s’ouvrir. Il ne s’agit pas, bien sûr, d’inventer de nouveaux mots mais de produire des sens nouveaux en incitant, par le mouvement même de la parole, une révolution. Et dès lors qu’une langue fait système, qu’elle s’établit, il me semble qu’il faut en changer. Pour dire encore autre chose. Les révolutions dont je parle permettent de découvrir des antériorités inconnues. Le chant, quant à lui, donne l’allant de la perforation.
J’aimerais savoir, pour ma part, comment tu places ta voix, comment elle se fractionne dans Débris de tuer (qui part et parle du drame rwandais) et pourquoi, pour dire quoi ? Y a-t-il dans le meurtre collectif un espace qui ne se parle pas, une sorte de langue exclue (car le phénomène dépasse toute compréhension, toute appréhension) ? Et quelle serait, dans ce silence, la place de ta poésie ? Et enfin, j’aimerais que tu me dises comment, par quels biais formels, as-tu réussi à dire la mort qui n’est pas la tienne, si cela est possible. As-tu l’intention par Débris de tuer d’écrire à la place du témoin ? Celui qui ne peut écrire. Parce que ce n’est pas dans sa tradition ? Parce qu’il est encore trop tôt ? Tu écris pour un public francophone, cette langue du bourreau si l’on considère la responsabilité coloniale, pour ce public, tu écris en tordant le sens, la musique, la typographie : pourquoi ?
Matthieu GOSZTOLA : Le témoin, un infans, dans Débris de tuer, celui qui ne peut parler, qui ne peut écrire. Celui à qui on a ôté la parole. Tu as raison, plusieurs raisons s’entremêlent, dans ce refus de parler. Il y a bien sûr, notamment, la pudeur africaine, bellement retranscrite par Raymond Depardon dans son film de 1996 Afriques : comment ça va avec la douleur ? Mais, plus encore qu’un refus, il faut considérer ici qu’il s’agit d’une impossibilité. On ne peut dire. Et s’il n’est pas permis de dire, c’est surtout 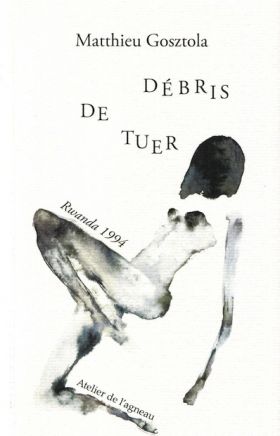 parce qu’en disant – on le sent confusément –, on dirait ce qui excède tout être, toute vie, et qui ne pourrait advenir, se cristallisant dans un sens, qu’en entraînant avec soi une déflagration qui causerait l’échec des planètes dans leur ballet presque intemporel – la perte de toute chose. De toutes choses. Si on disait, alors, on ne pourrait que dire la mort. Le sens qui se cristalliserait serait le sens qui engloberait tous les sens, et les réduirait à néant pour être seul à faire sens. Or, ce sens, c’est précisément l’absence de sens. L’absence de sens qui fait sens comme seul sens. De plus, pour chaque un, la mort = la mort de toute chose. Car la mort, à chaque fois une, pour n’advenir qu’en ruinant une idiosyncrasie, effondre un monde entier : celui de cette idiosyncrasie. Aussi, c’est très logiquement que l’absence de sens est vive, pour le toujours de la vie, de la mémoire et de l’Histoire. Si on disait, dans ces conditions, – les témoins le sentent en leur chair, même confusément –, on ne pourrait que faire advenir la mort. Pour toujours. Partout. Voilà pourquoi beaucoup de rescapés s’empêchent de parler, je crois. En parlant, ils diraient leur mort (en dméfinitive), et la feraient advenir, c’est-à-dire la feraient les rejoindre totalement. Car elle est déjà là par petits bouts ; des petits bouts qui prennent toute la place du quotidien, et des rêves, qui reviennent en trombe. Aussi, très fort ils s’empêchent de parler. Mais ce qu’ils ne savent pas, ou savent, mais confusément, c’est qu’en ne parlant pas, ils parlent. Par leur silence, ils parlent. Ils parlent encore davantage que s’ils articulaient des phrases. En signifiant, par leur silence, l’impossibilité qui est la leur de parler, en tissant un chant de silence et d’amertume, reclus sur lui-même, et placé tout au centre de leur cœur, ils PARLENT. (Et là, je rebondis bien sûr sur ce que tu écris dans La nuit d’un seul– La Rivière Echappée – : « Seul / le silence / de l’action dit / le nom de l’action ».) Ils crient, même (et il y a un chant de ce cri entièrement contenu dans un silence infini – proprement sans limites – auquel j’ai été très sensible et que j’ai voulu restituer sur la page dans le travail formel, à chaque page renouvelé, qui a été le mien). Oui, dans cette impossibilité (qui est l’ontologie de ce silence), dans la façon suivant laquelle cette impossibilité si particulière paraît à notre vue, à notre écoute, dans la façon suivant laquelle elle détonne, elle se déploie, elle se rétracte, quelque chose se dit. Quelque chose d’essentiel, qui a trait à l’humain. Et qui n’est pas l’humain, pourtant, puisqu’il s’agit de la mort. Pure abstraction, devenue réalité par l’hallucination, tu l’as rappelé. A ceci près que là, dans le cadre du génocide, la mort (qui est le pendant de la fragilité si extrême de la vie, et qui en constitue – même fantasmatiquement, mais c’est là l’irruption de sens qui fonde toute perception – le souffle, l’allant, l’élan, la saveur, et qui fait de nous des frères et des sœurs de cette fragilité si particulière, c’est-à-dire de frêles esquifs dans le torrent du vivre)…, la mort devient proprement humaine. J’entends par là qu’elle devient proprement un fait humain. Elle devient entièrement le fait de l’homme. Oui, c’est ce qu’ils disent, les rescapés, avec leurs silences (et non pas leur silence) : la mort peut être entièrement le fait de l’humain. Il faut entendre aussi, bien sûr, ce qui est contenu dans cette phrase et qui n’est pas déployé. Il faut entendre cette phrase comme suit : la mort la plus inhumaine (car c’est bien de cela qu’il s’agit) peut être entièrement le fait de l’humain. Ainsi, c’est la mort comme humanité (si paradoxale humanité) que le cri du silence, chez les rescapés, dit également (et c’est là le dernier point). La mort qui, en devenant une humanité, constitue l’inhumanité en tant que telle. Pour retranscrire cela dans le poème, j’ai dénaturé le langage humain, un langage multiple (j’ai fait s’entremêler le langage d’ici – la langue coloniale comme tu dis – et le langage de là-bas, qui était mon ici quand j’écrivais, et avant même le premier mot, quand j’ai été embarqué sur chaque témoignage, fendant quelle mer au ciel chargé de tonnerre), j’ai dénaturé ce langage multiple donc, – le ruinant aussi au moyen du blanc, de ce non sens absolu qu’est le blanc typographique, page encore vierge, en attente d’un sens qui viendrait s’y déposer, – afin de matérialiser la mort au sein même de l’humain, puisqu’il n’y a pas de plus grande humanité que celle qui est contenue (comme un feu confiant en ses braises) dans les paroles.
parce qu’en disant – on le sent confusément –, on dirait ce qui excède tout être, toute vie, et qui ne pourrait advenir, se cristallisant dans un sens, qu’en entraînant avec soi une déflagration qui causerait l’échec des planètes dans leur ballet presque intemporel – la perte de toute chose. De toutes choses. Si on disait, alors, on ne pourrait que dire la mort. Le sens qui se cristalliserait serait le sens qui engloberait tous les sens, et les réduirait à néant pour être seul à faire sens. Or, ce sens, c’est précisément l’absence de sens. L’absence de sens qui fait sens comme seul sens. De plus, pour chaque un, la mort = la mort de toute chose. Car la mort, à chaque fois une, pour n’advenir qu’en ruinant une idiosyncrasie, effondre un monde entier : celui de cette idiosyncrasie. Aussi, c’est très logiquement que l’absence de sens est vive, pour le toujours de la vie, de la mémoire et de l’Histoire. Si on disait, dans ces conditions, – les témoins le sentent en leur chair, même confusément –, on ne pourrait que faire advenir la mort. Pour toujours. Partout. Voilà pourquoi beaucoup de rescapés s’empêchent de parler, je crois. En parlant, ils diraient leur mort (en dméfinitive), et la feraient advenir, c’est-à-dire la feraient les rejoindre totalement. Car elle est déjà là par petits bouts ; des petits bouts qui prennent toute la place du quotidien, et des rêves, qui reviennent en trombe. Aussi, très fort ils s’empêchent de parler. Mais ce qu’ils ne savent pas, ou savent, mais confusément, c’est qu’en ne parlant pas, ils parlent. Par leur silence, ils parlent. Ils parlent encore davantage que s’ils articulaient des phrases. En signifiant, par leur silence, l’impossibilité qui est la leur de parler, en tissant un chant de silence et d’amertume, reclus sur lui-même, et placé tout au centre de leur cœur, ils PARLENT. (Et là, je rebondis bien sûr sur ce que tu écris dans La nuit d’un seul– La Rivière Echappée – : « Seul / le silence / de l’action dit / le nom de l’action ».) Ils crient, même (et il y a un chant de ce cri entièrement contenu dans un silence infini – proprement sans limites – auquel j’ai été très sensible et que j’ai voulu restituer sur la page dans le travail formel, à chaque page renouvelé, qui a été le mien). Oui, dans cette impossibilité (qui est l’ontologie de ce silence), dans la façon suivant laquelle cette impossibilité si particulière paraît à notre vue, à notre écoute, dans la façon suivant laquelle elle détonne, elle se déploie, elle se rétracte, quelque chose se dit. Quelque chose d’essentiel, qui a trait à l’humain. Et qui n’est pas l’humain, pourtant, puisqu’il s’agit de la mort. Pure abstraction, devenue réalité par l’hallucination, tu l’as rappelé. A ceci près que là, dans le cadre du génocide, la mort (qui est le pendant de la fragilité si extrême de la vie, et qui en constitue – même fantasmatiquement, mais c’est là l’irruption de sens qui fonde toute perception – le souffle, l’allant, l’élan, la saveur, et qui fait de nous des frères et des sœurs de cette fragilité si particulière, c’est-à-dire de frêles esquifs dans le torrent du vivre)…, la mort devient proprement humaine. J’entends par là qu’elle devient proprement un fait humain. Elle devient entièrement le fait de l’homme. Oui, c’est ce qu’ils disent, les rescapés, avec leurs silences (et non pas leur silence) : la mort peut être entièrement le fait de l’humain. Il faut entendre aussi, bien sûr, ce qui est contenu dans cette phrase et qui n’est pas déployé. Il faut entendre cette phrase comme suit : la mort la plus inhumaine (car c’est bien de cela qu’il s’agit) peut être entièrement le fait de l’humain. Ainsi, c’est la mort comme humanité (si paradoxale humanité) que le cri du silence, chez les rescapés, dit également (et c’est là le dernier point). La mort qui, en devenant une humanité, constitue l’inhumanité en tant que telle. Pour retranscrire cela dans le poème, j’ai dénaturé le langage humain, un langage multiple (j’ai fait s’entremêler le langage d’ici – la langue coloniale comme tu dis – et le langage de là-bas, qui était mon ici quand j’écrivais, et avant même le premier mot, quand j’ai été embarqué sur chaque témoignage, fendant quelle mer au ciel chargé de tonnerre), j’ai dénaturé ce langage multiple donc, – le ruinant aussi au moyen du blanc, de ce non sens absolu qu’est le blanc typographique, page encore vierge, en attente d’un sens qui viendrait s’y déposer, – afin de matérialiser la mort au sein même de l’humain, puisqu’il n’y a pas de plus grande humanité que celle qui est contenue (comme un feu confiant en ses braises) dans les paroles.
J’ai voulu écrire avec ce silence des rescapés, ce silence qui contient (notamment) leur mort, qu’ils n’ont pas encore suffisamment approchée pour se confondre avec elle mais qu’ils épient sans cesse, suivant les mouvements de son ombre sur le sol. Mais j’ai aussi voulu écrire avec le souffle des rescapés. Car il y a quand même un certain nombre de témoignages, écrits ou oraux, qui existent, pour ce qui est de ce génocide. Et d’ailleurs, dans la parole des rescapés, si prolixe soit-elle, il demeure, toujours, une part de silence, de ce silence qui est exactement (exactement !) le silence de ceux qui ne peuvent rien dire (car alors le système solaire partirait en poussière) et que j’ai évoqué plus haut. Tout le travail que j’ai effectué dans le cadre de la construction et de la déconstruction d’une forme poétique et narrative a consisté à signifier que dans toute parole, il y a, présent comme un trou noir, un silence qui contient toute parole, qui en est la fin, mais aussi le commencement, la réserve, la condamnation, la dénaturation, la moquerie, l’abandon, les larmes, le cri ; le souffle aussi.
Je n’ai pas voulu écrire à la place du témoin, mais bien écrire en laissant courir en moi le souffle de celui-ci, de telle manière que ma main puisse être l’aiguille du sismographe dont je ne commanditerais aucun  mouvement. Bien sûr, tout cela relève de l’idéalisation. Mais tel a été mon projet. Comment ai-je fait pour le mettre en place ? Je me suis enfermé, de longs mois, avec les témoignages, vivant avec eux, respirant, dormant, me scindant avec eux. Ils sont devenus la matière même de mes rêves. Par eux, j’ai choisi la dissipation (ou plutôt c’est la dissipation qui m’a choisi) et comme tu l’écris quelque part, « [c]elui qui choisit la dissipation dépose en lui tout le sens du vide. » Bien sûr, cela été très douloureux. Mais ça m’était nécessaire. Comment faire autrement ? Comment aurais-je pu écrire autour du génocide autrement ? (Autour, car je ne pourrai jamais écrire sur : il y a un impensable du génocide par quoi tu commences ton questionnement et que j’évoquerai in fine.) De cette construction du pluriel en moi qui ai vécu de longs mois avec cette parole de l’autre (un autre qui n’est pas autrui, car je suis aussi l’autre de cet autre), est né Débris de tuer (et je m’inspire ici précisément de ce que j’ai pu dire ailleurs, car il ne m’est pas possible d’exprimer les choses autrement). Invariablement, vivant avec les rescapés, dans le cénacle halluciné de la pensée, avec leur parole, avec leurs silences surtout, j’ai été, inlassablement, dans leur « langue le muet » (la formule est d’André du Bouchet). Invariablement, je n’ai voulu qu’une seule chose, contribuer, en faisant parler l’horreur que j’ai pu déceler dans leurs témoignages, à faire parler (individuellement, de telle sorte que la parole ne soit plus visée vers mais retour sur) ces êtres (à les faire parler par-delà le mensonge du langage, le mensonge de la logique qu’est tout langage, à les faire parler avec le souffle seul), avant qu’ils ne prêtent leurs lèvres « à une parole anonyme de l’histoire », comme l’écrit Lévinas, laquelle parole, parce qu’obligatoirement structurée (car organisée, qu’elle soit du reste synthétisée – ce qui est le cas le plus souvent – ou complexifiée), est mensongère quant à la trajectoire toujours individuelle de la douleur, et quant à l’horreur qui s’inscrit en l’être en épousant la trajectoire individuelle de la douleur. Ainsi, il s’agissait non pas de prendre le pas sur leur parole en faisant advenir une parole qui soit autre, mienne, et donc évidemment mensongère (car mystificatrice, en dépit même de son pouvoir – qui est en d’autres contextes une vertu – heuristique), mais de faire parler inlassablement l’horreur que les témoignages m’avaient donnée à lire, sans qu’elle soit formulée.
mouvement. Bien sûr, tout cela relève de l’idéalisation. Mais tel a été mon projet. Comment ai-je fait pour le mettre en place ? Je me suis enfermé, de longs mois, avec les témoignages, vivant avec eux, respirant, dormant, me scindant avec eux. Ils sont devenus la matière même de mes rêves. Par eux, j’ai choisi la dissipation (ou plutôt c’est la dissipation qui m’a choisi) et comme tu l’écris quelque part, « [c]elui qui choisit la dissipation dépose en lui tout le sens du vide. » Bien sûr, cela été très douloureux. Mais ça m’était nécessaire. Comment faire autrement ? Comment aurais-je pu écrire autour du génocide autrement ? (Autour, car je ne pourrai jamais écrire sur : il y a un impensable du génocide par quoi tu commences ton questionnement et que j’évoquerai in fine.) De cette construction du pluriel en moi qui ai vécu de longs mois avec cette parole de l’autre (un autre qui n’est pas autrui, car je suis aussi l’autre de cet autre), est né Débris de tuer (et je m’inspire ici précisément de ce que j’ai pu dire ailleurs, car il ne m’est pas possible d’exprimer les choses autrement). Invariablement, vivant avec les rescapés, dans le cénacle halluciné de la pensée, avec leur parole, avec leurs silences surtout, j’ai été, inlassablement, dans leur « langue le muet » (la formule est d’André du Bouchet). Invariablement, je n’ai voulu qu’une seule chose, contribuer, en faisant parler l’horreur que j’ai pu déceler dans leurs témoignages, à faire parler (individuellement, de telle sorte que la parole ne soit plus visée vers mais retour sur) ces êtres (à les faire parler par-delà le mensonge du langage, le mensonge de la logique qu’est tout langage, à les faire parler avec le souffle seul), avant qu’ils ne prêtent leurs lèvres « à une parole anonyme de l’histoire », comme l’écrit Lévinas, laquelle parole, parce qu’obligatoirement structurée (car organisée, qu’elle soit du reste synthétisée – ce qui est le cas le plus souvent – ou complexifiée), est mensongère quant à la trajectoire toujours individuelle de la douleur, et quant à l’horreur qui s’inscrit en l’être en épousant la trajectoire individuelle de la douleur. Ainsi, il s’agissait non pas de prendre le pas sur leur parole en faisant advenir une parole qui soit autre, mienne, et donc évidemment mensongère (car mystificatrice, en dépit même de son pouvoir – qui est en d’autres contextes une vertu – heuristique), mais de faire parler inlassablement l’horreur que les témoignages m’avaient donnée à lire, sans qu’elle soit formulée.
Cette horreur, c’est aussi celle de la défaite (irrévocable) du dire. De tout dire face à un événement aussi informulable qu’un génocide. Il y aurait ainsi, pour finir, une mort dans la langue, en ce sens que cette dernière ne saurait nullement exprimer ce pour quoi pourtant elle existe entièrement, incapacité motrice dans son cours même qui fait d’elle une langue mort-née, morte avant d’être arrivée à terme. Cela me fait songer très fortement à l’ouverture de La confusion de Faust(Dernier Télégramme) : « Il s’est commis un meurtre. […] Il s’est commis un meurtre. / En cette heure creuse, il est bien possible que ce soit celui de la parole […] ».
Et ce crime, de ton côté, est-il possible de le vivre au quotidien ? Comment se construit l’écriture en toi ?
Mathieu BROSSEAU : Je pense au métabolisme. Un corps ça bouge, je pense au tuyau glotte-sphincters, je pense à la conscience qui percute, .jpg) avale, digère et oublie. La perception du temps n’est qu’une succession de consciences (qui se pensent une). La prise de conscience, c’est l’Euréka, la jointure. Mais ce lien ténu, cette pénétration puis ce retrait du réel, forment un mouvement composite infiniment fragmentable (là où la mort et la renaissance sont partout).
avale, digère et oublie. La perception du temps n’est qu’une succession de consciences (qui se pensent une). La prise de conscience, c’est l’Euréka, la jointure. Mais ce lien ténu, cette pénétration puis ce retrait du réel, forment un mouvement composite infiniment fragmentable (là où la mort et la renaissance sont partout).
L’horloge ne donne pas l’heure, ni les secondes mais les frappes de la conscience sur le réel.
Dans mon livre qui vient de paraître, Ici dans ça, j’écris : « On sait bien que toute littérature n’est que frappes d’images dans le corps, reflets d’ailleurs, l’araignée irrémédiablement extérieure, la mort, toute littérature est histoires de bombardements ». L’idée, pour moi, est de retrouver ce qui se niche précisément dans les entretemps que j’appelle absences. D’autres les appelleraient trous. Il n’y a pas de mouvement UN et c’est pourquoi nous pensons notre vie et notre fin. Le meurtre de la parole est ce temps de retrouvaille avec l’absence d’entre les temps. Et ma théorie est précisément que la parole vient comme un vernis, un enduit, combler et lisser ces petits espaces vides, ces absences, ces entre-secondes, pour nous faire croire en la continuité (qui est en soi une vraie croyance, et donc un vrai dieu). La parole viendrait ainsi compenser pour rééquilibrer l’identité temporelle en faillite, à cause d’un foutu manque primordial : que se joue-t-il entre les temps, n’y aurait-il pas un peu d’éternité là-dedans ? Ou plutôt l’idée que nous en avons. Une aspiration sereine vers du rien ? Vers une inexistence reposante. Le repos d’une mort vécue.
Alors, relier les temps en parlant le discours même du temps (un discours reliant de façon naturelle et harmonieuse – structurellement non narrative et donc possiblement hors temps), ne serait-ce pas ça la poésie ? Mais parler le temps revient nécessairement à se dédoubler : vivre et mourir dans un même mouvement.
Mathieu Brosseau vit et travaille à Paris. Il a publié dans les revues : Action Restreinte, L’Etrangère, Ouste, Libr_critique, Remue.net, Dock(s), Boudoir & autres, Marelle et d’Ici-là, Sitaudis, Owerwriting, Fusées, Ce qui secret, La vie manifeste, etc. Ses derniers livres parus : Et même dans la disparition (éditions Wigwam, mars 2010), La confusion de Faust (éditions Le Dernier Télégramme, mars 2011), Uns (éditions Le Castor Astral, juin 2011). A paraître : Ici dans ça (éditions Le Castor Astral, juin 2013).
Docteur en littérature française, Matthieu Gosztola a obtenu en 2007 le Prix des découvreurs. Une vingtaine d’ouvrages parus, parmi lesquels Débris de tuer, Rwanda, 1994 (Atelier de l’agneau), Recueil des caresses échangées entre Camille Claudel et Auguste Rodin (Éditions de l’Atlantique), Matière à respirer (Création et Recherche). Ces ouvrages sont des recueils de poèmes, des ensembles d’aphorismes, des proses, des essais. Site internet : http://www.matthieugosztola.com.
![[Entretien] La mort dans la langue, dialogue entre Mathieu Brosseau et Matthieu Gosztola [Dossier Brosseau 2/3]](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)