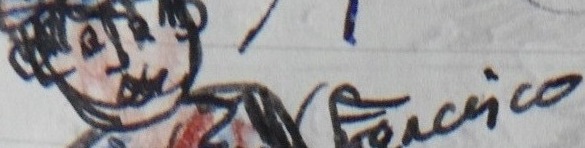
Nous remercions Christian Prigent d’avoir bien voulu nous donner en addendum au Dossier cet extrait d’un entretien avec Alain Jugnon sur Les Enfances Chino (à paraître en 2014 dans le numéro 1 des Cahiers Contre-Attaque).
Alain Jugnon. Le soin que vous mettez à écrire un monde peut-il être un soin pour le monde ? à l’époque de l’horreur occidentale, quelle clinique pour quelle critique ? si ce n’est plus guérir, est-ce encore panser ? quel type d’artiste va apparaître ?
Christian Prigent. — […] Ce qui artistiquement « apparaît » naît au fil d’activités créatrices entendues comme formes multiples de résistance à la réduction. Mais une activité effectivement artistique (id est : non académique, non réduite à la commande spectaculaire, imprévisiblement renouvelée dans ses formes et ses dires) ne l’est que pour autant qu’elle ne sait rien, a priori, de ce qui sous son impact reconfigurera une figure « humaine ». Il faut faire avec cette nietzschéenne « ignorance quant à l’avenir ». Je ne sais évidemment rien du « type d’artiste » qui est en train de venir. Je ferai juste cette remarque : « sois artiste ! » est devenu une injonction d’époque, facilitée, voire provoquée, par l’extension des réseaux internet, sites, et blogs divers. On ne peut manquer d’y soupçonner une invitation de la demande idéologico-mercantile elle-même. Cependant, innombrables sont ceux qui, dans l’envers du souci pragmatique et contre l’identification de la vie à la circulation des marchandises, y vont de leur production « poétique » gratuite, libérée de la sélection éditoriale et indifférente à la figure du « grand artiste » emblématique de son temps. Le poète Jean-Claude Pinson voit dans ce mouvement émerger ce qu’il appelle un « poétariat », une forme nouvelle de « démocratie artistique ». Mais reste, insistante et toujours aussi énigmatique, la question de la « valeur ». Disons qu’il n’est pas sûr que « démocratique » ait un sens, du côté de « l’esthétique ». Je ne le dis pas par morgue d’artiste plus ou moins « reconnu ». Mais parce que me taraude la question de l’excellence et de la singularité : celle de la capacité de quelques œuvres à s’excepter violemment, dès quelles apparaissent, du lieu commun — y compris du lieu commun de la production contemporaine — pour refonder notre vision des choses et garder comme je le disais le monde ouvert. Ce qui fonde la valeur de l’apparaissant, c’est sa puissance de transformation. Or celle-ci n’apparaît que dans le déjà apparu (= a posteriori). Mais au moins savons-nous qu’il n’est de valeur que dans ce qui nous maintient intranquilles et insoumis. Notre question, devant « ce qui apparaît », c’est : qu’est-ce qui y incarne un refus d’être aliéné aux représentations dominantes ? Qu’est-ce qui y forme les formes de cette insoumission, les formes formées et déformées par la certitude sensible que le monde effectivement éprouvé est toujours altérité innommable au réseau des noms déjà configurés ? Pas de réponse arraisonnable, à cela. En tout cas, nul ne le sait d’avance. Parce que c’est de non-savoir qu’il s’agit, d’échappée à la coagulation des savoirs, des idées et des mélodrames d’époque, qui sont des armes de soumission parce qu’ils règlent l’acceptation déprimée, la réduction de l’être à un « reflet des choses » qu’il possède – comme disait déjà Georges Bataille – et à son désir de participer aux bouffonneries dé-réalisantes du spectacle. C’est ce qu’intime à Chino « le flic du monde à gros sous, son doigt sympa pointé sur [son] estomac » : « sois ce que tu manges, ce dont tu te nippes […]. Soit in extenso ce que tu achètes » (p. 241).
Mais parce que me taraude la question de l’excellence et de la singularité : celle de la capacité de quelques œuvres à s’excepter violemment, dès quelles apparaissent, du lieu commun — y compris du lieu commun de la production contemporaine — pour refonder notre vision des choses et garder comme je le disais le monde ouvert. Ce qui fonde la valeur de l’apparaissant, c’est sa puissance de transformation. Or celle-ci n’apparaît que dans le déjà apparu (= a posteriori). Mais au moins savons-nous qu’il n’est de valeur que dans ce qui nous maintient intranquilles et insoumis. Notre question, devant « ce qui apparaît », c’est : qu’est-ce qui y incarne un refus d’être aliéné aux représentations dominantes ? Qu’est-ce qui y forme les formes de cette insoumission, les formes formées et déformées par la certitude sensible que le monde effectivement éprouvé est toujours altérité innommable au réseau des noms déjà configurés ? Pas de réponse arraisonnable, à cela. En tout cas, nul ne le sait d’avance. Parce que c’est de non-savoir qu’il s’agit, d’échappée à la coagulation des savoirs, des idées et des mélodrames d’époque, qui sont des armes de soumission parce qu’ils règlent l’acceptation déprimée, la réduction de l’être à un « reflet des choses » qu’il possède – comme disait déjà Georges Bataille – et à son désir de participer aux bouffonneries dé-réalisantes du spectacle. C’est ce qu’intime à Chino « le flic du monde à gros sous, son doigt sympa pointé sur [son] estomac » : « sois ce que tu manges, ce dont tu te nippes […]. Soit in extenso ce que tu achètes » (p. 241).
Au moins y a-t-il, donc, cette résistance. Littérature (faire de la…) en est pour moi le nom. Sans illusion aucune sur un  quelconque effet immédiatement critique — thérapeutique pas davantage. Tout cela ne joue que dans les catacombes du spectacle et de la politique pragmatique. Voire de la «vie littéraire », qui n’est le plus souvent que le supplément d’âme de ce pragma : un ornement destiné à réchauffer « les eaux glacées du calcul égoïste ». On ne fait de la littérature que pour se poursuivre, soi, en tant qu’humain insatisfait (c’est une tautologie) ; et, ce faisant, pour maintenir « de l’humain » parmi les décombres de la politique, les retours du religieux, la fadeur chromo de l’image de l’homme que notre monde sommairement crayonne et narcissiquement idolâtre pour avoir moins peur de l’énormité de la (vraie) vie. Ponge, Artaud (etc.), sont d’un tout autre temps : ils écrivaient dans un moment politique et culturel où la figure de l’écrivain était encore prestigieuse. Non comme vedette médiatique mais comme conscience d’époque, détenteur de clefs d’interprétation, proférateur de promesse, acteur de révolution et inventeur de vision : Camus, Aragon, Char, Sartre, la poésie encore dans sa gloire « résistante », etc… Même les « avant-gardes » des années 1960/70 fonctionnaient encore, nonobstant bien des réserves moqueuses, sur ce modèle. (Voir par exemple les déclarations dont un Pierre Guyotat accompagnait alors ses romans (entre autres dans Littérature interdite, Gallimard, 1972). C’en est fini, depuis très longtemps. Qui peut croire le contraire, rêver que ça ait encore (un) lieu ? L’onde de l’impact artistique, littéraire et philosophique, si onde il y a, n’agit plus du tout ainsi. Voire n’agit plus. Ceux qui ont régulièrement la parole (et peuvent s’illusionner encore sur une « influence »), ce sont pour l’essentiel des intellectuels mondains à la pensée vulgaire et au style académique. Et les écrivains (ceux qui ne sont ni du tout-venant roturier des gondoles, ni du « demi-monde » littéraire stylé : je parle de la littérature dite « de qualité » – ainsi, entre bien d’autres, la plupart des livres que publie désormais la maison qui fit découvrir il n’y a pourtant pas si longtemps Beckett, Simon, Duvert, etc.) bricolent leurs visions ailleurs, dans une sorte de nulle part polonais ; ceux dont le bruitage surexposé parle (les Angot, Houellebecq, etc) : pitance pour le spectacle, prétextes à mini-scandales, soutien au chœur du confort idéologique, n’est-ce pas ?… Pire : ce qui semble mort, c’est ce type de livre auquel notre discussion comme par réflexe se réfère, cette figure grandiose de l’écrivain, ces « grandes irrégularités de langage », ces œuvres qui traversent, comme on dit, le temps, ces textes exorbitants qui saisissent quelques jeunes gens inquiets au point de reconfigurer radicalement leurs vies. Est-ce que ces figures font encore sens ? Je ne sais. J’en doute. On voit surtout cette aristocratie se dissoudre dans l’effervescence prétenduement « démocratique » des réseaux. Je ne peux m’empêcher d’en être, pour le moins, désappointé. Mais ne pas se poser la question frapperait d’emblée d’insignifiance et d’incongruité tout ce qu’on pourrait dire sur le sujet et qui appartient sans doute à une histoire périmée. Je veux croire que cette péremption n’est pas définitive. Et j’aimerais que la sensation que j’en ai ne relève que de mon propre vieillissement. Parce que je ne peux aimer la littérature que si elle est encore et toujours ça, cette indéfendable aristocratie occupée à de prétentieuses prouesses — et ça veut dire, hélas, primo, n’aimer que fort peu de choses dans ce qui se pare encore du nom de littérature comme dans ce qui médiatiquement promeut ses productions ; deuzio, se sentir assez cruellement déclassé et anachronique dans le paysage où pourtant l’on persiste à déposer quelques œuvres incongrues — dont, vaniteusement, on aimerait bien qu’elles soient, stricto sensu, « monumentales ».
quelconque effet immédiatement critique — thérapeutique pas davantage. Tout cela ne joue que dans les catacombes du spectacle et de la politique pragmatique. Voire de la «vie littéraire », qui n’est le plus souvent que le supplément d’âme de ce pragma : un ornement destiné à réchauffer « les eaux glacées du calcul égoïste ». On ne fait de la littérature que pour se poursuivre, soi, en tant qu’humain insatisfait (c’est une tautologie) ; et, ce faisant, pour maintenir « de l’humain » parmi les décombres de la politique, les retours du religieux, la fadeur chromo de l’image de l’homme que notre monde sommairement crayonne et narcissiquement idolâtre pour avoir moins peur de l’énormité de la (vraie) vie. Ponge, Artaud (etc.), sont d’un tout autre temps : ils écrivaient dans un moment politique et culturel où la figure de l’écrivain était encore prestigieuse. Non comme vedette médiatique mais comme conscience d’époque, détenteur de clefs d’interprétation, proférateur de promesse, acteur de révolution et inventeur de vision : Camus, Aragon, Char, Sartre, la poésie encore dans sa gloire « résistante », etc… Même les « avant-gardes » des années 1960/70 fonctionnaient encore, nonobstant bien des réserves moqueuses, sur ce modèle. (Voir par exemple les déclarations dont un Pierre Guyotat accompagnait alors ses romans (entre autres dans Littérature interdite, Gallimard, 1972). C’en est fini, depuis très longtemps. Qui peut croire le contraire, rêver que ça ait encore (un) lieu ? L’onde de l’impact artistique, littéraire et philosophique, si onde il y a, n’agit plus du tout ainsi. Voire n’agit plus. Ceux qui ont régulièrement la parole (et peuvent s’illusionner encore sur une « influence »), ce sont pour l’essentiel des intellectuels mondains à la pensée vulgaire et au style académique. Et les écrivains (ceux qui ne sont ni du tout-venant roturier des gondoles, ni du « demi-monde » littéraire stylé : je parle de la littérature dite « de qualité » – ainsi, entre bien d’autres, la plupart des livres que publie désormais la maison qui fit découvrir il n’y a pourtant pas si longtemps Beckett, Simon, Duvert, etc.) bricolent leurs visions ailleurs, dans une sorte de nulle part polonais ; ceux dont le bruitage surexposé parle (les Angot, Houellebecq, etc) : pitance pour le spectacle, prétextes à mini-scandales, soutien au chœur du confort idéologique, n’est-ce pas ?… Pire : ce qui semble mort, c’est ce type de livre auquel notre discussion comme par réflexe se réfère, cette figure grandiose de l’écrivain, ces « grandes irrégularités de langage », ces œuvres qui traversent, comme on dit, le temps, ces textes exorbitants qui saisissent quelques jeunes gens inquiets au point de reconfigurer radicalement leurs vies. Est-ce que ces figures font encore sens ? Je ne sais. J’en doute. On voit surtout cette aristocratie se dissoudre dans l’effervescence prétenduement « démocratique » des réseaux. Je ne peux m’empêcher d’en être, pour le moins, désappointé. Mais ne pas se poser la question frapperait d’emblée d’insignifiance et d’incongruité tout ce qu’on pourrait dire sur le sujet et qui appartient sans doute à une histoire périmée. Je veux croire que cette péremption n’est pas définitive. Et j’aimerais que la sensation que j’en ai ne relève que de mon propre vieillissement. Parce que je ne peux aimer la littérature que si elle est encore et toujours ça, cette indéfendable aristocratie occupée à de prétentieuses prouesses — et ça veut dire, hélas, primo, n’aimer que fort peu de choses dans ce qui se pare encore du nom de littérature comme dans ce qui médiatiquement promeut ses productions ; deuzio, se sentir assez cruellement déclassé et anachronique dans le paysage où pourtant l’on persiste à déposer quelques œuvres incongrues — dont, vaniteusement, on aimerait bien qu’elles soient, stricto sensu, « monumentales ».
![[Entretien] Résister en langue, entretien avec Alain Jugnon (Christian Prigent, les aventures de l'écriture 7/7)](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)