Jérôme Bertin, Cas Soc’, éditions Vanloo, Aix-en-Provence, en librairie mais sortie officielle le 24 novembre 2018, 70 pages, 12 €, ISBN : 979-10-93160-32-0.
Quand on parle de l’écriture de Jérôme Bertin, on convoque la « phrase ciselée », courte, percutante. Puis on évoque la « parole », celle des prolos qui, au demeurant, ne sont près ni de lire ni d’accepter cette langue qui parle d’eux. Tout est vrai, ça saute aux yeux.
Au début de Cas Soc’, son dernier roman, il est question d’une vieille adipeuse, vulgaire et péteuse, qu’il héberge chez lui. Il s’endort, elle ronfle. L’épisode se termine par cette formule : « Au matin elle a mis les vents… » (p. 9), curieux mélange des « vents » que sont les pets et des « voiles » que l’on met quand on se tire. Jérôme Bertin est coutumier de ces mélanges d’expressions, c’est un jeu, une façon de parsemer l’écrit de marqueurs poétiques, mais des marqueurs point trop nobles.
Une expression en recouvre une autre, lâcher un vent par-dessus mettre les voiles, strates du temps de partir, strates du temps de n’être plus là, où l’odeur seulement reste encore. Marqueur poétique pour marqueur du temps mais comme accélération. Ici, ce qui condense accélère.
« Les mêmes clients nous moquent, pensant comme on pue fort que je suis son amant. » Une phrase de monosyllabes. Sur 15 mots, seuls 3 mots de 2 syllabes. En bonne rhétorique, l’abus des monosyllabes tue le rythme. Ici non. Au contraire. Ça file sur les ailes du « comme on pue fort » (p. 9), résumé d’idée et de rythme, articulation majeure, huile dans les rouages. Ce qu’on entend ? Une petite musique que rien n’arrête, désinvolte et abominablement précise.
Il serait bon d’étudier de façon plus exhaustive la manière dont s’y prend Bertin pour tenir une telle cadence, les procédés poétiques, la précision de la prosopopée… Et quelle énergie il faut pour rester au plus près de cette musique de poche, cadre obsédant, indispensable tant il est le cœur du travail
.
C’est le cadre de l’autofiction ; l’autofiction est l’écriture. Car je me vis en train d’écrire.
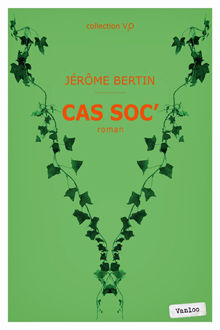 D’abord, il y a urgence. Les personnages comme précipités, tracés à grands traits, puis jetés sur le bord du récit, on y reviendra plus tard, ou non, ça importe peu. Il est d’ailleurs étonnant de voir avec quelle précision ils nous sont présentés, et avec quelle désinvolture ils sont abandonnés. Il y a quelque chose de la chair à canon dans le champ de bataille du livre. Tant d’affection et tant de violence leur sont faites, quasi dans le même temps. Cet art consommé de savoir laisser ce qui est venu à la conscience. Puisque l’écrivain sait que ce qui soudain lui vient à la conscience n’intéresse déjà plus personne. Il faut le jeter sous peine d’en crever, d’en devenir un histrion qui s’accroche à ses grimaces, sans même se souvenir du jour où elles furent une fois, une seule fois, vraies. Jérôme Bertin n’écrit donc que ce qui lui échappe.
D’abord, il y a urgence. Les personnages comme précipités, tracés à grands traits, puis jetés sur le bord du récit, on y reviendra plus tard, ou non, ça importe peu. Il est d’ailleurs étonnant de voir avec quelle précision ils nous sont présentés, et avec quelle désinvolture ils sont abandonnés. Il y a quelque chose de la chair à canon dans le champ de bataille du livre. Tant d’affection et tant de violence leur sont faites, quasi dans le même temps. Cet art consommé de savoir laisser ce qui est venu à la conscience. Puisque l’écrivain sait que ce qui soudain lui vient à la conscience n’intéresse déjà plus personne. Il faut le jeter sous peine d’en crever, d’en devenir un histrion qui s’accroche à ses grimaces, sans même se souvenir du jour où elles furent une fois, une seule fois, vraies. Jérôme Bertin n’écrit donc que ce qui lui échappe.
Seul le chat, Bardamu, revient, de livres en livres, de pages en pages, quand l’écrivain lève les yeux, quand il doit se reposer pour ne pas exploser, il est là, le chat, ce seul réel acceptable car il se suffit à lui-même.
Les personnages, disons les rencontres, maquillées en figures pour qu’elles ne soient pas trop vivantes, qu’elles entre dans de l’acceptable écriture, et pourquoi pas ? Dans Cas Soc’, des vieux, des vieilles, pas des prolos, des pires que ça, des sans statuts, des ni SDF ou un peu trop SDF, des vieux à qui il reste peu. Des marginaux vieux. Des écrasés entre les strates du montrable : pas assez miséreux pour faire vraiment pitié, pas assez représentatifs pour que s’en emparent les combattants de la révolution au poing levé, pas de bons clients au fond. Pour eux la langue doit aller très vite. Qui oserait s’y intéresser plus d’un paragraphe ?
figures pour qu’elles ne soient pas trop vivantes, qu’elles entre dans de l’acceptable écriture, et pourquoi pas ? Dans Cas Soc’, des vieux, des vieilles, pas des prolos, des pires que ça, des sans statuts, des ni SDF ou un peu trop SDF, des vieux à qui il reste peu. Des marginaux vieux. Des écrasés entre les strates du montrable : pas assez miséreux pour faire vraiment pitié, pas assez représentatifs pour que s’en emparent les combattants de la révolution au poing levé, pas de bons clients au fond. Pour eux la langue doit aller très vite. Qui oserait s’y intéresser plus d’un paragraphe ?
Là encore Bertin ruse. De ses vraies rencontres il fait des figures, puis des images du kaléidoscope de l’auteur en train d’écrire. On ne creuse pas, on donne l’apparence, la première impression qui est toujours si juste. Chaque épisode, chaque rencontre doit s’inscrire dans le temps précipité de la langue pour cette raison que ce qui est entre les strates ne peut guère que s’apercevoir, se saisir au vol, voire se deviner, tout comme certains précipités en chimie.
L’autofiction s’inquiète de ce que le rythme de la pensée va plus vite que celui de l’écriture. La musique intérieure, à la fois physique et intellectuelle, comme une synthèse, ce qu’il y a de moins mauvais pour rester vivant. On ne court pas contre l’anéantissement, mais pour respecter ce qui est vivant, c’est-à-dire cette tension entre l’idée trop rapide et le souffle trop lent. L’écriture est une recherche de synthèse. Pas un simple équilibre (l’équilibre est éternel, une fois tenu il ne flanche pas), mais une dynamique, aussi infime soit elle. L’écriture n’a pas de regret, ni de nostalgie, elle s’inscrit dans le temps décalé, légèrement étriqué, étouffé, d’une forme de présent, un présent qui court un peu derrière ce qu’il vient de penser. Et cette course poursuite est un épuisant gai-savoir.
![[Chronique] Le temps précipité d'une langue (sur Jérôme Bertin, Cas Soc'), par Philippe Hauer](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2018/11/BertinCassocBackG.jpg)
![[Chronique] Le temps précipité d’une langue (sur Jérôme Bertin, Cas Soc’), par Philippe Hauer](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2018/11/band-BertinCassoc.jpg)