 Alain Jessua, La Vie à l’envers, éditions Léo Scheer, (roman + DVD)
Alain Jessua, La Vie à l’envers, éditions Léo Scheer, (roman + DVD)
ISBN : 978-2-7561-0086-9 25 € [site des éditions Léo Scheer]
[Quatrième de couverture]
De ce roman limpide et vertigineux, resté inédit, Alain Jessua avait tiré son premier film, qui n’avait jamais été édité en DVD. En 1964, ce chef-d’oeuvre marqua ceux qui eurent le privilège de le voir, tel Martin Scorsese. La présente édition, en réunissant les deux oeuvres, manifeste avec éclat la singularité et la cohérence d’un grand artiste.
[Chronique]
Une métamorphose
 On commencera par une réflexion sur l’acte même de mettre à la disposition du public un texte inédit qui date de la même époque qu’un film devenu inaccessible (1964), c’est-à-dire en pleine période avant-gardiste. Ce qui apparaît comme une nécessité éditoriale présente également un intérêt artistique : non pas qu’il s’agisse de faire découvrir un chef-d’oeuvre, comme le claironne la quatrième de couverture, puisqu’à l’évidence La Vie à l’envers ne saurait accéder à l’ inactuel ; la valeur de ce diptyque est plutôt d’ordre historique, liée à ce qu’elle nous apprend sur une modernité datée.
On commencera par une réflexion sur l’acte même de mettre à la disposition du public un texte inédit qui date de la même époque qu’un film devenu inaccessible (1964), c’est-à-dire en pleine période avant-gardiste. Ce qui apparaît comme une nécessité éditoriale présente également un intérêt artistique : non pas qu’il s’agisse de faire découvrir un chef-d’oeuvre, comme le claironne la quatrième de couverture, puisqu’à l’évidence La Vie à l’envers ne saurait accéder à l’ inactuel ; la valeur de ce diptyque est plutôt d’ordre historique, liée à ce qu’elle nous apprend sur une modernité datée.
☛ La Nausée
Jacques Valin, le héros/antihéros de La Vie à l’envers, apparaît assez vite comme un avatar d’Antoine Roquentin : cet homme seul bénéficie en effet des mêmes apanages, l’extralucidité et l’humour pince-sans-rire. S’il est lié à Viviane, cover-girl élue Miss Camembert (sic !), qu’il finit par épouser pour lui faire plaisir et "avoir la conscience tranquille", il est si peu dupe qu’il est capable de ce genre de remarque à froid : "Qui sait, je l’ai peut-être épousée à cause de ses pieds ?" (p. 32) ; que, tel Roquentin face à Anny, il refuse d’entrer dans son jeu, la démasquant et la réduisant à une surface lisse de pin-up : il la voit s’agiter "comme une marionnette avec son chapeau sur la tête, dans son grand numéro de femme jalouse" (64) ; et même après sa tentative de suicide, il la jauge avec détachement : "C’est vrai, Viviane était guérie. Elle se peignait les ongles des pieds" (79). Au reste, lui qui ne comprend rien à "la poésie du petit moineau et du saule pleureur" (34), comment pourrait-il ne pas être agacé par les "cris d’oiseau" de sa compagne ? Cet esprit critique s’exerce naturellement à l’encontre de ce rite social qu’est le mariage : "Le nombre de trucs qu’on peut vous proposer dès que vous allez vous marier : la photo de famille, la batterie de cuisine, la vaisselle, les couches du futur lardon. C’était à se demander si on n’allait pas vous vendre par mensualités une méthode de copulation sans douleur" (21). Et naturellement cet humour s’applique à des cibles extra-conjugales. Son ami Paul : "Même dans la vie, il ne descendait jamais tout à fait de son trapèze" (39). Sa mère : "Ce n’était pas une excellente comédienne mais elle avait de très bons moments" (99).
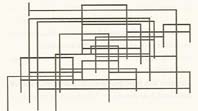 C’est dire à quel point il va rapidement prendre ses distances vis-à-vis du "monde des hommes", selon la fameuse formule de La Nausée : "Ils ne peuvent donc pas supporter de me voir heureux tout seul" (97). Abandonnant progressivement ses "yeux de tous les jours" (58), il se met à "regarder autrement" (57). Et d’accéder à son tour à l’envers du monde : sous son regard décapant, ce n’est pas un verre de bière comme dans La Nausée, mais un verre de limonade qui se métamorphose : "Je n’ai plus vu les bulles mais des espèces d’enveloppes géantes, légères et transparentes, dans lesquelles je m’élevais jusqu’à la surface du verre" (37). Plus loin, ce sont tous les meubles de la chambre, et jusqu’aux murs, qui s’animent. En fait, se libérant de leur ustensilité, les choses se mettent à exister : "Les meubles c’est comme les arbres, comme les buissons, si on ne fait pas attention, ça vous grignote. Ils ont grandi. Ils ont envahi mes murs, mon tapis, ma chambre. Ils voulaient se libérer. Si je n’agissais pas tout de suite, ils m’écraseraient. C’était eux ou moi" (90).
C’est dire à quel point il va rapidement prendre ses distances vis-à-vis du "monde des hommes", selon la fameuse formule de La Nausée : "Ils ne peuvent donc pas supporter de me voir heureux tout seul" (97). Abandonnant progressivement ses "yeux de tous les jours" (58), il se met à "regarder autrement" (57). Et d’accéder à son tour à l’envers du monde : sous son regard décapant, ce n’est pas un verre de bière comme dans La Nausée, mais un verre de limonade qui se métamorphose : "Je n’ai plus vu les bulles mais des espèces d’enveloppes géantes, légères et transparentes, dans lesquelles je m’élevais jusqu’à la surface du verre" (37). Plus loin, ce sont tous les meubles de la chambre, et jusqu’aux murs, qui s’animent. En fait, se libérant de leur ustensilité, les choses se mettent à exister : "Les meubles c’est comme les arbres, comme les buissons, si on ne fait pas attention, ça vous grignote. Ils ont grandi. Ils ont envahi mes murs, mon tapis, ma chambre. Ils voulaient se libérer. Si je n’agissais pas tout de suite, ils m’écraseraient. C’était eux ou moi" (90).
Pour ceux qui douteraient encore que La Nausée soit l’hypotexte de La Vie à l’envers, trois scènes emblématiques se trouvent récrites ici. Tout d’abord, celle du Jardin public, qui devient Jardin des Plantes : pour le personnage en extase devant un arbre, les mots perdent leur sens… Celle du miroir, ensuite : comme Roquentin, Valin s’avère incapable de comprendre son visage ("C’était moi, ça ?", p. 47). Celle de la révélation de l’existence, enfin : "passé de l’autre côté des choses ", enfin seul, il "découvre un autre monde", prenant conscience que "tout vit" (93)… Mais, après avoir eu la confirmation que les gens des années soixante sont aussi étrangers à l’existence que ceux des années trente, le lecteur ne doit nullement chercher de philosophie existentialiste, encore moins d’ écriture nauséeuse ou phénoménologique. Non, retour à la case Pascal, via l’école : "Quand j’étais à l’école, notre professeur nous parlait souvent d’un type, un philosophe, je crois, qui disait que tous les malheurs de l’homme viennent de ce qu’il ne sait pas vivre entre quatre murs. Moi, je peux" (93). C’est dire qu’on revient à la bonne-métaphysique-pour-tous.
☛ Journal d’un illuminé
De fait, après un bref séjour parmi les hommes – pour faire allusion au dernier roman de l’auteur (Éditions du Rocher, 2006) -, Jacques Valin bascule dans le monde de la folie. Les symptômes abondent, schizophréniques : "J’ai regardé mon profil droit…mon profil gauche. J’ai cru qu’il s’agissait de deux personnes différentes" (48), ou mégalomaniaques : "Je peux tout faire si je le veux" (93). En proie à de nombreuses hallucinations visuelles et auditives, Jacques Valin se perd dans un dédale intérieur que matérialise le labyrinthe qu’il trace lui-même en lieu et place d’un courrier… Avant même de tenir son journal parlé, grâce au magnétophone prêté par le médecin, il manifeste les mêmes troubles que le narrateur du Journal d’un fou de Gogol : les repères spatio-temporels se délitent, tout comme le sens de certains mots, tandis qu’il est persuadé de détenir à lui seul la vérité… Affublé d’un patronyme maupassantien (voir, entre autres, le conte "Aux champs"), tout comme le narrateur du "Horla", il sent "une présence étrangère à [ses] côtés" (52), et tout comme le Horla même il est fasciné par le blanc…
Cependant, rien de tragique ici. Certaines hallucinations vont jusqu’à se révéler des plus cocasses :
"L’Assemblée nationale a élu Miss France par 271 voix contre 170.
Je savais que les députés aimaient le beau sexe mais, quand même, j’étais un peu étonné. Je suis passé à une autre vitrine. J’ai vu la photo d’un bon gros bébé joufflu et, sur trois colonnes, ce titre :
L’ASSASSIN DE CLAMART ARRÊTÉ. Marcel Bernardi, deux ans et demi, avoue son horrible forfait" (50-51).
En outre, le monde auquel il accède est présenté comme idéal, doté des mêmes caractéristiques esthétiques que celles revendiquées dans "L’Invitation au voyage" de Baudelaire : là, tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté … Une volupté des plus mystiques, celle, suprême, que connaît le sage qui atteint le nirwana :
"Maintenant, je suis seul avec moi-même. J’ai chassé les hommes, j’ai chassé les autres, j’ai chassé leurs masques. Je me suis dépouillé. Mon corps ne pèse plus.
Comment décrire le vide, la paix, le blanc ?" (106).
☛ Naufrage du film de "qualité française"
Alain Jessua est aussi et avant tout un cinéaste marqué par Luis Bunuel, Jean Becker, Max Ophüls, Yves Allégret et Marcel Carné. Bien avant Traitement de choc (1972) et Armaguedon (1977), il traite de l’angoisse propre à l’homme moderne et des relations pathologiques au pouvoir. La Vie à l’envers, où, derrière le rôle principal interprété par Charles Denner, reconnu depuis le succès du Landru de Claude Chabrol en 1962, figure le débutant Jean Yanne, affiche d’emblée son horizon : le film commence comme un film de "qualité française". Mais peu à peu, et bien avant que Jessua ne s’oriente vers la science-fiction avec Crèvecoeur (1999) et Bref séjour chez les vivants (2006), grâce à la façon dont Charles Denner campe le comportement anticonformiste et de plus en plus étrange du personnage, et aussi à des gros plans déréalisants, l’oeuvre s’abîme pour nous plonger dans un autre monde.
![[Livre + chronique] Alain Jesssua, La Vie à l'envers](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)