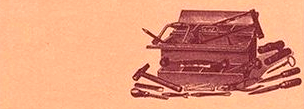 Jean-Luc Caizergues, Mon suicide, Flammarion, 2008, 330 pages, 20 €, ISBN : 978-2-0812-1068-4.
Jean-Luc Caizergues, Mon suicide, Flammarion, 2008, 330 pages, 20 €, ISBN : 978-2-0812-1068-4.
Dans la lignée de sa première poésie-fiction, La Plus Grande Civilisation de tous les temps (Flammarion, 2004), ce machiniste de 55 ans (opéra de Montpellier) nous livre un abyssal précis de décomposition, un vertigineux prêt-à-mourir…
Quatrième de couverture
Jean-Luc Caizergues poursuit avec Mon suicide sa joyeuse entreprise de destruction du paysage contemporain. Comme son précédent ouvrage, ce nouveau volume regroupe trois séquences de poèmes (l’auteur préfère le terme générique de «poésie-fiction») : un Petit catalogue de vente par correspondance qui répertorie jusqu’au vertige les objets usuels d’une maison étrangement désertée ; Perdant, qui égrène une série de défaites cruelles ou navrantes ; Mon suicide enfin, petit musée des horreurs intimes – d’un humour noir à la Topor – où les pères cherchent à se débarrasser des fils (et inversement). Un court récit en prose : Mourad, jette à la fin du volume une lumière plus trouble sur cette singulière entreprise, où le poème se voit littéralement réduit à sa plus simple expression.
Chronique
Quelque quatre-vingts ans après que Cendrars a proclamé que la publicité est la poésie des temps modernes, vous abordez le "Petit catalogue de vente par correspondance" en croyant à première vue avoir affaire à une série de petites annonces ou d’encarts publicitaires. Seulement, très vite le malaise s’empare de vous : tout n’est que vide, désolation et destruction. Si de nos jours la vie d’un Occidental peut se lire au travers des choses qu’il possède, c’est bel et bien dans un univers objectivement dramatique que nous sommes plongés : ustensiles hors d’usage, mobilier saccagé… Nous rencontrons même une image de l’enfer : 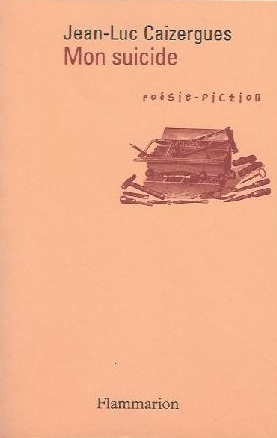
"chants
barbares
program-
més
et
répétés
en bou-
cle" (p. 69).
Soudain, la fin d’1 monde (93) : sang, mort…
Le deuxième volet change de registre : à l’atmosphère trouble et à la progression dramatique succède un véritable jeu de massacre allègrement horrible. Un surréaliste humour noir imprègne ces micro-contes cruels à la syntaxe désarticulée qui, reposant sur l’inversion des valeurs ou le renversement de situation, sont autant d’épiphanies infernales. Deux exemples parmi d’autres :
"L’AVEUGLE
Il brandit
sa canne
plombée
au-dessus
de ma
tête avant
de fendre
le crâne
de sa fille
blottie
dans mes
bras" (115).
"DÉPORTATION
Le contrôleur
qui
examine
mon billet
m’informe :
Vous
vous êtes
trompé
de train.
Puis ajou-
te : Je
plaisante" (174).
Ici, les victimes sont les bourreaux, les interdits paradoxaux, les jeux mortels, les parents infanticides, les enfants monstrueux, les incendiaires incendiés, les prises d’otage des carnavals… Si "détournement" (169) il y a, c’est bien celui de la parole biblique, du décalogue aux évangiles : "Honore ton père et ta mère", "Laissez venir à moi les enfants", "Ceci est mon sang"… On risquera un mot-valise pour rendre compte de cet univers jaune-noir : carnavage.
L’avant-dernière partie, qui confère son titre au recueil, reprend le même principe de composition : constitué de trois quatrains hétérométriques de vers très courts (une à quatre syllabes), chaque poème, aussi effilé qu’une lame de couteau, dresse devant nos yeux ébahis notre pierre tombale. Qui plus est, cette troisième section combine esthétique de la surprise (antititres, paradoxes) et inventaire objectif des mille et une façons de mourir, par suicide ou non. Y défilent les figures de Sisyphe, la sirène ou du Petit Poucet :
"Avec des
cailloux
ramassés
le long
du chemin
qui le
ramène à
la maison
mon fils
me lapide
dans le
jardin" (241).
Dans ce monde où coexistent bestiaire, requiem et clichés, ce qui frappe c’est la négation des signes d’appartenance, c’est-à-dire le triomphe de la désappropriation, la néantisation de toute humanité.
L’autoréfiction finale, pour employer un second mot-valise, déroule un équivoque fil rouge destiné à nous permettre de mieux appréhender un leitmotiv : l’infanticide. Mais quel que soit le rapport de l’auteur à l’enfance et à la mort, ce qui est certain c’est que l’effet de glaciation que produit cette oeuvre nous conforte dans notre ethos : la musique la plus adéquate à notre époque n’est autre que la marche funèbre.
![[Livre + chronique] Jean-Luc Caizergues, <strong><em>Mon suicide</strong></em>](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)
Ah oui, lu avec grand plaisir.