 Pierre Jourde, La Cantatrice avariée. Roman avec accompagnement d’orchestre. L’Esprit des péninsules, 2008, 261 pages, 19,90 € ISBN : 978-2-35315-035-9
Pierre Jourde, La Cantatrice avariée. Roman avec accompagnement d’orchestre. L’Esprit des péninsules, 2008, 261 pages, 19,90 € ISBN : 978-2-35315-035-9
Quatrième de couverture
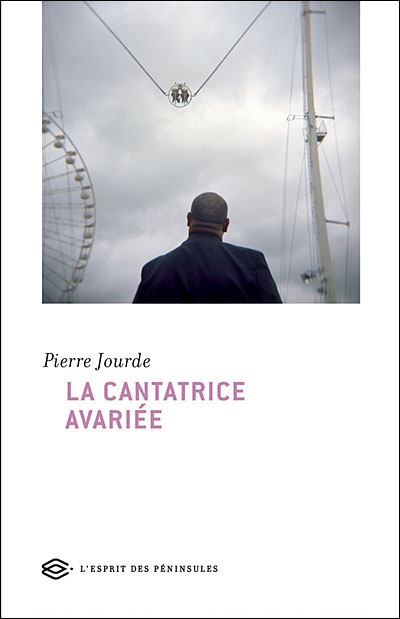 Cela commence dans un château délabré, hanté par des voix et des courants d’air, à la sortie d’un bourg noir, près de Clermont-Ferrand. La secte qui l’occupe y périclite depuis la disparition de son gourou. La fuite des effectifs devient problématique. On parvient encore à recruter, de temps en temps, un ex-communiste ou un chercheur au CNRS, mais les autres disparaissent, avalés par les couloirs brumeux ou récupérés par leurs familles. Deux ex-petits voyous, qui assurent le service d’ordre de la secte, entreprennent de reprendre les choses en main. Leur méthode de récupération des adeptes, quoique originale, pâtit d’une violence regrettable et d’une efficacité douteuse. Pour ne rien arranger, l’un est handicapé par des voix intérieures qui le harcèlent, l’autre par une mère envahissante que même la mort ne parvient pas à décramponner. C’est au cours d’une improbable expédition que certaine trouvaille va bouleverser leur destin et celui de la secte.
Cela commence dans un château délabré, hanté par des voix et des courants d’air, à la sortie d’un bourg noir, près de Clermont-Ferrand. La secte qui l’occupe y périclite depuis la disparition de son gourou. La fuite des effectifs devient problématique. On parvient encore à recruter, de temps en temps, un ex-communiste ou un chercheur au CNRS, mais les autres disparaissent, avalés par les couloirs brumeux ou récupérés par leurs familles. Deux ex-petits voyous, qui assurent le service d’ordre de la secte, entreprennent de reprendre les choses en main. Leur méthode de récupération des adeptes, quoique originale, pâtit d’une violence regrettable et d’une efficacité douteuse. Pour ne rien arranger, l’un est handicapé par des voix intérieures qui le harcèlent, l’autre par une mère envahissante que même la mort ne parvient pas à décramponner. C’est au cours d’une improbable expédition que certaine trouvaille va bouleverser leur destin et celui de la secte.
La Cantatrice avariée est un objet littéraire non identifié : narration picaresque des aventures de deux truands, pleine de rebondissements, de fantaisie, de cruauté, d’événements étranges et de personnages loufoques, c’est aussi un roman gothique à faire peur, avec nécromanciens et ressuscités, un récit burlesque pour faire rire, et surtout, peut-être, une histoire de rédemption.
[Chronique] Une farce mystique
Que les initiés se rassurent, la cantatrice de Jourde a infiniment plus de corps que celle de Ionesco, puisqu’elle n’est autre que l’imposante mère de l’un des deux personnages centraux, Bada :
"Elle avait été cantatrice, avant qu’il l’eût tétée. Elle avait vocalisé en robe blanche et falbalas roses sur toutes les scènes du Berry, de la Marche, de l’Auvergne et même du Poitou, écumées par les tournées Piloselle […]. Elle avait succombé aux entreprises amoureuses de sept dragons, dix-huit lieutenants de hussards, vingt-trois capitaines de cuirassiers, et un sergent d’infanterie. Elle avait épousé pour finir un pianiste catarrheux qui était parti du côlon et l’avait laissée veuve très jeune, avec son fils qu’il avait fallu élever. Adieu, Vienne, Schönbrunn et les glockenspiels, goodbye Mexico, les castagnettes et les mantilles, elle avait cousu tabliers et caleçons dans son garni" (p. 68-69).
Voilà ce qui s’appelle un destin, avec en point d’orgue un clin d’œil à La Fontaine ! Mais, direz-vous, pourquoi avariée ? Sans doute pour annoncer les avatars de cette extravagante ex-cantatrice : réduite à une chose gélatineuse après avoir été renversée par un trente-six tonnes, par déformation professionnelle, elle trouve encore le moyen de pousser des râles pouvant passer pour "les roucoulades de La Vie parisienne" (p. 201) ; mais ce n’était que réchapper pour mieux sombrer quelques pages plus loin… dans un accident d’avion qui atteint l’intégrité de son "précieux corps" – "à la fois déchiqueté, dispersé, écrasé, éclaté, lardé et cuit". À moins que ce titre n’arbore la même incongruité que celui de Ionesco… Au reste, on tient peut-être notre cantatrice chauve dans le compère travesti de Bada, Bolo, lorsqu’en plein slow il en vient à perdre sa perruque…
Pour le moment, relevons deux figures qui évoquent indirectement le romancier et/ou son roman. D’abord, celle d’Erik Satie (1866-1925), musicien ascète qui, fondateur d’une secte (l’Eglise métropolitaine d’art de Jésus-Conducteur), pratique une musique dont les résonances mystiques contrastent avec sa réputation d’humoriste ; ensuite, celle de l’oncle, mise en abyme de l’auteur : aimant "jouer avec les hypothèses métaphysiques", il s’amuse "en construisant des mondes improbables, des aberrations cosmologiques" (p. 259).
Ajoutons que les titres des trois parties dont les exergues, en plus de l’exergue général, sont empruntés à Satie, donnent le la à cette fiction fantaisiste qui retrouve la veine de Festins secrets (L’Esprit des péninsules, 2005) : Allegro feroce, Adagio con fagioli, Andante gluante…
Opus buffa
Du féroce, des haricots et du gluant, il en est question dans ce livre écrit sur le mode bouffon, où, cette fois, la cible est le microcosme mystique, et plus particulièrement le huis clos régressif des sectes. À cet égard, s’avère on ne peut plus révélatrice la cosmogonie – la "mystique potagère" ! – de la secte végétarienne fondée par le "Divin Guide", Manfred von Fanfulla, qui "était le plus grand mangeur de flageolets qui fût", lui dont "la boursouflure [du] corps obéissait à la pression intérieure de [l’]âme" (p. 42) : "Le fayot, avaient glosé quelques théoriciens résiduels, affecte la forme parfaite du germe. Il éveille dans l’intimité cette circulation de souffles en lesquels la vile matière se spiritualise" (39). Après la phase du haricot, la "secte sylvestre" connaît "sa période laitue cosmique" (142), selon laquelle "le temps devait adopter la forme d’une laitue" (143), puis l’"ascèse de la pédale" (181)…
La Chose que poursuivent ces deux crétins illuminés que sont Bolo et Bada, exécuteurs des basses œuvres, sans forcément être un haricot magique, est l’incarnation parodique de l’objet sacré comme de l’objet mélancolique. Convaincus d’avoir capturé la Chose en la personne de la jolie Lou, ils souhaitent d’autant plus se l’incorporer qu’elle ne semble pas réelle… Le résultat : "Lou démontée pièce à pièce, peau, viscères et os, tenait dans l’étui à violoncelle étendu à terre comme un sarcophage" (117). Et "le chœur des anges […] d’entonner pianissimo" une parodie de prière : "Te voici, à présent enfermée dans ton épiderme sans issue. Dis, te penses-tu plus réelle sous cette enveloppe sans défaut ? Te voilà, promesse de musique de peau, de fugues d’os et de concertos pour nez".
Tournant en dérision les élucubrations et les superstitions, les tics et les tocs des adeptes, Pierre Jourde joue avec les codes narratifs des fictions en vogue (newâgesques, policières, gothiques, trashs… sans oublier les fims d’horreur).
"Qu’est-ce que c’est que ces fariboles ?
Ce faisant, il fait la part belle au loufoque et à l’humour noir. La Cantatrice avariée présente en effet un univers où, folie et comédie ne faisant qu’un, nous avons droit à moult récits de délires, hallucinations visuelles et auditives, à des hypothèses farfelues comme celle-ci : "Dieu pouvait-il être un bavard impénitent et ennuyeux dans une robe de chambre rouge, occupé à gratter des maquereaux dans du papier journal, et revendant ses couverts en argent ?" (162) ; ou encore à d’autres micro-biographies fantaisistes que celle de la cantatrice, à des précipités de destins loufoques tel ce dernier : "[…] un jeune psychiatre habitué des émissions de variétés sur les sectes entreprit leur désintoxication mentale. […] Il en profita pour publier des études de cas et cinq ou six livres qui le rendirent encore plus célèbre. Il donna des conférences dans des croisières de luxe aux Caraïbes et mourut trente ans plus tard de la maladie d’Alzheimer, fou à lier, après avoir mordu sa femme, ses enfants et son médecin" (134) ; un univers où un Bolo peut se servir de ses stigmates pour manipuler ses victimes ; où les êtres se défont d’un seul coup et où "une nuée d’insectes" s’échappe d’un corps disséqué (220) ; où la chute d’un piano sur la tête d’une mère produit "un accord de la septième diminué" qui débouche sur un "concerto de la maman écrasée, pour cinq mains dont un moignon" (176-77) ; où il n’est rien de plus facile que de se lancer dans "la contrebande mystique" ou "un enfer ralenti" (222-23) ; où "une grande carpe visqueuse" révèle des secrets (234)… L’interrogation de Nestor, figure en abyme du lecteur, n’a donc rien d’étonnant : "Qu’est-ce que c’est que ces fariboles ?" (168).
Il faut dire que La Cantatrice avariée repousse les limites du vraisemblable comme les frontières entre réel et fiction. Aussi récit excentré – voire décentré, dans la mesure où le centre narratif final est également hypothétique – et récit excentrique vont-ils de pair : puisque la vie est comédie et/de folie, que notre monde est fait de leurres et de parodies perpétuels, le roman est une "machines à simulacres" (183) qui nous fait hésiter entre être et non-être, illusion et réalité, réel et virtuel. D’où le recours à un procédé, fréquent dans les films de Robbe-Grillet, qui vise à accentuer l’indétermination narrative : le démontage-remontage, c’est-à-dire le retour en arrière avec variante narrative (cf. p. 72-73).
Une éthique et une esthétique du neutre
Vu que dans ce roman réflexif tous les éléments sont donnés à ce maître senseur que doit être tout lecteur qui se respecte, pour répondre à la question nestoresque (sic !), il convient de se mettre à l’écoute du texte. De prêter attention, par exemple, à ce passage : "L’une des factions qui jouissait de la plus grande influence occulte prétendait au salut par le grotesque. Elle retournait les propositions les plus sérieuses en dialogues de clowns, réinterprétait tout le dogme version tarte à la crème. On allait le plus directement à Dieu par la pétomanie, le calembour et le poil à gratter" (44). Ou à celui-ci, qui évoque la dernière étape de l’initiation négative qu’ont suivie Bolo et Bada : "Ainsi, leur existence des dernières années leur apparut un beau jour comme une ascèse, une voie vers Dieu inconsciemment suivie : le salut dans la banalité. N’atteignaient-ils pas, dans cette insignifiance, dans cet oubli, comme une suspension du réel ? Une extase légère leur venait d’être vieux, d’être nuls, d’être inconnus, de ne rien faire. Le réel s’abolissait dans son triomphe" (246). Si son point d’aboutissement est une conception du bonheur selon laquelle le salut est dans le "martyre du quotidien" (248), La Cantatrice avariée constitue un anti-roman d’éducation qui sonne le glas des grandes fables métaphysiques prétendant rendre compte de l’humanité et de l’univers.
Les deux extraits ci-dessus sont encore à mettre en relation avec un essai paru chez le même éditeur en 2005, Littérature et authenticité, où Pierre Jourde définit l’éthique et l’esthétique du neutre comme la désappropriation du propre, la dé-singularisation de soi et de la langue, le dépassement des alternatives entre être et non-être, même et autre, positivité et négativité, bref comme l’horizon négatif de la parole et de l’existence : il s’agit d’accéder au non-sens par l’excès (dans l’idiotie et l’in-différence). L’idiotie comme mode d’être-au-monde et comme idiotisme ! Du double point de vue philosophique et stylistique, la rédemption par l’idiotie réside dans la double postulation entre grotesque et loufoque, d’une part, et d’autre part l’in-signifiance.
C’est en ce sens que La Cantatrice avariée ne saurait se réduire à l’affirmation absurde et que Bolo et Bada se situent au carrefour entre Bouvard-et-Pécuchet et Didi-et-Gogo (le fameux couple de En attendant Godot). En dernière analyse, c’est un autre entre-deux qui vient à l’esprit ; il est en effet impossible de ne pas rapporter le duo Bolo et Bada à cette double référence : d’une part, l’utopie Bolo’bolo de P.M. (Zurich, Paranoia City, 1983) ; d’autre part, Capitaine Bada de Jean Vauthier (Gallimard, 1966), qui conjugue tragique et clownesque.
![[Livre + chronique] Pierre Jourde, <strong>La Cantatrice avariée</strong>](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)
Intéressé par les Festins Secrets et carrément conquis par L’Heure et l’Ombre, je n’ai pas du tout apprécié cette Cantatrice, qui a fini dans ma corbeille à papier après avoir eu sa chance sur une centaine de pages. Moins envoûtant qu’un univers à la Ravalec, moins habile qu’une construction à la Chevillard, moins précis dans le choix du lexique qu’un roman de Marie Redonnet, La Cantatrice Avariée m’a semblé une mauvaise idée dont la concrétisation laissait vraiment à désirer.
Décevant de la part d’un auteur aussi prometteur que Pierre Jourde.
Il me semble que la raison de votre deception tient au fait de chercher midi a quatorze heures. Precis dans le lexique, habile, envoutant, bien construit: la Cantatrice ne me semblait pas viser cela, mais plutot le bancal, l’effondre, le flou etc. Vous ne goutez pas le decale du bouquin: c’est tant pis pour vous.
Je te rejoins totalement, Alexander ! – au reste, pas étonné de cette réaction : en France, on a toujours du mal avec le baroque… Je ne reviens donc pas sur ce que j’ai écrit dans cette chronique – par ailleurs rassuré par de nombreux lecteurs enthousiastes…