 Pierre Jourde, Le Tibet sans peine, Gallimard, "Nrf", 2008, 119 pages, 11,90 € ISBN : 978-2-07-011976-9
Pierre Jourde, Le Tibet sans peine, Gallimard, "Nrf", 2008, 119 pages, 11,90 € ISBN : 978-2-07-011976-9
Quatrième de couverture
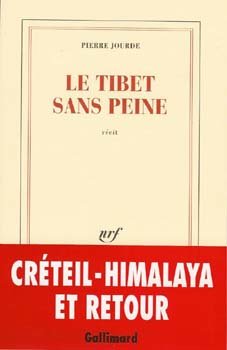 À trois reprises, Pierre Jourde est allé parcourir les pistes du Zanskar, vallée désertique de l’Himalaya, à quatre mille mètres d’altitude. Le Tibet sans peine raconte ces longs périples (l’auteur avait vint-cinq ans la première fois) sous forme d’une épopée cocasse, décrivant les tourments, les émerveillements et les ridicules de jeunes banlieusards occidentaux livrés à une nature démesurée. Traverser des glaciers et des tempêtes de neige avec un équipement de promeneur estival nécessite autant d’inconscience que de ténacité. L’équipée est racontée avec une verve comique teintée d’autodérision. À la description des paysages sublimes et de l’hospitalité généreuse des Tibétains répond celle du progressif délabrement physique et moral du voyageur et de ses compagnons dans la dureté de l’épreuve. Un régal de lecture, qui n’est pas sans évoquer l’humour espiègle et le sens de l’absurde des récits de Nicolas Bouvier.
À trois reprises, Pierre Jourde est allé parcourir les pistes du Zanskar, vallée désertique de l’Himalaya, à quatre mille mètres d’altitude. Le Tibet sans peine raconte ces longs périples (l’auteur avait vint-cinq ans la première fois) sous forme d’une épopée cocasse, décrivant les tourments, les émerveillements et les ridicules de jeunes banlieusards occidentaux livrés à une nature démesurée. Traverser des glaciers et des tempêtes de neige avec un équipement de promeneur estival nécessite autant d’inconscience que de ténacité. L’équipée est racontée avec une verve comique teintée d’autodérision. À la description des paysages sublimes et de l’hospitalité généreuse des Tibétains répond celle du progressif délabrement physique et moral du voyageur et de ses compagnons dans la dureté de l’épreuve. Un régal de lecture, qui n’est pas sans évoquer l’humour espiègle et le sens de l’absurde des récits de Nicolas Bouvier.
[Chronique]
Un récit distancié
À première vue, la raison même qui fait se retrouver en terrain connu les amateurs de documentaires culturels comme de récits de voyages ne manquera pas de susciter une certaine réserve chez les esprits plus critiques. Car ce n’est pas pour goûter en toute simplicité aux charmes du genre qu’il faut lire ce court récit de Pierre Jourde, dont le titre semble trop adapté à la civilisation des loisirs – ou, si l’on préfère, cligne un peu trop vers certains écrits satiriques, du genre Le Journalisme sans peine (Plon, 1997) de Burnier & Rambaud – pour ne pas être notoirement ironique, et donc nous mettre la puce à l’oreille.
 Assurément, les caractéristiques génériques constituent la materia prima de ce récit autobiographique, celle-là même qui, consignée dans les récits traditionnels, a engendré l’image traditionnelle du Tibet – celle propre aux livres présentés comme indispensables de Alexandra David-Néel (1868-1969) [1]Auteure, entre autres, de Souvenir d’une Parisienne à Lhassa et de Au pays des Brigands Gentilshommes. Grand Tibet (Plon, 1927 et 1933). Voir http://www.alexandra-david-neel.org et de Michel Peissel (né en 1937) [2] Auteur, entre autres, de Zanskar, royaume oublié aux confins du Tibet (Laffont, 1979). Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Peissel, mais également aux récits de voyage du XIXe siècle [3]On pourra lire, par exemple, les quatre récits publiés en octobre dernier, présentés par Chantal Edel : Fous du Tibet, Éditions des Riaux, 2007, 760 pages.. Sans surprise, on passe ainsi de notations géopolitiques ou ethnographiques à des hypostases ("L’Indien…"), des kyrielles de souvenirs parfois ponctués par le leitmotiv "Je me souviens…", ou ce genre de remarque sur les contingences du voyage, en droite ligne des Tristes tropiques de Lévi-Strauss : "Une grande partie du temps et de l’énergie d’un voyage se dépense à tenter d’acquérir puis confirmer et reconfirmer des billets d’avion, trouver des bus ou des trains, changer des devises" (p. 38). Ou encore des anecdotes, dont la chute peut être exotique : "M. Habibullah Fargadoo était un bon musulman. Il s’apprêtait à marier son fils, qu’il nous a présenté le lendemain de notre arrivée. Le fiancé se manifestait sous les espèces d’un enfant de dix ans à peu près" (44). Attendus aussi, les photos et le regard occidental, avec ses références picturales (Douanier Rousseau, Chirico, surréalisme) et ses jugements, dont voici l’exemple le plus frappant : "la capacité d’une civilisation à admettre l’autre, et par conséquent la possibilité pour un Occidental d’entrer dans un accord profond avec elle tout en restant lui-même, est en raison inverse du degré d’asservissement des femmes" (74). Moins courant, l’autoethnocritique : "Stupidement rivé aux précautions sanitaires que nous respectons depuis l’Inde, je m’oblige à y écraser la pilule de nivaquine désinfectante, au fort goût de javel. Le sublime yaourt se met aussitôt à ressembler à une fermentation d’eau de piscine" (105).
Assurément, les caractéristiques génériques constituent la materia prima de ce récit autobiographique, celle-là même qui, consignée dans les récits traditionnels, a engendré l’image traditionnelle du Tibet – celle propre aux livres présentés comme indispensables de Alexandra David-Néel (1868-1969) [1]Auteure, entre autres, de Souvenir d’une Parisienne à Lhassa et de Au pays des Brigands Gentilshommes. Grand Tibet (Plon, 1927 et 1933). Voir http://www.alexandra-david-neel.org et de Michel Peissel (né en 1937) [2] Auteur, entre autres, de Zanskar, royaume oublié aux confins du Tibet (Laffont, 1979). Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Peissel, mais également aux récits de voyage du XIXe siècle [3]On pourra lire, par exemple, les quatre récits publiés en octobre dernier, présentés par Chantal Edel : Fous du Tibet, Éditions des Riaux, 2007, 760 pages.. Sans surprise, on passe ainsi de notations géopolitiques ou ethnographiques à des hypostases ("L’Indien…"), des kyrielles de souvenirs parfois ponctués par le leitmotiv "Je me souviens…", ou ce genre de remarque sur les contingences du voyage, en droite ligne des Tristes tropiques de Lévi-Strauss : "Une grande partie du temps et de l’énergie d’un voyage se dépense à tenter d’acquérir puis confirmer et reconfirmer des billets d’avion, trouver des bus ou des trains, changer des devises" (p. 38). Ou encore des anecdotes, dont la chute peut être exotique : "M. Habibullah Fargadoo était un bon musulman. Il s’apprêtait à marier son fils, qu’il nous a présenté le lendemain de notre arrivée. Le fiancé se manifestait sous les espèces d’un enfant de dix ans à peu près" (44). Attendus aussi, les photos et le regard occidental, avec ses références picturales (Douanier Rousseau, Chirico, surréalisme) et ses jugements, dont voici l’exemple le plus frappant : "la capacité d’une civilisation à admettre l’autre, et par conséquent la possibilité pour un Occidental d’entrer dans un accord profond avec elle tout en restant lui-même, est en raison inverse du degré d’asservissement des femmes" (74). Moins courant, l’autoethnocritique : "Stupidement rivé aux précautions sanitaires que nous respectons depuis l’Inde, je m’oblige à y écraser la pilule de nivaquine désinfectante, au fort goût de javel. Le sublime yaourt se met aussitôt à ressembler à une fermentation d’eau de piscine" (105).
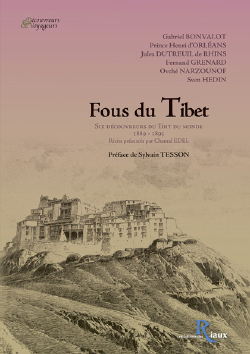 Cela étant, la question de l’apport géographique ou ethnologique – quasi nul en cette époque où abondent les films et reportages les plus divers, au cinéma, à la télévision comme sur internet – est bien vite réglée : qui n’a jamais rien lu sur le Tibet ou n’a jamais vu d’images sur les paysages et les moeurs du Tibet ? Qui ne sait que le yack est au centre de la vie tibétaine ? Les termes de gurgur tcha (thé salé au beurre de yack), de tsampa (farine d’orge) ou de tchang (boisson alcoolisée) sont-ils encore véritablement exotiques ? Les voyageurs eux-mêmes ne sont pas dupes : "Nous savions que le temps de l’inconnu était passé depuis longtemps" (20). Quant à l’auteur, il se montre lucide : "L’Occident aura aussi efficacement anéanti cette culture par la curiosité que, de l’autre côté de la frontière, la Chine par l’oppression" (114). Il sait en outre que "le véritable Tibet était ailleurs" (116), l’imagination infiltrant la mémoire, et ne manque pas de s’interroger sur les rapports entre le réel et ses représentations : "[…] un spectacle que je croyais réservé à la fiction, ou à des récits de voyage désuets sur le Tibet". "Dans presque tous ses détails, reproduits avec une surprenante précision, la scène où le grand lama, accompagné de son orchestre, remet une écharpe jaune à Tintin. Nous aurons voyagé dans une bande dessiné" (109).
Cela étant, la question de l’apport géographique ou ethnologique – quasi nul en cette époque où abondent les films et reportages les plus divers, au cinéma, à la télévision comme sur internet – est bien vite réglée : qui n’a jamais rien lu sur le Tibet ou n’a jamais vu d’images sur les paysages et les moeurs du Tibet ? Qui ne sait que le yack est au centre de la vie tibétaine ? Les termes de gurgur tcha (thé salé au beurre de yack), de tsampa (farine d’orge) ou de tchang (boisson alcoolisée) sont-ils encore véritablement exotiques ? Les voyageurs eux-mêmes ne sont pas dupes : "Nous savions que le temps de l’inconnu était passé depuis longtemps" (20). Quant à l’auteur, il se montre lucide : "L’Occident aura aussi efficacement anéanti cette culture par la curiosité que, de l’autre côté de la frontière, la Chine par l’oppression" (114). Il sait en outre que "le véritable Tibet était ailleurs" (116), l’imagination infiltrant la mémoire, et ne manque pas de s’interroger sur les rapports entre le réel et ses représentations : "[…] un spectacle que je croyais réservé à la fiction, ou à des récits de voyage désuets sur le Tibet". "Dans presque tous ses détails, reproduits avec une surprenante précision, la scène où le grand lama, accompagné de son orchestre, remet une écharpe jaune à Tintin. Nous aurons voyagé dans une bande dessiné" (109).
On pourra donc s’intéresser au regard décalé qui retient ce que le pittoresque peut avoir d’humoristique : "Les panneaux routiers ne reculent pas devant l’humour noir, en hindi et en anglais : Mieux vaut tard que jamais, ou Ralentissez : il reste des places au ciel, ou encore, dans une tonalité plus lyrique : La mort pose ses mains glacées sur les rois de la vitesse, ce qui, compte tenu de notre moyenne, peut également être classé dans le genre humoristique" (53). Ou encore au voyage dans le temps qui émerge du voyage dans l’espace : aux souvenirs des expéditions tibétaines se superposent ceux de l’enfance auvergnate. L’extase devant tel paysage peut ainsi s’expliquer par la matrice intérieure de tout paysage, qui renvoie bien évidemment au paysage originel. La clé de cette géographie magique nous est donnée à la fin : "Souvent, depuis vingt-trois ans, je refais le même rêve, dans lequel je tente de retourner là-bas. Le Tibet s’y confond avec l’Auvergne, suivant l’idée de Nerval, qui dans ses songes éveillés assimilait l’Himalaya et le Cantal. Comme si, dans ce qui m’était le plus étranger, j’avais retrouvé une identité secrète avec ce qui m’est le plus proche" (115). Mais le début contenait déjà l’antidote à toute mythologie : "L’homme a besoin de folklore comme d’oxygène. Il se déterre toujours des origines et bricole de l’authentique avec n’importe quoi" (24). Au reste, les citations en exergue introduisent d’emblée le balancement entre distanciation et contemplation : "J’ai toujours tenu pour suspects ou illusoires des récits de ce genre : récits d’aventures, feuilles de route, racontars – joufflus de mots sincères – d’actes qu’on affirmait avoir commis dans des lieux bien précisés, au long de jours catalogués" (Victor Segalen, Équipée). "Comme une eau, le monde vous traverse et pour un temps vous prête ses couleurs. Puis se retire, et vous replace devant ce vide qu’on porte en soi […]" (Nicolas Bouvier, L’Usage du monde).
Récit critique
Même si cette ligne de crête est par trop fuyante, c’est bien pour sa dimension critique qu’il faut lire ce livre. À l’ère du tourisme de masse et de son hypermédiatisation – des raids Nouvelles Frontières ! -, Pierre Jourde se joue de l’imagerie occidentale : "Ce n’était pas un pays, c’était un parc d’attractions, un train fantôme. Manquaient le Yéti, le dragon, les génies gardiens, les blocs de glace tamponneurs, les précipices et les labyrinthes, mais cela ne tarderait sûrement pas, à ce rythme" (87). Dressant l’inventaire des motivations qui poussent les Occidentaux à entreprendre leurs expéditions pour le Toit du monde, il donne au passage une recette pour-épater-la-galerie : "Dès qu’un silence s’installe, il suffit de lâcher, le plus discrètement possible, à la manière de quelqu’un qui n’y attache pas autrement d’importance : "Lorsque j’ai traversé l’Himalaya…", pour s’assurer une certaine considération" (19). Qui plus est, sa déconstruction des clichés s’accompagne d’une typologie critique des nouveaux "explorateurs", "conquérants" au rabais : on y trouve des mystiques, des "forcenés de la montagne", des "tribus de sportifs à gros souliers et sacs à dos, impatients de "dépasser leurs limites", d’affronter les éléments" (18)…
La morale est sans doute à chercher du côté de cette variante comique de la fameuse phrase proustienne à la fin d’Un amour de Swann ("Dire que j’ai…") : "Le voyage le plus étonnant de ma vie, je ne l’ai pas fait pour l’exploit, ni par curiosité culturelle, ni pour aucun motif qui présente un peu de sens. Je l’ai fait pour reprendre des photos". L’autodérision se teinte ici d’une ironie qui prend pour cible l’hypermédiatisation (au sens philosophique) de notre monde : "Tout pour la photo. Le monde est fait pour aboutir à un beau diaporama" (61).
![[Livre + chronique] Pierre Jourde, Le Tibet sans peine](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)