 Cet article, qui porte sur Mort d’un jardinier (La Table Ronde, 2008) et plus généralement sur le territoire de Lucien Suel, inaugure la série intitulée "Le roman contemporain : territoires et trajectoires".
Cet article, qui porte sur Mort d’un jardinier (La Table Ronde, 2008) et plus généralement sur le territoire de Lucien Suel, inaugure la série intitulée "Le roman contemporain : territoires et trajectoires".
De Lucien Suel, « poète ordinaire », j’ai chez moi quelques trucs inclassables, dans tous les sens du terme, car on ne sait pas toujours comment les ranger dans une bibliothèque. Ainsi, pour lire Instant T, – journal éclaté de résidence au Blosne –, il faut un exercice de dépliage qui me rappelle quand je découpais Francs-Jeux. La liste de ses publications est impressionnante, non moins que celle de ses éditeurs ou des structures éditoriales crées par lui-même, aux noms les plus inattendus. Je l’ai entendu aussi dire son Tout partout dans les rues d’Arras à l’occasion de la fête du livre le 1er mai. Il se fait quelquefois accompagner par un groupe de rock, Potchük, dont il est le chanteur et le bassiste [1]On trouve beaucoup de choses sur le Net concernant Lucien Suel. Voir ainsi, en plus de l’entretien de Lucien Suel en cliquant, "Mine de rien, Lucien Suel fait son trou dans la littérature" entretien avec Sylvain Courtoux sur le site Hermaphrodites, lundi 21 mars 2005). . « Potchük » : transcription approximative et personnelle de po d’chuque, « pois de sucre », c’est-à-dire petit pois en parler picard, ou du moins dans une de ses versions, Lucien Suel n’ayant jamais revendiqué de purisme en la matière. Il y a déjà là un produit du jardin, et l’on connaissait sa Justification de l’abbé Lemire, le curé d’Hazebrouck fondateur des jardins ouvriers. Le texte, en vers justifiés, comme on dit en typographie , c’est-à-dire avec un nombre de signes typographiques déterminé à l’avance, reproduisait les carrés d’un jardin, avec ses deux colonnes de douze tercets rappelant la disposition des planches de légumes et l’allée centrale d’un jardin [2] Cette composition est dite "arithmogrammatique" : l’écriture arithmogrammatique se fabrique en comptant le nombre de signes typographiques dans chaque ligne. Cf. Jean-Pierre Bobillot, qui a proposé cette appellation pour désigner le non métrique à nombre déterminé, "Le Principe de nudité métrique. Quelques précisions", Le Jardin ouvrier, supplément au n° 28, reproduit dans l’anthologie citée ci-dessous, p. 199 .
Ce texte paru aux éditions Mihàly en 1998, on avait pu en lire les trente premiers « épisodes » , de mars 1995 à octobre 1997 dans les premiers numéros d’une revue précisément intitulée Le Jardin ouvrier, animée par Ivar Ch’Vavar (Pierre Ivart) à Amiens, entre 1995 et 2003. 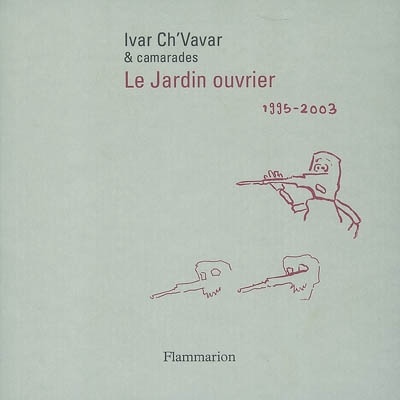 Ou plutôt, on aurait pu le lire si on avait connu cette publication confidentielle, aujourd’hui livrée à un public élargi grâce à une anthologie parue chez Flammarion. Anthologie qui nous a révélé une des entreprises les plus fascinantes de ces dernières années. J’allais dire une des entreprise poétiques, mais peut-être faudrait-il revenir à la notion d’écriture, aujourd’hui bien démodée, qui abolit pour nous la césure entre vers et prose, même si telle n’est pas l’intention de ses promoteurs, bien au contraire. Une entreprise qui en finit avec le poétique, ou qui fait du poétique l’effet improbable du prosaïque le plus lourd, le plus épais, le plus englué dans une matière brute, la berdouille [3]La boue. Cf. Jean-Noël Carion, "Souvenances", Le Jardin ouvrier, 1er supplément au n° 20, p. 154 de l’anthologie., enfin le plus ordinaire.
Ou plutôt, on aurait pu le lire si on avait connu cette publication confidentielle, aujourd’hui livrée à un public élargi grâce à une anthologie parue chez Flammarion. Anthologie qui nous a révélé une des entreprises les plus fascinantes de ces dernières années. J’allais dire une des entreprise poétiques, mais peut-être faudrait-il revenir à la notion d’écriture, aujourd’hui bien démodée, qui abolit pour nous la césure entre vers et prose, même si telle n’est pas l’intention de ses promoteurs, bien au contraire. Une entreprise qui en finit avec le poétique, ou qui fait du poétique l’effet improbable du prosaïque le plus lourd, le plus épais, le plus englué dans une matière brute, la berdouille [3]La boue. Cf. Jean-Noël Carion, "Souvenances", Le Jardin ouvrier, 1er supplément au n° 20, p. 154 de l’anthologie., enfin le plus ordinaire.
Précisément, de Lucien Suel il y a aussi Visions d’un jardin ordinaire (poèmes et photographies), publié avec sa femme Josiane, en 2000, au Marais du Livre, à Hazebrouck, et dont le texte seul avait paru d’abord en vers justifiés (37 caractères chacun hors ponctuation, aucun mot ne pouvant être artificiellement coupé) dans cette même revue. Avec un autre titre « Un jardin re/garde un/ jardin regarde », où « garde un » jouait avec le mot picard gardin (jardin). Ce texte d’allure géométrique avait quelque chose du cahier d’écolier : « Le cordeau raidi était la règle posée sur le cahier blanc du terrain propre et nu. Le fer de l’arbraquette a ligné la page invisible, dessiné l’espace de la cartographie horticole ». L’arbraquette, en picard, c’est la binette. Discrètement, cette langue, si l’on peut employer ce mot pour désigner une des parlures les plus dévalorisées du territoire français (Ivar Ch’Vavar se revendique, lui, du patois de Berck), est présente tout au long de ce texte qui a été retenu sur les listes de référence des ouvrages de littérature pour le cycle 3 de l’école primaire, en 2002.
Ce jardin, c’est celui d’un petit Blanc du Nord de l’Europe/du sud des États-Unis, c’est pareil. Dans ces terres grasses du côté de Saint-Omer, il y a toujours comme une présence américaine, celle de la Beat generation mais celle aussi des grands espaces et de la sécheresse : « La poussière se coagule au fond du wash (réf. Tony Hillerman) », écrit Suel à la page 35 de Visions d’un jardin ordinaire, s’amusant à donner lui-même la référence (le mot wash, qui désigne le lit desséché d’un creek, est sans cesse évoqué dans Voleur de temps (A Thief of Time, 1988), par exemple. Mais, page 29 : « ça sent le meu. » Et même page, parlant des cendres que l’on a mises dans l’allée : « groches transportées dans les charbonnières de tôle galvanisée ».
Les mots de picard, ou plutôt de patois, sont des groches, des amas grossiers de cendres, d’un charbon mal consumé, langue toujours déformée, loin de la noblesse de l’oc des troubadours : pourrite, pour « pourri », ce n’est même pas un autre mot, une autre langue, c’est le mot lui-même qui pourrit, bourgeonne. Mais cette langue, c’est aussi celle d’une nation première, de ces langues auxquelles Le Jardin ouvrier avait donné une place inattendue : touareg, langue du peuple gourma, etc.
Dans Mort d’un jardinier, Suel parlera du groet, un croc à pommes de terre, mot que personne dans le Nord ne ressent comme picard, n’ayant pas d’équivalent français. Ainsi le roman garde-t-il quelque chose de cette « poésie » des mots locaux, car voici que Lucien Suel nous propose un roman, un « premier roman » (jamais cette expression ne fut plus comique), fait de la même matière que toute sa poésie « ordinaire », expérimentée précédemment sous les formats les plus différents. Un roman, c’est plus pratique à ranger et à classer, cela permet sans doute d’être reçu plus facilement par un éditeur qui a pignon sur rue, c’est surtout la possibilité d’agrandir son jardin, d’y faire prospérer quelques boutures venues de plus petits carrés. Son roman, c’est le recyclage, l’enfouissement, le produit d’un compost fait de « Memento Matamore » (Le Jardin ouvrier, n°7/8, p. 55 de l’anthologie) ou de « Un jardin re/garde un : jardin regarde » (n°16, p. 105 de l’anthologie, et n°21, p. 162).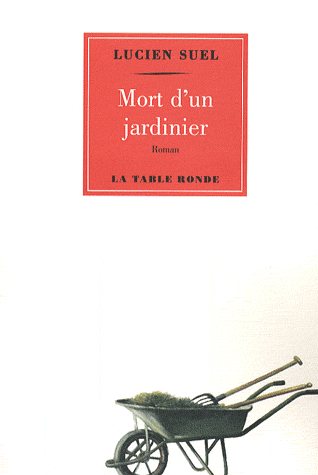
Du reste, « La mort en duplicata pour Cosmik Galata » (Le Jardin ouvrier, n°27, p. 177 de l’anthologie) était déjà présenté comme « mini-roman en vers justifiés », et était « à suivre » comme la plupart des textes édités dans cette revue, marqués par leur longueur, leur aspect litanique, leur difficulté à se terminer : de la poésie-feuilleton. Qui a quelque chose de l’épique, écrit à juste titre Philippe Blondeau dans sa présentation de l’anthologie où il remarque les longs récitatifs qui tirent la poésie vers la narration. Mais ajoutons que cette épopée se fait toujours entre quelques corons et quelques jardins, vouée en même temps à une sorte d’entreprise proto-ethnologique, sauvages se décrivant eux-mêmes comme sauvages, moins nobles que les Navajos de Tony Hillerman. Inventer la Picardie, c’est tout sauf lui donner une origine noble et guerrière. Plutôt, dans la ligne de Rimbaud, se dire nègre blanc ne fumant pas l’opium mais buvant de la bière. Une espèce d’errance immobile, revenant sur ses pas, toujours, dans des jardins qui sont des prisons et des échappées immenses.
Malgré l’évocation d’un voyage en Turquie, Lucien Suel est loin de l’errance d’un Jack Kerouac et de la Beat generation. Il est passé d’un jardin à l’autre, il en est au troisième. Ses jardins sont comme les périodes de Picasso. Et Le Jardin ouvrier nous fait plus penser aux ploucs du Sud, de Faulkner ou de Caldwell : voyez Épopée de Charles-Mézence Briseul dans Le Jardin ouvrier n°34 (p. 317 de l’anthologie) : « il est le héros de l’épopée dans sa campagne un peu plouc disons-le ». Épopée plouc, donc. Ce côté plouc prend chez Suel une singulière élégance, avec de longs phrasés où un mot entraîne un autre, dans un interminable monologue qui est celui de la vie, du cœur qui bat obstinément, du beat, jusqu’au moment de s’arrêter.
Un roman de poète, mais d’un poète qui n’a jamais voulu surélever la poésie, quelqu’un qui ne s’est pas placé du côté de la distinction, qui ne s’est pas posé la question des bonnes manières. Le jardin permet de mettre tout cela en parenthèse, ou du moins devrait le permettre. Je pense à La Place d’Annie Ernaux, où les parents sont hantés par la peur d’être trop haut ou trop bas, et où même le jardin bien tenu procède d’une morale pour le père, sous le regard de l’autre.
Rien de cela chez Suel, ou du moins rien d’un moralisme fût-il même écologique. Il fut un temps où se déclarer du côté de la terre pouvait passer pour réactionnaire. On peut en vouloir à ceux qui ont ainsi discrédité ce qui reste quand tout va mal et qu’on ne vous l’a pas encore enlevé. Cette terre n’est pas noble, elle a des traits « naturalistes », caractère très marqué dans Le Jardin ouvrier, mais comme si les mineurs et les paysans de Zola prenaient eux-mêmes la plume : jusqu’à la plage de Berck, qui a quelque chose d’une décharge, mais sans l’équivoque de ce regard zolien. Entourant le jardin, il y a des plaques de fibro-ciment (Evelyne « Salope » Nourtier : « Aujourd’hui », Le Jardin ouvrier, n°9, p. 51 de l’anthologie), du parpaing, des HLM (qui connotent une forme de ruralité ouvrière plus que l’urbanité), des supermarchés (même chose), des poubelles.
Dès la première page de Mort d’un jardinier, Suel évoque la gouttière en pvc en même temps que la tuile flamande rouge, et un peu plus loin le grillage qui empêche les lapins de venir croquer les légumes : « tu te bats continuellement contre la nature », si possible avec de l’huile de vidange pour brûler les débris amassés en bûcher. Plus loin encore, l’odeur de la porcherie monte à l’assaut du soir. Refuge, le jardin est aussi au milieu du monde, sous les avions et leur kérosène, ouvert aux pétarades d’une mobylette, mais aussi à tous les mots. Suel n’en rejette aucun : « ton regard scanne le jardin immobile » (p. 13), « tu frissonnes en slurpant la pellicule de glaire » (p. 50).
Mais soudain, te voici « cloué au centre du jardin ». Qui est ce « tu » venu du Nouveau Roman et qui va voir défiler non pas simplement son passé mais celui d’une génération ? Il y a quelque chose de Perec dans ce long dévidement de gestes, de noms de marques, de lectures, d’événements qui un jour ont tous été modernes, nouveaux, et qui sont déjà partis. On peut penser aussi aux Années d’Annie Ernaux, mais toujours avec cette différence déjà relevée plus haut, que Lucien Suel n’a jamais eu le sentiment de quitter sa « place » alors même qu’il est parti très loin dans sa tête. Navajo de Guarbecque, « passéiste moderne » en même temps que « moderne archaïque » (p. 113), le poète charge dans sa Saxo, – une voiture qui jazze ! – deux casiers de Hommel Beer et préfère écrire des poèmes sur ses légumes, mais avec dans l’oreille la trompette de Louis Amstrong, de Don Cherry, de Miles Davies, de Dizzie Gillespie, conciliant les deux sens du mot « culture », n’étant étranger à rien, à personne : mémère Rachel, Parrain Fleury, Christophe Tarkos, Saint Benoît Labre, Augustin Lesage, Claude Pélieu : la fin du livre renoue en quelque sorte avec les Congés du poète arrageois Jean Bodel, naguère réactualisés par Sylvie Nève, « préoccupée des voix mortes d’autrefois comme des voix écrasées d’aujourd’hui », et par Jean-Pierre Bobillot. Congé paradoxal qui semble plutôt un appel pour de nouveaux commencements : la nouvelle revue d’Ivar Ch’Vavar s’appelle Kminchmint.
![[Manières de critiquer] Territoires du roman contemporain : <em>Les Congés</em> de Lucien Suel](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)