 Cette semaine, afin de prendre de la distance – au propre comme au figuré – avec la sacro-sainte Rentrée franco-française, direction Publie.net pour la mise en ligne d’un texte majeur de Mathieu BROSSEAU (UNS), avant de recueillir des échos de l’espace francophone (Libr-voix d’ailleurs : Léonora MIANO, Wahiba KHIARI et Mustapha BENFODIL). /FT/
Cette semaine, afin de prendre de la distance – au propre comme au figuré – avec la sacro-sainte Rentrée franco-française, direction Publie.net pour la mise en ligne d’un texte majeur de Mathieu BROSSEAU (UNS), avant de recueillir des échos de l’espace francophone (Libr-voix d’ailleurs : Léonora MIANO, Wahiba KHIARI et Mustapha BENFODIL). /FT/
PUBLIE.NET : Mathieu Brosseau, UNS
Mathieu Brosseau, UNS, PDF écran et eBook (Sony/iPhone), 97 pages, 5,50 €, ISBN : 978-2-8145-0259-8.
Présentation éditoriale (Armand Dupuy)
" le berger, dans son corps se trouveront les bêtes."
Après La nuit d’un seul, paru début 2009 chez La rivière échappée, Mathieu Brosseau poursuit son entreprise de remembrement, déjà commencée avec L’Aquatone et Surfaces, journal perpétuel. Le titre de ce nouveau texte semble l’annoncer : il s’agit de rassembler sa pluralité, de l’encercler dans la langue s’il n’est pas possible d’en faire l’inventaire (on se reportera, à ce sujet, à l’entretien avec l’auteur paru sur Remue.net, dans lequel on peut lire « Le fait que je fasse unité passe nécessairement par le démantèlement de mon histoire, pour l’analyse, puis dans un second temps par sa restructuration dans un système (autofictif) cohérent. Naît ici une sorte de cosmogonie du soi… ». ) On retrouve donc dans Uns tous les thèmes récurrents du travail de Mathieu Brosseau, mais ce texte, plus que les  précédents, est d’une puissance radicale. En effet, Mathieu Brosseau renverse et réinvente l’axe de sa parole : « En français, on ne distingue que trop mal la parole qui passe du cul à la gorge, de l’archaïque au présent contraint. » écrit-t-il. On pensera peut-être aux propos de Georges Bataille lorsqu’il oppose l’axe bouche-oeil du visage humain à l’axe bouche-anus des animaux à quatre pattes. Dans le premier cas, lié à la verticalité, l’axe désigne la bouche en terme de pouvoir d’expression. Dans le second, où l’axe est lié à l’horizontalité de l’animal, la bouche est élément de prise, de mise à mort et d’ingestion de la proie. L’anus en est l’issue. Mais chez Mathieu Brosseau, c’est une sorte de reflux qui s’opère, cela se fait « du cul à la gorge » et non pas dans le sens naturel des choses. Il s’agit de faire retour. Retour à l’animalité. Retrouver, avec et dans la langue, les parts les plus sourdes et les plus insoumises de soi. Ainsi, quand l’axe du langage s’horizontalise, pour aligner la bouche sur les parties basses, celui du temps se redresse : Mathieu Brosseau écrit dans l’épaisseur de tous ses temps. Il confie d’ailleurs dans ce livre « Je lui parle, la modernité m’est impossible. » Ne faut-il pas entendre, dans cet aveu, que nous sommes fondamentalement attachés à quelque chose de bien plus archaïque et instable que l’ici et maintenant. L’écriture de Mathieu Brosseau est une écriture reliée. Elle se fait dans le millefeuille des moments qui la constituent. Toujours prise dans ce paradoxe actif du délitement, de ce qui sépare, divise (La nuit, le démon, etc.) et de ce qui rassemble, unifie. Cette parole habitée (une sorte d’animisme du langage qui semble plus véloce que jamais) fait route comme animal : « Juste au bout de mes doigts : là, dans le prolongement de mes ongles, tous les animaux s’élancent, ils crient sans colère, ils chantent sans musique, < ils sont l’inhumain de mon corps >, seule leur expression est la mienne, seule féroce et complice, ils sont l’inhumain de mes jambes et de mes veines :: :: là, juste au bout de mes doigts, homme libre, tu vivras, tu verras ces animaux relâchés, renards, saumons, pies à tête de buffle, oie à coude serpent, regarde, cet homme à tête de biche, il est un animal , tout ceux-là, tu les verras à toute allure, courant, nageant,… » Une langue à la fois simple et chahutée. Une langue qui spirale et s’invente en se faisant.
précédents, est d’une puissance radicale. En effet, Mathieu Brosseau renverse et réinvente l’axe de sa parole : « En français, on ne distingue que trop mal la parole qui passe du cul à la gorge, de l’archaïque au présent contraint. » écrit-t-il. On pensera peut-être aux propos de Georges Bataille lorsqu’il oppose l’axe bouche-oeil du visage humain à l’axe bouche-anus des animaux à quatre pattes. Dans le premier cas, lié à la verticalité, l’axe désigne la bouche en terme de pouvoir d’expression. Dans le second, où l’axe est lié à l’horizontalité de l’animal, la bouche est élément de prise, de mise à mort et d’ingestion de la proie. L’anus en est l’issue. Mais chez Mathieu Brosseau, c’est une sorte de reflux qui s’opère, cela se fait « du cul à la gorge » et non pas dans le sens naturel des choses. Il s’agit de faire retour. Retour à l’animalité. Retrouver, avec et dans la langue, les parts les plus sourdes et les plus insoumises de soi. Ainsi, quand l’axe du langage s’horizontalise, pour aligner la bouche sur les parties basses, celui du temps se redresse : Mathieu Brosseau écrit dans l’épaisseur de tous ses temps. Il confie d’ailleurs dans ce livre « Je lui parle, la modernité m’est impossible. » Ne faut-il pas entendre, dans cet aveu, que nous sommes fondamentalement attachés à quelque chose de bien plus archaïque et instable que l’ici et maintenant. L’écriture de Mathieu Brosseau est une écriture reliée. Elle se fait dans le millefeuille des moments qui la constituent. Toujours prise dans ce paradoxe actif du délitement, de ce qui sépare, divise (La nuit, le démon, etc.) et de ce qui rassemble, unifie. Cette parole habitée (une sorte d’animisme du langage qui semble plus véloce que jamais) fait route comme animal : « Juste au bout de mes doigts : là, dans le prolongement de mes ongles, tous les animaux s’élancent, ils crient sans colère, ils chantent sans musique, < ils sont l’inhumain de mon corps >, seule leur expression est la mienne, seule féroce et complice, ils sont l’inhumain de mes jambes et de mes veines :: :: là, juste au bout de mes doigts, homme libre, tu vivras, tu verras ces animaux relâchés, renards, saumons, pies à tête de buffle, oie à coude serpent, regarde, cet homme à tête de biche, il est un animal , tout ceux-là, tu les verras à toute allure, courant, nageant,… » Une langue à la fois simple et chahutée. Une langue qui spirale et s’invente en se faisant.
Relisant Uns, pour rédiger ces quelques lignes, je pensais au peintre Gérard Garouste, à cette cohabitation du classique et l’indien qui lui est chère. Et nous y sommes, c’est dans cette tension que Mathieu Brosseau se situe. Un cocktail de lyrisme, de langue française bien assise, rodée, (même si elle n’est pas apte à faire le trajet comme le note l’auteur) et d’intuition. Un affût, une sensibilité particulière qui défie les codes et cherche sa voie. C’est dans la langue que cela se joue, dans un style proprement jubilatoire. Une langue qui est à la fois le corps meurtri de Saint-Sébastien que l’auteur convoque plusieurs fois (« Ne suis pas Saint Sébastien, lui étant percé par les flèches, je ne le suis que par mon trou sans forme. »), l’homme debout, le guérisseur, et la flèche, tendue, horizontale, animale (axe cul – gorge, toujours), qui attaque, saisit, blesse. La langue de Mathieu Brosseau est une boussole affolée dont le nord est en perpétuel déplacement. C’est en cela que son travail est singulier. Tout simplement parce qu’il ne s’agit pas de littérature gratuite, mais d’un cheminement humain, maintenant retranscrit pour nous.
Note de lecture
"Homme libre, passe les portes de la langue, passe les uns et les nombres déjà connus, casse l’écho, passe-le" (95).
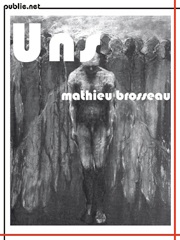 D’emblée, la couverture donne le ton : l’œuvre du peintre Winfried Veit fait songer à Goya, à Munch ou au Golem de Meyrink, immanquablement à une figure baudelairienne.
D’emblée, la couverture donne le ton : l’œuvre du peintre Winfried Veit fait songer à Goya, à Munch ou au Golem de Meyrink, immanquablement à une figure baudelairienne.
UNS. Entre singulier et pluriel, identité et altérité. UNS.
Entre vide et transcendance, silence et musique, silence et parole, enfance et inhumanité, se déploie une écriture poétique qui s’arc-boute à la mémoire, pousse "la langue dans l’entre-deux" et s’érige contre l’extension du domaine de l’économie.
Plus encore que La Nuit d’un seul, UNS constitue à la fois un art poétique et un espace des métamorphoses. Faisant "confiance à la dynamique", celui pour qui "la modernité est impossible" laisse dériver une écriture de la répétition/variation, donne libre cours à un mysticisme selon lequel l’âme est substance, présence qui comble l’absence… à une mélancolie toute baudelairienne : "l’homme disparaîtra quand le poison disparaîtra"…
Ces réflexions seront approfondies la semaine prochaine par un entretien-portrait avec l’auteur.
Libr-voix d’ailleurs
Précisons d’emblée que nous reviendrons sur ces auteurs au moyen de chroniques plus développées et/ou de publications de textes originaux.
[+] Léonora Miano, Les Aubes écarlates, Plon, août 2009, 280 pages, 18,90 €, ISBN : 2-259-21067-8.
Présentation éditoriale :
Epa a été enrôlé de force dans les troupes d’Isilo, un mégalomane qui rêve de rendre sa grandeur à toute une région de l’Afrique équatoriale. Emmené au cœur d’une zone isolée, il découvre qu’il est entouré de présences mystérieuses : plusieurs fois, il aperçoit des ombres enchaînées demander réparation pour les crimes du passé. Sur tout le continent, les esprits des disparus de la traite négrière distillent l’amertume et la folie en attendant que justice leur soit rendue…
Parvenant à s’échapper, Epa retrouve Ayané, une fille énigmatique et attentionnée qui l’aide à reprendre goût à la vie. Comment donner à l’Afrique la chance de connaître des aubes lumineuses ? Pour conjurer le passé d’une terre qui ne cesse de se faire souffrir elle-même, Epa devra rechercher ses compagnons d’infortune et les rendre à leur famille.
Premières impressions :
" Qu’il soit fait clair pour tous que le passé ignoré confisque les lendemains."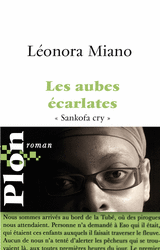
À 36 ans, l’auteure camerounaise collectionne déjà les prix littéraires : par exemple, en 2006 prix Louis Guilloux, René Fallet et Goncourt des lycéens pour Contours du jour qui vient. Avec ces Aubes écarlates, elle poursuit son projet littéraire : une écriture incantatoire et fantasmagorique pour évoquer une Afrique des plus noires :
" C’est un peuple qui délaisse ses morts, dont la vue ne dérange plus personne. Un continent voué à l’échec.
Sauf si quelqu’un entend la voix de ces âmes errantes et prend la place d’un messager. La Parole peut alors être entendue. Cette voix sera celle d’Epupa. Elle reprendra alors un poème de Birago Diop :
Ceux qui sont morts ne sont jamais partis :
Ils sont dans l’ombre qui s’éclaire
Et dans l’ombre qui s’épaissit."
[+] Wahiba Khiari, Nos silences, coll. "Éclats de vie", éditions Elyzad/Clairefontaine, Tunis (diffusion en France), août 2009, 128 pages, 13,90 €, ISBN : 978-9973-58-018-4.
Quatrième de couverture :
Algérie, années 1990. Elles ont été des milliers à être enlevées, violées, parfois assassinées, les filles de la décennie noire. Ces très jeunes filles, à qui l’on a demandé de pardonner, se sont tues et ont ravalé leur honte. Tandis que résonne le cri de l’une d’entre elles, la narratrice raconte sa culpabilité d’avoir choisi l’exil et trouvé le bonheur.
Deux voix de femmes en écho qui prennent la parole haut et fort, en mémoire de toutes les autres.
L’écriture pour vaincre le silence de ceux qui savent. Un roman contre l’oubli.
Note de lecture :
Le poignant récit dialogique de Wahiba Khiari se circonscrit entre ces deux phrases cris :
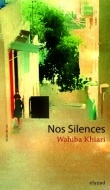 " Je suis née à retardement, une alerte à la bombe, une grenade dégoupillée par la nature, une déflagration annoncée, un danger. Je suis née quelque part où il me fut bon de vivre, jusqu’au jour où je réalisai qu’autour de moi, rester en vie était devenu un projet de société, le régime en vigueur."
" Je suis née à retardement, une alerte à la bombe, une grenade dégoupillée par la nature, une déflagration annoncée, un danger. Je suis née quelque part où il me fut bon de vivre, jusqu’au jour où je réalisai qu’autour de moi, rester en vie était devenu un projet de société, le régime en vigueur."
" Algérie, une douleur étymologique est inscrite dans son génotype, ton nom en porte la trace comme une fatalité. Devrais-je t’écrire toujours et encore pour me rapprocher de toi, peut-être me faire pardonner de t’avoir un jour, quittée ?"
Récit moderne placé sous les auspices de Marguerite Duras : " Écrire c’est aussi ne pas parler. C’est se taire. C’est hurler sans bruit." Ce silence figure ici à la fois comme thème et comme forme. Silence – sous peine de mort – des femmes soumises à la loi tribale : " Ils en ont fait des fatwas, les autres, pour tout ce qui leur passait par la tête et même ailleurs que par la tête. Ils se sont fait faire des fatwas comme des prescriptions sur ordonnance, des fatwas de connivence entre collègues. Ils ont retaillé l’islam à leur mesure, rajouté les vierges à leurs listes de butin de guerre, une récompense, un trophée " (p. 111). Silence de la parole douloureuse, silence entre les mots, les sections, les relais de parole.
Faisant sien le principe formel de Perec dans W, ou le souvenir d’enfance, le texte alterne passages en caractères romains et récit en italiques. Mais il s’agit ici de deux voix distinctes correspondant à deux personnages antithétiques. L’une est celle d’une femme émancipée, professeur d’anglais qui réunit à elle "seule la liste des raisons pour lesquelles ils s’étaient donné le droit de tuer" : non voilée, elle enseigne « la langue des "renégats" dans un établissement mixte » (14). L’autre est celle d’une victime, jeune fille violée après sa soeur, alors que leurs parents ont été tués. Le montage alterné débouche sur un parallèle entre celle qui a échappé à son destin et la rescapée : toutes deux accouchent, l’une d’un enfant de l’amour, l’autre de la honte…
Portrait d’un "rêveurévolutionnaire" : Mustapha BENFODIL (1968)
Dans un pays où les "auteurs de mots" sont assimilés à des "fauteurs de troubles", soutenu par son éditeur Barzakh et le quotidien El Watan (Alger), l’écrivain et journaliste Mustapha Benfodil défend la liberté d’expression, prône un "théâtre-commando" et pratique des "lectures sauvages." Fin août dernier, l’auteur de Paris-Alger, classe enfer (2004) et de Clandestinopolis (2006) est interpellé manu militari pour une lecture sans autorisation de sa pièce Les Borgnes ou le Col intérieur brut (2009).
le quotidien El Watan (Alger), l’écrivain et journaliste Mustapha Benfodil défend la liberté d’expression, prône un "théâtre-commando" et pratique des "lectures sauvages." Fin août dernier, l’auteur de Paris-Alger, classe enfer (2004) et de Clandestinopolis (2006) est interpellé manu militari pour une lecture sans autorisation de sa pièce Les Borgnes ou le Col intérieur brut (2009).
Avec Libr-critique, relayez l’appel à soutien lancé par El Watan.
![[News] News du dimanche](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)