Hans Limon, Poéticide, Quidam, 8 novembre, 96 pages, 13 €, ISBN : 978-2-37491-086-4.
C’est le type même de livre que peut produire un poète qui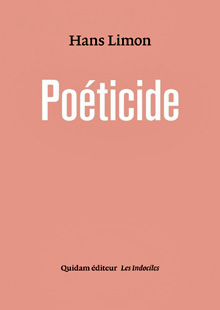 entre dans le champ : « Tous les crever ! Tous les rayer ! » C’est bien entendu un moyen radical pour se donner une chance de trouver sa voix. Mais encore ? « Les poètes nous ont menti. […] Assassiner les poètes, c’est rendre aux hommes la vision nette et pure, dégagée des schémas déformants […] »… En outre, la Poésie est une fille publique : « Elle quémande les prix, les récompenses, les subventions, les caresses, les dessous de table ! » Poéticide s’attaque à la poésie de célébration, celle qui trône sur son piédestal, en parodiant les topos de la poésie à capitales. Et comme en son temps le clamait Denis Roche, « LA POÉSIE N’EXISTE PAS »… À l’« agitateur de mots » de la faire exister de façon sensible. /Fabrice Thumerel/
entre dans le champ : « Tous les crever ! Tous les rayer ! » C’est bien entendu un moyen radical pour se donner une chance de trouver sa voix. Mais encore ? « Les poètes nous ont menti. […] Assassiner les poètes, c’est rendre aux hommes la vision nette et pure, dégagée des schémas déformants […] »… En outre, la Poésie est une fille publique : « Elle quémande les prix, les récompenses, les subventions, les caresses, les dessous de table ! » Poéticide s’attaque à la poésie de célébration, celle qui trône sur son piédestal, en parodiant les topos de la poésie à capitales. Et comme en son temps le clamait Denis Roche, « LA POÉSIE N’EXISTE PAS »… À l’« agitateur de mots » de la faire exister de façon sensible. /Fabrice Thumerel/
Hans Limon, « La Poésie n’existe pas »
6 rue Le Regrattier. Là où Charles Baudelaire logea la « Vénus noire », Jeanne la mulâtresse. Là où mon Poéticide assassine ou plutôt fait sauvagement assassiner le chantre désabusé du spleen et de l’idéal. À trente-trois ans – un âge à se faire crucifier –, me voici donc au seuil d’un nouveau néologisme délictueux, d’une insupportable prétention, en pèlerinage, le front plissé, les points serrés, me demandant ce qui a bien pu se passer entre mes presque six et mes plus de trente-trois ans. Prétentieux est le bon mot. Car je prétends, et c’est là mon unique réseau et probablement mon unique raison, qu’on peut tout à fait être « d’extraction basse » et s’élever jusqu’à la plaine capitale, qu’on peut et doit se retourner pour tendre la main à ceux qui sont restés embourbés dans leurs méfaits divers, quitte à se prendre des coups sur la gueule, quitte à les demander, parce qu’on sait pertinemment qu’ils soulageront qui les distribuera, que la littérature, et par voie de conséquence la poésie, ne sont en aucun cas l’apanage des classes aisées, favorisées, qu’on peut s’amuser avec les mots comme avec des pâtés de sable, et brandir des paragraphes avec la gloire d’un gosse de cinq ans qui pense avoir surpassé Versailles et décoiffé Lenôtre, que l’école de la République peut sauver des rêves et des vies, qu’on peut s’y faire des pères, des mères, des avenirs et des emmerdes, mais jamais très graves, qu’on peut avoir poussé dans la misère, l’exclusion, les complexes, la violence, les faits divers glauques, en garder quelques séquelles, certes, mais en faire naître pléthore de fruits gorgés de sucre à s’en niquer les molaires, qu’on peut s’acheter un manuel et se marteau-piquer bien comme il faut la prosodie du dix-neuvième siècle, et surtout, qu’on peut s’aimer assez proprement pour ne pas rougir de ses origines, tracer sa route et se dire un jour, aujourd’hui, demain, le 8 novembre, au choix : « Spinoza, je t’encule ! »
« La poésie n’existe pas » est le mot d’ordre de Poéticide. Quelle signification accorder à cette phrase comme balancée au lance-pierres ? Adorno proclamait qu’il était absurde d’écrire de la poésie après Auschwitz. Je suis d’avis, et cet avis n’engage que moi, qu’on ne peut plus écrire la même poésie qu’auparavant, compte tenu des événements et des auteurs qui nous ont précédés, et même, et cet avis n’engage toujours que moi, compte tenu de chaque existence particulière. La jeunesse du dix-neuvième siècle était beaucoup plus imprégnée de poésie que celle d’aujourd’hui. Philothée O’Neddy, romantique frénétique, avait, dans l’ombre de Victor Hugo, l’ambition de révolutionner la poésie, l’art et la société. Il a publié un recueil à seulement vingt-deux ans, Feu et flamme, puis a fait disparaître son pseudonyme avec son idéal. Il avait « son mot à dire ». Étouffé par la Monarchie de Juillet puis Napoléon III, il a fermé sa gueule et laissé le champ libre aux « anciennistes ». Le siècle qui nous précède, celui qui débute, la crise migratoire, les clodos qui croissent et multiplient, l’opulence exhibitionniste, la nature à l’agonie, la recherche toujours plus sanguinaire du profit, l’anomie, la désagrégation du corps social malgré le développement des technologies de communication, tout cela m’empêche de griffonner des poèmes jolis, des recueils brassant les jacinthes, les galets polis, les chevreuils, les alouettes, les chèvres et les bigorneaux. Un poète est une harpe éolienne : le vent qui le fait frémir passe à travers les bois… et les cadavres.
La poésie n’existe pas, parce qu’elle est sans cesse à réinventer : Villon, Celan, Hugo, Salabreuil, Rimbaud, Pessoa ont été les témoins de leur époque, et des chamanes, des sorciers, des bagarreurs, pour certains. Une œuvre poétique, sous forme de recueil, d’épopée ou de roman (cf. La chute d’un ange de Lamartine), au sens fort et noble de terme, fait gigoter, vaciller, trembler la Poésie sur ses gonds, pour mieux la refonder. Elle peut déranger de prime abord, mais elle fera date.
Là s’arrête ma prétention. Les noms cités plus haut ont réussi là où je ne suis même pas encore certain d’avoir essayé. En écrivant Poéticide, j’ai voulu rendre hommage à ces grandes figures qui, à l’instar des philosophes qui prennent le monde à bras-le-corps, innervent nos pensées, nos inconscients, et s’étalent un peu partout sur les plaques de nos rues. Je voulais aussi les rencontrer, du moins en rêve, et faire la nique au destin en faisant dialoguer le dormeur du val et le petit branleur de la ZUP.
Je ne crois plus vraiment aux génies. J’ai passé l’âge d’idolâtrer. Je n’accorde aucune importance à ces théoriciens qui, par esprit de conventionnalisme et recherche d’autosatisfaction, décident que tel auteur sera le nouveau classique ou celui qui comptera durant les prochaines années. Je ne me pose tout simplement plus ces questions, parce qu’elles sont étrangères à l’acte d’écrire, dans ce qu’il a de plus intime et charnel. Écrire, c’est l’union de la chair et de la métaphysique : le lecteur est le témoin de cette miraculeuse et pourtant si banale union.
La poésie n’existe pas, jusqu’à preuve du contraire. Il faut sans cesse la remodeler. Prétentieux est le bon mot. Car je prétends qu’il m’est impossible d’écrire uniquement sur les mésanges après avoir vu un grand échalas se faire trouer la paillasse, lorsque j’avais presque six ans. Ce qui n’empêche pas le passereau de s’introduire de temps à autre dans le conduit coupable et d’y pépier sa mélopée charmante. Mais dans ce cas, je vérifie systématiquement s’il ne se trouve pas, dans les parages, un canon de fortune prêt à lui trouer le bec.
Les trajectoires de vie dessinent les parcours d’écriture et de lecture. J’ai grandi et vécu à Calais. Je ne peux saisir les pissenlits que par la racine. La plupart du temps, du moins. Je fais bouger les frontières, j’ai mon mot à dire. Quand j’aurai tout dit, ou quand on m’aura fait tout cracher, publié ou pas, je pourrai fermer ma gueule et me poser.
Comme une mésange. Ou presque.
Le bec troué. Ou pas.
![[Texte - News] Hans Limon, Poéticide /](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2018/11/LimonPoesie.jpg)
![[Texte – News] Hans Limon, Poéticide / « La poésie n’existe pas »](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2018/11/band-Poeticide.jpg)