Les rivages sont ceux à tout jamais de l’Arabie heureuse. Il est peu de livres qui happent, absorbent autant que Les Mille et Une Nuits dont on ne peut se détacher, non tant comme le sultan Schahriar pour connaître la suite du feuilleton emboîté en poupées russes, que pour le charme, qui ne se laisse pas lever. On ne retrouve pas la flèche enchantée, tant elle a de loin outrepassé sa cible.
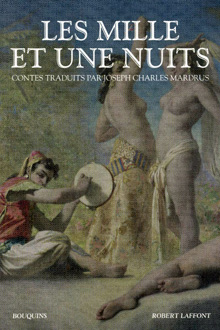 Soit un corps de récits comme il est des corps de légendes, d’antiquité persane et arabe comme il en est une hindoue ou grecque, Homère décidément multiple – elle a en Galland et Mardrus son Sophocle et son Euripide français, après cinq à sept siècles. Littérale, conforme aux textes premiers la version de Mardrus, tel Euripide mettant en scène la prostitution de Silène au Cyclope, qui n’omet pas un détail des copulations (Mardrus restant toutefois discret dans le conte le plus pédérastique où l’amoureux accomplissant les destins perce par malchance, au quarantième et dernier jour, le cœur du garçon de quinze ans enfermé dans un caveau pour le préserver de lui) ; elle conserve les parties lyriques en vers arabes agréables aux auditeurs d’origine mais que nous recevons comme des longueurs cassant la poésie des rêves, ceux rendus avec un taquin plaisir, temps et distance abolis, dix ans en une nuit (histoire de Noureddin Ali) ; toutefois plus riche en couleurs (« notre histoire, si elle était écrite avec des aiguilles sur le coin intérieur de l’œil », ou « à cette vue le monde noircit sur son visage » ou djinn ou efrit que Galland a traduits en génie, calife resté khalifat).
Soit un corps de récits comme il est des corps de légendes, d’antiquité persane et arabe comme il en est une hindoue ou grecque, Homère décidément multiple – elle a en Galland et Mardrus son Sophocle et son Euripide français, après cinq à sept siècles. Littérale, conforme aux textes premiers la version de Mardrus, tel Euripide mettant en scène la prostitution de Silène au Cyclope, qui n’omet pas un détail des copulations (Mardrus restant toutefois discret dans le conte le plus pédérastique où l’amoureux accomplissant les destins perce par malchance, au quarantième et dernier jour, le cœur du garçon de quinze ans enfermé dans un caveau pour le préserver de lui) ; elle conserve les parties lyriques en vers arabes agréables aux auditeurs d’origine mais que nous recevons comme des longueurs cassant la poésie des rêves, ceux rendus avec un taquin plaisir, temps et distance abolis, dix ans en une nuit (histoire de Noureddin Ali) ; toutefois plus riche en couleurs (« notre histoire, si elle était écrite avec des aiguilles sur le coin intérieur de l’œil », ou « à cette vue le monde noircit sur son visage » ou djinn ou efrit que Galland a traduits en génie, calife resté khalifat).
En ces temps bénis où le b a bah de l’enrichissement était encore de commencer par dissiper ses biens, l’histoire de Sindbad le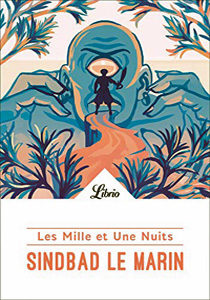 marin nous est contée comme le paradigme de l’esprit d’entreprise, à inscrire en lettres d’or au fronton du medef, de celles qui ne parlaient pas encore la langue de bois. Hindbad le portefaix et Sindbad le capitaliste du quitte ou décuple, ne diffèrent que d’une consonne, comme on a peine à le faire entendre à ceux qui peinent à aspirer le h.
marin nous est contée comme le paradigme de l’esprit d’entreprise, à inscrire en lettres d’or au fronton du medef, de celles qui ne parlaient pas encore la langue de bois. Hindbad le portefaix et Sindbad le capitaliste du quitte ou décuple, ne diffèrent que d’une consonne, comme on a peine à le faire entendre à ceux qui peinent à aspirer le h.
Récits de tiers état, d’un comique moins populaire que n’est Molière, où plus encore que dans les tragédies de Racine, adressées à un roi-soleil, la puissance souveraine est évoquée au travers de personnages princiers, mais où le quotidien, tant des conteurs que du public, est de richesse marchande, de bonne foi mercantile, de bonnes manières dont la matière est le commerce, des gens, des denrées, des étoffes, des joyaux, où joailler tutoie vizir, où seul l’amour d’Allah tricote le lien social avec les rustres et les rois, mais où la condition normale, normative, est celle d’entrepreneur en bagatelles, en bagues à telle enseigne que les massacres y sont occultés, que chrétien et juif, davantage que juif en chrétienté, y sont tolérés, que tôt les rais et les rayons de chalandise l’emportent sur les rêves, gâchent du rêve mais en structurent comme élément premier des contes l’immarcescible empreinte.
 Si Versailles m’était contée comme le sont ici Bagdad et Damas, Mossoul, Le Caire, bien avant le romantisme et tous nos ismes en cascade, et l’invitation au voyage, de Châteaubriand et Byron à Mérimée sans l’intériorité baudelairienne – jamais Galland n’eût fait sensation, obtenu succès de Cour et de librairie (celui-ci relatif faute seulement de tirages et d’alphabétisation) avec son bienséant orientalisme. Ce qu’il traduit, et que traduisent ses lecteurs en Comment peut-on être persan, sont de politesse à politesse avec un à deux siècles d’avance (le premier volume de ses contes paraît en 1704), les degrés de l’Histoire. Et quand Mardrus y reviendra, avec des affectations dignes de Bloch du Temps perdu, un érotisme de pacotille à la Pierre Louÿs, un lyrisme de Nourritures terrestres, tant de philologues ayant martelé de leur exigence le drap d’or des lettres, les mille et une nuits dans leur version première auront si fort imprégné notre littérature, de Stendhal à Proust, que malgré son lancement à grands éclats par La revue blanche, son tour sera passé.
Si Versailles m’était contée comme le sont ici Bagdad et Damas, Mossoul, Le Caire, bien avant le romantisme et tous nos ismes en cascade, et l’invitation au voyage, de Châteaubriand et Byron à Mérimée sans l’intériorité baudelairienne – jamais Galland n’eût fait sensation, obtenu succès de Cour et de librairie (celui-ci relatif faute seulement de tirages et d’alphabétisation) avec son bienséant orientalisme. Ce qu’il traduit, et que traduisent ses lecteurs en Comment peut-on être persan, sont de politesse à politesse avec un à deux siècles d’avance (le premier volume de ses contes paraît en 1704), les degrés de l’Histoire. Et quand Mardrus y reviendra, avec des affectations dignes de Bloch du Temps perdu, un érotisme de pacotille à la Pierre Louÿs, un lyrisme de Nourritures terrestres, tant de philologues ayant martelé de leur exigence le drap d’or des lettres, les mille et une nuits dans leur version première auront si fort imprégné notre littérature, de Stendhal à Proust, que malgré son lancement à grands éclats par La revue blanche, son tour sera passé.
Poésie. Sous le pinceau de Delvaux l’esplanade de la Défense semée de palais de marbre en guise de tours, au coin de la rue entre deux collines à quelques années lumière, des poissons de quatre couleurs nageant dans un vaste bassin, est une cité figée dont est banni le végétal irrégulier, tous ses habitants statufiés à l’exception du roi, lui seulement à mi-corps – je condense deux trois contes.
La plupart, alternant comique et tragique, marqués par un climat d’enfance (Histoire des amours de Camaralzaman), sont datés du douzième siècle, soit des rayons bas d’un âge d’or, d’un paradis perdu de l’Islam, époque des philosophes Averroès et Maïmonide, avant qu’il ne décline sous l’assaut des Croisés et de Gengis khan également barbares, et ne se radicalise bien avant les fanatismes contemporains.

![[Chronique] Christophe Stolowicki, Galland ou Mardrus ?](http://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2021/05/band-MilleMardrus.jpg)