En hommage à Jacques Roubaud, décédé le jour même de son 92e anniversaire (5 décembre 1932 – 5 décembre 2024), nous republions la chronique mise en ligne il y a presque dix-huit ans sur le premier site LIBR-CRITIQUE, qui portait sur le sixième volume de son cycle « autobiographique » inauguré par Le Grand Incendie de Londres (Seuil, 1989), et poursuivi aux mêmes éditions du Seuil par La Boucle (1993), Mathématique (1997), Poésie (2000) et La Bibliothèque de Warburg (2002).
volume de son cycle « autobiographique » inauguré par Le Grand Incendie de Londres (Seuil, 1989), et poursuivi aux mêmes éditions du Seuil par La Boucle (1993), Mathématique (1997), Poésie (2000) et La Bibliothèque de Warburg (2002).
C’est l’occasion de réexaminer la position particulière qu’occupe Jacques Roubaud au sein de l’espace littéraire : entré dans le champ à l’époque où, à l’écart des avant-gardes textualistes, l’Oulipo de Queneau livrait sa version du séculaire clivage poétique entre inspiration et travail (contrainte oulipienne versus imagination surréaliste), un peu en marge de ce groupe auquel il s’est rattaché, et contre de nouvelles pratiques (écritures numériques et multimédia notamment) qui, selon lui, n’ont pas conservé la mémoire de la poésie, cet écrivain reconnu n’a eu de cesse que de défendre, en vers ou en prose, une poésie traditionnellement novatrice.
En janvier prochain, les éditions Nous feront paraître, préfacées par l’un des meilleurs spécialistes de l’œuvre, Stéphane Baquey, ses 32 textes théoriques publiés entre 1968 et 2015, en revues et dans divers collectifs, sous le titre Poétique.
Jacques Roubaud, Nous, les moins-que-rien, fils aînés de personne. 12 (+1) autobiographies, Fayard, 2006, 324 pages, 20 €, ISBN : 978-2-213-62613-8.
12 singularités roubaldiennes
1. La « prose de mémoire » est mémoire des autres proses du cycle. Signe d’appartenance de la sixième « branche » à l’ensemble, c’est le même matériau autobiographique qui est repris : images-souvenirs, « passion des nombres », articulations poésie/mathématiques, goût du sonnet, idéal poétique du trobar clus… Mais le polygraphe explore d’autres variations potentielles parmi d’innombrables, et c’est en raison de cette infinitude que l’esthétique de Roubaud est celle de l’inachèvement et que « toute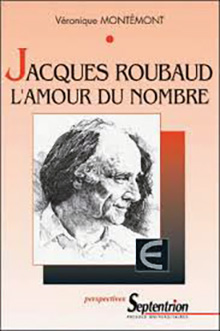 autobiographie, par définition, ne peut qu’être inachevée » (Autobiographie, chapitre dix, Gallimard, 1977, p.120). Aussi les principes de composition demeurent-ils identiques, mais appliqués à des continuations : la répétition/variation, mais aussi, au plan microstructurel, le rapport entre sous-titres et premières phrases (cf. chap. V).
autobiographie, par définition, ne peut qu’être inachevée » (Autobiographie, chapitre dix, Gallimard, 1977, p.120). Aussi les principes de composition demeurent-ils identiques, mais appliqués à des continuations : la répétition/variation, mais aussi, au plan microstructurel, le rapport entre sous-titres et premières phrases (cf. chap. V).
2. La « prose de mémoire » est mémoire du Projet poétique. Plus précisément, ce cycle vise avant tout à rendre compte d’un Projet poétique originel qui, composé de trois « moments » correspondant à des étapes cruciales dans l’histoire des formes (la canso des troubadours, à laquelle succède le sonnet, le tanka de la poésie classique japonaise) et à des modèles précis (poésie courtoise, Canzoniere de Pétrarque, anthologies japonaises…), est allé de totalisations en détotalisations depuis la parution du Signe d’appartenance (Gallimard, 1967) : genèse, avatars, apories et architecture du Projet ; genèse des vocations poétique et mathématique; théories et pratiques poétiques… Nous, les moins-que-rien… se concentre sur ces deux derniers aspects dans un tout construit comme un hyperalexandrin. Si l’on considère que nous avons affaire à un trimètre, les temps forts (moments accentués) sont, outre le chapitre XII où l’auteur se met lui-même en scène pour un « dernier POC », le quatrième (« Vida du troubadour Rubaut ») et le huitième, où sont juxtaposés parodie de l’autobiographie traditionnelle, transcription en vers d’un discours de Robert Hooke et méditations sur la mémoire ; et s’il s’agit d’un tétramètre, les « moments » mis en valeur sont tout aussi essentiels : le troisième, consacré au sonnet, et le neuvième au tanka (poème bref en cinq vers obéissant en principe à la distribution syllabique 5-7-5-7-7), tandis que le sixième est un lipogramme établi par un certain Roubaud, Bourguignon prisonnier à l’époque de Jeanne d’Arc, et restitué par l’éditeur Octavius J. Cayley.
3. Pour être neutre, la prose qui met en mémoire la poésie est néanmoins elle-même poétique, dans la mesure où elle se révèle énigmatique et labyrinthique. A commencer par le titre, envers microstructurel du sous-titre – 12 (-1) syllabes –, dont la première partie peut se comprendre relativement au statut du sujet dans cette anti-autobiographie (cf. ci-dessous) et la seconde, entre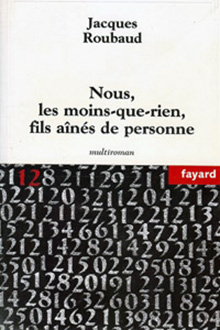 autres interprétations, comme une possible trace d’un drame de l’enfance déjà présent dans Signe d’appartenance, la mort du frère cadet. Passé le seuil cryptique du livre, excroissance centrifuge d’un Nous, nous sommes plongés dans un inextricable dédale de lieux, d’époques, de références culturelles, d’écritures différentes, de jeux oulipiens… Un tel foisonnement hétérogène n’est pas sans poser un problème de lisibilité qui rappelle l’art hermétique du troubadour.
autres interprétations, comme une possible trace d’un drame de l’enfance déjà présent dans Signe d’appartenance, la mort du frère cadet. Passé le seuil cryptique du livre, excroissance centrifuge d’un Nous, nous sommes plongés dans un inextricable dédale de lieux, d’époques, de références culturelles, d’écritures différentes, de jeux oulipiens… Un tel foisonnement hétérogène n’est pas sans poser un problème de lisibilité qui rappelle l’art hermétique du troubadour.
4. La « prose de mémoire » se référant plus au Grand Livre qu’à la petite histoire intime, plutôt que d’autobiographie il faut parler d’autobiobibliographie.
5. La « prose de mémoire » est mémoire de rien. D’où l’excroissance de la structure alexandrine qui condense les douze fictions autobiographiques : parmi de petits riens, le chapitre XIII, « Une vie de rien », rapporte un curieux cogito-Chat qui a guidé le narrateur durant soixante-quinze ans (autre indice autobiographique), « Je pense rien »… donc j’existe. Aussi ne sommes-nous pas tant en présence d’un larvatus prodeo que d’un je vide. Qui plus est, Je est tellement Autre qu’il devient Nous. Et en fin de compte, si l’on en croit la formule roubaldienne qui constitue un avatar de la mallarméenne disparition élocutoire, le jeu a détrôné le je : « toute contrainte implique une disparition » (L’Arc, n° 76, 1979). Car l’origine de ce Nous triomphant est la contrainte qui, tirée du Jeu des perles de verre, de Hermann Hesse, trône au verso de la page de titre : un rite universitaire à l’usage des plus jeunes étudiants, « un genre particulier de dissertation ou d’exercice de style qu’on appela curriculum vitae« , une sorte d’ »autobiographie fictive » qui permet de « considérer sa propre personne comme un travesti, comme l’habit précaire d’une entéléchie« .

© Philippe Matsas / Opale : photo de Jacques Roubaud et son masque
6. La « prose de mémoire » qualifiée de multiroman se fonde sur l’impossibilité même de l’autobiographie. D’où la parodie du pacte autobiographique qu’offre la page 235 : « Personne ne connaît autant de choses sur ma vie que moi-même, je veux la livrer à la Postérité, écrite de mes propres mains. Je déclare que tout y est dit franchement et impartialement, mon seul but étant de prévenir les falsifications et désabuser ceux qui les croient ». Se trouve ramassé ici tout ce qui fait problème : grandiloquence, prétention et naïveté, hypostase de la postérité…
7. A la fiction, Jacques Roubaud préfère toutefois l’invention. D’autant que « le roman, à la différence des poèmes, (…) est voué à s’effacer, parce qu’il finit » (Poésie, p. 237). Car, mémoire de la langue et des formes poétiques antérieures, la poésie affecte la mémoire par ses qualités métrico-rythmiques. A l’instar du Lancelot, la « prose de mémoire » crée un système d’échos et d’entrelacements narratifs qui suppose une mémoire absolue.
8. Mise en nombre d’une existence (cf. p. 182), la « prose de mémoire » est éminemment oulipienne : outre les divers systèmes numériques qui régissent la matière narrative, dont l’un se réfère à l’informatique (au macintosh d’un Roubaud qui « s’interrompt à la date du 13 mars 2006 » ?) – @1…@2… –, on n’oubliera évidemment pas, comme élément structurant, le nombre douze, repérable dans la construction d’ensemble, les numéros de section ou de rubrique, l’alexandrin, la somme des chiffres constituant la date 1605 ou l’immatriculation 318, et présent dans le texte en tant que nombre abondant (qui compte beaucoup de diviseurs) ou simplement tel quel au fil des pages (115, 160, 242…). La transposition des mathématiques modernes dans l’univers littéraire et le ludisme corrélatif rattachent ainsi Jacques Roubaud à l’Oulipo, auquel il fait allusion à deux reprises (pp. 230 et 232) : « La méthode axiomatique transposée, le pseudo-bourbakisme appliqué à un objet aussi éloigné des mathématiques que le sonnet ont un caractère ludique évident » (« Description du projet », Mezura, n° 9, 1979, p. 9). Cela dit, l’enjoué écrivain fait prévaloir les contraintes poétiques sur les contraintes arbitraires tous azimuts pour la seule raison qu’elles sont motivées en tant qu’actualisation du rythme. (Ce n’est donc pas un hasard s’il s’est choisi un nombre qui n’ »appartient » pas à Queneau). A cette motivation esthétique peut s’en ajouter une autre : par exemple, Corneille est le seul de son temps à insérer des acrostiches dans ses vers à des fins autobiographiques.
9. Cet exemple nous met sur la voie d’une autre différenciation par rapport à l’Oulipo : l’expérimentation formelle ne doit pas s’effectuer au détriment de la réflexion sur l’expérience humaine – cette expérience fût-elle scientifique ou littéraire, voire plus ou moins indépendante de l’innovation formelle. Ainsi, les chapitres huit, neuf et onze, parallèlement à des explorations formelles (transcription en vers du discours de R. Hooke ; « octonions » du duo Sir James Roubaud / Cayley, inspirés des « quaternions » du mathématicien William Rowan Hamilton) ou l’exploration du tanka, offre de passionnants développements sur la mémoire, la vocation poétique, le temps… Arrêtons-nous enfin sur l’un des chapitres les plus longs, le cinquième, qui doit son nom au dernier vers du sonnet final (« Cherche ce qui se doit »), sonnet dont on apprend le code numérique dans l’ »Apendice I » (p. 316) : l’aphorisme et la trilogie éthique (« FLAMME / LOI / ARDU ») que dévoilent les acrostiches cachés dans le poème condensant la doctrine d’une secte, la Famille d’amour, viennent éclairer, en cette époque trouble des guerres de religion, l’étonnante trajectoire d’un esprit tolérant, Jacobus Robaldus.
indépendante de l’innovation formelle. Ainsi, les chapitres huit, neuf et onze, parallèlement à des explorations formelles (transcription en vers du discours de R. Hooke ; « octonions » du duo Sir James Roubaud / Cayley, inspirés des « quaternions » du mathématicien William Rowan Hamilton) ou l’exploration du tanka, offre de passionnants développements sur la mémoire, la vocation poétique, le temps… Arrêtons-nous enfin sur l’un des chapitres les plus longs, le cinquième, qui doit son nom au dernier vers du sonnet final (« Cherche ce qui se doit »), sonnet dont on apprend le code numérique dans l’ »Apendice I » (p. 316) : l’aphorisme et la trilogie éthique (« FLAMME / LOI / ARDU ») que dévoilent les acrostiches cachés dans le poème condensant la doctrine d’une secte, la Famille d’amour, viennent éclairer, en cette époque trouble des guerres de religion, l’étonnante trajectoire d’un esprit tolérant, Jacobus Robaldus.
10. Si, contrairement à certains oulipiens, Jacques Roubaud réussit à éviter le piège du formalisme, c’est qu’il ne craint pas d’associer innovation formelle et tradition. En cela il rejoint certes l’Oulipo, qui, dès sa création, s’est opposé à l’esthétique de la tabula rasa que revendiquaient la plupart des avant-gardes contemporaines : « Je ne suis pas du tout partisan de la théorie avant-gardiste de la table rase », tonne le Roubaud mis en scène dans « Le Dernier POC » après s’être réclamé d’une tradition qu’il étudie et dont il s’inspire. Seulement, plus encore que les praticiens de l’anoulipisme (examen des contraintes inventées au fil des siècles), il s’attache à renouveler des formes anciennes dont il croit à la productivité (sextine, tanka, sonnet).
11. D’où sa volonté d’ériger en art le travail formel et réflexif qui a pour matériau le patrimoine littéraire mondial : le geste de l’anthologiste facétieux qui consiste à donner en accéléré une tragédie de Le Royer de Prade (1666) et à « codécimer » Phèdre, c’est-à-dire à ne laisser « subsister que les vers ou débuts de vers dont la charge émotive est forte » ; la création d’un sonnet à partir de  quatorze vers des Fleurs du mal (pp. 120-121)… A ce propos, on se souvient que Autobiographie, chapitre dix (Gallimard, 1977) était un gigantesque centon : l’assemblage de fragments de poèmes en vers libres publiés dans les dix-huit années précédant sa naissance (1914-1932) était pour l’écrivain un moyen d’écrire une autobiographie oblique, c’est-à-dire de porter un regard sur sa propre vie à travers le prisme de son héritage poétique.
quatorze vers des Fleurs du mal (pp. 120-121)… A ce propos, on se souvient que Autobiographie, chapitre dix (Gallimard, 1977) était un gigantesque centon : l’assemblage de fragments de poèmes en vers libres publiés dans les dix-huit années précédant sa naissance (1914-1932) était pour l’écrivain un moyen d’écrire une autobiographie oblique, c’est-à-dire de porter un regard sur sa propre vie à travers le prisme de son héritage poétique.
12. Dans l’univers roubaldien, le sérieux encyclopédique et philosophique se combine logiquement avec l’humour, l’ironie et la fantaisie bouffonne. C’est ainsi que Pierre Corneille Roubaud se fait déchiffreur d’énigmes pour traquer les grotesques inter-dits des acrostiches cornéliens : par exemple, les vers 444-450 d’Horace recèlent une insulte sans doute destinée à un rival amoureux (« SALE CUL »). Un peu plus loin, le narrateur s’amuse à débusquer des poètes lanternistes aux noms éloquents : Joseph Pétasse, Désiré Tricot, Alexandre Cosnard, Michel Poulailler – auteur d’ »Un chant d’oiseau » –, Henri Passérieu, Alfred Migrenne… La parodie, quant à elle, touche aussi bien l’écriture dramatique (au travers des didascalies : cf. chap. XII) que le cinéma d’avant-garde, dont cette annonce se veut emblématique : « Ceci est la première composition cinématographique d’une minute d’Orson Roubaud. Elle dure une minute » (p. 232). Et quand s’engage un débat sur la crise du théâtre, les cibles privilégiées font partie de la triade Auteur-Metteur en scène-critique : entre autres propositions saugrenues, retenons que, par souhait de simplification, le schéma d’une pièce pourrait se réduire à celui-ci : « Lever de rideau / Le rideau se lève / FIN » (p. 87); que, pour « être résolument moderne », il faut alléger les pièces du répertoire en supprimant les rimes ou en synthétisant l’intrigue à l’extrême ; qu’afin de faciliter « l’intégration théâtrale européenne », il importe de faire jouer chaque pièce simultanément en quatre langues…
Relativisation des variations roubaldiennes
Avec ce multiroman, Jacques Roubaud s’inscrit en droite ligne d’une modernité qui a déconstruit le modèle autobiographique 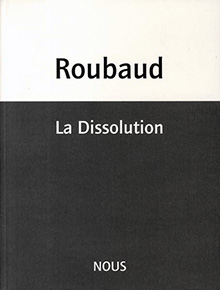 formalisé a posteriori par Philippe Lejeune pour mettre en place de nouvelles formes : « autobiogre » (Lucot), « autofiction » (Doubrovsky), « automythobiographie » (Combet), « autosociobiographie » (Ernaux), « circonfession » et « otobiographie » (Derrida), « curriculum vitae » (Butor), « Nouvelle Autobiographie » (Robbe-Grillet)… Reste que ces variations multiromanesques ne font rien d’autre qu’exposer dans un seul livre qui affiche son artefactualité les potentialités autobiographiques qu’explore tout véritable romancier dans une œuvre entière. Autre problème : pourquoi reprendre le procédé ironique de la mise en scène éditoriale, qui, d’ailleurs, pour dater du XVIIIe siècle, n’en est pas moins repris aujourd’hui par des romanciers comme Chevillard ou Jourde ? C’est de l’ironie au second degré, dira-t-on. Certes… En dernière analyse, si « l’auteur oulipien est un rat qui construit lui-même le labyrinthe dont il se propose de sortir » (Poésie, etcetera : ménage, Stock, 1995, p. 209), qu’en est-il du lecteur ? S’il y a suffisamment de jeu pour qu’il puisse jouer également, tout dépend en fait de quel lecteur il s’agit : ne tarderont pas à s’égarer et à être pris au piège tous ceux qui ne placent pas par-dessus tout le « plaisir de mémoire », le plaisir de l’intellect et des formes.
formalisé a posteriori par Philippe Lejeune pour mettre en place de nouvelles formes : « autobiogre » (Lucot), « autofiction » (Doubrovsky), « automythobiographie » (Combet), « autosociobiographie » (Ernaux), « circonfession » et « otobiographie » (Derrida), « curriculum vitae » (Butor), « Nouvelle Autobiographie » (Robbe-Grillet)… Reste que ces variations multiromanesques ne font rien d’autre qu’exposer dans un seul livre qui affiche son artefactualité les potentialités autobiographiques qu’explore tout véritable romancier dans une œuvre entière. Autre problème : pourquoi reprendre le procédé ironique de la mise en scène éditoriale, qui, d’ailleurs, pour dater du XVIIIe siècle, n’en est pas moins repris aujourd’hui par des romanciers comme Chevillard ou Jourde ? C’est de l’ironie au second degré, dira-t-on. Certes… En dernière analyse, si « l’auteur oulipien est un rat qui construit lui-même le labyrinthe dont il se propose de sortir » (Poésie, etcetera : ménage, Stock, 1995, p. 209), qu’en est-il du lecteur ? S’il y a suffisamment de jeu pour qu’il puisse jouer également, tout dépend en fait de quel lecteur il s’agit : ne tarderont pas à s’égarer et à être pris au piège tous ceux qui ne placent pas par-dessus tout le « plaisir de mémoire », le plaisir de l’intellect et des formes.
![[Chronique] Hommage à Jacques Roubaud (Nous, les moins-que-rien, fils aînés de personne. 12 (+1) autobiographies), par Fabrice Thumerel](http://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2024/12/Roubaud_poemeCouleurs.jpg)

![[Chronique] Hommage à Jacques Roubaud (Nous, les moins-que-rien, fils aînés de personne. 12 (+1) autobiographies), par Fabrice Thumerel](http://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2024/12/band-RoubaudMPP.jpg)