Maurice MOURIER, Mémoires comme d’oubli, PhB Editions, novembre 2024, 528 pages, 25 €, ISBN : 979-10-93732-87-9.
Avec son précédent livre, La Femme bue par l’aube, Maurice Mourier avait déjà brillamment montré son pouvoir de 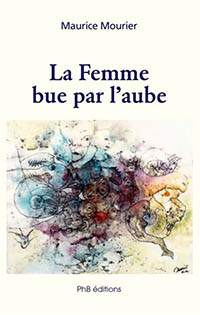 subversion des genres littéraires. Dans ce nouveau roman (l’expression pourrait presque ici revêtir un double sens), il maintient ce cap. En contant ou racontant cette histoire, il nous amène à explorer chemin faisant sa nature, la part de réel et d’imaginaire qu’elle contient, les sources mêmes, l’ontologie de l’écriture.
subversion des genres littéraires. Dans ce nouveau roman (l’expression pourrait presque ici revêtir un double sens), il maintient ce cap. En contant ou racontant cette histoire, il nous amène à explorer chemin faisant sa nature, la part de réel et d’imaginaire qu’elle contient, les sources mêmes, l’ontologie de l’écriture.
Ce seraient donc des Mémoires. Mais alors d’emblée, ce titre interroge, associé à son antithèse, oubli…Qu’à cela ne tienne, car dès l’Ouverture, une clé possible est proposée dans un facétieux dialogue entre un Professeur émérite aux titres ronflants et… l’auteur (son double ?), Maurice Mourier en personne ! Précisons que l’ensemble du récit, composé de six parties, comme les mouvements d’une pièce musicale, se trouve enchâssé entre cette « Ouverture » et une « Coda » qui viennent avec humour tout à la fois éclairer et obscurcir les pistes proposées. Ainsi la Coda mettra en scène, dans un débat fort animé, ledit professeur et ses étudiants cherchant à cerner la notion d’autobiographie dans un feu d’artifice de réparties comme pour couronner le roman et le mettre en abyme, invitant avec espièglerie le lecteur arrivé au terme du récit à le considérer sans naïveté ni a priori comme un objet d’étude littéraire.
Cela pourrait aussi être un roman d’apprentissage, une fiction autobiographique, un conte, un long chant d’amour en prose poétique, la recherche d’un temps perdu immédiatement retrouvé dans le miracle des mots. Mais on pourrait également dire, à l’instar de Magritte dans sa « Trahison des images » (« Ceci n’est pas une pipe », « Ceci n’est pas une pomme »), ceci n’est pas un roman, un conte, une autobiographie (genre écorné au passage, avec « l’autobougrinfâmie », objet du séminaire de l’inénarrable professeur).
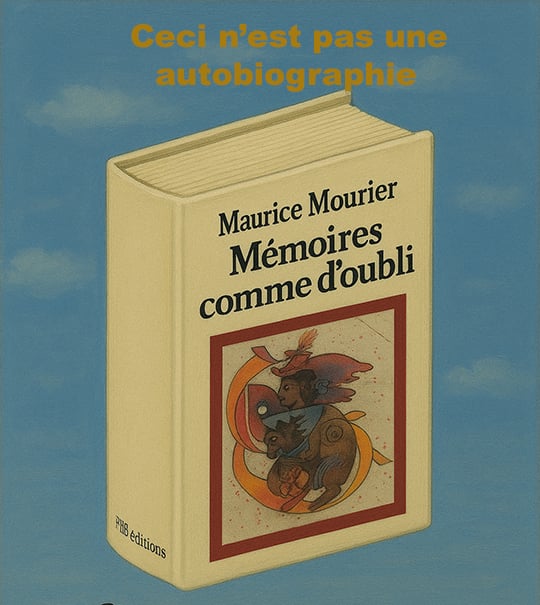
En tout état de cause, ce récit, qui retrace l’itinéraire d’un petit garçon jusqu’à son entrée dans le monde adulte, nous emporte, nous touche, nous fait accéder à une forme de vérité et d’universalité au-delà de la question de la véracité des faits racontés, en sejouant des codes, en équilibre sur des frontières, d’infinis territoires entre rêve et réalité.
Et si la vie est un songe, Mémoires comme d’oubli nous fait passer de l’autre côté du miroir et basculer dans un univers insoupçonné. On y entre tout d’abord de manière un peu brutale, à l’instar d’Alice suivant le lapin dans son terrier, en trébuchant brièvement sur le titre, puis avec cette brève « Ouverture », prologue inattendu, et enfin, troisième rebond, en découvrant le début saisissant de la première partie intitulée « Le petit garçon aux cheveux rouges » : « IL EST UNE FOIS UN PETIT GARÇON AUX CHEVEUX ROUGES qui atteint l’âge de douze ans. Auquel il est mort. Au-dessus de lui, l’œil immense du globe d’où tombe une aveuglante lumière blanche. » Le globe lumineux c’est le point de réfraction, ou d’effraction par-delà lequel le petit garçon peut accéder à une autre dimension, traverser le miroir. Nous, lecteurs, à sa suite on se lance, le début est haletant. Disons simplement qu’il faut mourir pour renaître. Après cette intensité douloureuse, c’est d’une tout autre manière que l’on entre dans l’histoire et que l’on découvre un Royaume, celui de l’enfant ; sur la pointe des pieds, cette fois, en retenant son souffle comme dans un lieu sacré, et d’un bout à l’autre du récit, on le suivra sans le lâcher un instant.
« Une manière d’enchantement »
Ces mots empruntés au chapitre 4 de la première partie, lorsque l’enfant et celle qui est nommée « la Fée », ou « la Reine », sa mère bien-aimée, se trouvent ensemble, en osmose dans la nature, dans un espace-temps qui n’appartient qu’à eux, pourraient aussi définir le sentiment du lecteur au seuil de cet univers qui s’ouvre devant lui. « Dans la sphère magique », ou encore dans « une zone merveilleusement dépourvue de temps », « ce lieu de l’enfance blottie » – « C’est qu’il y va de l’équilibre du monde » – nous avançons dans les pas de l’enfant.
À quoi peut bien tenir ce sortilège de lecture, finalement assez rare et précieux pour que l’on cherche à comprendre ce qui se produit au fil des pages, à saisir ce mystérieux alignement des planètes dans la constellation littéraire, au point que l’on se dit d’emblée qu’il se passe là quelque chose de puissant, de singulier, et qu’on se trouve en présence d’un grand livre ? C’est sans aucun doute une conjonction de plusieurs éléments, mais on sait que cette alchimie par nature restera mystérieuse, on l’accepte, on est prévenu (ainsi, la Reine, c’est-à-dire la Fée, est aussi une magicienne, pratique exorcismes et formules magiques, apparaît et disparaît – « La Reine n’est pas d’ici, est-elle d’ailleurs ? »).
Cependant ces mots de Balzac pourraient nous aider à apprivoiser le mystère :
« Beaucoup de choses véritables sont souverainement ennuyeuses, aussi est-ce la moitié du talent que de choisir dans le vrai ce qui peut devenir poétique », écrit-il dans sa nouvelle « Le message ». Balzac, maître du roman, place donc la poésie au centre de tout projet romanesque. Maurice Mourier possède précisément ce talent, dans la lignée des grands romanciers et d’un bout à l’autre de l’histoire, partant du vrai, de la recomposition d’une réalité certainement vécue et parfois rêvée, de déployer toute la poésie et l’imaginaire du pays d’enfance dans lequel grandit le petit garçon aux cheveux rouges. Mais « il faudrait creuser un peu plus avant », comme l’indiquent en leitmotiv ces mots malicieusement lancés au fil du texte par le narrateur. Alors, allons-y.
« Choisir dans le vrai ce qui peut devenir poétique »
Le cadre : C’est le centre du monde pour le petit garçon aux cheveux rouges. Au siècle dernier, dans les années 40. Une campagne française reculée et relativement protégée ; malgré les conséquences diffuses de la guerre, puis de l’après-guerre, on vit dignement, on ne s’apitoie sur rien. Un petit village, une maison, une cuisine où règne une « Mère-Grand » extraordinaire, et tout alentour, la nature souveraine, vaste terrain de jeux et de découvertes de l’enfant, réservoir infini de son imaginaire. « La campagne », désignée par son terme générique, est peu située géographiquement.
Quelques petites touches impressionnistes (« la Halte » où arrive souvent la Fée par le train du soir, allusions au Vexin, à Méry-sur-Oise dont il est question quand « la Reine et son page » cherchent un nom pour le village qu’ils créent pour « les fourmis, les bourdons, les sauterelles » – comme en écho à la recherche d’un lecteur curieux qui voudrait aussi mettre un nom sur cette campagne) et divers recoupements permettent de la situer approximativement. Pour que la Reine, depuis la capitale, puisse régulièrement, dès que son métier de journaliste le lui permet, rendre visite à l’enfant qui vit avec Mère-Grand, il faut bien que ce lieu soit assez facilement accessible par le chemin de fer. Mais la situation géographique importe peu, puisque ce cadre, point d’ancrage du petit garçon aux cheveux rouges, est clairement la patrie du rêve, des elfes, des animaux et des lutins. En contrepoint à la clarté de ce monde, de ce microcosme paradoxalement infini, de cet Idéal – « cette bienheureuse plage d’éternité qui ne demande qu’à s’étendre en tous sens puisqu’il n’y a plus de temps » – existe inévitablement celui d’un autre espace-temps honni, celui de la contrainte de l’école d’abord, (« il passe le plus noir de son temps à l’école »), puis à mesure que l’enfant grandit, du lycée et des classes préparatoires celui du Spleen de la ville sale et sombre où il est bien obligé de vivre pour poursuivre (brillamment malgré tout) ses études.
Les personnages
Les personnages principaux font l’objet des six parties précédemment évoquées, qui pourraient aussi être considérés comme les six tomes de cette « Recherche ». D’abord « Le petit garçon aux cheveux rouges » (I), fil conducteur du livre ou ce qu’il est convenu d’appeler le héros, puis les figures essentielles de « Mère-Grand » (II), et La Fée « Une Reine messagère » (III), aux personnalités différentes et complémentaires. L’une est stabilité, ancrage dans la vie quotidienne ; ancienne infirmière qui a vécu en Algérie, elle garde les pieds sur terre. L’autre évanescente et intermittente auprès de l’enfant, retenue ailleurs par son travail et son mari « Le monsieur vêtu de noir » (IV) qui n’est autre que le père de l’enfant. Le petit garçon grandit, se constitue auprès de ces deux femmes et, sinon « contre » l’homme qu’il répugne à nommer son père (quel Œdipe !), du moins dans une indifférence appuyée à l’égard de celui qui finalement apparaît aux yeux des trois principaux protagonistes comme une malheureuse « pièce rapportée », grain de sable dans l’harmonie de leur « trio initial » (ce que l’auteur appelle si joliment leur « roulotte originelle ») et du « petit lopin d’espace de l’enfant ». Les parties V et VI sont respectivement consacrées au groupe indistinct « Des Immortelles », et à l’unique « Ajoupa », rencontrées au fil du temps par celui qui devient peu à peu (et à son corps défendant : « – Il faut bien grandir. – Je ne veux pas grandir ») « le grand garçon », « l’adolescent » et enfin « le garçon ». Ce dernier, au moment du dénouement, prend d’ailleurs dans la fiction la place de l’auteur, s’empare d’une plume et d’un « carnet à spirale tout neuf », traçant à la fois les dernières et les premières lignes vibrantes de son histoire, qu’il faut laisser aux lecteurs le soin de découvrir.
Chez les personnages féminins, la poésie est partout. « La Reine messagère du bonheur » en est la quintessence, par sa beauté, sa profondeur, son secret. C’est elle qui initie l’enfant aux livres, au rêve, à l’amour, sur des lisières parfois troublantes que son passé permet subtilement d’éclairer – mais qu’est-ce qui est de l’ordre du vécu et de l’imaginé ? Nul ne saurait le dire. La Fée est à bien des égards restée une enfant. Elle a connu, tout comme Mère-Grand, une tragédie ; chacune à sa façon en porte la mémoire (comme d’oubli), mais toutes deux avancent tête haute.
Mère-Grand enseigne au petit garçon la vie d’une autre manière, sur le versant du réel. Elle raconte beaucoup, commente le présent, fait revivre le passé, remonte aux sources de leur histoire dans des tirades magnifiques, elle sauve, guérit, fourbit les armes pour affronter l’existence.
Ces deux femmes ont d’abord conçu l’enfant (si le roman dévoile peu à peu les origines de sa conception, dès les premières pages on sait qui est qui : « (…) un géant débonnaire prévint Mère-Grand, en qui il a reconnu d’un coup d’œil le chef de famille » – d’ailleurs, n’appelle-t-elle pas l’enfant « mon fi » ?), puis veillé sur lui « au cours des années longues », jusqu’à ce qu’il devienne un jeune homme.

© Photo de Tristan Felix
Les « Immortelles » peuplent son espace sensuel et fantasmagorique. Ce sont les créatures de ses désirs, réels ou imaginaires. Elles passent en laissant leurs traces plus ou moins persistantes dans sa mémoire sensorielle, comme pour donner le temps au jeune garçon d’achever sa métamorphose, comme pour le préparer à l’avènement d’«Ajoupa » qui surgit à la fois en majesté, « incroyablement là, éclose tel le bonheur inattendu » et « sans bruit, sans irruption violente dans le réel » : l’essentielle, l’existentielle, celle qui va bouleverser sa vie (« Rien ne se passe mais tout s’est produit. Le jour vient de se rompre en son milieu, sans bruit » : notons au passage que tout est dit ou plutôt suggéré dans l’équilibre admirable de ces deux phrases, avec ces deux décasyllabes suivis des deux monosyllabes « sans bruit », qui viennent en écho contrebalancer ce qui précède), sans doute transcender l’amour absolu appris des deux femmes originelles et donner ses lettres de noblesse à la sexualité et la sensualité explorées avec les Immortelles, puisqu’il va par Ajoupa, à travers elle, passer de l’amour physique à une métaphysique de l’amour, comme le dévoilent (tout en préservant le mystère) les dernières pages du livre.
Mère-Grand et La Reine donnent donc au petit garçon des clés pour lire le monde, l’écrire et le vivre (parallèlement aux clés laissées par l’auteur à notre usage). Chacune avec sa grammaire lui transmet son approche sensible et son « discours amoureux ». « Leurs accents conjugués » construisent les fondations, le socle d’une existence placée sous le signe de la liberté, de la nature, de la beauté, de la sensorialité, de la pensée et des mots. Ainsi, elles lui ouvrent le chemin d’accès au poème, à toutes les « voix chères qui se sont tues » (la citation de Verlaine figure ici parmi beaucoup d’autres, également fondatrices), à celles des poètes qui l’accompagneront à jamais. Superbes pages en leur hommage dans la sixième partie, consacrées au chant polyphonique de ces voix mêlées à celles des deux premières femmes aimées (« Voix de Mère-Grand, la plus belle par l’extraordinaire ampleur de ses registres », « Voix de la Reine, plus faible et plus voilée »). Ainsi le chemin d’apprentissage de la vie est indissociable de celui des mots et de l’écriture.
Au-delà de ces figures tutélaires, le royaume de l’enfant est peuplé de personnages secondaires ou même de simples silhouettes dont la présence, aussi forte que celle des autres protagonistes, ajoute à la densité poétique du texte. Les animaux donnent une couleur particulière au récit. Réels (les abeilles, le taureau, les chiens), imaginaires, représentés (la frise d’animaux de la tapisserie qui ouvre la voie de la rêverie), objets de multiples métaphores ou comparaisons (certains objets inanimés personnifiés, comme vus par l’enfant : le car, qui « ressemble à une grosse poule jaune (…) », ou la Vespa : « L’adolescent s’approche doucement de l’objet, comme d’une bête qu’il ne faut pas effrayer.» ; « sa structure fine d’insecte »)… et surtout les périphrases aimantes employées par la Reine pour nommer son Page, son « bel oiseau bleu aux couleurs du temps ». Protecteurs ou effrayants, ils constituent un véritable bestiaire qui accompagne l’enfant dans sa lente transformation. D’ailleurs, le petit garçon lui-même, dès les premières pages, est associé à « la chrysalide qu’il déterre parfois » (…) « relégué dans un creux douillet du rien, l’enfant préservé de la vie connaît peut-être à nouveau l’aise du séjour intra-utérin », tandis que tout près du dénouement, il achèvera explicitement sa métamorphose « dans cette atmosphère de renfermement poussiéreux qui aujourd’hui se révèle pour la première fois être aussi un cocon où la chrysalide brune attendait de jaillir en papillon. »
Dans cette poétique romanesque, les événements fondateurs jalonnent le parcours du petit garçon jusqu’à l’âge adulte. Très tôt, il fait l’expérience de la mort précédemment évoquée. D’autres épreuves douloureuses, d’autres épisodes initiatiques marquants sont parfois liés à des lieux ou objets hautement symboliques, comme celui de la perte des livres, de la perte de la clé confiée par Mère-Grand, de la confrontation avec le taureau, l’exploration du labyrinthe. Au-delà des chocs existentiels et points d’orgue que représentent certains événements, les apprentissages, en particulier ceux, très prégnants, de l’éveil de la sensualité et de la sexualité (solitaire ou pas) s’inscrivent aussi dans le temps long, toujours dans un espace-temps comme en marge du réel, dans un étonnant équilibre entre une façon très libre, directe de décrire la vie intime et une forme de retenue et même de non-dit.
La cristallisation du monde
Au fond, tout se joue sur le fil d’un narrateur équilibriste ou jonglant jusqu’au vertige, mais sans accroc, sur son ouvrage de dentelle romanesque, avec ses multiples fuseaux sur tous les fils tramés du vrai et de la poésie. C’est en grande partie à cela que tient l’aspect merveilleux ou miraculeux du récit, ajouté au fait que les êtres et le monde sont perçus à travers le prisme onirique, les yeux et les émotions de l’enfant puis du jeune garçon. Il les lit, les interprète au-delà de leurs apparences. Le petit garçon aux cheveux rouges a été à bonne école pour se faire Voyant.
Intensité et cristallisation des présences, de toutes les présences.
Celles des personnages qui existent immédiatement, in medias res, dans l’action, par l’action quelle que soit leur importance, leur place dans le récit. Dès le premier mouvement on est happé, chaque phrase fait mouche. Tout de suite, ils/elles sont campés, à la fois dans l’évidence de leur vérité et au-delà de leur représentation. Ainsi, une simple esquisse de Mère-Grand la fait densément exister dans une situation dramatique à travers cette courte phrase « Faites, docteur, j’ai confiance », comme si ces quelques mots oraculaires contenaient en germe ou dans une extrême condensation de moyens et d’émotions toutes ses prises de paroles à venir. De même, le portrait du chirurgien sera brossé en sept mots « un géant débonnaire, vêtu en clown blanc », lors de sa brève et décisive apparition.
Celles des lieux : les descriptions de la maison, de ses différentes pièces, du jardin, de la nature, à la fois extrêmement justes et précises et qui, peut-être même grâce à ces détails, trouvent le point de passage, de bascule, d’une réalité presque objective vers sa dimension onirique («On peut atteindre ce bout de forêt préservé parce qu’il ne sert à rien, il est trop pentu et le très petit sentier qui le traverse tortille son plancher raboteux à flanc d’ubac, du côté froid de la vallée (…). Dans la clairière arrondie que baigne la pénombre, comme une décoction claire des brouillards de chaleurs montés à droite de la vallée, le vieux chêne l’a attendu. C’est un passant vénérable, qui s’est arrêté là depuis toujours. »). Celles des objets, à haute charge symbolique, comme on l’a évoqué précédemment. À ce titre, cette cristallisation leur donne un statut de personnages à part entière. Ainsi, l’horloge et ses dysfonctionnements, ou la Vespa, compagne d’aventures rendant l’âme au moment où le jeune homme, après l’amour du transport (dans ses deux acceptions), découvre le transport de l’amour, qui va l’orienter dans une tout autre direction et sceller son parcours à venir, sont emblématiques de son évolution et occupent une place spéciale dans sa mythologie personnelle. On le voit, tous les éléments de cette poétique contribuent à métamorphoser le réel, à le faire scintiller dans toute sa dimension féerique.
Voilà sans doute pour « la moitié du talent » selon le propos de Balzac.
Et l’autre moitié du talent ?
Disons qu’elle procède évidemment de la première. Elle tient à une écriture ancrée dans cette féerie, qui s’en nourrit autant qu’elle la produit, dans une étonnante circulation de flux et correspondances harmoniques, en parfaite adéquation du fond avec la forme. Et ce qui relève encore du miracle, c’est que tous ces personnages et cet univers sciemment féeriques, selon l’angle 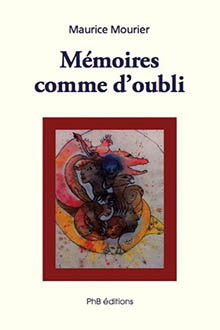 d’attaque, s’il variait d’un ou deux imperceptibles degrés, pourraient tout aussi bien ne pas fonctionner, ou même tomber à plat, mais il n’en est rien. Si les protagonistes de Mémoires comme d’oubli n’ont souvent pas d’autres noms que des termes génériques, ils sont loin de ressembler aux personnages stéréotypés des contes aux contours et à la psychologie sommaires. La sincérité, l’émotion, la précision avec lesquels ils sont créés (ou rendus à la vie), leur donnent une force, une vérité et une éternité insubmersibles. Et ce récit qui pourrait apparaître comme une histoire singulière, possiblement autobiographique, prend une dimension universelle, porté par une écriture dense, d’un lyrisme qui l’investit de sa présence diffuse. La brillante définition de J. Dupin à propos de l’abstraction lyrique chez Miró pourrait d’ailleurs parfaitement définir l’esthétique à l’œuvre chez Mourier : « (…) la création d’un espace extrêmement suggestif par la confusion de la texture et de la structure qui ouvrira une voie scandaleusement nouvelle à la génération qui suit »). La fiction emprunte et dépasse donc les genres, les codes. En particulier, le conte loin d’être une fin en soi constitue bien un moyen emprunté, à l’instar de la mythique Vespa, pour aller beaucoup plus loin. Au fond, aucune action, aucune parole de personnage ne sont là par hasard. Chaque événement en apparence mineur donne lieu à une réflexion psychologique, ontologique – oui, le narrateur va toujours « creuser plus avant » ! La grâce tient encore à cette écriture de la profondeur qui à partir de la surface des choses, de la représentation au scalpel d’une réalité, les dépasse et s’engage dans une quête radicale de leur sens, de leurs strates, dans une démarche introspective qui appelle l’introspection du lecteur. Elle s’inscrit ainsi dans la lignée des grands auteurs découvreurs, explorateurs, qui ont ouvert la voie du roman moderne, ou d’un autre roman, depuis Madame de La Fayette jusqu’à Nathalie Sarraute et Claude Simon en passant par Proust, questionnant le réel pour mieux interroger l’être et l’écriture. Mais cette recherche n’a rien de labyrinthique. L’écriture est limpide – ce qui n’exclut pas la complexité – elle coule de source, comme si tout le travail sur la phrase, le rythme, les mots, avec le plus grand naturel s’effaçait, gagné par l’univers magique de l’enfant, puis l’élévation progressive du jeune garçon vers l’Idéal qu’il rencontre à deux pas du dénouement.
d’attaque, s’il variait d’un ou deux imperceptibles degrés, pourraient tout aussi bien ne pas fonctionner, ou même tomber à plat, mais il n’en est rien. Si les protagonistes de Mémoires comme d’oubli n’ont souvent pas d’autres noms que des termes génériques, ils sont loin de ressembler aux personnages stéréotypés des contes aux contours et à la psychologie sommaires. La sincérité, l’émotion, la précision avec lesquels ils sont créés (ou rendus à la vie), leur donnent une force, une vérité et une éternité insubmersibles. Et ce récit qui pourrait apparaître comme une histoire singulière, possiblement autobiographique, prend une dimension universelle, porté par une écriture dense, d’un lyrisme qui l’investit de sa présence diffuse. La brillante définition de J. Dupin à propos de l’abstraction lyrique chez Miró pourrait d’ailleurs parfaitement définir l’esthétique à l’œuvre chez Mourier : « (…) la création d’un espace extrêmement suggestif par la confusion de la texture et de la structure qui ouvrira une voie scandaleusement nouvelle à la génération qui suit »). La fiction emprunte et dépasse donc les genres, les codes. En particulier, le conte loin d’être une fin en soi constitue bien un moyen emprunté, à l’instar de la mythique Vespa, pour aller beaucoup plus loin. Au fond, aucune action, aucune parole de personnage ne sont là par hasard. Chaque événement en apparence mineur donne lieu à une réflexion psychologique, ontologique – oui, le narrateur va toujours « creuser plus avant » ! La grâce tient encore à cette écriture de la profondeur qui à partir de la surface des choses, de la représentation au scalpel d’une réalité, les dépasse et s’engage dans une quête radicale de leur sens, de leurs strates, dans une démarche introspective qui appelle l’introspection du lecteur. Elle s’inscrit ainsi dans la lignée des grands auteurs découvreurs, explorateurs, qui ont ouvert la voie du roman moderne, ou d’un autre roman, depuis Madame de La Fayette jusqu’à Nathalie Sarraute et Claude Simon en passant par Proust, questionnant le réel pour mieux interroger l’être et l’écriture. Mais cette recherche n’a rien de labyrinthique. L’écriture est limpide – ce qui n’exclut pas la complexité – elle coule de source, comme si tout le travail sur la phrase, le rythme, les mots, avec le plus grand naturel s’effaçait, gagné par l’univers magique de l’enfant, puis l’élévation progressive du jeune garçon vers l’Idéal qu’il rencontre à deux pas du dénouement.
Ainsi, déposés tout près du seuil de la Coda, ces quelques vers du grand poème de Baudelaire « Élévation », avec l’humilité du fragment, comme une simple ritournelle, laissent délicatement une clé précieuse : « Et les voilà envolés, « au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, / Des campagnes, des bois des montagnes, des mers », au-dessus vraiment oui des étants (…) », en ce qu’ils nous invitent bien sûr à reconstituer l’ensemble du poème. On se trouve alors face à une sorte d’étonnant sommaire qui vient éclairer et condenser, une nouvelle fois, toute la lecture du roman.
Mémoires comme d’oubli atteint le centre des choses, des êtres. C’est un Voyage au centre de la Mère, de la Femme, de la Vie, de l’Amour. C’est un envol « Par-delà les confins des sphères étoilées ».
Alors, si l’on ne devait retenir que deux raisons d’enfourcher à notre tour la Vespa et de suivre l’itinéraire de l’enfant ? En premier lieu ce serait pour ces deux personnages féminins sublimes, Mère-Grand et La Reine, à qui il est urgent de rendre hommage en les faisant entrer, elles le méritent tant, au Panthéon des grands personnages romanesques de l’histoire littéraire. Passer à côté d’elles sans les avoir approchées, connues, aimées, priverait tout amoureux de la littérature d’une très grande rencontre. Enfin, et c’est une évidence, pour la puissance évocatrice de cette écriture lumineuse et spéculaire qui place Mémoires comme d’oubli au firmament des grandes œuvres littéraires. Mais c’est à chaque lectrice et lecteur de traverser le miroir, de découvrir cet univers et d’y tracer son propre chemin.

![[Chronique] Maurice MOURIER, Mémoires comme d’oubli, par Annie Drimaracci](http://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2025/05/band-Maurice-Mourier.jpg)