Laurent Fourcaut, Sacrée marchandise, hein ?, éditions Le Merle Moqueur, 2025, 156 pages, 12 €.
Après avoir longtemps pratiqué le sonnet dans une demi-douzaine d’ouvrages, Laurent Fourcaut, universitaire et poète, opte cette fois-ci pour le dizain (comme le titre du livre l’indique espièglement), composé de décasyllabes, forme dite strophe « carrée », qui court dans l’histoire poétique de Maurice Scève jusqu’à William Cliff.
De ce choix découlent au moins deux conséquences : la première est que le poème doit viser plus vite au but, donc accroître sa densité ; la seconde est que le rythme perd de sa présumée splendeur en abandonnant « l’alexandrin / dont finit par lasser faraud le chibre / souvent non sans grandiloquence il vibre ».
Dans ce cadre constitué de contraintes non seulement rythmiques mais aussi sonores à travers un enchaînement précis de rimes, 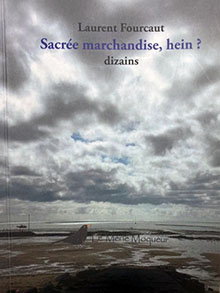 l’auteur tente de faire entrer ce qui ne cesse pas d’excéder, ce réel auquel nous sommes confrontés par notre existence même. D’où le fait que la forme choisie déborde, justement, de différentes manières. Par exemple, le dizain se retrouve augmenté d’un onzième vers qui ne va pas jusqu’à douze syllabes et peut ne compter qu’une lettre, parfois imprononçable : « et les céphalées du cher curé d’A / rs » Quant à la rime, si elle est toujours assurée, c’est fréquemment de façon peu orthodoxe, en recourant à des coupes qui engendrent des effets de sens ou, au contraire, semblent être là pour souligner l’arbitraire d’un moteur prosodique où la langue se serait pris les mots : « du moi mourant vous tirent côté fou / le désir sans objet a un goût fou / tre si ambivalent que le vertige ». De même, la métrique entraîne amputations (l’antic / vit’fait) et raccourcis ou permutations syntaxiques qui éloignent considérablement sujet et verbe ou nom et adjectif qualificatif, le vers fournissant le combustible majeur de la dynamique du texte. À ce propos, rappelons que, loin du vers libre atone si répandu actuellement (cf. la définition du VIL par Jacques Roubaud[1]), cette dimension appartient à l’histoire littéraire depuis belle lurette – ainsi Jude Stéfan disait avoir compris ce qu’était la poésie en entendant isolément ce décasyllabe de Ronsard : « Chutes à terre elles fussent demain ».[2] Par ailleurs, le travail sonore ne se limite pas aux rimes qui opèrent des rapprochements quelquefois surprenants mais passe également par tout un jeu d’échos, notamment par allitérations et paronomases (sa folle fiole / l’autre con continue / désirable désastre / la mère merle).
l’auteur tente de faire entrer ce qui ne cesse pas d’excéder, ce réel auquel nous sommes confrontés par notre existence même. D’où le fait que la forme choisie déborde, justement, de différentes manières. Par exemple, le dizain se retrouve augmenté d’un onzième vers qui ne va pas jusqu’à douze syllabes et peut ne compter qu’une lettre, parfois imprononçable : « et les céphalées du cher curé d’A / rs » Quant à la rime, si elle est toujours assurée, c’est fréquemment de façon peu orthodoxe, en recourant à des coupes qui engendrent des effets de sens ou, au contraire, semblent être là pour souligner l’arbitraire d’un moteur prosodique où la langue se serait pris les mots : « du moi mourant vous tirent côté fou / le désir sans objet a un goût fou / tre si ambivalent que le vertige ». De même, la métrique entraîne amputations (l’antic / vit’fait) et raccourcis ou permutations syntaxiques qui éloignent considérablement sujet et verbe ou nom et adjectif qualificatif, le vers fournissant le combustible majeur de la dynamique du texte. À ce propos, rappelons que, loin du vers libre atone si répandu actuellement (cf. la définition du VIL par Jacques Roubaud[1]), cette dimension appartient à l’histoire littéraire depuis belle lurette – ainsi Jude Stéfan disait avoir compris ce qu’était la poésie en entendant isolément ce décasyllabe de Ronsard : « Chutes à terre elles fussent demain ».[2] Par ailleurs, le travail sonore ne se limite pas aux rimes qui opèrent des rapprochements quelquefois surprenants mais passe également par tout un jeu d’échos, notamment par allitérations et paronomases (sa folle fiole / l’autre con continue / désirable désastre / la mère merle).
Une telle écriture, dont l’auteur affirme avec raison qu’elle correspond à un « art poétique matérialiste », ne sombre pas pour autant dans un formalisme qui tournerait à vide. Tout d’abord, à l’image de ce qui fait nos vies, elle entrelace subtilement des éléments relevant aussi bien de la culture dite savante que de celle qualifiée de populaire. C’est pourquoi on ira de la mythologie grecque à Tintin, en passant par Villon, La Fontaine, Apollinaire, Claude Nougaro et Christian Prigent, entre autres – cet éclectisme rejoignant le goût de L. Fourcaut pour les brocantes où l’on peut dénicher de tout. L’ouverture lexicale, pas si fréquente dans ce qui s’écrit aujourd’hui en poésie, témoigne elle aussi de cette conscience d’une hétérogénéité fondamentale, étrangère aux purifications diverses et variées de l’époque : de l’argot au français « branché » des winners, avec inclusion de termes issus de l’histoire de la langue : ores, prime, cil, lésine… Cette variété coïncide avec la conception – et le ressenti – d’un moi multiple, à rebours d’une prétendue identité close sur elle-même, ce que l’auteur évoque avec humour : « or les moi se suivent comme dit Proust / et ne se ressemblent pas un moi moust / ique s’incruste quand vous venez maître / un peu de vous »
éléments relevant aussi bien de la culture dite savante que de celle qualifiée de populaire. C’est pourquoi on ira de la mythologie grecque à Tintin, en passant par Villon, La Fontaine, Apollinaire, Claude Nougaro et Christian Prigent, entre autres – cet éclectisme rejoignant le goût de L. Fourcaut pour les brocantes où l’on peut dénicher de tout. L’ouverture lexicale, pas si fréquente dans ce qui s’écrit aujourd’hui en poésie, témoigne elle aussi de cette conscience d’une hétérogénéité fondamentale, étrangère aux purifications diverses et variées de l’époque : de l’argot au français « branché » des winners, avec inclusion de termes issus de l’histoire de la langue : ores, prime, cil, lésine… Cette variété coïncide avec la conception – et le ressenti – d’un moi multiple, à rebours d’une prétendue identité close sur elle-même, ce que l’auteur évoque avec humour : « or les moi se suivent comme dit Proust / et ne se ressemblent pas un moi moust / ique s’incruste quand vous venez maître / un peu de vous »
L’armature formelle essaie de contenir cette profusion du monde que menacent d’appauvrir, voire de détruire, certaines activités humaines et ce d’autant plus que ce livre fut écrit pendant la période du premier Covid, L. Fourcaut voyant dans le confinement « le symptôme / aigu du latent devenir fantôme / des pékins réduits à faire tourner / la machine à sous », autrement dit le summum d’une organisation du travail qui réduit chacun à son rôle de producteur-consommateur solitaire. Au-delà de cette période particulière, comme dans ses précédents ouvrages, l’auteur fait part de sa virulente critique d’un système où l’appât du gain est érigé en modèle, le titre du livre trouvant plusieurs échos intérieurs, entre ceux qui « ont fait depuis longtemps rôtir le veau / d’or pour convertir tout en marchandise » et, à l’opposé, ces oiseaux marins « reflétés dans l’eau ils sont des poissons / pris entre deux feux sacrée gourmandise ! ». Au fil des poèmes sont mentionnées diverses catastrophes en cours : climat qui part en vrille (après des décennies d’inaction, y aurait plus qu’à s’adapter…), pollutions chimiques (merci M’sieur Duplomb !) et « médiatiques », une bonne part de l’humanité étant sous perfusion quasi permanente via écrans, oreillettes et musique d’ambiance.
Pour tenter d’échapper à cette débâcle généralisée, L. Fourcaut cherche refuge dans les lieux où la nature, bien qu’affectée par l’Homo occidentalis, offre encore à ses yeux des motifs dignes d’intérêt – en particulier les marais de Carentan dont les espaces tranchent avec ceux de la capitale obstruée à tous points de vue. De nombreux dizains, tels des miniatures, se développent à partir de scènes observées avec attention : bêtes sauvages et arbres qui n’évitent pas toujours d’être massacrés à la tronçonneuse. Cela dit, l’auteur ne cède pas à une écopoésie à la mode dont la naïveté théorique va de pair avec la pauvreté formelle. Au contraire, la séparation indépassable entre l’humain et la nature est évoquée à plusieurs niveaux : d’une part, tout ce qui est naturel n’est pas, bien entendu, nécessairement favorable au quidam qui n’apprécie guère ni les fientes des étourneaux, « espèce qu’à bon droit on dira chiante » ni l’invasion de son salon par des centaines de fourmis ; d’autre part, L. Fourcaut est conscient de la scission foncière entre le « monde muet » cher à Ponge et les êtres parlants qui « sont les seuls à souffrir de carence / parce qu’abstraite la parole fuit ».
l’Homo occidentalis, offre encore à ses yeux des motifs dignes d’intérêt – en particulier les marais de Carentan dont les espaces tranchent avec ceux de la capitale obstruée à tous points de vue. De nombreux dizains, tels des miniatures, se développent à partir de scènes observées avec attention : bêtes sauvages et arbres qui n’évitent pas toujours d’être massacrés à la tronçonneuse. Cela dit, l’auteur ne cède pas à une écopoésie à la mode dont la naïveté théorique va de pair avec la pauvreté formelle. Au contraire, la séparation indépassable entre l’humain et la nature est évoquée à plusieurs niveaux : d’une part, tout ce qui est naturel n’est pas, bien entendu, nécessairement favorable au quidam qui n’apprécie guère ni les fientes des étourneaux, « espèce qu’à bon droit on dira chiante » ni l’invasion de son salon par des centaines de fourmis ; d’autre part, L. Fourcaut est conscient de la scission foncière entre le « monde muet » cher à Ponge et les êtres parlants qui « sont les seuls à souffrir de carence / parce qu’abstraite la parole fuit ».
Une autre façon de susciter le désir de vivre réside dans celui éprouvé par « qui voit trop que la splendeur bour / re la peau du sexe qu’on dit deuxième » ainsi que dans la fréquentation étroite des œuvres artistiques – outre la littérature, on notera la présence récurrente de la peinture et surtout de la musique, de Bach à Thelonious Monk.
Enfin, pour tromper « son acédie / qui s’épanouit entre les quatre murs », il reste l’écriture que l’on suppose quotidienne ou presque, la suite de poèmes ayant l’allure d’un journal en vers, écriture à la fois vitale et insuffisante, donc sans cesse à reprendre dans « un voyage si lent qu’il semble immo / bile demeure malgré tout l’usage / qui se raccroche en désespoir aux mots ».
[1] Obstination de la poésie, par Jacques Roubaud (Le Monde diplomatique, janvier 2010)
[2] Sonnet à Marie (1555)
![[Chronique] Laurent Fourcaut, Sacrée marchandise, hein ?, par Bruno Fern](http://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2025/07/laurent-fourcaut-marchandiseBackG.jpg)

![[Chronique] Laurent Fourcaut, Sacrée marchandise, hein ?, par Bruno Fern](http://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2025/07/band-laurent-fourcaut-sacree-marchandise.jpg)