Maurice Mourier, La Femme bue par l’aube, PhB éditions, printemps 2023, 690 pages, 25 euros, ISBN : 979-10-93732-69-5.
Soit un roman, dont le titre, La Femme bue par l’aube, aussi poétique et mystérieux que la superbe aquarelle qui l’accompagne en première de couverture, ne laisse pas d’attiser la curiosité de la lectrice (qu’il lui soit permis d’utiliser le féminin comme terme générique, pour évoquer un roman dans lequel la femme est souveraine).
Soit un roman, donc, et non des moindres, parce qu’il comporte une infinité de facettes, d’entrées, sorties, angles d’attaque, rebondissements, questionnements, énigmes, niveaux de lecture. Et non des moindres, parce que oui, pavé il y a, à plus d’un titre. Mais si magistralement écrit d’un bout à l’autre, si « merveilleusement vain, divers et ondoyant », à l’image de l’Homme, si inattendu au détour des pages et chapitres, qu’il devient rapidement évident à la lectrice (et elle gage qu’il en est de même pour le lecteur) qu’il sera hors de question de le lâcher, et qu’elle fera le voyage jusqu’au bout, embarquée qu’elle est dans un univers, un imaginaire, une pensée hors du commun.
Caractériser ce roman est une gageure, tant il échappe à toute tentative de classement, et s’inscrit – ou ne s’inscrit pas – dans des marges, des genres variés, et constitue peut-être même un genre à part dont il serait d’ailleurs à ce jour l’unique représentant.
L’action se déroule sur une île, « Backwards Island », au milieu de nulle part, au septentrion de quoi, on ne sait précisément. Une  petite société d’hommes, femmes et enfants y survit, et même tente d’y bien vivre – après le grand cataclysme d’une troisième guerre mondiale concomitant à celui du climat – selon ses propres lois qui se rapprocheraient assez du Fay ce que vouldras de l’abbaye de Thélème. Un idéal de Renaissance, en quelque sorte, puisqu’après la catastrophe, il faut bien renaître de ses cendres, ou de celles du monde d’avant. Et les survivants sont de bons vivants, « l’utopie de l’île avait été fondée sur l’autogestion et le partage, et plus encore sur des convictions libertaires à la base du recrutement amical de commensaux par Charchaluchat ». Les libertés de ton, de pensée, d’action, de mœurs sont vécues dans une harmonie festive, sensuelle et baroque, et les protagonistes aiment à se mettre en scène dans des représentations hautes en couleur : puisque le monde est un théâtre (en ruine), que la vie est un songe, que les humains sont si éphémères et volatils, autant jouer à fond la partition du spectacle !
petite société d’hommes, femmes et enfants y survit, et même tente d’y bien vivre – après le grand cataclysme d’une troisième guerre mondiale concomitant à celui du climat – selon ses propres lois qui se rapprocheraient assez du Fay ce que vouldras de l’abbaye de Thélème. Un idéal de Renaissance, en quelque sorte, puisqu’après la catastrophe, il faut bien renaître de ses cendres, ou de celles du monde d’avant. Et les survivants sont de bons vivants, « l’utopie de l’île avait été fondée sur l’autogestion et le partage, et plus encore sur des convictions libertaires à la base du recrutement amical de commensaux par Charchaluchat ». Les libertés de ton, de pensée, d’action, de mœurs sont vécues dans une harmonie festive, sensuelle et baroque, et les protagonistes aiment à se mettre en scène dans des représentations hautes en couleur : puisque le monde est un théâtre (en ruine), que la vie est un songe, que les humains sont si éphémères et volatils, autant jouer à fond la partition du spectacle !
Les différences sont scrutées, respectées, acceptées, dans ce microcosme insulaire où la tolérance est une règle d’or, sans pour autant être brandie comme un étendard. Le refus de toute idéologie y est sans doute la condition sine qua non de la paix sociale. Contre vents et marées – car après l’effondrement, le dérèglement, la dégradation du climat et la planète se poursuivent inéluctablement (« il existe, en arrière du Phare, trois sources à mi-pente de la colline, que le réchauffement climatique, qui continue ses ravages malgré la disparition de l’homme, n’a pas encore réussi à tarir ») – il faut bien continuer d’avancer malgré la tragédie sous-jacente, ou peut-être en raison même de sa présence. Et ces désordres ne sont d’ailleurs presque rien au regard de ce que les « îlottins » doivent encore affronter : les disparitions étranges, inexpliquées, en particulier de celle qui règne sur les cœurs de toutes et tous : la divine Évelyne, dont le prénom chuchote celui de la première femme, Ève, celle de l’aube des temps, l’origine du monde sacralisée sur l’île, et qui est sans doute, pour l’auteur, la dernière femme de l’histoire humaine, et de l’histoire tout court, la sienne, retournant au monde des origines. Bue et absorbée donc, par l’aube d’où elle vient, et par le titre même du roman. Les phénomènes d’apparitions et de disparitions, d’étranges lueurs à l’horizon, les déflagrations sont donc monnaie courante dans la vie des habitants de Backwards Island qui donne son titre à la première des sept parties du roman. Et pour tous ces joyeux désespérés que sont les principaux protagonistes, Charchaluchat, L’abbé Takorn, Faux-Derche, Rabbi Dosh et tant d’autres, il est naturel de rester tête haute et de se jouer des rigueurs de leur condition. Comment vivre, comment survivre, résister, exister, se tenir debout dans un monde exténué, sur un îlot hors du temps qui semble flotter au-dessus du néant, lorsque l’on est probablement le jouet de forces adverses impondérables ? C’est la question posée tout au long du roman, et les réponses sont plurielles, on peut l’imaginer, parmi lesquelles rire (l’onomastique de leurs noms parfois délirants ne cesse de le rappeler), aimer, jouir de tous les plaisirs, débattre, en découdre sur tous les terrains de la pensée et s’organiser, faire société. Les innombrables chausse-trappes rencontrées par les personnages (tel le lac boueux, « effroyable piège » tendu à Évelyne, dont elle réchappe miraculeusement et près duquel elle finira par survivre quelque temps : « il faut avouer que l’absence totale de vie dans cette abominable résidence avait aussi ses avantages : l’asepsie y était une donnée immédiate du néant »), entament gravement leurs forces, mais ne parviennent pas toujours à les mettre à terre, et si aux dernières extrémités, leur capitulation semble imminente, ils ne rateront pas leur sortie.
♦♦♦♦♦
Mais les grandes lignes de l’argument étant posées, revenons à la question qui nous occupe : quès aco ? Comment caractériser ce livre ? Roman d’aventure ? De science-fiction ? D’apprentissage ? Fantastique ? Roman ou conte philosophique ? De collapsologie ? Baroque ? Roman à thèse ? Métaphysique ? Iconoclaste ? Utopie ? Dystopie ? Oui, oui, et oui, tout cela à la fois et bien plus encore.
Une somme … ? En quelque sorte. Et qui constitue un état des lieux grinçant, drôle et puissant de la situation de l’Humanité en ce temps-là, si proche de la nôtre que toute ressemblance avec elle est hélas plus qu’évidente. Maurice Mourier, à travers ses personnages qui pratiquent volontiers le débat, à l’instar de la disputatio chère aux humanistes de la Renaissance, dresse en effet un constat implacable de tout ce qui a conduit l’homme à sa propre destruction. Ainsi, les causes de l’effondrement sont passées en revue, approfondies et dénoncées avec force : le capitalisme débridé, le pouvoir de l’argent, les effets délétères de toutes les religions et de la violence, des massacres qu’elles ont engendrés. D’où le refus catégorique des îlottins – c’est là la seule limite de leur tolérance – de laisser la moindre chance dans leur communauté aux donneurs de leçons et prosélytes de tout poil qui entendraient venir prêcher la bonne parole, conscients qu’ils sont du danger de toute intrusion idéologique parmi eux. Hors de question sur l’île de reproduire les conditions de ce qui a conduit l’humanité à sa perte. Il en va de leur survie ! Ainsi, l’inconnu débarqué là on ne sait comment et se revendiquant Saint va se trouver face à un comité d’accueil attentif et posé mais radical, véritable tribunal qui ne s’en laissera nullement conter et le mettra sans violence – c’est la seule règle absolue que d’en refuser tout usage – hors d’état de nuire. Et si l’analyse – ou l’autopsie – des sociétés humaines convoque aussi bien la sociologie, que la philosophie, l’histoire, la science, la métaphysique ou la théologie, le roman évite brillamment l’écueil d’une didactique appuyée qui enrayerait la dynamique fictionnelle. Nulle position de surplomb de l’auteur qui ne se prive cependant pas de jouer parfois avec espièglerie la carte du démiurge. On est tous « embarqués » pour réfléchir et tenter de trouver ensemble une réponse à la question centrale « comment survivre ? » dans « L’Hypermerdier » – lieu important du roman faisant l’objet d’un chapitre, « Maison Commode (…) remplie au fil des ans d’un bric-à-brac qui explique son nom actuel d’Hypermerdier » – dont on comprend aisément qu’il est une métaphore de celui où nous nous trouvons tous, de fait ! Les débats et dialogues sont si remarquablement construits, vivants et précis que l’on est conduit à se représenter personnages et situations en images, « comme au cinéma ». Ici, l’ekphrasis est reine, et l’on se prend à penser que cette Femme bue par l’aube ferait l’objet d’un très beau film, si d’aventure elle tombait entre les mains d’un grand réalisateur.
religions et de la violence, des massacres qu’elles ont engendrés. D’où le refus catégorique des îlottins – c’est là la seule limite de leur tolérance – de laisser la moindre chance dans leur communauté aux donneurs de leçons et prosélytes de tout poil qui entendraient venir prêcher la bonne parole, conscients qu’ils sont du danger de toute intrusion idéologique parmi eux. Hors de question sur l’île de reproduire les conditions de ce qui a conduit l’humanité à sa perte. Il en va de leur survie ! Ainsi, l’inconnu débarqué là on ne sait comment et se revendiquant Saint va se trouver face à un comité d’accueil attentif et posé mais radical, véritable tribunal qui ne s’en laissera nullement conter et le mettra sans violence – c’est la seule règle absolue que d’en refuser tout usage – hors d’état de nuire. Et si l’analyse – ou l’autopsie – des sociétés humaines convoque aussi bien la sociologie, que la philosophie, l’histoire, la science, la métaphysique ou la théologie, le roman évite brillamment l’écueil d’une didactique appuyée qui enrayerait la dynamique fictionnelle. Nulle position de surplomb de l’auteur qui ne se prive cependant pas de jouer parfois avec espièglerie la carte du démiurge. On est tous « embarqués » pour réfléchir et tenter de trouver ensemble une réponse à la question centrale « comment survivre ? » dans « L’Hypermerdier » – lieu important du roman faisant l’objet d’un chapitre, « Maison Commode (…) remplie au fil des ans d’un bric-à-brac qui explique son nom actuel d’Hypermerdier » – dont on comprend aisément qu’il est une métaphore de celui où nous nous trouvons tous, de fait ! Les débats et dialogues sont si remarquablement construits, vivants et précis que l’on est conduit à se représenter personnages et situations en images, « comme au cinéma ». Ici, l’ekphrasis est reine, et l’on se prend à penser que cette Femme bue par l’aube ferait l’objet d’un très beau film, si d’aventure elle tombait entre les mains d’un grand réalisateur.
Une Bible… ? Sans doute, dans la mesure où ce roman hors du temps et du monde, qui nous dit beaucoup de choses de nous-mêmes, pourrait constituer une sorte de manuel de survie ou de méditations à usage des hommes par temps de crise. Les références aux Écritures sont nombreuses, on l’observe déjà en parcourant la table des matières : « L’Annonce faite à Évelyne » (d’ailleurs Évelyne, au-delà de la présence d’Ève en filigrane de son prénom, n’est pas sans rapport avec la Vierge Marie puisqu’elle va finir par se trouver enceinte par l’opération du Saint Esprit ! Il se pourrait aussi qu’elle représente une figure christique, si l’on considère sa présence/absence, au fil du roman, entre incarnation et évaporation, mais dans une version qui sacraliserait sa féminité), « Visitation », « Épiphanie », « Réincarnation », « Transsubstantiation », « Résurrection » … Le seul Dieu acceptable serait donc une déesse.
En effet, si l’on retient l’idée d’une bible, il faut très vite admettre qu’il s’agit d’une Bible (ou un manifeste) libertaire, qui n’a de cesse de dynamiter consciencieusement toutes les croyances en exaltant une libre pensée débarrassée de tout ce qui a pollué matériellement et idéologiquement l’Humanité aux siècles des siècles. L’auteur n’y va pas par quatre chemins, et c’est tour à tour par la voix ironique (comme la description hilarante du scapulaire au chapitre « Macabre découverte » : « Qu’est-ce que cette variété de dépotoir ? » qui rassemble « dans un bijou qui pèse une tonne » (…) « tous les symboles des religions prétendument révélées » auxquels s’ajoutent des croyances sectaires et superstitions populaires, jetées pêle-mêle dans le même sac en un syncrétisme désopilant) ou par celle, tonitruante et irrévérencieuse, de ses personnages, qu’il exprime sa dénonciation des méfaits de toutes les religions « C’est donc un créateur infirme, maladroit, bougon, rancunier, qui au mieux ne connaît que la méthode des essais et des erreurs, au pire s’emmêle constamment les pédales quand il s’agit pourtant de son métier de base, créer. À moins que ce fouteur de merde récidiviste prenne un malin plaisir à monter des châteaux de cartes puis à les détruire à coups de pieds comme un môme qui mérite des claques (…) ». Mourier, on le voit, s’amuse beaucoup à cette subversion iconoclaste, et pour reprendre le titre de l’un de ses chapitres « Un peu d’athéologie amusante », on pourrait également caractériser son roman comme un traité d’athéologie assumé, mais ouvert au débat bienveillant puisque plusieurs personnages viennent en cours de route apporter la contradiction aux thèses de la non-existence de Dieu. Et si l’érudition (a)théologique de l’auteur lui permet d’aborder en conscience la question ontologique de l’existence de Dieu, il ne craint pas de faire voler en éclats (de rire) tout l’arsenal démonstratif de la pensée religieuse.
Un architexte… ? En tout état de cause, on est en présence d’un monument littéraire, dont l’architecture (l’architexture… ?) à la fois savante, déjantée et éminemment baroque, transposée à celle des bâtiments, ne serait pas sans rappeler celle d’un Gaudí : la singularité absolue du roman, comme celle des édifices du génial architecte catalan, se nourrit néanmoins du patrimoine qui lui a permis d’exister, et lui rend hommage tout en le détournant brillamment. Bref, l’auteur et son œuvre constitueraient donc une sorte d’architexte, et pas seulement pour l’analogie ou le jeu de mot – bien que les pirouettes et clins d’œil lexicaux, sémantiques ne cessent de ponctuer le roman, et y soient non seulement permis mais hautement revendiqués, depuis « l’anthropobscène » jusqu’à « Nausicaïn-Nausicaa » en passant par la « parthénogêneuse » – mais surtout pour reprendre le concept d’ « architexte » qui peut apporter une nouvelle piste de lecture de La Femme bue par l’aube, et défini par Genette dans Palimpsestes comme « l’ensemble des catégories générales, ou transcendantes – types de discours, modes d’énonciation, genres littéraires, etc. – dont relève chaque texte singulier ».
Ainsi, au-delà de l’univers onirique, du territoire d’aventures incroyable qu’offre « Backwards Island » à ses habitants, mais aussi aux lectrices et lecteurs (nous sommes tous des « îlottins » !) le roman peut se lire à l’infini comme un jeu de pistes, un 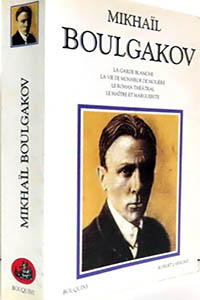 labyrinthe ou une tour de Babel littéraires absolument inépuisables. D’ailleurs, les références mythologiques ne manquent pas de signaler l’aspect labyrinthique et sibyllin du texte, avec « Monsieur Minosse » ou la « Sibylle d’écume », par exemple qui font chacun l’objet d’un chapitre. On peut aussi au fil du texte percevoir l’ombre de nombreux fantômes littéraires, mais chaque lecture est singulière, et l’on arrive là avec ses propres bagages. J’ai eu la sensation fugace de croiser des personnages de Steinbeck, Faulkner, de Jules Verne ou Poe, de voyager tour à tour avec Rabelais ou Henri Michaux, de me trouver projetée dans le roman noir anglais du XVIIIème siècle, chez Le Moine, de Lewis, ou dans le romantisme noir d’Aloysius Bertrand, l’onirisme fragile de Nerval, la folie de Boulgakov ou de traverser les Métamorphoses d’Ovide. L’écriture, jouant brillamment sur les genres, les registres et les stéréotypies, est profondément baroque, avec toutes les nuances du comique, du dramatique, du réalisme, du fantastique. Les registres de langue tourbillonnent aussi du savant, précieux, soutenu au familier voire argotique. Mais on ne dirait rien de ce livre si l’on ne s’arrêtait un peu sur les instants suspendus de sa poésie, versifiée parfois…
labyrinthe ou une tour de Babel littéraires absolument inépuisables. D’ailleurs, les références mythologiques ne manquent pas de signaler l’aspect labyrinthique et sibyllin du texte, avec « Monsieur Minosse » ou la « Sibylle d’écume », par exemple qui font chacun l’objet d’un chapitre. On peut aussi au fil du texte percevoir l’ombre de nombreux fantômes littéraires, mais chaque lecture est singulière, et l’on arrive là avec ses propres bagages. J’ai eu la sensation fugace de croiser des personnages de Steinbeck, Faulkner, de Jules Verne ou Poe, de voyager tour à tour avec Rabelais ou Henri Michaux, de me trouver projetée dans le roman noir anglais du XVIIIème siècle, chez Le Moine, de Lewis, ou dans le romantisme noir d’Aloysius Bertrand, l’onirisme fragile de Nerval, la folie de Boulgakov ou de traverser les Métamorphoses d’Ovide. L’écriture, jouant brillamment sur les genres, les registres et les stéréotypies, est profondément baroque, avec toutes les nuances du comique, du dramatique, du réalisme, du fantastique. Les registres de langue tourbillonnent aussi du savant, précieux, soutenu au familier voire argotique. Mais on ne dirait rien de ce livre si l’on ne s’arrêtait un peu sur les instants suspendus de sa poésie, versifiée parfois…
« Du souvenir fléchi…laisse là le travail
Qui noiera de courroux l’arc pur de ton désir
L’espoir démantelé use le souvenir »
(« Treize sonnets d’amour frêle » Quel titre !)
… et le plus souvent prose poétique où l’on entre comme par effraction dans une autre dimension, celle d’un lyrisme doux, mélancolique ou parfois sauvage et capiteux, pause musicale harmonique dans le tempo soutenu de la fiction, tels « le sourire à secrets » d’Evelyne, ou encore poésie en prose, avec les pages somptueuses de la dernière partie, texte 3, « Derniers jours à Gnôthi-la-Ronde » :
« La danse des heures la cadence la caducité tout ce qui flue tout ce qui bouge le fluet en brins en herbe en fétus en riens Gnôthi connaît pas.
C’est calme.
L’orée des bois l’or des neiges la rose perpétue il fut autrefois du vent a balayé les miasmes.
Le gris.
Le nul. »
Mais on ne peut faire le tour d’un tel édifice ou le survoler en quelques pages, le résumer à quelques lignes et l’épingler comme un papillon rare sur une planche d’entomologiste. Le maelström romanesque résiste, emporte, demande du temps. S’apprivoise peut-être, mais ne délivrera sans doute pas tous ses secrets et énigmes, même s’il laisse volontiers traîner quelques clés et outils métaphysiques ou littéraires (« Backwards Island est par hasard située dans une manière de no man’s land régressif tout à fait singulier où on se croit seul parce qu’on ne voit rien autour de soi »). Acceptons de visiter, d’explorer en tous sens cette terra incognita, d’avancer sur des sables mouvants, d’être dérangés, propulsés, stoppés ou désorientés, à l’instar des protagonistes du roman. Acceptons l’idée de parcourir, sous le pavé, des marges infinies et mystérieuses qui ouvrent sur des univers insondables. De rester sur des questions sans réponse. Qui se joue des îlottins de Backwards Island et tire les ficelles de leurs existences ? Que reste-t-il du monde d’avant, de cet extérieur désormais interdit dont ils ne perçoivent que d’inquiétants épiphénomènes ? Quel Deus ex machina – ou quel diable – régit leur microcosme ? Et surtout qui raconte cette étrange histoire ? Qui est ce narrateur, d’abord invisible, signalant peu à peu sa présence discrète par un « nous » singulier ou collectif, qui le place en témoin, observateur, partie prenante de l’action (mais à quel titre ?), et dont on sait seulement qu’il appartient à la jeune génération des îlottins ? Qui est cet « archiviste éditeur, perplexe » qui signe ironiquement le texte de 4ème de couverture et apparaît juste avant la dernière partie dans un ajout hors-texte absolument génial de quatre pages, en marge justement des sept parties du livre, comme en suspens, intitulé « Dramatis personae » pour commenter et pointer non moins ironiquement les failles du récit et ses zones d’ombre ?

Les pièges tendus aux habitants de Backwards Island, les machinations surnaturelles dans l’île sont à l’image des subterfuges narratifs et du dispositif romanesque, jusqu’à « LA COMMOTION, est-il un autre mot ? » – un autre mot ? Le dénouement ! pourrait-on suggérer au personnage ! – qui va précipiter l’effacement ou la disparition des protagonistes, conscients de l’imminence de leur extinction, qui continuent néanmoins à deviser : « – Tu penses que de toute façon il n’y a plus rien à faire ? – C’est bien possible. » La lectrice ou le lecteur ne s’en tireront pas plus facilement que les îlottins, bien qu’ils soient les uns comme les autres, de fait, poussés vers la sortie et appelés à disparaître du champ fictionnel ou romanesque. Alors que se passe-t-il après l’inévitable disparition, l’effacement ou la perte des traces ?
Un dénouement… ? Pas exactement. Et l’on n’en attendait pas moins de ce roman. Ce serait trop simple et abrupt ; une chute libre dans le blanc de la dernière page, une coquille vide qui renverrait au néant. L’idée d’« un cénotaphe »,envisagée par les îlottins en quête de leur propre fin, travaillant, collaborant presque de bonne grâce à leur dénouement, est d’ailleurs rapidement abandonnée parce qu’interdite : « les seules lois universellement valables et complètement infrangibles s’y opposent, celles de la sémantique (…) ». Disons qu’ils sont plus avisés que des personnages beckettiens ; ils préparent leur sortie plutôt que de la subir. La singularité du dénouement, impondérable, réside dans le fait qu’il n’y a pas vraiment de dernier mot. Après ce qu’il est convenu d’appeler « la fin », s’ouvre un autre coffre aux trésors, celui de la Septième partie, évidemment composée de sept textes, extrêmement divers, traces extraordinaires prétendument laissées par les protagonistes devenus à leur tour auteurs, archives de l’île exhumées, on l’imagine, par le mystérieux « archiviste », qui ouvrent d’autres portes, d’autres mondes infinis, d’autres possibles, d’autres vies, nous emportant jusqu’au vertige dans un nouveau voyage d’écriture aux confins du rêve et de la réalité. Il n’est d’ailleurs pas anodin que l’illustration de la 1ère de couverture s’intitule Chimères, tandis que le livre se clôt (et sans point final, s’il vous plaît !) par une suite de treize sonnets faisant manifestement écho aux Chimères de Nerval, comme pour rendre hommage au poète maudit, « Prince d’Aquitaine à la Tour abolie », El Desdichado, déshérité de tout sauf de la richesse de ses mots, comme pour dire à la lectrice, au lecteur, que seules l’écriture, la poésie, «la rêverie super-naturaliste » permettent de résister au temps et au néant.
La singularité du dénouement, impondérable, réside dans le fait qu’il n’y a pas vraiment de dernier mot. Après ce qu’il est convenu d’appeler « la fin », s’ouvre un autre coffre aux trésors, celui de la Septième partie, évidemment composée de sept textes, extrêmement divers, traces extraordinaires prétendument laissées par les protagonistes devenus à leur tour auteurs, archives de l’île exhumées, on l’imagine, par le mystérieux « archiviste », qui ouvrent d’autres portes, d’autres mondes infinis, d’autres possibles, d’autres vies, nous emportant jusqu’au vertige dans un nouveau voyage d’écriture aux confins du rêve et de la réalité. Il n’est d’ailleurs pas anodin que l’illustration de la 1ère de couverture s’intitule Chimères, tandis que le livre se clôt (et sans point final, s’il vous plaît !) par une suite de treize sonnets faisant manifestement écho aux Chimères de Nerval, comme pour rendre hommage au poète maudit, « Prince d’Aquitaine à la Tour abolie », El Desdichado, déshérité de tout sauf de la richesse de ses mots, comme pour dire à la lectrice, au lecteur, que seules l’écriture, la poésie, «la rêverie super-naturaliste » permettent de résister au temps et au néant.
Ainsi, La Femme bue par l’aube, malgré la situation tragique des protagonistes si tristement prophétique de ce qui est déjà à l’œuvre sur notre planète, malgré les énigmes irrésolues du roman, en miroir de tous les mystères existentiels avec lesquels nous devons vivre et mourir, ne nous envoie paradoxalement pas un message de désespoir. Comment survivre au bord de l’apocalypse, mais aussi comment écrire dans ces conditions extrêmes ? C’est aussi la question qui traverse et structure le roman, à laquelle Maurice Mourier répond avec vitalité et humanité par un grand texte de littérature. Par un pavé dans la mare de la bien-pensance, de nos habitudes et de nos fausses urgences : ici on ne zappe pas, on joue sur le temps long. L’écriture du désastre, pour reprendre une formulation de Blanchot, ne nous expédie pas dans une impasse ou droit dans un mur, n’est nullement en décomposition, ou en perte de sens. Elle est altière, elle prend son temps, malgré l’imminence de l’effondrement, ouvre encore des voies, des pistes possibles. Elle est à l’image du monde, protéiforme, en mouvement, en perpétuelle métamorphose. Et si l’on a clairement fait fausse route, au fil du fameux « anthropobscène »,tout n’est peut-être pas perdu. Il reste la raison, la déraison, la joie, l’amour, l’humour, l’amitié indéfectible, et surtout, surtout, la passion inextinguible des mots et de l’aventure de l’écriture.

![[Chronique] Annie Drimaracci, Sous le pavé, la marge ! … ou petite incursion en terre inconnue (à propos de Maurice Mourier, La Femme bue par l’aube)](http://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2023/10/band-Fay_ce_que_voudras.jpg)