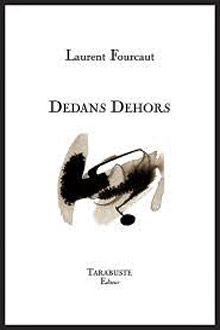Laurent Fourcaut, Dedans Dehors, sonnets contemporains, Tarabuste éditeur, 176 pages, 2021, 16 €, ISBN : 978-2-84587-523-4.
Encore une fois, Laurent Fourcaut a joué du sonnet avec ce nouveau livre de plus de 160 poèmes adoptant cette forme, cette longue suite constituant comme le journal intime d’un narrateur autant désigné par la première personne du singulier[1] que par les deux premières personnes du pluriel ou un on.
Parcourant lieux maritimes ou champêtres (la plupart situés dans l’ancienne Basse-Normandie) et urbains (essentiellement Paris, avec une prédilection pour restaurants et bistrots), ce personnage aussi central que décentré entremêle subtilement perceptions, sentiments, souvenirs et réflexions dans des textes qu’on pourrait qualifier de circonstance à condition de ne pas les réduire à des petits tableaux clos sur eux-mêmes – cette dimension picturale étant marquée dès le premier sonnet affirmant que l’objet visé est « le labyrinthe convoité où tout vous prive / vous comble à l’aide de la brosse ou du stylo ». Au contraire, entre la « roseraie profuse » qu’est le monde selon Dominique Fourcade et l’intériorité du poète observateur, ce qui est éprouvé sensoriellement se trouve sans cesse débordé par des jeux de pensées, pour reprendre la fameuse formule d’Arno Schmidt. En témoignent notamment les nombreux échos, diversement explicites, faits à la littérature (de La Fontaine à Verheggen en passant par Baudelaire et Proust), à la musique (de Bach à Eric Clapton) et à la peinture (Le Caravage, Watteau, Van Gogh, Pissarro, etc.), cette érudition éclectique n’étant pas là pour épater le lecteur mais parce que c’est ainsi qu’on écrit – ou plutôt qu’on devrait écrire, à rebours des adeptes de la tabula rasa trop souvent raplapla – « Quand on a une vision fixe, non historique de la langue, on écrit ‘plat’, langue plate, littérairement dominante » (Pierre Guyotat, in Cahier Critique de Poésie, n°1, 2000). Face à cet univers de signes, « le monde muet » (Ponge) est surtout ici celui de milieux naturels de plus en plus menacés par une humanité envahissante, tapageuse (« et le silence un luxe aujourd’hui hors de prix ») et obnubilée par le storytelling du profit à tout prix : « La violence on la sent jusque dans l’air des rues / chaque pouce de l’espace est sous la pression / du forcing de la marchandise vile et brute »… Cela dit, Laurent Fourcaut ne cède pas pour autant à une quelconque tendance néo-bucolique car ce grand dehors qu’est la nature, s’il est préféré aux activités humaines qui le dégradent, ne saurait être entièrement bon : « c’est la cruauté de l’été et son larcin : / il vous dépouille du vieux fantasme du sein / maternel et plus rien où l’on puisse se prendre » De plus, il sait qu’un écart entre les sphères naturelles et humaines demeure irréductible, comme l’illustre ce sentiment océanique contrarié : « voilà le grand théâtre cosmique il vous venge / vous vous sentez prêt à le rejoindre à la nage / mais la conscience (c’est l’ennui) joue l’objecteur ». Enfin, il ne masque pas certaines de ses dépendances envers cette société décriée, une simple panne d’électricité suffisant pour en attester : « vous voilà humilié d’être à ce pont accro / à une anti-nature que vous pourfendîtes / comme groupie du bio intoxiquée aux frites ».
Au-delà de cette disjonction nature / humanité, Laurent Fourcaut n’ignore pas que si les expériences non-verbales échappent peu ou prou au langage l’écrivain peut jouer de ces vides dans la trame : « La jouissance c’est de VOIR les dessous absents / de tout ce creux que rien ne sait remplir ça sent / le parfum sulfureux de l’absence éhontée » – autrement dit par Christian Prigent : « On bâtit une fiction où le réel n’est pas touché, mais arraché en négatif à l’organisation des significations et dessiné en creux : en tant qu’intouchable » (in La peinture me regarde, écrits sur l’art, 1974-2019, éditions L’Atelier contemporain, 2020). Dans cette optique, le sonnet devient l’intersection entre un dedans (sa forme fixe en 14 alexandrins rigoureusement comptés et rimés) et un dehors sensible à travers les acrobaties métriques : enjambements multiples où l’auteur n’hésite pas à couper les mots non seulement entre deux syllabes mais même en deux parties dont l’une est imprononçable, le poème pouvant aller jusqu’à déborder sur un quinzième vers fragmentaire : « ça ne fait pas toujours l’affaire à son léza / rd » ; élisions et amputations : « le désir de durer se rêver Poléon » ; syntaxe plus que bousculée : « le monde se les gants donne d’être immobile » Ces tensions entre « le clos et l’ouvert » (titre de l’un des sonnets) se traduisent également par une ouverture lexicale grand angle, loin de tous ceux qui croient encore que la poésie imposerait de se cantonner à un certain registre – heureusement, ici l’on traverse toutes les strates de la langue, aussi bien sociales qu’historiques, de « pertuiser » et « orde » à « bide » et « lousdé » en passant par « iPhone » et « dilection ».
Enfin, Laurent Fourcaut mêle étroitement une mélancolie de fond (« acédie » est l’un des mots récurrents) et un humour qui tente de sauver la mise malgré tout : « rêve d’échapper à l’abjecte compression / pour rejoindre les prés y poursuivre l’étude / du paître et du néant » ou bien « car c’est à ça que ça sert d’écrire / on soustrait un chouïa de sens (et son radis) / à l’absolu recyclage et puis on peut rire »… Par ailleurs, le désir amoureux permet parfois, même si c’est provisoire, d’atténuer cette mélancolie : « pas geindre pas pleurer le leurre féminin / remplit une vie d’homme toujours sur la brèche ».
Avec ces diverses tonalités et un tel travail formel, le sonnet fourcautien finit par constituer l’un des lieux privilégiés où « entre dedans et dehors ça tire un trait ».
[1] Et, quand il l’est, c’est souvent pour souligner en quoi son identité ne peut être que fluctuante – ainsi dans le poème justement intitulé Mon hôte l’autre.

![[Chronique] Laurent Fourcaut, Dedans Dehors, par Bruno Fern](http://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2021/04/band-FourcautDedans.jpg)