Krishna Monteiro Ce qui n’existe plus. Traduit du portugais (Brésil) par Stéphane Chao. Éditions Le Lampadaire, printemps 2020, 102 pages, 10 €, ISBN : 978-2-9559097-3-7. [Commander]
Les éditions Le Lampadaire proposent la première traduction française de Krishna Monteiro, écrivain et diplomate brésilien né en 1973. O que não existe mais (2015) est son premier ouvrage ; il comprend sept nouvelles dont la plus longue, Monte Castello, porte en exergue une citation de Clarisse Lispector qui fait écho au titre et pourrait fournir une première clé pour entrer dans le livre : écrire c’est bien souvent se rappeler ce qui n’a jamais existé.
L’impression d’étrangeté ressentie à la lecture tient en effet au statut incertain des récits de Monteiro : pris en charge par un narrateur (un enfant, un homme, un chat même) à la première ou à la troisième personne, ils convoquent des souvenirs qui ont toute l’apparence de la véracité aussi bien que des scènes hallucinatoires ou fantasmatiques. Le lecteur est prié de renoncer à la plus petite parcelle de scepticisme, au moins pendant ce court laps de temps où nous parlons ensemble. Souvenez-vous plutôt de ces voix inattendues qui de temps à autre vous appellent par votre nom.
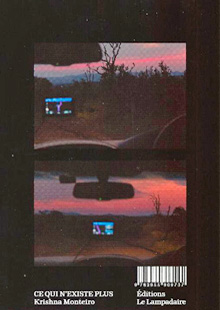 Ainsi, dans la nouvelle énigmatique intitulée « Les croisements du Docteur Rosa », le narrateur qui, tel un Dante désenchanté se trouve « au moment le plus inattendu de (s)a vie », est surpris par un appel surgi de la nuit : « Viens ». C’est un médecin qui l’entraîne dans une sorte de chevauchée fantastique dans le désert, peuplé de « craignant-Dieu » et lui remet au sommet de la montagne, non pas les tables de la Loi, mais une valise remplie de papiers portant tous sa signature, avec lesquels le narrateur se construit un abri pour habiter « entre les lignes du texte ». Au-delà de l’influence du Livre, manifeste (citations de Matthieu, allusions à Moïse), Monteiro ne cesse d’interroger, dans cette nouvelle comme dans d’autres, sa propre position d’écrivain : « blotti, enveloppé dans la couverture de ces pages, j’habite désormais leur être, leur noyau, les mots ». Il parle du « combat qui [lui] tombe en partage, appuyé sur des volumes, des livres ».
Ainsi, dans la nouvelle énigmatique intitulée « Les croisements du Docteur Rosa », le narrateur qui, tel un Dante désenchanté se trouve « au moment le plus inattendu de (s)a vie », est surpris par un appel surgi de la nuit : « Viens ». C’est un médecin qui l’entraîne dans une sorte de chevauchée fantastique dans le désert, peuplé de « craignant-Dieu » et lui remet au sommet de la montagne, non pas les tables de la Loi, mais une valise remplie de papiers portant tous sa signature, avec lesquels le narrateur se construit un abri pour habiter « entre les lignes du texte ». Au-delà de l’influence du Livre, manifeste (citations de Matthieu, allusions à Moïse), Monteiro ne cesse d’interroger, dans cette nouvelle comme dans d’autres, sa propre position d’écrivain : « blotti, enveloppé dans la couverture de ces pages, j’habite désormais leur être, leur noyau, les mots ». Il parle du « combat qui [lui] tombe en partage, appuyé sur des volumes, des livres ».
Sur le versant autobiographique (réel ou fantasmé), les figures paternelles ou grand-paternelles donnent lieu à deux nouvelles. Celle qui donne son titre à l’ouvrage est placée sous l’invocation de Carlos Drummond de Andrade : Dans le désert de Itabara/ l’ombre de mon père / me prit par la main. Le narrateur voit apparaître son père après la mort de celui-ci, arrachant « des étagères les auteurs qui depuis longtemps s’y abritaient » : de manière kafkaïenne, il l’interpelle « avec une audace qui ne m’avait jamais habité du temps où [il] était parmi les vivants » pour lui demander de quel droit il touche à ses livres. Il se souvient de la fascination que ce père « splendide » exerçait sur lui et pense que, peut-être, le mort n’est pas celui qu’on croit. Pourtant, le verdict (encore un terme emprunté à Kafka) rendu par le miroir dans lequel il se contemple est différent : « toi, père, tu es enfermé en moi (…) j’arrive à la conclusion, père, que tu existeras toujours ».
La seconde nouvelle « autobiographique », Monte Castello, est construite sur un entrecroisement de souvenirs d’enfance du narrateur – les vacances chez son grand-père, les conflits entre sa grand-mère et sa mère – et le récit de la bataille italienne de Monte Castello (novembre 1944 – février 1945) qui voit l’entrée dans le second conflit mondial des forces brésiliennes et à laquelle ce grand-père a participé. Dans ce texte magnifique, les éléments mythologiques (les pièces de monnaie qu’on place dans la bouche des morts pour payer à Charon le passage du Styx) rencontrent les prosaïques lires italiennes rapportées de la guerre. Le conflit mondial croise la guerre intestine, familiale.
narrateur – les vacances chez son grand-père, les conflits entre sa grand-mère et sa mère – et le récit de la bataille italienne de Monte Castello (novembre 1944 – février 1945) qui voit l’entrée dans le second conflit mondial des forces brésiliennes et à laquelle ce grand-père a participé. Dans ce texte magnifique, les éléments mythologiques (les pièces de monnaie qu’on place dans la bouche des morts pour payer à Charon le passage du Styx) rencontrent les prosaïques lires italiennes rapportées de la guerre. Le conflit mondial croise la guerre intestine, familiale.
L’unité du recueil est assurée superficiellement par certains éléments récurrents (la maison coloniale, rue Varzea, les allusions aux combats en Italie), mais surtout par la voix du narrateur, lequel, inlassablement, tisse les récits à la manière de la potière et conteuse de la nouvelle Une âme en travers du corps : « l’infinité d’histoires qui remplit la cuisine cède la place à une parole unique : le récit interdit, inachevé, le Verbe qui avait manqué à la femme, le flux qu’elle avait si longtemps poursuivi ».
Ces quelques aperçus de l’ouvrage sont loin d’épuiser la richesse des thèmes abordés par Monteiro, qui pourront parfois décontenancer le lecteur. L’effort requis, pas insurmontable, est largement récompensé par la découverte d’un écrivain de grande qualité dont l’univers personnel fait parfois penser à celui d’un Bruno Schulz.

![[Chronique] Krishna Monteiro, Ce qui n’existe plus, par François Crosnier](http://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2021/05/band-monteiro.jpg)