 Abdelfattah Kilito, L’Œil et l’aiguille. Essais sur Les Mille et une Nuits, Paris, La Découverte, collection « Textes à l’appui », rééd. 2010, 130 pages, 10 € pour la version numérique.
Abdelfattah Kilito, L’Œil et l’aiguille. Essais sur Les Mille et une Nuits, Paris, La Découverte, collection « Textes à l’appui », rééd. 2010, 130 pages, 10 € pour la version numérique.
J’avait rendu compte, voici déjà quelques temps, d’un essai d’Abdelfattah Kilito intitulé Les Arabes et l’art du récit ; tout récemment, un peu par hasard, j’ai découvert que La Découverte avait réédité un essai antérieur sur les Mille et une Nuits : L’Œil et l’aiguille. J’avais perdu ce livre, me souvenant seulement de l’avoir beaucoup aimé et je me le suis donc procuré. Si la relecture est un plaisir essentiel de l’amateur de littérature, il est rare qu’il en aille de même pour les essais critiques, en général voués à une consommation utilitaire : tel est le destin de la « littérature seconde » dont la fonction épuise la valeur, alors que la capacité de se laisser redécouvrir presque indéfiniment est le propre de ce que nous sommes encore quelques-uns à appeler les « œuvres ». Cependant, certains essais possèdent aussi ce don mystérieux de se recréer par la relecture et c’est le cas de celui-ci.
On débattra sans doute indéfiniment du statut littéraire des Mille et Une Nuits : sont-elles le produit d’une culture orale polyphonique ou bien émanent-elles, à date ancienne, d’un auteur – ou d’un collectif d’auteurs ? Et puis comment interpréter cette contradiction de leur statut longtemps méprisable chez les lettrés arabes, avec leur inscription indiscutable, désormais, au patrimoine de la littérature mondiale. C’est une des questions que posait 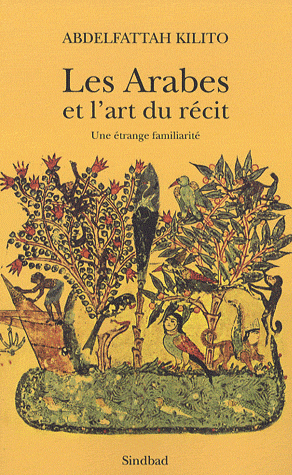 d’ailleurs A. Kilito dans Les Arabes et l’art du récit. Dans L’Œil et l’aiguille, on découvre que certaines histoires des Nuits ouvrent sur cette problématique même : il est en effet des récits tellement précieux qu’ils ne doivent jamais être racontés mais seulement lus et pour un public trié sur le volet. C’est le prologue de l’ « Histoire de Sayf al-Mulûk » où l’on découvre comment un roi qui a entendu toutes les histoires exige de l’inédit et mande son pourvoyeur, sous peine du pire, de le lui dénicher. Il est dit qu’une fois rapportée, cette histoire a le don merveilleux de désennuyer le roi chaque fois qu’il se la fait lire : si la dernière des histoires connues « ne transige pas avec l’exclusivité, note A. Kilito, c’est que son pouvoir de renouvellement, de rajeunissement, de régénération est tel que, dans un élan à la fois répétitif et imprévisible, il redouble et reconduit tous les livres » (p. 35). Il y a ainsi dans les Nuits une histoire qui affirme la supériorité de la littérature écrite sur la culture de l’oralité ; en effet, son détenteur n’accepte de la transmettre que sous condition : « L’histoire ne doit être communiquée qu’à un public distingué et restreint : les rois, les vizirs et les gens du savoir (ahl al-ma‘rifa), un public qui veillera à la conservation du texte et à la correction de sa transmission, bref un public familier du livre. Le vieillard pose comme condition que le texte de l’histoire ne soit pas "dit" mais "lu", ce qui dessine une ligne de démarcation entre deux types de culture : la culture du vulgaire, exclusivement orale, et la culture savante, essentiellement écrite. » (p. 32).
d’ailleurs A. Kilito dans Les Arabes et l’art du récit. Dans L’Œil et l’aiguille, on découvre que certaines histoires des Nuits ouvrent sur cette problématique même : il est en effet des récits tellement précieux qu’ils ne doivent jamais être racontés mais seulement lus et pour un public trié sur le volet. C’est le prologue de l’ « Histoire de Sayf al-Mulûk » où l’on découvre comment un roi qui a entendu toutes les histoires exige de l’inédit et mande son pourvoyeur, sous peine du pire, de le lui dénicher. Il est dit qu’une fois rapportée, cette histoire a le don merveilleux de désennuyer le roi chaque fois qu’il se la fait lire : si la dernière des histoires connues « ne transige pas avec l’exclusivité, note A. Kilito, c’est que son pouvoir de renouvellement, de rajeunissement, de régénération est tel que, dans un élan à la fois répétitif et imprévisible, il redouble et reconduit tous les livres » (p. 35). Il y a ainsi dans les Nuits une histoire qui affirme la supériorité de la littérature écrite sur la culture de l’oralité ; en effet, son détenteur n’accepte de la transmettre que sous condition : « L’histoire ne doit être communiquée qu’à un public distingué et restreint : les rois, les vizirs et les gens du savoir (ahl al-ma‘rifa), un public qui veillera à la conservation du texte et à la correction de sa transmission, bref un public familier du livre. Le vieillard pose comme condition que le texte de l’histoire ne soit pas "dit" mais "lu", ce qui dessine une ligne de démarcation entre deux types de culture : la culture du vulgaire, exclusivement orale, et la culture savante, essentiellement écrite. » (p. 32).
Si Shahrazâd est capable de raconter cette histoire secrète, c’est qu’elle est une lettrée de haut vol ; en effet, la matière de ce qu’elle raconte chaque nuit provient de ses immenses lectures: « ses seuls maîtres sont des livres, au nombre de mille, où elle a appris la médecine, la poésie, l’histoire et les dits des sages et des rois » (p. 14). Quant à l’ « Histoire de Sayf al-Mulûk », c’est ainsi que la conteuse l’annonce au roi avant de la raconter : « Voici cette merveilleuse histoire, d’après une copie exacte qui en est parvenue jusqu’à nous ». C’est ce qu’on lit dans la traduction de Trébutien (Contes inédits des Mille et une Nuits, t. II, Paris, 1828, p. 126).
Il y a donc des récits tellement précieux qu’il faut jalousement veiller à l’intégrité de leur  transmission et à la qualité de leur interprétation. Et pourquoi donc ? Parce que, comme un remède peut aussi devenir un poison, une histoire qui sauve peut aussi tuer. C’est l’un des fils rouges de la méditation d’A. Kilito dans cet essai et c’est en particulier le propos du chapitre 3 : « Le livre qui tue ». Il y a des auteurs qui préfèrent détruire à tout jamais ce qu’ils ont écrit plutôt que de prendre le risque de l’abandonner à de mauvais lecteurs :
transmission et à la qualité de leur interprétation. Et pourquoi donc ? Parce que, comme un remède peut aussi devenir un poison, une histoire qui sauve peut aussi tuer. C’est l’un des fils rouges de la méditation d’A. Kilito dans cet essai et c’est en particulier le propos du chapitre 3 : « Le livre qui tue ». Il y a des auteurs qui préfèrent détruire à tout jamais ce qu’ils ont écrit plutôt que de prendre le risque de l’abandonner à de mauvais lecteurs :
Comme le juriste Abû Zakarîyâ était tombé gravement malade, il m’ordonna de lui apporter l’un de ses livres et de le détremper dans l’eau. « Pourquoi, ô mon seigneur ? lui demandai-je. – Je crains, me dit-il, que quelqu’un qui viendra après moi ne le comprenne pas et qu’il soit pour lui une cause d’égarement ». Al-Bâdisî, Al-Maqsad (XIIIe siècle)
Dans les Nuits, le livre qui tue c’est le livre empoisonné par le médecin Dûbân, dont la tête coupée persiste à parler pour inciter le roi Yûnân à feuilleter ces pages où trois lignes sur la page de gauche une fois lues, elle répondrait à toutes ses questions. On le sait, les pages collées obligent le roi à humecter son doigt pour les séparer et à pénétrer ainsi, à son insu, au territoire de sa propre mort. Ce médecin étranger, qui voyage avec tous ses livres, l’a débarrassé de la lèpre par un remède imprégnant un maillet dont la manipulation introduit les bienfaits par sa transpiration ; le roi voulant le faire mourir ensuite sous l’influence d’un vizir jaloux, le médecin trouve le moyen de mettre à nouveau son corps en contact avec sa science, et c’est ce livre empoisonné où rien n’est écrit que l’absence. C’est le même verbe, sarâ, qui dans le texte désigne l’action du remède et celle du poison. Le médecin Dûbân est une figure parfaite du bouc-émissaire, étranger, détenteur de livres écrits dans toutes les langues, il vient d’ailleurs, il est l’Autre qui guérit le roi mais dont le savoir s’avère mortel à qui ne respecte pas le tabou qu’il confère. Ainsi le livre que ne peut déchiffrer le roi est-il celui de son existence qui s’achève ; mais il est aussi une allégorie de la littérature : « tout livre est une tête coupée qui parle, un dialogue entre un lecteur vivant et un auteur mort (ou absent). […] Miracle d’une tête coupée qui conserve l’usage de la parole, le livre est le rendez-vous de l’absence et de la présence, de la mort et de la vie. » (p. 50).
Un autre chapitre de l’essai d’A. Kilito reprend le fil de cette méditation sur la littérature et la mort qui m’évoque souvent la problématique de Maurice Blanchot. Dans la Cité d’airain, enfermée dans ses murailles en plein désert, les voyageurs découvrent un peuple de morts. Un puissant roi a voulu cette expédition vers cette région du Couchant, parce que des récits rapportent qu’on peut y trouver ces vases scellés où Salomon enferma les génies rebelles à son autorité. C’est la même racine en arabe, indique A. Kilito, qui se trouve « au cœur du déclin solaire (maghrib) et du merveilleux (gharâba) » (p. 91). Les voyageurs sont conduits par un guide qui détient l’itinéraire par tradition de lignée et possède aussi le savoir des étoiles et celui des langues ; c’est ainsi qu’il est le seul à pouvoir déchiffrer les caractères ioniens des tombeaux et des inscriptions de la cité lorsqu’ils y parviendront. Il sait lire l’écriture des morts. « Dans l’histoire de la ville d’airain, les voyageurs ont affaire à des morts, à des êtres qui ne sont plus mais dont la vie se perpétue par l’écriture » (p. 93). Les génies dans les vases, eux demeurent bien vivants ; mais qu’arrive-t-il quand on les en délivre ? Ils proclament leur repentir devant Salomon avant de s’échapper ; autrement dit, à la différence du génie délivré par le pêcheur dans une autre fameuse histoire des Nuits, ils ignorent que le temps s’est écoulé : tandis que les voyageurs distinguent le passé du présent, le génie délivré vit au temps de Salomon. Ainsi voisinent, sans se mélanger, deux temporalités dont l’une, celle du génie, est sans prise sur le présent : il parle comme un mort, « sa parole, apparemment vivante […] est une parole gelée, qui fond, se dissout au contact de l’air extérieur » (p. 89) ; pour qu’il rentre dans la vie, il faudrait qu’un dialogue s’entame avec les vivants, que le temps lui advienne, et avec lui un passé distingué du présent ; mais l’ « Histoire du pêcheur et du génie » révèle le risque encouru par celui qui entre en contact physique et verbal avec les revenants ! (C’est d’ailleurs un motif universel du folklore).
L’autre modalité selon laquelle les voyageurs ont affaire à la parole des morts dans ce  récit, c’est l’écriture. Au cœur du palais, la reine seule paraît vivante, tellement que l’émir la salue solennellement ; mais il apprend qu’elle est morte et que c’est par artifice qu’elle paraît vivre ; c’est par l’intermédiaire d’une tablette qu’elle raconte aux voyageurs l’histoire de la sécheresse de sept années qui a condamné la cité à périr. Dans ce récit d’outre-mort, il y a une leçon à méditer pour les vivants ; il y a aussi une menace à qui voudrait toucher la reine. L’un des voyageurs y perd sa tête : « il n’a pas compris que seule une relation à distance est possible avec la reine morte, avec les morts » (p. 96). Dans une note, A. Kilito rappelle une remarque de Barthes à propos du conte de Poe, « La Vérité sur le cas de M. Valdemar » : « l’accolement de la première personne (Je) et de l’attribut « mort » est précisément celui qui est radicalement impossible ». Pourtant, c’est bien ce qui advient dans ce conte des Nuits ; dans le récit gravé sur sa tombe, le roi Kûsh termine ainsi son récit : « je me suis soumis au jugement de Dieu, endurant patiemment l’affliction jusqu’à ce qu’Il prît mon âme et me fît habiter mon tombeau » ; et la tablette contenant le récit de la reine se termine par ces mots : « Alors nous mourûmes tous ». Si pour A. Kilito, ce « scandale sémantique » témoigne, de la part des morts, d’une nostalgie de la vie et d’une tentative de survivre dans la mémoire de ceux qui découvriront leurs traces, on peut aussi interpréter cela comme une fable sur la littérature en tant qu’elle est un « don des morts », pour reprendre la formule de Danielle Sallenave : « se faire narrateur, c’est jouer le rôle du mort pour permettre aux morts de se faire entendre. Protégé par l’espace désincarné du livre, le narrateur, le poète, mène alors avec les morts la conversation interminable que l’espace littéraire rend possible. » (Le Don des morts).
récit, c’est l’écriture. Au cœur du palais, la reine seule paraît vivante, tellement que l’émir la salue solennellement ; mais il apprend qu’elle est morte et que c’est par artifice qu’elle paraît vivre ; c’est par l’intermédiaire d’une tablette qu’elle raconte aux voyageurs l’histoire de la sécheresse de sept années qui a condamné la cité à périr. Dans ce récit d’outre-mort, il y a une leçon à méditer pour les vivants ; il y a aussi une menace à qui voudrait toucher la reine. L’un des voyageurs y perd sa tête : « il n’a pas compris que seule une relation à distance est possible avec la reine morte, avec les morts » (p. 96). Dans une note, A. Kilito rappelle une remarque de Barthes à propos du conte de Poe, « La Vérité sur le cas de M. Valdemar » : « l’accolement de la première personne (Je) et de l’attribut « mort » est précisément celui qui est radicalement impossible ». Pourtant, c’est bien ce qui advient dans ce conte des Nuits ; dans le récit gravé sur sa tombe, le roi Kûsh termine ainsi son récit : « je me suis soumis au jugement de Dieu, endurant patiemment l’affliction jusqu’à ce qu’Il prît mon âme et me fît habiter mon tombeau » ; et la tablette contenant le récit de la reine se termine par ces mots : « Alors nous mourûmes tous ». Si pour A. Kilito, ce « scandale sémantique » témoigne, de la part des morts, d’une nostalgie de la vie et d’une tentative de survivre dans la mémoire de ceux qui découvriront leurs traces, on peut aussi interpréter cela comme une fable sur la littérature en tant qu’elle est un « don des morts », pour reprendre la formule de Danielle Sallenave : « se faire narrateur, c’est jouer le rôle du mort pour permettre aux morts de se faire entendre. Protégé par l’espace désincarné du livre, le narrateur, le poète, mène alors avec les morts la conversation interminable que l’espace littéraire rend possible. » (Le Don des morts).
C’est ensuite une superbe méditation sur le thème du « livre noyé » qu’offre le chapitre 4, avec l’ « Histoire de Hâsib Karîm ad-Dîn » où tout le savoir du monde est contenu dans cinq feuillets rescapés du naufrage de toute une bibliothèque – mais cinq feuillets que seul saura comprendre celui qui aura acquis par science infuse tout le savoir du monde … Quant au chapitre 5, intitulé « Le sourire de Sindbâd », il présente le héros comme « un homme de l’oubli » (p. 62) confronté par ses aventures à des pertes récurrentes de son identité, ne la recouvrant que par les récits qui le réinsèrent dans la communauté ; une fois redevenu sédentaire, Sindbâd le marin se trouve en effet confronté à son propre double : Sindbâd de la terre, ce portefaix qui chante à sa porte son étonnement de n’avoir rien quand l’autre a tout, lequel l’accueille alors chez lui sept jours durant pour lui raconter ses aventures et par là se légitimer : « pour prix de son écoute, le Portefaix reçoit quotidiennement cent pièces d’or du Marin. En dehors de la relation psychanalytique, remarque malicieusement A. Kilito, pareil contrat ne figure, à ma connaissance, dans aucune littérature narrative » (p. 84). C’est que le Portefaix, désormais « se charge du Marin » : « de part et d’autre on se libère de son fardeau, et de part et d’autre on a charge d’âme » (p. 85). C’est au fond toute l’histoire du couple Narrateur-auteur/auditeur-lecteur et de ses tensions : hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère …
Un mot, pour conclure, à propos du titre de cet essai. Dans l’ « Histoire du marchand et du génie », le vieillard qui a tué le fils du génie par mégarde, revient sur les lieux un an après, selon sa promesse, pour recevoir son châtiment après avoir réglé ses affaires ; il y rencontre un autre vieillard auquel il raconte son histoire et qui lui répond après l’avoir écouté : « Par Dieu, j’admire ton respect de la parole donnée, et je trouve ton histoire extraordinaire. Si on pouvait l’écrire à l’aiguille sur le coin intérieur de l’œil, elle donnerait à réfléchir à qui sait réfléchir. » (Les Mille et Une Nuits, folio-Gallimard, p. 55). Constatant la récurrence de cette formule qui n’apparaît, pour la littérature arabe, que dans les Mille et Une Nuits, A. Kilito tente d’en penser l’enjeu sans écarter ce qu’elle comporte de proprement terrifiant : « se crever les yeux après avoir entendu une histoire est une action que seul Œdipe a accomplie – il est vrai qu’il s’agissait de son histoire racontée par Tirésias, le devin aveugle. » (p. 108). Quant à nous, en quoi ces histoires nous regardent-elles, finalement ? Telle est la question, n’est-ce pas ?
![[Libr-relecture] KILITO, L'oeil et l'aiguille, par Jean-Nicolas Clamanges](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)