
En cette semaine où LIBR-CRITIQUE traite des poétiques en marche, Jean-Nicolas Clamanges vous invite avec maestria à redécouvrir Amelia Rosselli (1930-1996) au travers du dernier livre traduit. Musique rossellinienne…
Amelia Rosselli, Variations de guerre. Traduction et postface de Marie Fabre. Préface de Jean-Baptiste Para. Suivi de « Note sur Amelia Rosselli » par Pier Paolo Pasolini. Ypsilon éditeur, Paris, 2012, 23 euros, ISBN : 978-2-35654-020-1.
En étrange langue que notre langue même, voilà où nous plonge cette traduction des Variazioni belliche (1964) jusqu’ici inédites en français, d’Amelia Rosselli (Paris, 1930-Rome, 1996). Comme si l’impact de cette extraordinaire poésie, elle-même si étrange paraît-il, en sa propre langue, révélait des possibilités latentes dans la nôtre, non tellement inédites (la langue d’avant la cure Malherbe ou la lignée expérimentale jusqu’à Novarina), qu’inlassablement classées à part ou (re)confinées à la marge à peine réapparues, par le courant normatif de nos Lettres hexagonales.
Réinventer les mots et la grammaire de la Tribu donc, pour faire entendre quelque chose des Variations de guerre rosselliennes, tel est le parti inventif et audacieux adopté par Marie Fabre, leur traductrice :
« Rosselli se délecte d’idiomatismes dont elle aime à faire glisser le sens, s’arrête sur chaque spécificité syntaxique, grammaticale, sonore ou graphique pour l’explorer et l’exploiter. Elle cherche dans la langue son noyau singulier jusque dans ses « erreurs ». Le choix a été de se tenir au plus près de cette langue italienne, quitte à rendre un français déstabilisé par celle-ci, et donc lui aussi marqué par des processus de distorsion et de contamination (…). Le dispositif poétique de Rosselli est si fort qu’il est capable de réactiver certaines possibilités inédites de la langue française elle-même contenue comme « langue dormante » (dans ce dispositif) s’éveillant au fil de la traduction – cela à condition d’aller chercher ses angles morts, quitte à caresser sans cesse l’incorrection (l’insurrection). »
Pari tenu, et brillamment ! Par exemple:
Dans l’éléphantiasis de la journée se conduisait une rapide
débandade de causes et d’effets. Des affects se concluaient
dehors et dedans le ruisseau. Tout était bien
inoculé dehors et dedans la cellule. La
cellule de toutes les fraîcheurs s’isolait désolée
dans sa vieillerie. Je conduisais une compétition grandiloquace
et la pulchritude des journées était une barrière
à la communion. Pour pardonner la compétition je réinventais
des syllabes abstruses, grandiloquaces comme le vent qui germe
en floraison sèche. Conditionnée à faire grâce à la foule
et les pauvres relever, la compétition terminait faussée par
les marches coupables dehors et dedans la compétition
des riches et idiots en dehors du passe-temps du soleil. (p. 66)
Ou pour le revival de la vieille langue d’amour amer :
Qu’a donc mon cœur qui bat si suavement
et luy le rend désespéré, et les
plus durs sondages ? toi Ces
scolances que j’y imprimay av’ant qu’el
se tormentât si
férocement, tous ont disparu pour luy ! Ô si mei
lapins courants par mei nerfs et par les
givreux canaux de mea lymphe (ô vie !)
ne stoppent pas, alors là oui, qu’moi je m’y
approchoy de lae mortae ! En toute franchetés mon âme
toi porte-lui secours, je t’étreins, toi, –
trouves ceste Parole Suave, toi reviens
à l’idiome compris qui fait que l’amour reste. (p. 30)
« Je rimais au gré de mon pouvoir
et je participais au vide »
Dès son entrée en vie d’écriture, c’est-à-dire extrêmement tôt, Amelia Rosselli a cherché des formes  universelles à l’expérience humaine, tant au plan vital que spirituel, transversalement, si l’on peut dire, à la diversité des idiomes de l’espèce, à ce qu’elle nomme un babelare commosso – un babèlement ému – dans le premier poème du livre ; cela comme intuition d’une forme à trouver hic et nunc pour rendre le vif de l’affect, son immédiat rythmique qui s’avère toujours mentalement spatialisé : « … au gré de la situation que mon cerveau affrontait à chaque détour de ma vie, à chaque déplacement spatial ou temporel de mon expérience pratique quotidienne (…) je notais d’étranges densifications dans la rythmicité de ma pensée, d’étranges arrêts, d’étranges coagulations et changements de temps, d’étranges intervalles de repos … : de nouvelles fusions sonores et idéales selon les changements du temps pratique, des espaces graphiques et des espaces qui m’entouraient continuellement et matériellement ».
universelles à l’expérience humaine, tant au plan vital que spirituel, transversalement, si l’on peut dire, à la diversité des idiomes de l’espèce, à ce qu’elle nomme un babelare commosso – un babèlement ému – dans le premier poème du livre ; cela comme intuition d’une forme à trouver hic et nunc pour rendre le vif de l’affect, son immédiat rythmique qui s’avère toujours mentalement spatialisé : « … au gré de la situation que mon cerveau affrontait à chaque détour de ma vie, à chaque déplacement spatial ou temporel de mon expérience pratique quotidienne (…) je notais d’étranges densifications dans la rythmicité de ma pensée, d’étranges arrêts, d’étranges coagulations et changements de temps, d’étranges intervalles de repos … : de nouvelles fusions sonores et idéales selon les changements du temps pratique, des espaces graphiques et des espaces qui m’entouraient continuellement et matériellement ».
Ce témoignage qu’elle livre en 1962 dans un texte théorique sur sa poétique que lui a demandé Pasolini, ici traduit sous le titre Espaces métriques, résonne avec toute une culture moderne du ‘stream of consciousness’ (Joyce), des recherches surréalistes sur le « fonctionnement de la pensée » (Breton), des expériences (subies) d’Artaud ou (délibérées) de Michaux sur les rythmes et les vitesses, les lenteurs, voire les arrêts ou suspensions des processus mentaux, etc. La culture d’Amelia Rosselli est à cet égard très précise et quasi expérimentale. Son Diario in tre lingue (1955-1956) – elle maîtrise le français et l’anglais qui sont ses langues d’exil depuis l’enfance – montre par exemple qu’elle a l’habitude de s’exercer à la métrique comparée sur diverses langues, y compris le latin et le grec – autant sur de la prose courante que sur des vers ; qu’elle réfléchit sur le rythme des phrases complexes en latin, chez Proust, Dante, Lautréamont ; qu’elle s’exerce à diverses réécritures sur ce plan, avec Rimbaud ou La Fontaine, etc. Ce que nous lisons comme œuvre achevée (par éclairs et non sans gouffres il est vrai…) dans les Variations, est le produit d’un laboratoire central intime en perpétuelle recherche, dont ce journal nous donne la chance de savoir qu’on y travaille dans les trois langues à la fois, sans compter les autres … et toutes époques mêlées, car cette exilée de l’Italie fasciste (Mussolini a fait assassiner son père) vit et pense avec John Donne, Eliot, Rimbaud, autant qu’avec Leopardi, Pétrarque ou Montale.
Née à Paris travaillée dans l’épopée de notre génération
fallacieuse. Échouée en Amérique parmi les riches champs des possédants
et de l’État étatique. Vécu en Italie, pays barbare
Fui l’Angleterre pays de sophistiqués. Pleine d’espoir
dans l’Ouest où pour l’heure rien ne croît. (p. 58)
Sa question n’est pas tant de trouver sa langue : elle assume totalement son plurilinguisme foncier, que de rendre son vers capable de rendre et transmettre une expérience totale. C’est ce qu’elle a  cherché longtemps, n’étant pas satisfaite du vers libre des Modernes, jugé trop versatile, trop complaisant à toutes mains, pour maîtriser un « procès créatif » qui s’éprouve et se joue pour elle comme « une fusion de plusieurs éléments mal distingués mal séparables », ainsi qu’elle l’écrit, directement en français, dans un récit intitulé Le Chinois à Rome. Désespérant longtemps de sa capacité à inventer la prosodie qu’il lui fallait, elle dit qu’elle l’a découverte un peu par hasard en se tournant vers le sonnet italien de la Renaissance. Mais avant d’y venir, il faut insister d’abord sur le caractère de réappropriation dépaysante et foncièrement dissonante qu’a recouvert le choix de faire son œuvre en italien : elle y apporte une culture : Pound, Eliot, S. Plath (qu’elle traduit), l’avant-garde française, etc., qu’elle pratique depuis longtemps, alors que sa génération la découvrait et la lisait surtout en traduction ; en outre, sa langue d’auteur doit intégrer son histoire linguistique, laquelle reflète ou transpose elle-même quasi organiquement une histoire politique déterminée par l’antifascisme et la condition de l’exilée. Il se peut ainsi qu’elle reste encore une exilée dans cette langue même comme d’ailleurs dans la nôtre et toutes les autres. C’est peut-être aussi une définition possible de la condition poétique en général, quand elle est authentique.
cherché longtemps, n’étant pas satisfaite du vers libre des Modernes, jugé trop versatile, trop complaisant à toutes mains, pour maîtriser un « procès créatif » qui s’éprouve et se joue pour elle comme « une fusion de plusieurs éléments mal distingués mal séparables », ainsi qu’elle l’écrit, directement en français, dans un récit intitulé Le Chinois à Rome. Désespérant longtemps de sa capacité à inventer la prosodie qu’il lui fallait, elle dit qu’elle l’a découverte un peu par hasard en se tournant vers le sonnet italien de la Renaissance. Mais avant d’y venir, il faut insister d’abord sur le caractère de réappropriation dépaysante et foncièrement dissonante qu’a recouvert le choix de faire son œuvre en italien : elle y apporte une culture : Pound, Eliot, S. Plath (qu’elle traduit), l’avant-garde française, etc., qu’elle pratique depuis longtemps, alors que sa génération la découvrait et la lisait surtout en traduction ; en outre, sa langue d’auteur doit intégrer son histoire linguistique, laquelle reflète ou transpose elle-même quasi organiquement une histoire politique déterminée par l’antifascisme et la condition de l’exilée. Il se peut ainsi qu’elle reste encore une exilée dans cette langue même comme d’ailleurs dans la nôtre et toutes les autres. C’est peut-être aussi une définition possible de la condition poétique en général, quand elle est authentique.
Le « cadre » : composer avec l’espace-temps intérieur
Cette extranéité aussi cultivée que foncièrement étrange donne un caractère proprement météorique à son apparition sur la scène littéraire italienne, certes saluée par Vittorini (qui la publie dans sa revue Il Menabo) et par Pasolini (qui lui dédie une Note fameuse, ici reprise dans le volume français), mais demeurant irréductible et inclassable dans le paysage littéraire moderne puisque cette poésie s’élabore au confluent de plusieurs langues qui s’entretraduisent en elle, si l’on peut dire, y compris par simple rémanence virtuelle :
(…) j’ai cherché l’immense et la totale
parfaite dysharmonie, mais de basses cordes résonnent même si tu ne
les touches pas même si tu n’arranges pas les avalanches les cris et
les petites égratignures en cet unique
châle sûr. (p. 47)
À la recherche d’une forme donc, capable d’inscrire l’expérience d’une « totale et parfaite dysharmonie » – de tenir le chaos : c’est cela. Et le sonnet italien primitif est redécouvert comme une chance à saisir car il procure l’idée d’un « cadre » formel propre à fixer les vertiges de la chose à dire, malgré son indicible – et même avec. Ce qu’elle retient là, c’est moins le schéma strophique standard du sonnet que la forme d’un espace clos : une strophe, c’est au fond une chambre, une pièce d’écriture, ou encore un studio de (re)composition du langage selon les données immédiates de l’espace et du temps : « en rédigeant la première ligne du poème je fixais définitivement la largeur du cadre à la fois spatial et temporel ; les vers suivants devaient s’adapter à mesure égale, à formulation identique. En écrivant je passais de vers en vers sans me soucier d’une quelconque priorité de signification dans les mots mis en fin de ligne comme par hasard. (…) Le cadre en effet devait être complètement recouvert et la phrase devait être énoncée d’un trait sans silences ni interruptions ; reflétant la réalité parlée et pensée où, dans le sonore, nous lions nos mots et dans la pensée nous ne connaissons pas d’interruptions à part celles, explicatives et logiques, de la ponctuation ».
Fixer, donc, le rythme de la pensée même, par l’efficace d’un dispositif formel simple et contraignant : c’est retrouver l’expérimentation ‘automatique’ de Breton et Soupault dans Les Champs magnétiques, mais selon un autre dispositif et d’autres prémisses (ils contrôlaient surtout la durée des séances et les variation de rythmes d’écriture) – et d’autres objectifs également car Rosselli travaille sa matière comme un compositeur dodécaphoniste : l’unité de base des Variations est le mot, envisagé selon toute une série de microparamètres : graphie et rythme, son et timbre, durée auditive et/ou mentale : « (dans cette forme) l’espace n’était pas infini, puisque préétabli, comme s’il comprimait l’idée, l’expérience ou le souvenir, transformant mes syllabes et mes timbres (éparpillés dans le poème en manière de rimes non rythmiques) en associations denses et subtiles : le sentiment revécu s’affirmait momentanément à travers quelque rythme fixe. (…) Je refermai le livre sur son unique tentative d’ordre abstrait, c’est-à-dire le dernier poème ».
Que voici, d’abord en italien :
Tutto il mondo è vedovo se è vero che tu cammini ancora
tutto il mondo è vedovo se è vero ! Tutto il mondo
è vero se è vero che tu cammini ancora, tutto il
mondo è vedovo se tu non muori ! Tutto il mondo
è mio se è vero che tu non sei vivo ma solo
una lanterna per i miei occhi obliqui. Cieca rimasi
dalla tua nascita e l’importanza del nuovo giorno
non è che notte per la tua distanza. Cieca sono
ché tu cammini ancora ! cieca sono che tu cammini
e il mondo è vedovo e il mondo è cieco se tu cammini
ancora aggrappato ai miei occhi celestiali.
Puis dans la traduction de Marie Fabre :
Le monde entier est veuf s’il est vrai que tu marches encore
le monde entier est veuf s’il est vrai ! Le monde entier
est vrai s’il est vrai que tu marches encore, le monde
entier est veuf si tu ne meurs pas ! Le monde entier
est mien s’il est vrai que tu n’es vivant que tu n’es
qu’une lanterne pour mes yeux obliques. Aveugle je restai
depuis ta naissance et l’importance du jour nouveau
ne m’est que nuit dans ta distance. Aveugle je suis
car tu marches encore ! Aveugle je suis que tu marches
et le monde est veuf et le monde est aveugle si tu marches
encore agrippé à mes yeux célestes.
Pour aller au-delà dans le champ du vers, il faudrait aborder concrètement le travail d’une métrique dont tous les commentateurs, à commencer par les poètes italiens, nous disent qu’elle est infiniment novatrice et complexe : une métrique dont Amelia Rosselli écrit que « si elle n’était pas régulière elle était du moins totale » et qu’elle est « musicale jusqu’aux dernières expérimentations du post-webernisme ». J’en suis évidemment incapable. Et c’est de la traductrice qu’il faut espérer quelque jour un essai qui nous rendrait accessibles les enjeux, pour les deux langues et leurs poétiques, de la transposition étonnante qu’elle a réalisée ici d’une métrique vers l’autre.
De quelques constantes formelles
Pour autant, il y a d’autres entrées possibles, et plus accessibles au lecteur ordinaire de la poésie, des techniques pratiquées par Rosselli pour que simplement tienne ce qui, de l’incessante rumeur des 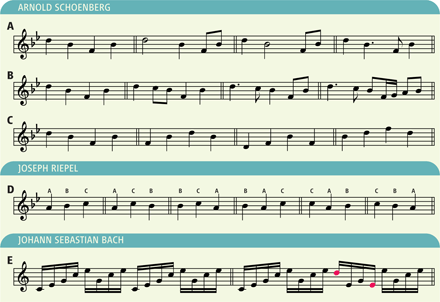 langues, s’inscrit dans ses carrés de vers tissés comme des châles. À cet égard, le dernier poème qu’on a lu, aussi unique soit-il dans son registre, a néanmoins l’avantage de nous introduire à d’autres éléments de cet art de la capture littérale des flux sensibles dont le babil linguistique inscrit en nous le passage incessant, par un sens profond de ce que l’on pourrait appeler les universels de la signification dont c’est le propre des œuvres d’art que de les réinventer en permanence.
langues, s’inscrit dans ses carrés de vers tissés comme des châles. À cet égard, le dernier poème qu’on a lu, aussi unique soit-il dans son registre, a néanmoins l’avantage de nous introduire à d’autres éléments de cet art de la capture littérale des flux sensibles dont le babil linguistique inscrit en nous le passage incessant, par un sens profond de ce que l’on pourrait appeler les universels de la signification dont c’est le propre des œuvres d’art que de les réinventer en permanence.
Au premier rang desquels le travail de la répétition, qui est précisément une donnée constitutive du modèle musical de la variation : un sujet dont Rosselli connaît tous les attendus en théorie et composition musicale (qu’elle pratiquait à un haut niveau et qu’elle considérait comme inséparables de sa poétique de la langue) ; mais on peut aussi se souvenir ici d’un des titres que Mallarmé adopta pour certaines de ses proses : Variations sur un sujet : aux premiers alinéas du morceau intitulé Crise de vers, consacré à l’émergence du vers libre, on lit qu’une fois Victor Hugo disparu, non seulement le vers français se rompt, mais qu’en même temps « toute la langue, ajustée à la métrique, y recouvrant ses coupes vitales, s’évade, selon une libre disjonction aux mille éléments simples ». Et voici qui nous rapproche de ce qui nous occupe : « La variation date de là, poursuit-il : quoique en dessous et d’avance inopinément préparée par Verlaine, si fluide, revenu à de primitives épellations ».
Les Variations Rosselli, elles aussi, depuis tels cercles ultérieurs de la spirale temporelle, ne reviennent-elles pas à leur tour à de primitives épellations ? Babil, babèlement ému, ce bruit des langues au plus intime … – lequel exige, pour être rendu à tous, un art de la composition: « la langue dans laquelle j’écris est une seule langue d’une fois sur l’autre, alors que mon expérience sonore, logique et associative est certainement celle de tous les peuples, et peut se refléter dans toutes les langues » (Espaces métriques).
La poétique du glissement syllabique, du quasi lapsus, du renversement et de l’écho sonore concerté est au fond la pain quotidien des rimeurs de tous les temps ; à l’époque moderne en Europe, cela se généralise à l’ensemble du vers, sans privilège particulier désormais pour sa fin, sa césure ou son attaque. Chez Rosselli, c’est toute la langue qui s’émulsionne ainsi incessamment, mais sa marque propre, me semble-t-il, est l’approche quasi logique qu’elle y fait prévaloir : ce sont des équations verbales en déplacement métonymique, de proche en proche, avec des renversements quasi réglés de termes qui engendrent un effet d’épuisement de la donnée : l’aveuglement risqué (aux termes du poème plus haut cité) de ce qu’Andrea Zanzotto nomme « un monologue fondamental face au néant, le dialogue avec un tu supposément inaccessible » (« Ce que Rosselli nous donne » –1976).
Cependant, on peut lui objecter que sur le plan énonciatif au moins, ce dialogue maintenu d’un « je » avec un « tu » aussi peu assignables qu’on voudra sur le plan sémantique (mais pas si insensé non plus), est bien tout de même une des données formelles les plus insistantes du livre : il y a en effet très peu de poèmes qui ne mettent en scène l’adresse à un « tu » qui pourrait être, entre autres, le père assassiné, l’amant (e ?), Dieu ou le Christ très explicitement nommés et visés dans une langue qui flirte souvent avec la grande mystique – ou encore elle-même aussi en sa propre quête, selon une singulière trinité inidentitaire : « elle, moi et la même » :
Pour que le ciel prédise ta hâte de mourir
enseveli sous une chute de sentiments, je m’éloignai
à la poursuite d’un nouveau ciel. La compagnie élue
ensevelit Électre, elle ceignit son front de lauriers
blanchis de poussière de larmes ; le rose et le sel,
la pitié et les cris au garde-à-vous ! Synonyme de la
peur, hyène de la très humaine vallée – elle, moi et
la même changeâmes toute pitié (…). (p. 99)
Lisant ces vers, nous voici du coup en contact avec la narrativité courante du livre tout entier : le système verbal du récit (imparfait, passé-simple) en est sans doute la dominante et sa prégnance est telle qu’il oriente même dans ce sens les textes au présent. Quelque chose se raconte par nappes de verbes au passé où l’imparfait inscrit la profondeur dans le champ – qui est presque toujours un champ de bataille :
L’enfer de la lumière était l’amour. L’enfer de l’amour
était le sexe. L’enfer du monde était l’oubli des
simples règles de la vie : papier timbré et un simple
protocole. Quatre lits à plat ventre sur le lit quatre
amis morts pistolet au poing quatre fausses notes
au piano qui redonnent à espérer. (p. 85)
*
(…) Conditionnée à une prise de pouvoir qui n’était pas le
mien j’entrais sur la place et voyais le soleil brûler, les
femmes découper des herbes dessus la place ardente de
malice : la milice
Le sol fa mi do de toutes tes batailles. (p. 81)
*
En proie à un shock violentissime, dans la misère
et près de ton cœur j’envoyais des parfums d’encens dans
tes cernes. Les fosses ardéatines combinaient croyances
et rêves – j’étais partie, tu étais rentré – la mort
était une croissance de violences qui étouffaient
dans ta tête de tromperie.
(…) : je rimais au gré de mon pouvoir
et je participais au vide. (…). (p. 64)
Zanzotto cherchant à rendre l’unité de la dissémination chaotique avec son contraire dans cette poésie, trouve la formule d’ « une solidification maximale où se faisaient jour des angles et des reliefs à vif ». Cet effet de « prise » (au sens d’un magma par exemple) n’est peut-être jamais maximal car quelque chose bouge toujours dans ces poèmes ; le livre semble même être conçu pour que jamais rien ne cesse de s’y mouvoir à toutes les échelles de son spectre ; en revanche, l’image des reliefs à vif et des angles visibles reflète un trait formel structurant, à la fois très simple et très efficace car sensible à l’oreille comme à l’œil, qui est leur disposition anaphorique quasi systématique.
À cet égard, le schème le plus fréquent est certainement celui de la disposition en « si … alors » qui lie une séquence d’hypothèses en rafales ou en éventail, débouchant sur une/des conséquence(s) à effet de « chute » (ré)interprétative de ce qu’on a lu : héritage sans doute de la forme-sonnet (dont les derniers vers – la pointe – ont en principe cette fonction), mais en quelque sorte virtualisé ou explosé selon la logique bouleversante d’une ironie supérieure proche de Leopardi… ou de Rimbaud :
Si l’âme perd son don alors elle perd du terrain, si l’enfer
est chose certaine alors l’Abyssinie de mon âme renaît.
Si l’aube décide de mourir, alors le fleuve de nos
larmes s’élargit, et la voix de Dieu demeure contemplée.
Si l’âme est la rétive des sens, alors l’amour est une
science qui s’écroule au premier venu. Si l’âme vend son
bagage alors l’encre est un paradis. Si l’âme
descend de sa marche, la terre meurt.
Je contemple les oiseaux qui chantent mais mon âme est
triste comme un soldat en guerre. (p. 59)
*
(…) Si dans l’enfer des heures nocturnes je rappelle à moi
les anges et les protectrices qui embarquaient pour des rivages
bien plus directs que les miens, si du fond des larmes qui jaillissaient
je distribuais missiles et coups de pieds inconscients aux amis qui
jouaient mal leurs rôles de soldats amoureux, si des finesses
de mon esprit naissaient batailles et contradictions, –
alors l’ennui en moi mourait, ma maladie d’insatisfaction
désaccordait la gaieté ; l’air fin continuait et les chansons
autour tout autour déroulaient de fébriles activités. (…) (p. 53)
Ainsi, ces « caillots de matière en cendre » (Zanzotto), ces « formes strophiques d’autant plus closes et absolues qu’elles sont arbitraires » (Pasolini), ce « carré tissé du poème … où se nouent ‘harmonies’ et ‘disharmonies’, ‘dissonance’ et ‘dissidence’ » (Marie Fabre), pourraient-ils se lire comme des attracteurs formels extrêmement puissants par leur simplicité et leur pouvoir de (com)préhension, pour capter, retenir et transmettre, vaille que vaille, l’infra-conscience des langues qui conditionne intimement notre espace-temps mental: « comme si le fait de versifier pouvait équivaloir à celui de sentir et de penser un espace visuel-émotionnel autour de moi », écrivait Amelia Rosselli dans son introduction de 1993 à Espaces métriques.
Allez y voir vous-même si vous ne voulez pas me croire.
NOTE D’APPOINT
1. On trouvera sur le site de Poezibao une introduction dense et claire d’Angèle Paoli à la vie et à l’œuvre d’Amelia Rosselli et sur celui de Terres de femmes une notice intéressante de Marie Fabre publiée en 2009 à l’occasion de l’anniversaire de sa disparition. Le site des éditions Ypsilon procure l’essentiel des comptes-rendus suscités par cette traduction des Variations de guerre.
2. La revue Europe n° 1996, avril 2012 a consacré un dossier à Amalia Rosselli, avec des articles de Marie Fabre, Antonella Anedda, Andrea Zanzotto, une anthologie de poèmes et une traduction de l’introduction d’Amelia Rosselli à Espaces métriques.
3. On trouve sur You tube divers enregistrements de lectures données par Amelia Rosselli ; écouter en particulier Prosavox – Variazioni Belliche
![[Libr-relecture] Amelia Rosselli, Variations de guerre, par Jean-Nicolas Clamanges](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)

Vous indiquez en note : » On trouvera sur le site de Poezibao une introduction dense et claire de Marie Fabre à la vie et à l’œuvre d’Amelia Rosselli. » Est-ce bien exact ?
Bien à vous,
AP
Toutes nos excuses, chère Angèle : je viens de corriger – et je vais ajouter le lien actif.