Lionel Fondeville, La Péremption, éditions Tinbad, printemps 2021, 162 pages, 18 €, ISBN : 979-10-96415-34-2.
La péremption de Lionel Fondeville ne se présente pas d’un seul tenant, elle est diffuse, lente, parcellaire, l’œuvre se déploie en une nébuleuse de fragments – plus ou moins courts. Fragments rendus nébuleux par tout un dispositif scriptural.
Au présent de l’infinitif
Prendre La péremption par le Verbe : substantifs et verbes à l’infinitif. Attaquons par ces derniers, dès les premières pages, impossible de passer à côté de la succession d’infinitifs qui émaillent le premier texte de Lionel Fondeville. Ces verbes non conjugués, libres de tout  ancrage et qui s’étalent sur le blanc des feuilles de ce précieux livre – bel objet comme savent nous en offrir les éditions Tinbad – le Verbe et les verbes sont jetés en pâture aux lecteur·ices, laissés à leur bonne – ou mauvaise – volonté, à elles et eux de s’en saisir et s’en emparer, faire sien·nes les situations, s’y retrouver ou les rejeter, s’identifier ou s’emporter contre ces « modalités de la péremption » (p. 9).
ancrage et qui s’étalent sur le blanc des feuilles de ce précieux livre – bel objet comme savent nous en offrir les éditions Tinbad – le Verbe et les verbes sont jetés en pâture aux lecteur·ices, laissés à leur bonne – ou mauvaise – volonté, à elles et eux de s’en saisir et s’en emparer, faire sien·nes les situations, s’y retrouver ou les rejeter, s’identifier ou s’emporter contre ces « modalités de la péremption » (p. 9).
«…traiter les difficultés financières avec maladresse, proposer un échelonnement des traites, débattre avec un imbécile charismatique, pratiquer l’espace des administrations publiques, (…) vulgariser un penseur, faire un livre, approcher une entreprise en expansion à l’international, siffler l’Internationale à un meeting politique sans connaître les opinions de la foule, (…) calquer on apparence sur une autre apparence, s’exprimer, représenter, apparaître, harmoniser ses demandes, correspondre au profil, séparer les objectifs et les classer, prendre parti dans le vent de l’instant (…) radicaliser ses positions, éclairer des lanternes percées, obtenir satisfaction, sacrifier l’essentiel (…) s’opposer pour s’opposer… » (pp. 8-9).
L’écrit lâche
Les premières pages d’un livre – quel qu’il soit – sont décisives, première approche, premiers contacts avec les mots, la manière du texte, par cette série d’infinitifs c’est la matière même du texte qui nous est donnée, l’indécision et l’écart constants, la mise en déroute de toute certitude hormis celle de l’écrit. Le tout se matérialise par ces longues et lentes juxtapositions instaurées et installées dès les lignes inaugurales, séries ininterrompues de phrases mises les unes à côté des autres qui relancent sans relâche le discours. Voici comment Lionel Fondeville pose, dans et par l’écrit, les fondements de La péremption.
« L’éclatement de cette écriture – inévitable de l’évoquer – parle de lui-même, s’infiltre ici même, dans les mots mêmes de cette écriture-ci. Il y travaille, y creuse sa tanière, y ronge ses provisions bien avant la fin de l’hiver, s’y promène, explore par des regards détachés chacun des dégâts qu’il inflige et fait pivoter les conditions sur elles-mêmes pour montrer le visage du futur » (pp. 18-16).
Au fil des fragments et de leur enchaînement apparaissent ces phrases nominales toutes tissées 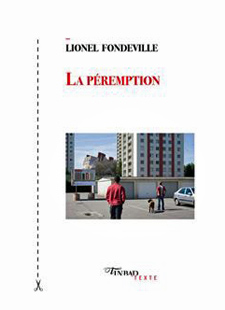 de participes présents. D’un fragment l’autre s’instaureront une variation, plusieurs manières de faire advenir ce que je nommerai le « lâche de l’écrit ». Écriture lâche, paradoxalement lâche. Rappelons qu’en typographie on qualifie de lâche une écriture dont les caractères sont mal formés et trop espacés. Rien de tout cela, ici, un coup d’œil à la mise en page suffit pour s’en convaincre ; succession de blocs textuels compacts. Le lâche de l’écrit advient dans et par la manière de l’écriture, écriture qui nous lâche dans ce torrent d’incertitudes et de contradictions. Quand l’écrit s’ancre, qu’on lit des verbes conjugués, ces passages se trouvent insérés entre une amorce et une fin de fragment tissé d’indécision.
de participes présents. D’un fragment l’autre s’instaureront une variation, plusieurs manières de faire advenir ce que je nommerai le « lâche de l’écrit ». Écriture lâche, paradoxalement lâche. Rappelons qu’en typographie on qualifie de lâche une écriture dont les caractères sont mal formés et trop espacés. Rien de tout cela, ici, un coup d’œil à la mise en page suffit pour s’en convaincre ; succession de blocs textuels compacts. Le lâche de l’écrit advient dans et par la manière de l’écriture, écriture qui nous lâche dans ce torrent d’incertitudes et de contradictions. Quand l’écrit s’ancre, qu’on lit des verbes conjugués, ces passages se trouvent insérés entre une amorce et une fin de fragment tissé d’indécision.
« Passer des heures à. Retourner la question dans tous les sens. La considérer sous tous les angles. Dans quel guêpier s’est-on fourré ? Aucune question, aucun sujet ne se laisse épuiser. À quoi bon lutter dans ces conditions ? Sans vouloir jouer les défaitistes, il y aurait mieux à faire que s’acharner ainsi. Voilà ce que disent ceux qui n’ont jamais goûté les délices de l’acharnement désespéré. Voilà ce qu’ânonnent, la bouche pâteuse, les esprits qui ne cherchent pas à en connaître davantage. Passer des heures. Passer ces heures dans le mélange unique des échos tièdes de ces remarques, entrelacées aux voluptés nées de crispations ressassées. S’en nourrir, y puiser l’énergie d’une journée supplémentaire » (p. 116).
On pourrait même se permettre d’écrire que dans sa matière (son contenu, pour le dire rapidement) il s’agit d’une écriture de « lâche » (les guillemets sont de rigueur), pas de prise de position tranchée, (re)niant tout et acquiesçant à tout dans le même temps. Comme un air du temps qui s’exprime, ici, pas sans rappeler le fameux « en même temps » mais chez Fondeville il s’exprime et s’expose de manière caustique. L’auteur joue même de cette indétermination dans un fragment où il expose son écriture dans ce sérieux tout (entre)mêlé de dérisions qui le et la caractérise ; manière qui pourrait nous faire penser, par certains aspects, à un pastiche de la fameuse assertion de Gustave Flaubert au sujet de son « style » [1].
rapidement) il s’agit d’une écriture de « lâche » (les guillemets sont de rigueur), pas de prise de position tranchée, (re)niant tout et acquiesçant à tout dans le même temps. Comme un air du temps qui s’exprime, ici, pas sans rappeler le fameux « en même temps » mais chez Fondeville il s’exprime et s’expose de manière caustique. L’auteur joue même de cette indétermination dans un fragment où il expose son écriture dans ce sérieux tout (entre)mêlé de dérisions qui le et la caractérise ; manière qui pourrait nous faire penser, par certains aspects, à un pastiche de la fameuse assertion de Gustave Flaubert au sujet de son « style » [1].
« Ce serait une écriture sans socle, poudreuse et légère comme limaille, flottant au milieu d’aurores boréales en plastique moitié cramé, plus froide que l’azote liquide, plus prétentieuse encore. Elle aurait la faiblesse des rédactions sur papier quadrillé, leur naïveté pas convaincue, avec du silicone de première génération injecté dans les fissures, c’est-à-dire plastifiée à la manière des condamnés traités et tranchés en fines lamelles jambon pour étudiants en médecine » (pp. 14-15).
Questions de posture(s) et position(s)
Lâche de l’écrit, La péremption ne se réduit bien évidemment pas à ça, ce sont des lignes fortes que j’esquisse, procédés scripturaux qui permettent aussi la saisie d’un certain quotidien, cet écrit non-tendu offre la possibilité à ses lecteur·ices d’y entrer et de s’y lover, à leur aise. Notamment au travers de ces descriptions personnelles par leur manière, impersonnelles du point de vue de la matière.
« Oh ! Le goût du jour ! Ce dimanche dernier du genre. Dense, pesante et souple, glissé dans ses ondes, entrelacé de petites-voix sans réalité, chantantes, distinctes qui disent le la des à-venir, leurs contours flous, leurs éventements et leurs sirops. Successives, mêlées, elles insistent et ravivent les échos mourants. Plus loin, plus tard, les ultraviolets cuisent la peau du cou côté jardin » (p. 57).
On regrettera tout de même l’usage si inconséquent du terme « nègre » dans le sens de prête-plume (p. 95) ; plus particulièrement lorsque la matière même du livre est l’écriture. Car il faut le dire, ce lâche de l’écrit ne rime pas avec relativisme. Ce souci de l’écrit, on l’aura compris, impose parfois la tenue de postures, ce qui n’empêche pas pour autant le surgissement de positions contre le pouvoir, tous les pouvoirs (politiques, managériaux, économiques, celui du travail…etc.), soit par une « simple » phrase-fragment :
« Ma main-d’œuvre sur ta gueule » (p. 86) ;
soit au travers fragments où le discours se fait brusquement plus dense : contre le pouvoir, la puissance de l’écrit.
« Avec des gueules de déterrés, on décharge les camions. Et malgré l’index coupé, on baisse le front. Des usines ultra-modernes, des paquebots plantés. Cauchemars de Jules Verne parmi les champs de blé. C’est dramatique, c’est effrayant, c’est écœurant, c’est dégueulasse. Des gueules de déterrés. On baisse le front » (p.101).
Contre la péremption du monde, l’écrit non péremptoire…
[1] « J’en conçois pourtant un, moi, un style, un style qui serait beau, que quelqu’un fera à quelque jour, dans dix ans ou dans dix siècles, et qui serait rythmé comme le vers, précis comme le langage des sciences, et avec des ondulations, des renflements de violoncelle, des aigrettes de feu. Un style qui nous entrerait dans l’idée comme un coup de stylet et où notre pensée enfin voyagerait sur des surfaces lisses comme lorsqu’on file sur un canot avec un bon vent arrière. La prose est née d’hier, voilà ce qu’il faut se dire » (Gustave Flaubert, Correspondance, t. II, p. 399).

![[Chronique] Lionel Fondeville, La Péremption, par Ahmed Slama](http://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2021/07/band-La-peremption.jpg)
→
Merci, cher Ahmed Slama, de m’en apprendre sur ce livre.