Ahmed SLAMA, Marche-frontière, éditions Publie.net, mars 2021, 130 pages, 13 €, ISBN : 978-2-37177-607-4.
Sur la route
Après nous avoir relaté, dans Orance, les démarches de son narrateur pour s’extraire d’Algérie et rejoindre la France, Ahmed Slama aborde l’autre versant de l’« emmigration » [terme qu’il invente], ce qui arrive donc de l’autre côté de la mer en France. « Rouler – pourquoi pas ? » ces premiers mots de Marche-frontièrepourraient être l’incipit d’un « road-roman », à la différence que les déplacements sont imposés au narrateur. Devenu sans-papiers, après une perte de son titre de séjour, le personnage doit désormais vivre la condition de sans-abri. Alors  rouler, pourquoi pas ? Amorcer ce road-roman contraint et jouer malgré soi la partition de celle ou celui qui ne peut justifier sa présence. Au grès des villes et des rencontres, le narrateur nous immisce dans la peau de celle ou celui qui perd toute indépendance, à la merci d’une administration lente, qui ne peut rien faire directement pour lui.
rouler, pourquoi pas ? Amorcer ce road-roman contraint et jouer malgré soi la partition de celle ou celui qui ne peut justifier sa présence. Au grès des villes et des rencontres, le narrateur nous immisce dans la peau de celle ou celui qui perd toute indépendance, à la merci d’une administration lente, qui ne peut rien faire directement pour lui.
Les choix stylistiques d’Ahmed Slama, l’utilisation très fréquente du « on » ou des infinitifs, nous installent immédiatement à la place du personnage. Ce n’est ni « il » ni « je » qui parcourt les routes françaises, mais un « on » indéfini. La rareté des pronoms personnels marqués pose ici le récit dans un hors-temps, une parenthèse où chaque action serait saisie à sa racine, il devient récit commun, en incluant ses lecteur.ice.s. Si cette forme d’écriture, à l’infinitif, implique la description d’un quotidien « universel », A. Slama y ajoute un sentiment de décalage, de discordance – ce n’est pas tant le fait de porter une parole, pour celles et ceux qui sont dans sa situation qui importe, mais bien de nous placer, nous, dans le groupe du narrateur, à savoir : hors-frontière.
La frontière
La première incarnation de la frontière est celle des remparts d’Avignon, qui forcent à se définir comme intra- ou extra-muros. L’urbanisme détermine l’image que l’on porte sur son appartenance à certains groupes ; à ce qu’on pourrait appeler des classes géographiques. Attendant d’entrer dans une bibliothèque publique, en compagnie d’étudiants et de sans-abris, le narrateur entend cette remarque : « […] pourquoi des clodos dans une bibliothèque ? et nous, on attend avec eux, on devrait être prioritaires, on vient pour étudier ». Jusque dans les représentations individuelles, l’espace est une délimitation franche, une frontière ; il y a ceux qui peuvent légitimement entrer dans la bibliothèque publique et ceux qui, n’ayant pas les mêmes « droits », devraient attendre à l’extérieur. Les gardiens de cet espace, ceux qui le délimitent, sont les forces de l’ordre qui, quelles que soient les démarches entreprises, ont le pouvoir de décider qui peut rester, qui doit partir. Ils ne gardent pas l’« ordre public », mais surveillent l’espace commun, à la recherche des individu.e.s qui n’y sont pas légitimes. De même que le narrateur, un moment accueilli dans une ferme, doit racler, sarcler la terre pour en extraire les « mauvaises herbes », l’activité policière est perçue comme une récolte, un désherbage, qui finit par s’inscrire dans une production marchande :
le narrateur entend cette remarque : « […] pourquoi des clodos dans une bibliothèque ? et nous, on attend avec eux, on devrait être prioritaires, on vient pour étudier ». Jusque dans les représentations individuelles, l’espace est une délimitation franche, une frontière ; il y a ceux qui peuvent légitimement entrer dans la bibliothèque publique et ceux qui, n’ayant pas les mêmes « droits », devraient attendre à l’extérieur. Les gardiens de cet espace, ceux qui le délimitent, sont les forces de l’ordre qui, quelles que soient les démarches entreprises, ont le pouvoir de décider qui peut rester, qui doit partir. Ils ne gardent pas l’« ordre public », mais surveillent l’espace commun, à la recherche des individu.e.s qui n’y sont pas légitimes. De même que le narrateur, un moment accueilli dans une ferme, doit racler, sarcler la terre pour en extraire les « mauvaises herbes », l’activité policière est perçue comme une récolte, un désherbage, qui finit par s’inscrire dans une production marchande :
« Voiture tricolore parquée à proximité, ils sont deux plus une, arpentant la rue, à l’aise comme de coutume. Sentiment de conquête en surplus. Périphérie de la ville, leur terrain de jeu. Chercher quelques infractions à gratter, les verbalisations qui iront avec. Comme ça qu’ils sont productifs, faire du chiffre. Et l’étranger, le sans-papier, denrée prisée. En prendre un, comme ça, en cueillir une, ça équivaut à du flagrant délit. Pas besoin d’enquête ni de procédures lourdes. Valeur ajoutée directe à la productivité du mois. »
L’être hors-classe que représente le sans-abri finit dans la catégorie des parasites, des herbes non admises, des rongeurs, sa présence risquerait de déranger la circulation des personnes qui font partie, eux, d’une classe bien délimitée et admise : les citadins. On voit comment, par glissement, le contrôle policier exclut une partie des habitants de la ville, dont la survie dépend pourtant de sa proximité, en lui refusant le droit minimal, celui de (sur)vivre.
Des souris et des rats
Les souris et les rats qui pullulent dans le livre font partie de ce que Will Kymlicka et Sue 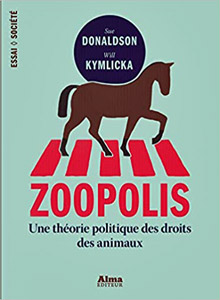 Donaldson appellent, dans Zoopolis : une théorie politique des droits des animaux, les « animaux liminaires », pour les différencier des animaux sauvages ou domestiques. Dans la géographie urbaine, une souris vit au dépend de l’activité humaine, qui lui est nécessaire. Sa survie est étroitement liée à ce qu’elle sera capable de trouver ou non. La souris n’est de ce fait ni sauvage ni domestique, mais possède un statut intermédiaire, qui en fait en quelque sorte une habitante de la ville. Dans le roman, un sentiment de proximité se noue peu à peu entre le narrateur et ces animaux. N’est-il pas, lui-même, une souris dans l’enchevêtrement urbain et national ? C’est à dire un être dépendant de ce qu’on lui laisse, que ce soient les douches publiques, les domiciles, les papiers convoités, jusqu’à son activité de pêcheurs de mégots (les miettes ramassées dans les cendriers, qui lui permettent de profiter d’un ersatz de cigarette), comme enfin tous les espaces trouvés libres pour dormir ou passer la nuit (bancs, aéroport, bibliothèques, dépôts de train, etc.) :
Donaldson appellent, dans Zoopolis : une théorie politique des droits des animaux, les « animaux liminaires », pour les différencier des animaux sauvages ou domestiques. Dans la géographie urbaine, une souris vit au dépend de l’activité humaine, qui lui est nécessaire. Sa survie est étroitement liée à ce qu’elle sera capable de trouver ou non. La souris n’est de ce fait ni sauvage ni domestique, mais possède un statut intermédiaire, qui en fait en quelque sorte une habitante de la ville. Dans le roman, un sentiment de proximité se noue peu à peu entre le narrateur et ces animaux. N’est-il pas, lui-même, une souris dans l’enchevêtrement urbain et national ? C’est à dire un être dépendant de ce qu’on lui laisse, que ce soient les douches publiques, les domiciles, les papiers convoités, jusqu’à son activité de pêcheurs de mégots (les miettes ramassées dans les cendriers, qui lui permettent de profiter d’un ersatz de cigarette), comme enfin tous les espaces trouvés libres pour dormir ou passer la nuit (bancs, aéroport, bibliothèques, dépôts de train, etc.) :
« […] j’ai repensé à notre conversation sur les rats, comment ils se font jamais prendre la main dans le sac, comment ils vivent, se reproduisent à la marge, sans même être vus, même pas ce besoin d’être vus, cette souris et la conversation, ils ont fait tache d’huile, m’ont rappelé le دُوّارْ [douar] d’où je viens, les rats et les souris ne se cachent pas là-bas, on en a pas peur, on les tue pas, comme dans certaines campagnes ici, et cette souris que j’ai fixée dans les yeux, bah, elle m’a rappelé d’un coup ma vie […] »
Si ce n’est pas le narrateur qui s’exprime ici, mais Arsim, son témoignage peut néanmoins s’appliquer à sa situation. Tous deux se reconnaissent en tant qu’être liminaires : comme les souris leurs conditions de survivance (leur écologie, c’est à dire comment survivre dans un écosystème) dépendent de leurs droits, des circonstances dans lesquelles ils peuvent se déplacer ou combler leurs besoins vitaux. Si Marche-frontière est un road-roman, on l’aura compris, ce n’est pas tant par choix que par obligation ; « sans domicile fixe », relégué à la marge, la présence du narrateur est toujours rendue suspecte et fragilisée par la disparition de son titre de séjour (qui la rendait valable). L’administratif vient ici neutraliser tout devoir envers un pair et justifier l’exclusion de groupes humains en grande précarité ; elle va même jusqu’à éclipser légalement et dans les mœurs individuelles certains droits fondamentaux, comme celui par exemple de libre circulation. Se représentant « marche-frontière », le narrateur ne peut se construire autrement que par la négative : je ne peux rester là, je ne peux prétendre à ça ; des mécanismes incorporés qui nous sont pour la plupart étrangers. C’est peut-être là le tour de force du livre, de réussir à nous placer nous, habitués à la normalisation perpétuelle de notre légitimité, pour un certain temps et par le style, à la place d’un « illégitime », d’un « marche-frontière » ou d’un « emmigré ». On sort, ici, de ce que la littérature [romanesque] nous habitue à lire en ce moment.

![[Chronique] Oscar Fabre, L’être humain liminaire ( à propos de Marche-frontière d’Ahmed Slama)](http://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2021/09/band-Slama.jpg)
Pingback: Marche-Frontière, revue de presse – Journal Litteralutte