Christophe Esnault, L’Apatride culturel, Ars Poetica, 2023, 107 pages, 16 €, ISBN : 978-2-9577215-7-3.
Attention, fragile !
J’en attendais trois[i], ayant imaginé qu’il s’agissait d’un tryptique dans la lignée des peintres ; il n’en est arrivé qu’un, L’apatride culturel, vraisemblablement la pièce maîtresse la plus signifiante et chère à son auteur, celle aussi susceptible de faire miroir à mon for intérieur : bingo !
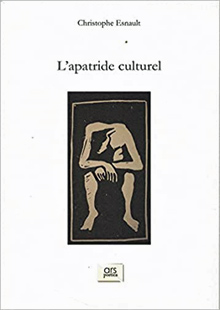 Rien de savant ne s’y revendique, aucune posture avant-gardiste ni prétention conceptuelle, Christophe Esnault écrit en grande simplicité ses rêveries d’un buveur de bière solitaire, le cœur battant librement à ciel ouvert, avec cet humour désabusé qui est la marque de fabrique d’un souffle au cœur et d’une authenticité vraie : pas une ligne qui n’ait été validée par cet espèce de lutin – ou de fée – que la plupart des intellectuels purs et durs s’empressent de mettre au placard une fois atteint l’âge de raison.
Rien de savant ne s’y revendique, aucune posture avant-gardiste ni prétention conceptuelle, Christophe Esnault écrit en grande simplicité ses rêveries d’un buveur de bière solitaire, le cœur battant librement à ciel ouvert, avec cet humour désabusé qui est la marque de fabrique d’un souffle au cœur et d’une authenticité vraie : pas une ligne qui n’ait été validée par cet espèce de lutin – ou de fée – que la plupart des intellectuels purs et durs s’empressent de mettre au placard une fois atteint l’âge de raison.
Et s’il est question de sexe – et même d’un penchant pornographe, « le blanc / D’une culotte » menant précocement à « l’existence d’une petite fente » –, l’intimité tutoyant la nudité, le forever kid n’est jamais loin, sa poésie indissociable du sentiment.
All that jazz – le moi social, l’éveil de la sexualité et l’impulsion en gestation d’écrire – prenant concomitamment racine dans l’enfance entrelace les mailles d’un texte sans ponctuation à porter à même la peau sans façon tel un pull maison à mémoire de forme ravaudé de main maternelle en remontant le fil rouge d’une nostalgie fondamentale.
Le livre initie le tango d’un tête-à-tête ; lisant lentement, un pas en avant trois pages en arrière, s’imprégner de ce solo, un think-tendre à lui tout seul : le dit du mouton noir.
En couverture et grande complicité, Aurélia Bécuwe nous offre une version contemporaine du Penseur de Rodin, un penseur sans solution, poings liés sur la margoulette tête en berne sous la ligne des épaules indiquant qu’il en chie.
Au carrefour de la quarantaine autobiographiquement bien tassée, quelque chose affleure mi-figue mi-raisin de réminiscence en confession sous l’horizontalité fragmentée de la dictée qui ressemble au déchant d’un Qui suis-je ?, soit un inextricable mélange d’ennui, de fatigue existentielle, de causticité et de tendresse émaillé « Vingt jours par an / Si tu montes le curser du vivre » d’instants à haute valeur ajoutée.
Pour pierre d’angle le constat que le livre, cet objet fétiche – une addiction comme une autre –, l’écriture, ce refuge, ce projet, cette mission de vie improbable, cet inépuisable substitut au désenchantement simple, ne sont pas un trait d’union fédérateur entre soi et l’autre mais a contrario le passeport pour le désert d’une passion solitaire et le point de rupture de tout sentiment de filiation.
filiation.
De là osciller, de démarcation en démarcation, de points d’acmé autocréateurs de sens en bouffées de contrition face à sa propre marginalité insubmersible dans l’eau du bain qui arase tout ce qui dépasse et aspire à se surpasser.
D’où l’aveu de la tentation vague d’un environnement sans livres, nature & découverte, recentré sur une passion simple partageable à l’infini de la durée ramassée dans un bouchon de liège.
Mais la culture bon sang, la culture d’abord, mon beau combat !
Lire et écrire étant les deux pôles d’une passion inavouable et la promesse d’un supplément de solitude, le texte se compose autour de ces éclairs de lucidité dont on pressent qu’ils sont précurseurs du point de bascule d’une crise existentielle fondamentale.
Faut-il forcer le cochon à aimer la confiture ? À quoi bon persister à vouloir écrire à l’ancienne ? Pour qui ? À quel prix ? Comment atteindre le quidam éteint, l’hyperactif qui court après un labyrinthe d’illusions inclusives, les œillères pragmatiques de la noria ?
Du rouleau de comptoir au livre de poésie il y a mille bons prétextes pour déserter la langue et mille raisons de se l’approprier ; et si la poésie a considérablement investi l’oralité – « Jusqu’où le poète doit-il être le clown / Qu’on lui demande d’être ? » – c’est sans doute parce que plus personne ne lit, hormis les messages qui s’affichent continûment sur nos écrans, Cette année faites le plein de voyages, Goûtez les thés du monde entier, Votre cadeau vous attend : le téléphone portable a remplacé partout et en toute occasion le livre compagnon.
C’est de facto un petit livre saignant qui mine de rien soulève des questions que personne n’ose poser frontalement et qui de coup de blues en coup de gueule mezzo voce, les poings sur les hanches met les points sur les i.
Comment alors, écrire terre à terre un recueil de poésie concrète sans passer pour un bourgeois, écrire au plus proche du lecteur, aller à l’essentiel, sinon écrire cash avec son cœur un livre à portée d’entendement en prise directe avec le réel dans lequel au ras de la ligne bruisserait le quotidien du monde et juste en dessous, en miroir, ce qu’il nous fait, intimement et de manière absolument singulière, dès lors que l’on autorise son moi social – son moi adulte – à se laisser sombrer par les couches profondes de tous les moi souverains qui nous constituent, depuis les aurores boréales de notre enfant intérieur jusqu’aux scellés du « gros consommateur naze » formaté au conditionnement réflexe ?
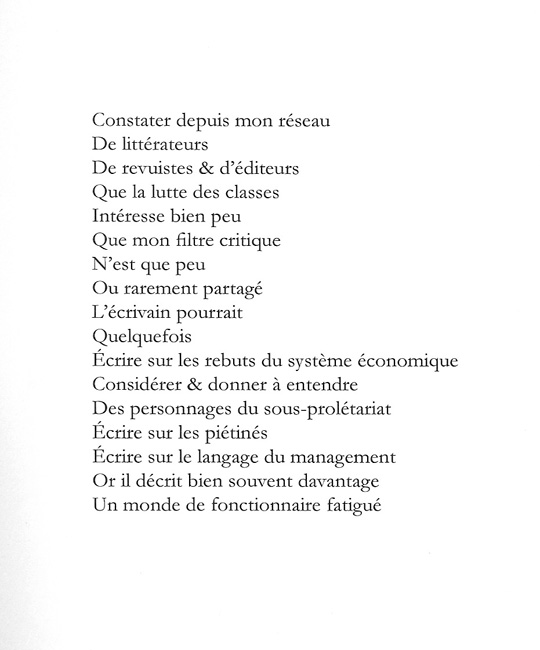
Autant de cris du corps et du cœur, de coups de pied à contre-courant dans le ciel, autant de clips & de drops qui jouent de la satire en vers librement assumés et feuilles détachées, avec l’espoir d’induire ce grand retournement qui nous ferait passer de la fabrique intellectuelle du livre de poèmes à l’état natif de poésie, du temps court de « la foutaise des jours » au temps long de la lecture, du mords de l’âge adulte à la vocation naguère de vivre par tous les pores de la peau et de la vue sa différence éclairée.
Comment rester en prise avec le vivant, rejoindre, stimuler, inspirer, réveiller le kid et le faire grandir en poésie, communier ensemble depuis sa propre sensibilité à mi-chemin de son soi et du soi de son prochain, réconcilier le brin de paille des commissures et le purin quotidien de l’étable ?
La lutte des classes est-elle miscible dans le domaine de la poésie ? La lucidité est-elle le privilège de quelques-uns ? Le droit à l’élévation de la pensée est-il légitime, nécessaire, vital ? Que faire de soi lorsque, frustré, l’on réalise que l’on ne se reconnaît dans aucun milieu ? Où trouver sa place en ce monde, que ce soit dans le corps social ou sur la scène poétique, sans se renier ni surjouer telle ou telle posture, gardien de son centre, sa voix, sa voie ?
Soul to soul compatir, oui le poète est un apatride et « la cosse ouverte de l’enfance » le fonds de commerce de la poésie et une patrie à part entière, dernier bastion en péril avant l’extinction et de la poésie et de l’humanité.
« Et l’écriture permet / D’y retourner ».
[i] Christophe Esnault vient de publier aux éditions Æthalidès Pas même le boucher, aux éditions Cactus Inébranlable Hilarité confite suivi de Cas contact de cas social, aux éditions Ars Poetica L’apatride culturel.

![[Chronique] Christophe Esnault, L’Apatride culturel, par Carole Darricarrère](http://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2023/04/band-ApatrideCulturel.jpg)