Comme j’ai pu le spécifier précédemment, dans d’autres articles de cette série dont le présent épisode est le troisième à être publié, je mène une sorte de réflexion-rêverie autour de l’écriture du livre Les Os rêvent paru en mars dernier aux Éditions du Dernier télégramme. Si le but avoué de cette entreprise reste de discourir plus ou moins adroitement sur mon travail afin de le présenter et, disons-le tout net, de le vendre, son objectif latent, plus essentiel il me semble, vise à ralentir le processus par lequel l’écriture de ce livre trouve une fin. En d’autres termes, pourrais-je dire, je cherche ici à prolonger cet état particulier de concentration, mi-divagant, mi-raisonnant, qui fut le mien pendant la rédaction de cet ouvrage, comme on se délecte parfois à explorer l’état semi-conscient de la phase d’éveil, au sortir d’un long et très profond sommeil. Il en va sans doute d’un trouble plaisir dont le ressort se trouve dans la perplexité que suscite en moi toute terminaison.
Intéressons-nous, voulez-vous, à l’aspect romanesque de ce livre intitulé Les Os rêvent. Il ne fait aucun doute que cet ouvrage est un roman. On y raconte une histoire, celle d’une étude ostéonirismologique, menée par l’ostéonirismologue débutant nommé Giacomo Palestrina. On peut aisément l’apparenter à diverses catégories, dont celles des romans d’apprentissage, d’aventure ou encore du merveilleux scientifique.
Concernant cette dernière, qu’au demeurant je ne connais pas bien, puisque j’en sais ce que la lecture rapide et partielle d’une page Wikipédia peut apprendre, il est attendu qu’un roman qui prétendrait y appartenir présente un aspect invraisemblable du monde, causé et/ou expliqué par la science, que celle-ci soit appréhendée par ses confins extravagants (télépathie,  métagnomie, téléportation…) ou ses pratiques les plus sérieuses (recherche en laboratoire). Cette littérature met donc régulièrement en scène des personnages de savants, de chercheurs, de scientifiques. Elle explore les conséquences liées à la distorsion d’une loi physique, à une découverte scientifique ou à l’intrusion d’un élément incongru dans le cours des choses.
métagnomie, téléportation…) ou ses pratiques les plus sérieuses (recherche en laboratoire). Cette littérature met donc régulièrement en scène des personnages de savants, de chercheurs, de scientifiques. Elle explore les conséquences liées à la distorsion d’une loi physique, à une découverte scientifique ou à l’intrusion d’un élément incongru dans le cours des choses.
Par ces qualités, le roman Les Os rêvent évoque cet univers scientifique et imaginaire. Cependant, il s’en démarque en ceci que tout est parfaitement habituel dans le monde ostéonirismologique décrit. Le ressort du roman propre au merveilleux-scientifique semble être la survenue d’un accident dans le cours ordinaire du monde tel que nous le connaissons. Or, l’univers ostéonirismologique n’apparaît pas sur le fond de notre monde, il constitue un autre monde, inconnu, étrange, aussi ressemblant au nôtre que radicalement autre.
De fait, l’étude de l’ostéonirismologue Palestrina, si elle paraît extravagante depuis le point de vue qui est le nôtre, demeure circonscrite à la plus parfaite normalité ostéonirismologique ; en témoignent les nombreux protocoles, éprouvés par la tradition, réalisés par le personnage. Et si suspense il y a, il réside dans l’extrême dangerosité de certaines procédures et sûrement pas dans la résolution d’un problème qui permettrait le retour à une réalité ordinaire.
En revanche, le merveilleux-scientifique me semble être pleinement épousé, non par l’intrigue qui charpente l’histoire racontée, mais par un biais formel, sans doute inaccoutumée dans le genre. On trouve en effet, depuis l’introduction jusqu’à l’épilogue final, entrelardés aux paragraphes romanesques, de nombreux développements de type scientifique visant à présenter et expliquer les phénomènes et la culture ostéonirismologiques. Comme nous le verrons par la suite, ces développements ont vocation à solliciter le lecteur dans un effort particulier. Ils ont aussi pour conséquence que l’emportement propre à la lecture romanesque se trouve très régulièrement contrarié. Autrement dit, la narration de l’histoire est sans cesse reportée au profit de descriptions et d’explications rapportables à diverses disciplines, formalisées dans un style universitaire. Cette tournure singulière du roman répond à une nécessité doublement fondée.
Il se trouve que je suis très profondément fâché avec, mais aussi totalement obsédé par ce travail qui consiste à raconter une histoire. Je peux situer la cause de cet écartèlement dans la suite de l’histoire occidentale du XXe siècle autant que dans les entrelacs de mon histoire personnelle. (L’entre-appartenance du sujet et de la civilisation, belle formule de Pierre Legendre, est ici à envisager comme principe et méthode d’une possible compréhension de soi et d’autrui, dans la suite d’une proposition très fructueuse énoncée par Freud : être humain et société suivent des développements structurés selon des étapes similaires).
suite de l’histoire occidentale du XXe siècle autant que dans les entrelacs de mon histoire personnelle. (L’entre-appartenance du sujet et de la civilisation, belle formule de Pierre Legendre, est ici à envisager comme principe et méthode d’une possible compréhension de soi et d’autrui, dans la suite d’une proposition très fructueuse énoncée par Freud : être humain et société suivent des développements structurés selon des étapes similaires).
Il y eut un père dans l’enfance dont les paroles furent aussi rares qu’extrêmement limitées à l’émission désincarnée d’une information la plus plate. Ainsi, du plus grand déploiement de paroles que ce père d’enfance réalisa, on peut affirmer qu’il tient en ces quelques mots : passe-moi le sel, ou mange ta soupe, ou encore oui, ou le plus souvent non. Mais toujours son visage buté et silencieux laissait entendre qu’il disait : merde, ferme-la, fous-moi la paix.
Il convient de préciser ceci. S’il est un père, et que ce père côtoie l’enfant, il y aura transmission, parce que la transmission ne tient pas tant à la volonté des protagonistes qu’à une situation généalogiquement organisée. La question n’est donc pas : père, m’as-tu transmis quelque chose ? La question peut être énoncée de la sorte : père, quel objet m’as-tu transmis ? Certains objets sont transmis manifestement. Il peut s’agir d’un récit, d’un savoir-faire, d’un engagement, d’une croyance, etc. D’autres objets sont transmis de façon latente, depuis l’opacité d’un comportement énigmatique que nulle parole ne vient expliquer. Cet objet de transmission, que nous pourrions nommer d’un terme ostéonirismologique, à savoir matière silencieuse, loge dans l’enfant à la manière d’un trou. De l’avenir de cet enfant dépendra l’efficacité avec laquelle il saura border ce trou, contenir sa charge et lui prêter une signification.
Toutefois, pour autant qu’il parvienne dans les années de sa jeunesse, et parfois de sa maturité,  à construire un entendement de cette matière silencieuse, il ne pourra jamais émettre une formule qui en emportera toute l’explication. Pour le dire autrement, l’enfant, y compris celui qui logera dans l’adulte qu’il sera devenu, ne ligaturera jamais la viduité massive de cette transmission énigmatique. Aussi, il se résoudra à déporter cette impossibilité dans un certain registre de langage qu’on nomme paradoxe – ou, pourquoi pas, poème. Un paradoxe a en effet cette qualité formidable de contenir une torsion de la logique, parfois même une contradiction, sans la résoudre, de sorte qu’elle bée dans les limites même de sa manifestation. C’est donc un modèle grammairien de savoir-y-faire avec le trou.
à construire un entendement de cette matière silencieuse, il ne pourra jamais émettre une formule qui en emportera toute l’explication. Pour le dire autrement, l’enfant, y compris celui qui logera dans l’adulte qu’il sera devenu, ne ligaturera jamais la viduité massive de cette transmission énigmatique. Aussi, il se résoudra à déporter cette impossibilité dans un certain registre de langage qu’on nomme paradoxe – ou, pourquoi pas, poème. Un paradoxe a en effet cette qualité formidable de contenir une torsion de la logique, parfois même une contradiction, sans la résoudre, de sorte qu’elle bée dans les limites même de sa manifestation. C’est donc un modèle grammairien de savoir-y-faire avec le trou.
Il est entendu qu’au cours d’une existence ce paradoxe trouvera bien des formulations différentes, selon les rencontres, les théories, les récits et les œuvres d’art que le sujet aura l’opportunité de saisir. Me concernant, la psychanalyse, l’anthropologie dogmatique, la littérature, la musique, la peinture et, avant tout, la poésie, en ce qu’elle tient sa substance même de l’énoncé impossible qu’elle irradie, m’ont donné de formuler les paradoxes nécessaires à l’intégration harmonieuse de la matière silencieuse paternelle dans mon existence.
Ici, rapportant ce paradoxe au contexte du roman Les Os rêvent, nous envisagerons la formule suivante : un roman raconte qu’un roman n’a rien à raconter, et il le raconte, dérivée de mon expérience personnelle que je peux énoncer de la sorte : un père transmet qu’il n’y a rien à transmettre, et il le transmet. Nous trouverons un développement de cet aspect du roman dans l’article Un livre sur rien, à paraître dans la revue Catastrophes. On s’étonnera sans doute de ce rajout qui semble ne rien apporter à la formule : et il le raconte. Pourquoi donc se donner la peine d’ajouter ce qui n’apporte sémantiquement rien : et il le transmet ? D’abord, il convient que je confesse que je ne saurais pas expliquer cela. Voici un fait de langage qui s’impose comme étant adéquat sans que je puisse réellement rendre compte de cette pertinence. Ensuite, je peux avancer quelques hypothèses. Je me risque à penser, en effet, que cet ajout pléonastique a au moins trois raisons : la sincérité dans la formule, la vibration tautologique, la réalisation non-effective effective.
Cette dernière raison, la réalisation effective non-effective, vise sans aucun doute à exprimer un certain mode de réalisation propre au caractère paradoxal de notre situation. En exprimant que l’agent de l’action (le roman) fait effectivement ce qu’il fait (raconter qu’un roman n’a rien à raconter), nous formulons en une seule expression deux tendances contradictoires. D’abord, nous signifions que l’agent réalise effectivement ce qu’il est dit qu’il fait. Ensuite, nous signifions que cette effectivité est fondamentalement incertaine parce que, si ce n’était pas le cas, il n’y aurait pas besoin de préciser que la réalisation est bien effective. Nous renforçons l’affirmation tout autant que nous l’affaiblissons, d’autant que, et parce que, la nature de l’action décrite est elle-même, fondamentalement, paradoxale. Ce régime de signification antagonique exprime fidèlement le régime de narration du roman qui ne cesse pas, à bien des égards, de se présenter comme narration vide dont le vide même abîmerait le mouvement tout autant qu’il l’engendrerait.
Par la deuxième, que nous nommons la vibration tautologique, nous avançons que, par le biais de cette redondance, nous perforons les épaisseurs sémantiques usuelles de la langue pour atteindre le noyau vide et vibrant, sans lieu ni temps propre, qui réside au fondement de tout acte de signification. C’est-à-dire que cet ajout, qui semble ne rien ajouter, à bien le considérer, parvient, réellement, à ajouter du rien. Il nous faut comprendre que nous assistons là à une opération de retournement qui voit le rien s’immiscer au cœur même d’un quelque chose. Se manifeste en plénitude une valeur négative si bien que, en dernier terme, ce rien menace d’envahir la formulation entière, et peut-être même toutes possibilités sémantiques du texte. Et cette menace oriente notre regard de la même façon que peut le faire la formulation décisive biblique, quand Dieu se présente à Moïse et qu’il lui confie son nom : Je suis celui qui est.
De la première – la sincérité dans la formule –, nous déduisons que ces ajouts au premier abord gratuits témoignent d’une intention qui ne vise pas à transmettre une information mais à témoigner d’une certaine authenticité. Comme on le constate chez les enfants parfois, ou chez les poètes, la manière de formuler les choses adhère à un certain état émotionnel, à une énergie particulière du corps, si bien que la phrase semble suivre les contours d’une présence autant que poursuivre l’objectif d’une communication.
Toutefois, il nous faut considérer qu’une méta raison organise ces trois causes. Comme nous avons affirmé que la transmission tient d’abord à une situation généalogiquement organisée, nous avançons que la narration romanesque est premièrement structurée selon la condition propre à la lecture. Comme on le sait, une situation de lecture implique à minima qu’un sujet lise un texte. Nous affirmons ceci, et cela n’a absolument rien de révolutionnaire – voir Flaubert et son livre sur rien par exemple –, qu’une lecture romanesque ne nécessite pas que le texte raconte quelque chose pour que quelque chose soit raconté, à partir du moment néanmoins où un lecteur côtoie ce texte. Ce qui nous intéresse ici, c’est donc que la situation de lecture et le dispositif de transmission généalogique (entre père et fils en ce qui me concerne) ont cette qualité qu’ils peuvent fonctionner autour d’un objet négatif, d’un objet qui circule sans avoir une consistance propre. En résumé, la lecture romanesque est en mesure de rééditer les enjeux d’une transmission généalogique en creux. Elle est un outil privilégié qui se prête à l’exploration de la matière silencieuse ; pour le dire d’une manière peut-être plus littéraire et implicite : là où manque le père, la littérature manque d’histoire, ou encore, là où manque du père, la littérature ne manque pas.
Maintenant que nous avons un tant soit peu énoncé ce qui pouvait, dans un aspect biographique, provoquer l’écartèlement décisif de mon rapport à la narration romanesque, intéressons-nous à cela dans la dimension d’une civilisation, à savoir celle d’Europe. Il est évident que nous n’entendons pas épuiser un sujet aussi vaste que la place ambiguë de la narration dans la littérature européenne du début du XXIe siècle. Nous cherchons simplement 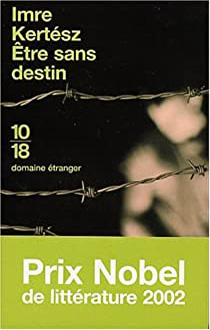 à faire part d’un repère qui, pour ma pratique d’écriture, constitue un point d’articulation fondamental dans cette perspective de l’entre-appartenance du sujet et de la civilisation. Je me situe dans l’héritage que constituent certains textes rédigés par quelques grands témoins de la destruction des populations mise en œuvre par différents régimes totalitaires, sur le territoire européen (auquel nous joignons la Russie), durant le XXe siècle. Je pense aux ouvrages suivants : Le sang du ciel de Piotr Rawicz, Être sans destin d’Imre Kertész, À pas perdus de par le monde de Leib Rochman, Au cœur de l’enfer de Zalmen Gradowski, Transcriptions de Heimrad Bäcker, Holocauste de Charles Reznikoff, Récits de la Kolyma de Varlam Chalamov. Chacun de ses textes, à sa façon, prend en charge, dans sa forme, ce que nous continuerons d’appeler matière silencieuse, entendons cet objet sans consistance que nous repérons comme étant à la fois au travail dans certaines transmissions généalogiques et situations de lecture. Les auteurs cités, témoins de la destruction systématique de l’être humain par des États meurtriers, ont tous cherché à rendre compte d’une réalité intransmissible car située en dehors de la sphère d’un entendement commun. Ils ont réalisé ce travail en profondeur en établissant ceci qu’un texte narratif ne pouvait suffire car ce que les événements rapportés remettaient en cause, c’était notre rapport à la langue et au langage. Il ne pouvait pas s’agir d’établir une simple relation ou analyse des faits, comme le font, par exemple, Primo Levi, Eli Wiesel ou Jorge Semprun, lesquels, il nous semble, continuent d’écrire dans une langue d’avant ces destructions, comme si, de fait, ce qui avait eu lieu n’avait pas déplacé les coordonnées de la littérature. Piotr Rawicz se joue des styles et des formes littéraires pour créer le trouble dans le rapport que le lecteur peut construire avec la véracité du récit ; Imre Kertész construit un roman sériel, atonal, dans lequel tout sens tragique s’effondre au profit d’une
à faire part d’un repère qui, pour ma pratique d’écriture, constitue un point d’articulation fondamental dans cette perspective de l’entre-appartenance du sujet et de la civilisation. Je me situe dans l’héritage que constituent certains textes rédigés par quelques grands témoins de la destruction des populations mise en œuvre par différents régimes totalitaires, sur le territoire européen (auquel nous joignons la Russie), durant le XXe siècle. Je pense aux ouvrages suivants : Le sang du ciel de Piotr Rawicz, Être sans destin d’Imre Kertész, À pas perdus de par le monde de Leib Rochman, Au cœur de l’enfer de Zalmen Gradowski, Transcriptions de Heimrad Bäcker, Holocauste de Charles Reznikoff, Récits de la Kolyma de Varlam Chalamov. Chacun de ses textes, à sa façon, prend en charge, dans sa forme, ce que nous continuerons d’appeler matière silencieuse, entendons cet objet sans consistance que nous repérons comme étant à la fois au travail dans certaines transmissions généalogiques et situations de lecture. Les auteurs cités, témoins de la destruction systématique de l’être humain par des États meurtriers, ont tous cherché à rendre compte d’une réalité intransmissible car située en dehors de la sphère d’un entendement commun. Ils ont réalisé ce travail en profondeur en établissant ceci qu’un texte narratif ne pouvait suffire car ce que les événements rapportés remettaient en cause, c’était notre rapport à la langue et au langage. Il ne pouvait pas s’agir d’établir une simple relation ou analyse des faits, comme le font, par exemple, Primo Levi, Eli Wiesel ou Jorge Semprun, lesquels, il nous semble, continuent d’écrire dans une langue d’avant ces destructions, comme si, de fait, ce qui avait eu lieu n’avait pas déplacé les coordonnées de la littérature. Piotr Rawicz se joue des styles et des formes littéraires pour créer le trouble dans le rapport que le lecteur peut construire avec la véracité du récit ; Imre Kertész construit un roman sériel, atonal, dans lequel tout sens tragique s’effondre au profit d’une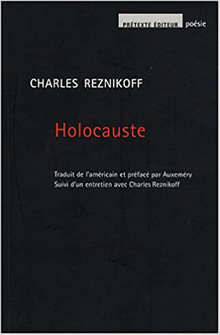 monstrueuse banalité ; Leib Rochman écrit pour les morts, dans les termes de sa culture juive, un récit halluciné, protéiforme, où les catégories organisatrices d’un monde humain volent en éclat ; Zalmen Gradowski (sonderkommando assassiné à Auschwitz) décrit des scènes vécues dans les chambres à gaz, observations empreintes d’un lyrisme religieux tel qu’elles retournent la cruauté extrême des situations évoquées en testament de tout un peuple : la langue semble brûler et se figer en stèle dans le même mouvement ; Heimrad Baker produit un montage d’archives administratives (des listes, des tableaux, des comptes, des rapports…) qui dressent un paysage aussi glacé que horrifiant de la destruction des personnes ; Charles Reznikoff versifie d’authentiques dépositions de survivants, il fusionne témoignages et poèmes pour enjamber notre vertige ; Varlam Chalamov établit un immense livre fragmentaire, troué, ouvert sur l’indicible, pour rendre compte de son expérience du Goulag et de cela même dont il sait qu’il ne pourra jamais le saisir dans les rets de la langue.
monstrueuse banalité ; Leib Rochman écrit pour les morts, dans les termes de sa culture juive, un récit halluciné, protéiforme, où les catégories organisatrices d’un monde humain volent en éclat ; Zalmen Gradowski (sonderkommando assassiné à Auschwitz) décrit des scènes vécues dans les chambres à gaz, observations empreintes d’un lyrisme religieux tel qu’elles retournent la cruauté extrême des situations évoquées en testament de tout un peuple : la langue semble brûler et se figer en stèle dans le même mouvement ; Heimrad Baker produit un montage d’archives administratives (des listes, des tableaux, des comptes, des rapports…) qui dressent un paysage aussi glacé que horrifiant de la destruction des personnes ; Charles Reznikoff versifie d’authentiques dépositions de survivants, il fusionne témoignages et poèmes pour enjamber notre vertige ; Varlam Chalamov établit un immense livre fragmentaire, troué, ouvert sur l’indicible, pour rendre compte de son expérience du Goulag et de cela même dont il sait qu’il ne pourra jamais le saisir dans les rets de la langue.
Si je tiens à m’inscrire dans cet héritage, ce n’est pas seulement que je suis intéressé par les enjeux formels qui le traversent, c’est d’abord parce que le sous-tend une possible formulation de la culture européenne aujourd’hui. Pour reprendre l’expression d’Imre Kertész, l’Holocauste est une culture, il est une valeur. C’est-à-dire qu’il n’est pas seulement un crime incommensurable, il est aussi, et d’abord, un point zéro à partir duquel penser notre culture. Auschwitz, mais entendons voulez-vous ici la destruction des populations par les États, est une matrice de notre être européen. Cette destruction est une valeur à partir de laquelle construire un entendement de notre situation aujourd’hui. Écrire, si je prends ce postulat au sérieux, nécessite donc de commencer à partir de cette destruction. Et raconter une histoire à partir de cette destruction des populations par les États, c’est, me semble-t-il, raconter qu’un roman raconte qu’il n’a rien à raconter, et qu’il le raconte, parce que ce qu’il est sommé de raconter n’est en rien exprimable dans les termes de quelque chose. Comme l’ont réalisé les auteurs cités précédemment, il s’agit de mettre en scène la langue dans cette perspective, bien plus peut-être que d’inventer des histoires qui traitent du thème de la destruction des populations.
Ainsi, deux raisons président à la narration contrariée qui organise le roman Les Os rêvent : la première, biographique, fondée dans une reprise de la transmission paternelle négative, la seconde, civilisationnelle, établie dans la destruction des populations comme valeur et culture européenne. Toutes deux organisent l’entre-appartenance du sujet et de la civilisation qui nous structure.
Plutôt qu’une narration contrariée, il nous semble plus juste, comme l’affirme le titre de ce texte, d’évoquer une narration que nous pourrions qualifier à l’aide du néologisme décontrarié. Le roman fonctionne en effet selon un régime de négation redoublée, à l’image sans doute de la formule pléonastique évoquée précédemment. Il contrarie sans cesse son élan mais ne cesse jamais pour autant de contrarier sa contradiction, c’est-à-dire de se relancer. La narration du roman fonctionne selon une négation d’elle-même, qu’opèrent les explications ostéonirismologiques, ainsi que sur une autre négation qui nie la première, que réalisent les mêmes explications ostéonirismologiques car, si elles interrompent le récit de l’histoire, elles effectuent aussi la liaison qui permet son recommencement. C’est pourquoi je propose ce néologisme qui emporte le double mouvement de négation en un seul mot : la narration est contrariée et cette contradiction qu’elle contient est elle-même contrariée : elle est décontrariée.
jamais pour autant de contrarier sa contradiction, c’est-à-dire de se relancer. La narration du roman fonctionne selon une négation d’elle-même, qu’opèrent les explications ostéonirismologiques, ainsi que sur une autre négation qui nie la première, que réalisent les mêmes explications ostéonirismologiques car, si elles interrompent le récit de l’histoire, elles effectuent aussi la liaison qui permet son recommencement. C’est pourquoi je propose ce néologisme qui emporte le double mouvement de négation en un seul mot : la narration est contrariée et cette contradiction qu’elle contient est elle-même contrariée : elle est décontrariée.
Je soumets ici une analogie avec les comédies musicales de l’âge d’or de Hollywood. Comme nous le savons tous, durant les parties chantées et dansées, la narration est mise de côté (ce qui n’est pas forcément le cas dans des films chantés plus récents, comme le Moulin rouge de Baz Luhrmann par exemple). On se désintéresse des enjeux de l’histoire qui nous est racontée pour orienter notre attention sur des chorégraphies, chants, musiques, jusqu’à la reprise des scènes narratives. Si l’intérêt d’un numéro de claquettes semble aller de soi, il n’en est pas de même des plus ou moins longues explications ostéonirismologiques qui organisent le roman Les Os rêvent. Intéressons-nous aux différents ressorts de ces blocs décontradicteurs : comment fonctionnent-ils ? Que donnent-ils à lire au lecteur ? Comment sollicitent-ils l’effort du lecteur jusqu’à la reprise de la narration ?
Nous identifions trois raisons qui pourraient emporter le lecteur, pour peu que ce dernier soit suffisamment opiniâtre et raisonnablement déraisonnable. La première relève d’une légère hypnose, processus que nous présentons dans les articles Un savoir réel 1 et 2 publiés dans la revue Catastrophes ; elle se présente comme expérience d’un savoir rapporté à un contenu sans substance. La deuxième tient à une métaphore du processus de création littéraire que nous explicitons dans l’article Transsubstantiation du corps et de la lettre, également publié dans la revue Catastrophes. La troisième, quant à elle, est rapportable à l’expérience d’une subjectivité singulière que fomente l’ensemble des présentations, descriptions et explications ostéonirismologiques.
Comprenons que ces paragraphes explicatifs évoquent un dispositif imaginaire mais aussi forment un dispositif efficient dans l’économie narrative du livre. Avant d’expliquer ceci, il convient que nous abordions, brièvement, la notion de dispositif telle qu’elle est présentée par Giorgio Agamben à la suite de Michel Foucault. Je m’appuierai sur la lecture du bref et très  utile ouvrage d’Agamben intitulé Qu’est-ce qu’un dispositif ? « Ce que j’essaie de repérer sous ce nom c’est, […] un ensemble résolument hétérogène comportant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philanthropiques ; bref, du dit aussi bien que du non-dit, voilà les éléments du dispositif. » C’est en ces termes que Foucault, cité par Agamben, présente un dispositif. Or, précisément, ce que nous avons nommé des blocs décontradicteurs, c’est-à-dire les paragraphes explicatifs de l’ostéonirismologie, évoquent des concepts, des processus historiques, des institutions, des appareils législatifs, des discours scientifiques, des élaborations philosophiques, des architectures, des usages administratifs, des protocoles, des techniques et des outils, bref, cet ensemble hétérogène d’éléments qui constitue l’ossature d’un dispositif. Foucault ajoute : « Le dispositif lui-même c’est le réseau qu’on établit entre ces éléments […] ». Comme l’illustre avec une certaine évidence le glossaire situé en fin d’ouvrage, les éléments du dit et du non-dit ostéonirismologiques se rapportent les uns aux autres dans un entrelacement serré et cohérent : ils forment un réseau rapportable à la notion de dispositif pensée par Foucault.
utile ouvrage d’Agamben intitulé Qu’est-ce qu’un dispositif ? « Ce que j’essaie de repérer sous ce nom c’est, […] un ensemble résolument hétérogène comportant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philanthropiques ; bref, du dit aussi bien que du non-dit, voilà les éléments du dispositif. » C’est en ces termes que Foucault, cité par Agamben, présente un dispositif. Or, précisément, ce que nous avons nommé des blocs décontradicteurs, c’est-à-dire les paragraphes explicatifs de l’ostéonirismologie, évoquent des concepts, des processus historiques, des institutions, des appareils législatifs, des discours scientifiques, des élaborations philosophiques, des architectures, des usages administratifs, des protocoles, des techniques et des outils, bref, cet ensemble hétérogène d’éléments qui constitue l’ossature d’un dispositif. Foucault ajoute : « Le dispositif lui-même c’est le réseau qu’on établit entre ces éléments […] ». Comme l’illustre avec une certaine évidence le glossaire situé en fin d’ouvrage, les éléments du dit et du non-dit ostéonirismologiques se rapportent les uns aux autres dans un entrelacement serré et cohérent : ils forment un réseau rapportable à la notion de dispositif pensée par Foucault.
Quel est l’objet d’un dispositif ? Quelle est son action ? Agamben l’énonce sans ambages : « […] j’appelle dispositif tout ce qui a, d’une manière ou d’une autre, la capacité de capturer, d’orienter, de déterminer, d’intercepter, de modeler, de contrôler et d’assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants ». Autrement dit, « […] les dispositifs doivent toujours impliquer un processus de subjectivation. Ils doivent produire leur sujet ». Afin de ne pas être « un pur exercice de violence […] les dispositifs visent, à travers une série de pratiques et de discours, de savoirs et d’exercices, à la création de corps dociles mais libres qui assument leur identité et leur liberté de sujet dans le processus même de leur assujettissement ».
Dans le roman Les Os rêvent, le lecteur se trouve peu à peu informé, au fil des explications ostéonirismologiques, d’un dispositif imaginaire. Des institutions (comité ostéonirismologique, sandjak, institutiones), des concepts (ostéonirismologie métarelationnelle, inversion de la causalité ostéonirismologique), des notions (matière silencieuse, sentiment poignant, esmerveil), des exercices (exercices chirurgicaux, exercices biographiques), des techniques (méthode narrative, théâtre anatomique), des approches épistémologiques (abord des lettres illisibles au fil des siècles), des travaux historiques (dispute des ostéonirismologues de type Panini et des capsarius), trament un dispositif général, tentaculaire, incontournable.
Simultanément, le lecteur se trouve immergé dans cet entrelacement de savoirs et de pratiques dont les paragraphes qui en livrent les contenus ne cessent, comme nous l’avons vu, d’interrompre et de relancer la narration romanesque, de la décontrarier, si bien que, passé les cent premières pages, il devient évident qu’ils sont autant organisateurs du roman que ne le sont les enjeux classiques liés aux personnages, à leur évolution, à leur rapport aux événements.
Le roman présente donc un dispositif producteur de subjectivités et un type de subjectivité produite par ce dispositif, en la personne du personnage Giacomo Palestrina. Pour être précis, le roman tend à porter son attention sur le dispositif plutôt que sur la subjectivité du personnage (même si les ressentis et réflexions de Palestrina sont régulièrement énoncées, elles ne constituent pas le thème central de l’ouvrage) ; il se situe dans l’entrelacement d’une subjectivité (celle de Palestrina) et du dispositif qui la produit, dispositif au sens décrit par Agamben et Foucault. Cet entrelacement se manifeste dans l’économie décontrariée de la narration et constitue, in fine, l’objet du roman, l’objet présenté au jugement du lecteur, à sa sagacité et son désir d’élucidation.
Outre l’hypnose et la métaphore, il nous semble donc que le lecteur est sollicité pour persévérer dans la décontradictonpropre aux explications ostéonirismologiques parce que, en dernier terme, il y prend connaissance du dispositif qui produit la subjectivité du personnage Giacomo Palestrina.
Notons enfin ceci, que nous avons déjà abordé dans l’épisode Un monde ostéonirismologique : que cette subjectivité soit empreinte d’une grande mélancolie indique que le dispositif ostéonirismologique en lui-même est porteur de cet affect, il en est la matrice.

![[Chronique] Julien Boutonnier, Un roman décontrarié, Peut(-)être un journal – Les os rêvent](http://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2022/10/band-BoutonnierOs.jpg)
Pingback: Un livre sur rien (1/2) – Catastrophes
Pingback: Un savoir réel (1/2) – Catastrophes
Pingback: Issue – Catastrophes
Pingback: Phénomènes de Transsubstantiation – Catastrophes
Pingback: Un livre sur rien (2/2) – Catastrophes