Hannah Sullivan, Trois poèmes, version bilingue, éditions de La Table Ronde, mars 2021, 163 pages, 16 €, ISBN : 979-10-371-0514-1.
Trois poèmes est le premier recueil de poèmes de Hannah Sullivan, publié à l’origine par l’éditeur londonien Faber, et en mars dernier en version bilingue anglais-français, dans la 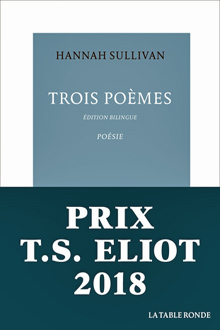 traduction en français de Patrick Hersant, par les éditions de La Table Ronde. Les trois poèmes, écrits en vers libres, sont subdivisés en parties dont certaines peuvent être considérées comme des poèmes se tenant par eux-mêmes.
traduction en français de Patrick Hersant, par les éditions de La Table Ronde. Les trois poèmes, écrits en vers libres, sont subdivisés en parties dont certaines peuvent être considérées comme des poèmes se tenant par eux-mêmes.
La poésie de ce recueil tire son énergie singulière de quantités de sources : littéraires (Hannah Sullivan enseigne la littérature anglaise à l’université d’Oxford) mais aussi philosophiques et scientifiques.
Le premier des trois poèmes, intitulé « Toi, très jeune à New York », est narratif et raconte le séjour à New York d’une jeune femme qui travaille dans une société où elle est « censée remédier aux inefficacités des processus en ligne, // Gérer le multicanal, veiller à la gestion des petites entreprises ». La narration se centre bientôt sur l’épisode des retrouvailles avec un amant, qui seront finalement ratées.
Le deuxième poème, intitulé « En boucle avant l’instant t » et en sous-titre : « Un poème pour Héraclite » est traversé par une méditation au ton à la fois humoristique et tragique sur l’histoire, la forme et l’informe, et sur certaines théories physiques (cosmologiques en particulier). Il se termine sur l’évocation de Trinity, le premier essai d’une bombe atomique, réalisé le 16 juillet 1945 dans le désert du Nouveau Mexique.
Le troisième poème, « Le bac à sable après la pluie », de toute évidence biographique, évoque en les juxtaposant la mort du père et la naissance du premier enfant de la poétesse. Il comporte des parties narratives, en particulier le récit de l’accouchement laborieux du bébé, et se termine par une méditation sur la mort.
La poésie de Hannah Sullivan est ample, capable de percevoir le monde par l’intermédiaire des voix les plus diverses, et de l’accueillir dans son espace. Elle est aussi merveilleusement fraîche, dépoussiérée des convenances littéraires et des lieux communs.
Les toponymes, les noms de personnes ou de types humains, les noms de spécialités culinaires, ceux de marques, d’enseignes de café ou de restaurant, abondent. Ces noms évoquent une époque, et un espace géographique mais aussi social déterminés, en particulier des lieux et des sociétés urbains.
« Oui les hipsters picorent leur kouign-amann à San Francisco,
la brume se lève comme une porte de garage, les MacBooks se mettent en route.
Une fille en manque se balance devant un studio de Bikram embué. »
On est loin de l’aridité et de l’hygiène d’une certaine poésie contemporaine où l’évocation de la moindre circonstance ou la mention d’un nom de marque, parce qu’elles porteraient prétendument atteinte à la qualité universelle assignée à la poésie, sont considérées comme impures et par suite exclues. Les références à des lieux, à un temps et à des circonstances particuliers ancrent dans une réalité circonstanciée, mais cet ancrage ne compromet en rien le caractère universel de ce qui est vécu, voire le souligne.
Les notations sont précises, parfois presque cinématographiques dans leur exactitude. Associées à la diversité de ce qu’elles désignent, elles créent un imaginaire singulier, vaste et composé d’objets et d’êtres originaux.
« Rappelle-toi le mauvais feng shui de la maison que tu as vendue.
La rue transversale qui débouchait pile devant la porte,
Puis, après l’échoppe de jus de fruits avec ses sacs de pulpe fibreuse
(Curcuma purifié, blettes arc-en-ciel, chou kale piqueté)
Menait aux villas Eichler qu’enserrait le brouillard de six heures,
Les toits malicieux des années cinquante ? »
Cette poésie narrative à certains moments, méditative voire spéculative à d’autres, est de bout en bout imprégnée d’un lyrisme bouleversant. Le choix des notations et leur accumulation lui confèrent ce lyrisme, et aussi l’apparition au sein de ces évocations du « je » ou de son miroir le « tu », qui rappellent que tout cela est la vision d’une personne singulière.
« La nuit, tu songes à l’immeuble d’en face, à ses lumières qui l’une
Après l’autre s’éteignent, Mondrian appauvri, un carré d’ocre
Où une femme se dévêt pour la ville, caressant ses cuisses bouffies.
Tu l’entends parler au téléphone, de toi, sa « petite innocente ».
Tout l’été tu as mangé des pêches du marché fermier. »
Ou, dans le corps d’une méditation où la poétesse tourne en ridicule l’idée de « l’amour vrai » proposée par Shelley, le développement des idées est déchiré par l’évocation de circonstances qui pourraient appartenir au récit d’amours malheureuses :
« Pour finir nous voilà sur un quai désolé
Guettant avec un maladroit bouquet de lys
Celle ou celui qu’on aime avancer sous la pluie
Tête penchée, avec son rire de toujours,
Tenant une autre main. »

Poésie urbaine, créée par une habitante de la grande ville, qui décrit les lieux et les personnes d’une manière transparente, en leur donnant les noms sous lesquels ils sont connus de tous. En ce sens, et bien que les références littéraires abondent par ailleurs, poésie populaire qui évoque la ville sans le filtrage d’une « clé » ou d’un code qui seraient nécessaires pour accéder au sens :
« Personne pour t’attendre dans le hall des arrivées,
Sinon le vide et la lumière de cathédrale du Terminal 5,
L’éclat d’une enseigne Krispy Kreme et le fauve embonpoint
Des bouteilles de Scotch à caresser après la douane : seul moyen
Après un tel voyage de retarder le retour. »
L’humour affleure partout, de même que le sentiment tragique auquel il est souvent mêlé, dans un mélange qui exprime une tristesse lucide et sereine, davantage que l’ironie.
Les automatismes d’un certain langage professionnel sont tournés en dérision :
« L’associé principal appelle de Newark, « Bravo à l’équipe (ronron
De sa voix mince, il sirote quelque chose), on vise le gagnant-gagnant » ».
Dans un poème qui aboutit à une méditation sur le langage, les modèles cosmologiques concernant l’origine de l’univers sont tournés en dérision :
« Au début, tout était rien
Et il n’y avait pas grand-chose, et pas de début. »
Une certaine situation est perçue avec un point de vue légèrement décalé. Dans cette mise à distance, un caractère dérisoire ou absurde apparaît, souvent relié à l’impermanence de l’existence humaine. Ainsi, évoquant la nuit qui a suivi l’accouchement, et parlant d’elle et de son bébé :
« Ni lui ni moi, cette première nuit, n’étions au mieux de notre forme » et, comparant la relation qui s’établit entre elle et le bébé, à celle qui existait entre elle et son père mort peu de temps auparavant :
« Le bébé ne ressemblait nullement à mon père,
Mais il y avait quelque chose de commun :
De part et d’autre, une gêne maladroite. (…)
Il y avait aussi une anglicité partagée. (…)
Chacun de nous timidement réjoui par l’autre,
Avec un rien de snobisme dans le soulagement, l’acceptation. »
La force de ces poèmes et leur beauté viennent aussi de leur merveilleuse limpidité. Évocation, développement narratif ou argumentatif, tout est exprimé de manière transparente, aussitôt compréhensible, touchant le lecteur directement. Une magie propre à l’expression poétique opère cependant, et cette impression directe pénètre en profondeur et est rémanente.
Dans le cours du dernier des trois poèmes, une anguille de mer en instance de mourir apparaît comme un exemple de l’indifférence que la poétesse suggère de prendre en exemple :
« Elle voudrait quitter l’aquarium, le cri des langoustes,
La vision monotone des banquettes de skaï,
Les gens du métier venus saliver en collègues :
« Moitié en sashimi, moitié en friture épicée »,
Mais voudrait aussi ne pas quitter l’aquarium, être à jamais
Choisie et non choisie, ni vivante ni morte,
A tourbillonner entre deux murs de bulles et de verre. »
L’animal aperçoit le monde extérieur à travers la transparence de l’eau et du verre, et cependant en est séparée, et est comme emprisonnée dans la transparence. C’est à cette transparence que la poétesse s’en remet finalement, par ce constat qui conclut l’ensemble du recueil :
« Tu as deux fois été du nombre des vivants,
Et par deux fois aimée.
Te voilà retombée dans la clarté de l’air. »
![[Chronique] Arnaud Talhouarn, Trois poèmes limpides et bouleversants (à propos de Hannah Sullivan, Trois poèmes)](https://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2021/09/Hannah-Sullivan-BackGround.jpg)

![[Chronique] Arnaud Talhouarn, Trois poèmes limpides et bouleversants (à propos de Hannah Sullivan, Trois poèmes)](https://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2021/09/band-poemes-Hannah-Sullivan.jpg)